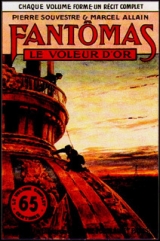
Текст книги "Le Voleur d'Or (Золотой вор)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
C’était ce que Juve appelait avoir « tiré Fandor un peu plus loin » !
Le journaliste, affreusement brûlé, s’était réveillé d’un long évanouissement dans une chambre d’hôtel où Juve l’avait fait transporter, cependant qu’on installait à côté la pauvre M me Rambert.
Fandor, retrouvant tout son courage, avait alors anxieusement demandé des nouvelles de Fantômas.
– Disparu ! répondait Juve, enfui !…
Puis Fandor s’inquiétait de sa mère.
– Elle n’est pas blessée, n’est-ce pas ?
Et c’était alors que le malheureux journaliste devait subir le coup le plus douloureux.
Avec des mots très doux, des phrases de pitié, Juve apprenait l’horrible vérité à Fandor.
M me Rambert était folle, sa raison avait chancelé à la suite de l’effroyable drame dont elle venait d’être victime !
Juve, toutefois, laissait un peu d’espoir à Fandor.
– Le médecin affirme, prétendait-il, que cette crise peut n’être que passagère. Ta mère peut retrouver la raison. Il prescrit pour elle un repos absolu, un voyage en Suisse, par exemple, une installation dans une petite bourgade bien tranquille. Il faudrait que tu sois toujours auprès d’elle à guetter les lueurs de sa raison, pour tâcher de l’aider à se sauver de la démence.
Juve parlait lentement, épiant sur le visage de Fandor l’émotion que ces paroles allaient infailliblement causer au jeune homme.
Fandor se troublait en effet, il pâlissait en écoutant Juve.
– Mon Dieu ! répondait-il, le médecin a dit cela ? Juve, Juve, comment donc faudrait-il faire ? Vous n’oubliez pas que je dois partir dans quelques jours pour le Chili, où je dois aller retrouver Hélène ?
Juve, à ce moment, se levait. Sa physionomie devenait grave, cependant qu’il regardait fixement Fandor.
– Je n’oublie pas cela, disait-il, et je sais en effet, Fandor, que tu vas te trouver aux prises avec deux devoirs bien distincts : ton devoir d’amoureux et ton devoir de fils… Et il te faudra choisir, mon petit !
Mais déjà Fandor relevait la tête, déjà il reprenait :
– Vous avez raison, Juve, ce sont deux devoirs, et ces deux devoirs sont tels que ma conscience ne me laisse pas libre de choisir. Ma mère d’abord, Hélène ensuite ! Je sais d’ailleurs que c’est ce qu’exigerait Hélène elle-même !
La voix de Fandor tremblait. Il souffrait affreusement. Il eut pourtant comme une extraordinaire joie en écoutant Juve.
– Écoute, disait le policier, je ne doutais pas de toi ni de ta décision. Il faut en effet que tu restes auprès de ta mère, mais moi, moi qui suis libre, j’irai rechercher Hélène !
Et, s’efforçant de sourire, Juve ajoutait :
– Et, foi de Juve, je te le promets, Fandor, je te ramènerai ta femme !
IV
Adversaires tragiques
Depuis le matin le vent avait cessé et la mer qui, jusqu’alors, s’enflait en vagues violentes, secouant le bâtiment de belle manière, était soudain devenue calme comme il entrait en rade et stationnait à l’embouchure de la Gironde où l’on devait prendre les derniers passagers, les passagers de grand luxe, ceux qui ne s’embarquaient que là pour éviter le trajet assez long du Havre à Bordeaux.
C’était un grand navire qui portait le nom glorieux de Jean-Bartet qui appartenait à une puissante compagnie assurant les services réguliers de l’Amérique du Sud à la France.
Le Jean-Bartétait parti depuis trois jours et, de toute la vitesse de ses robustes machines, avait longé les côtes de France, venant faire une courte escale à Bordeaux avant de reprendre le large, avant de foncer droit vers l’horizon pour traverser l’Atlantique et venir ranger les côtes américaines.
À bord du Jean-Bart,énorme vaisseau, toute une foule de passagers avaient pris place, riches occupants des cabines de première classe, voyageurs économes qui se contentaient des secondes, de pauvres émigrants, encore parqués dans l’entrepont, mal nourris, à moitié vêtus, et devant vivre un véritable cauchemar de froid, de misère et de souffrance pendant toute la traversée.
À bord du Jean-Bart, notamment, on citait la présence de deux agents consulaires, d’une actrice en renom, d’une jeune divorcée dont la réputation était détestable, et, enfin, d’un général mexicain que l’on se désignait du doigt en disant qu’il retournait dans son pays avec le secret désir de jouer un rôle dans les événements politiques qui perpétuellement bouleversent cette malheureuse et belle contrée.
C’était là, croyait l’état-major du bord, toutes les célébrités, toutes les personnalités marquantes qui avaient pris place à bord du paquebot…
On en tombait communément d’accord, et pourtant on faisait erreur, grave erreur même, ainsi qu’on ne devait pas tarder à l’apprendre avec stupéfaction.
Le Jean-Bartavait à peine jeté l’ancre, en effet, et courait encore en cercle sur son erre, autour de la chaîne raidie de son ancre, qu’une série de signaux commençaient à s’échanger entre le bâtiment et le sémaphore de la côte. Assurément, on devait communiquer de graves nouvelles, car bientôt, le jeune enseigne qui était de quart ce matin-là, quittait la passerelle du commandement et se dirigeait vers l’arrière du bâtiment où se trouvaient les appartements réservés au commandant du navire.
– Qu’est-ce qu’il y a donc ? demandait l’actrice, qui avait rapidement lié connaissance avec le général mexicain. Sûrement on nous communique une dépêche intéressante. Voyez, tout l’état-major est en l’air !
Des officiers couraient en effet à bord du Jean-Bart, s’abordaient avec des gestes étonnés, semblaient échanger des colloques animés, se demander des renseignements avec une réelle stupéfaction.
Le général mexicain qu’interrogeait l’actrice hocha la tête d’un air convaincu.
– Je ne sais pas ce qu’il y a, faisait-il gravement, mais j’ai peur. Tenez, madame, je pense que le gouvernement français est bien capable de prendre en ce moment une mesure contre moi. Il y a peut-être une intervention officielle de la part du Chili, on va peut-être m’obliger à débarquer…
L’actrice se récriait à ces mots. Elle était vivement intéressée par les suppositions du général, mais elle se refusait à les admettre. La France, c’était le pays de la liberté. La République avait horreur d’intervenir dans les affaires gouvernementales des pays étrangers. Non ! non ! Le général faisait erreur, il ne devait pas s’agir de lui !
Et, se faisant le champion du gouvernement français, l’actrice se répandait en de violentes protestations, affirmant qu’en France on respectait le droit d’agir, et que pas un ministre n’oserait ordonner le débarquement d’un réfugié étranger.
Cependant que ces deux passagers causaient, ailleurs on émettait d’autres suppositions :
– Moi, disait un petite femme qui se trouvait en seconde classe et qui se cramponnait nerveusement au bras d’un robuste gaillard qu’elle affirmait être son mari et qui avait bien dix ans de moins qu’elle, moi, Jules, cela me fait très peur ! Je suis sûre que tous ces signaux sont destinés à annoncer un orage épouvantable… Nous allons avoir une tempête… Sûrement nous allons avoir une tempête, un cyclone peut-être !
Plus loin, parmi le groupe que formaient une théorie de voyageurs de commerce qui se rendaient au Brésil pour y écouler toute une pacotille de marchandises dont ne voulait plus la France, on formait encore d’autres suppositions :
– Pas de veine ! disait l’un des voyageurs. Je parie que c’est un truc du service de santé. Peut-être bien n’avons-nous pas nos patentes en règle et allons-nous être retenus… Ou bien alors, on signale la fièvre jaune quelque part, et l’on nous subtilisera une escale !
À la vérité, tout le monde se trompait.
Il ne s’agissait pas du général mexicain, on ne signalait aucune tempête, et le corps de santé n’exigeait l’accomplissement d’aucune formalité longue et minutieuse.
C’était même de tout autre chose qu’il était question, et les passagers se fussent rassurés s’ils avaient pu entendre le colloque qui s’engageait entre le commandant du Jean-Bartet son premier officier.
Celui-ci, quittant la passerelle, s’était rendu au salon réservé au commandant du paquebot. Son chef venait l’y rejoindre, il interrogeait :
– Vous me demandez, lieutenant ? Qu’y a-t-il donc ?
– Mon commandant, j’ai une dépêche de l’amirauté à vous transmettre.
– De l’amirauté ? sursauta le commandant. Que diable l’amirauté me veut-elle ?
– On nous pose, continua le lieutenant, une question extraordinaire. Je ne voulais pas vous déranger, et j’ai répondu non, tout d’abord, mais de terre on insiste, et l’on m’enjoint de vous prévenir. C’est pourquoi je me suis permis…
– Vous avez bien fait, lieutenant. Que désire l’amirauté ?
Un sourire ironique sembla un instant égayer le visage naturellement sévère du jeune officier. Il répondit brièvement :
– Voilà, mon commandant : la préfecture maritime nous fait signaler par le sémaphore, et cela en vertu d’un télégramme officiel émanant de Paris, cette demande laconique : le policier Juve est-il à bord ?
L’officier, en parlant, surveillait la physionomie du commandant du vaisseau, s’attendait à le voir éclater de rire, car il ne venait pas à la pensée du jeune homme que le célèbre policier pût être en réalité parmi les passagers du Jean-Bartsans qu’il le sût.
Or, le commandant du Jean-Bart, un vieux marin, qui depuis vingt ans traînait sur la mer et en avait connu toutes les traîtrises, toutes les colères, tous les sourires aussi, ne marquait aucun étonnement.
– Ah ! faisait-il simplement… Une dépêche officielle demande si le policier Juve est à bord ? Pourquoi veut-on savoir cela ? Vous l’ignorez ?
Le jeune officier secoua la tête.
– Non, mon commandant. On nous a encore signalé cette fin de dépêche :
Au cas où le policier Juve se trouverait à bord duJean-Bart, lui communiquer un ordre formel du préfet de police d’avoir à débarquer de toute urgence et à regagner la préfecture.
Le commandant du Jean-Bart, entendant cela, haussait les épaules. Il se promenait de long en large dans son salon, il paraissait fort ennuyé.
– Bon ! disait-il, c’est clair, c’est net, mais c’est bigrement fâcheux !
Et, très bas, il ajoutait :
– Oui, c’est bigrement fâcheux !
Le jeune lieutenant de vaisseau, cependant, allait de surprise en surprise. Il ne comprenait pas très nettement ce qui semblait fâcheux à son chef, et surtout il s’étonnait fort de son attitude, car il était toujours persuadé que le policier Juve n’était pas à bord, et qu’en conséquence la dépêche officielle était nulle et sans objet.
Brusquement, le commandant parut prendre une décision :
– C’est bien ! faisait-il. Signalez à la terre que nous allons faire le nécessaire !
Et comme le lieutenant de vaisseau saluait son chef et s’apprêtait à le quitter pour remonter sur la passerelle, le commandant ordonnait : Veuillez prévenir le commissaire du bord d’avoir à venir me parler immédiatement !
À l’instant même, cependant, où le marin donnait cet ordre, on frappait discrètement à la porte du salon.
– Entrez ! ordonna le commandant du Jean-Bart.
Un homme parut, qui pouvait avoir une quarantaine d’années, avait le masque énergique, l’attitude résolue, le geste large et décidé.
Il saluait profondément, en entrant, le commandant du navire, puis, en personnage qui se trouve en présence d’un ami, il déclarait sur un ton bonhomme où perçait une pointe de mécontentement :
– Eh bien, mon commandant, vos précautions étaient inutiles ! Vous savez ce qu’on signale de la terre ?
Le commandant du Jean-Bartsursauta :
– On me l’apprend à la minute, répondait-il. Mais vous comprenez donc les signaux, monsieur Juve ?
– Assurément, affirma le policier. Je les ai appris jadis au cours d’un voyage tragique que je fis au cap de Bonne-Espérance.
Et comme le lieutenant de vaisseau considérait l’étranger d’un air ahuri, Juve, car c’était bien Juve, tranquillement reprenait :
– Vous seriez aimable, monsieur, de signaler à la terre que je descends immédiatement. Quant à vous, mon commandant, je vous serais fort obligé de vouloir bien mettre à ma disposition une baleinière.
– Lieutenant, vous donnerez les ordres nécessaires !
Le commandant avait congédié son officier et il se retournait vers Juve.
Il marchait vers lui les bras tendus :
– Mon cher ami, déclarait-il, il n’y a point de ma faute dans ce qui arrive, je tiens à vous en avertir. Personne à bord ne se doutait de votre présence. J’avais scrupuleusement gardé le secret sur votre personnalité, j’ignore qui a pu renseigner le monde officiel sur votre embarquement à bord du Jean-Bart !
Juve, à ces mots, avait un petit haussement d’épaules résigné ; il ripostait sur un ton un peu las :
– Je n’en doute pas, mon commandant. Et puis, qu’importe ! du moment que le devoir est là, et que je suis forcé d’obéir !…
C’était toute la conclusion malheureuse d’un véritable petit complot ourdi par Juve que cette dépêche atteignant le Jean- Barten rade de Bordeaux et obligeant Juve à quitter le paquebot.
Pourquoi Juve, en effet, se trouvait-il à bord du transatlantique et pourquoi s’y trouvait-il caché incognito, voyageant sous un nom d’emprunt, et avec les apparences d’un très modeste voyageur de seconde classe ?
Juve s’était embarqué trois jours plus tôt à bord du Jean-Bartau Havre pour se diriger vers le Chili. Il s’y était embarqué pour donner satisfaction à Fandor qui, retenu auprès de sa mère par son devoir filial, se désespérait à la pensée qu’Hélène devait incessamment débarquer en Amérique du Sud et, seule là-bas, se trouver exposée aux pires tentatives du terrible Fantômas.
Juve était parti pour chercher la jeune femme et la ramener auprès de Fandor. Juve, toutefois, était parti fort discrètement, et peu rassuré sur les suites qu’allait avoir ce voyage.
Juve était en effet toujours inspecteur à la Sûreté. On lui accordait certes une grande liberté d’action et, en raison de ses mérites, en raison de son génie, en raison de son habileté de policier on ne l’ennuyait pas comme il se plaisait à le dire. Juve comptait toutefois, à la préfecture et parmi les bureaucrates, sinon quelques ennemis, du moins quelques adversaires. Ceux-là trouvaient que le policier en prenait souvent à son aise avec les exigences du service et estimaient que Juve, s’il était un bon agent de la Sûreté, était un déplorable sous-ordre.
– Il marche suivant sa fantaisie, disait-on, il fait ce que bon lui semble, il faudra que cela cesse !
Une campagne avait été menée traîtreusement contre lui, elle avait donné des résultats immédiats, puisque, au moment où Juve venait voir M. Havard et sollicitait de lui un congé nécessaire pour aller chercher Hélène, le chef de la Sûreté, brusquement, refusait toute permission de voyage à Juve.
– Vous vous occupez, disait avec un ricanement M. Havard, d’affaires privées ! Or, vous n’en avez pas le droit. S’il vous plaît de marier votre ami Fandor, démissionnez et vous serez libre. Mais, si vous voulez rester inspecteur de la Sûreté et émarger chaque mois au budget, demeurez en France. Vous êtes l’adversaire de Fantômas. Fantômas est en France, restez-y, vous aussi, et poursuivez la lutte !… Allez !
C’était net et précis, Juve avait fait la grimace, mais avait dû s’incliner.
Depuis longtemps, en effet, Juve savait que M. Havard, tout en étant fort aimable avec lui, était en réalité quelque peu son adversaire et son ennemi. Il y avait de la part du chef de la Sûreté à l’égard de Juve comme une véritable petite jalousie qui se traduisait souvent par de réelles injustices dont Juve n’était pas sans souffrir…
Cette fois-ci, toutefois, Juve avait estimé que M. Havard avait été trop loin. Juve n’était pas riche, il ne pouvait démissionner. Il avait d’autre part plus de cent fois risqué sa vie pour l’intérêt général, il trouvait qu’il méritait une autre récompense à ses bons et loyaux services qu’un refus partiel à une faveur si exceptionnellement sollicitée.
– On aurait pu me donner quinze jours de congé ! songeait-il. Et d’ailleurs…
À ce moment, Juve avait un sourire ironique, une idée extraordinaire lui venait. M. Havard lui ordonnait de poursuivre Fantômas. C’était la consigne impérative qu’on lui passait. Or, pourquoi voulait-il aller au Chili si ce n’était pour protéger Hélène des tentatives criminelles de Fantômas !
– Bon, songea Juve, j’ai fait une gaffe. J’ai demandé mes vacances pour aller rechercher Hélène, j’aurais dû au lieu de solliciter un congé, exiger des frais de route et présenter mon voyage comme une manœuvre policière à la rencontre du bandit !
Fort de ce raisonnement, Juve écrivait le lendemain au chef de la Sûreté une lettre assez peu explicite, dans laquelle il informait celui-ci qu’un hasard venait de le mettre sur la piste de Fantômas et qu’il partait à sa poursuite.
– On aura de mes nouvelles, disait Juve, dès que j’aurai un résultat !
Ayant joué avec les mots, commettant, pour la première fois peut-être, une irrégularité dans son service, par la faute de l’imbécillité malveillante de son chef, Juve allait s’embarquer au Havre sur le Jean-Bartpour partir au Chili.
Juve ne tenait pas toutefois à ce qu’on connût à la préfecture son escapade. Il s’inscrivait donc sur la liste des passagers sous un faux nom et, seulement pour tout prévoir, avertissait de sa véritable personnalité le commandant du navire, tout en lui demandant de lui garder un secret absolu à ce sujet.
Les choses avaient été fort bien jusqu’à Bordeaux, mais à Bordeaux Juve recevait un ordre formel d’avoir à regagner la terre.
– Zut ! grondait-il, cependant qu’une chaloupe le ramenait vers la côte. Comment diable, quai de l’Horloge, a-t-on pu savoir que j’étais à bord du Jean-Bart ?
On l’avait su à la préfecture, et Juve devait l’apprendre le soir même, de la façon la plus simple du monde. Le hasard seul avait trahi Juve. Un cinéma s’était avisé de prendre le départ du général mexicain lors de son embarquement sur le Jean-Bart.Juve, qui suivait l’étranger, avait été, sans s’en douter, photographié.
Un jour plus tard, le film était projeté dans un établissement des boulevards, un inspecteur reconnaissait Juve, signalait le fait, sans penser à mal, à M. Havard. Immédiatement, M. Havard envoyait la dépêche qui devait arrêter Juve !
Le policier apprenait tout cela le soir même de son débarquement à Bordeaux.
À peine avait-il rejoint la côte, en effet, qu’il sautait dans un rapide pour Paris et, aussitôt arrivé à Paris, il courait à la préfecture, où Léon et Michel le mettaient rapidement au fait.
– Très bien, remarqua Juve. C’est un bon savon en perspective de la part de M. Havard !
Il était alors onze heures tout juste. Juve pensait à aller se coucher, étant assez fatigué de son voyage en chemin de fer, lorsque Léon lui disait en souriant :
– Bah ! monsieur Juve, un savon du chef, cela n’a pas grande importance ! Et puis, Havard a bien d’autres choses en tête !… Il est dans son bureau, d’ailleurs. Voulez-vous le voir tout de suite ?
Juve hésita, puis se décida.
– Ma foi oui, autant en finir…
M. Havard était en effet dans son bureau. Il n’y était pas seul, il s’y trouvait en compagnie du directeur du service des recherches. Or, à peine Juve était-il entré dans le cabinet que M. Havard se levait, courait à sa rencontre les mains tendues. M. Havard était nerveux au possible, et cependant, à la grande surprise du policier, faisait à Juve le meilleur accueil.
– Écoutez, mon cher, commençait-il, je vous demande infiniment pardon de vous avoir fait revenir ainsi, mais, ma foi, je n’avais pas le choix des moyens, et l’on a besoin de vous à Paris.
– Vraiment ? dit Juve qui se tenait sur la défensive. Pourquoi, chef ?
– Parce que… parce que… nous sommes dans l’embêtement !
Et comme Juve considérait le chef de la Sûreté d’un air assez surpris, M. Havard, brusquement, expliqua sa pensée :
– Voilà, déclara-t-il, vous étiez parti pour l’Amérique du Sud afin d’y poursuivre Fantômas, n’est-ce pas ?
– Oui et non ! fit Juve, tenant toujours à ne pas se compromettre.
Mais M. Havard ne remarquait pas son hésitation. Il continuait en effet :
– Eh bien, si Fantômas est en Amérique du Sud, s’il a fichu le camp à l’étranger, laissons-le tranquille. Ici, à Paris, nous avons d’autres chiens à fouetter ! Figurez-vous, mon cher Juve, qu’il y a deux jours une affaire terrible et qui vise de hautes personnalités a eu lieu à Paris. Vous êtes seul de taille à débrouiller cette enquête. Évidemment, vous allez vous trouver en face d’un autre adversaire que Fantômas, car Fantômas n’est pas mêlé à cette histoire, mais tout de même elle vous intéressera…
Et, s’aidant d’un dossier qui traînait sur son bureau, donnant des détails que Juve prenait soigneusement en note, M. Havard faisait au policier le récit du crime extraordinaire qui s’était passé deux jours plus tôt chez Léon Drapier, et qui menaçait de tourner au scandale abominable.
– Voilà, achevait-il. Qu’en pensez-vous, Juve ? Qui a tué ? Et pourquoi a-t-on tué ?
Juve répondit qu’il n’en avait aucune idée, mais il n’était peut-être pas très sincère.
Juve, en effet, avait l’air brusquement intéressé par l’étrange histoire dont il venait d’écouter les détails.
Le policier, en sortant du cabinet du chef de la Sûreté, après avoir promis de mener l’enquête activement, articulait en effet d’un ton convaincu :
– Le chef est persuadé que ce n’est pas Fantômas que je vais avoir à combattre, est-ce qu’il ne se tromperait pas, par hasard ? Elle est tragique, cette aventure qui menace d’endeuiller toute la famille du directeur de la Monnaie !…
Juve rentra chez lui, rue Tardieu, fort préoccupé. Il répondit à peine aux questions, d’ailleurs flegmatiques, que lui posait le vieux Jean, étonné malgré son calme de le voir revenir.
Le vieux Jean croyait son maître parti pour deux mois, et Juve arrivait au bout de deux jours. Mais le vieux Jean avait bien trop l’habitude des excentricités de Juve pour s’étonner outre mesure.
– Mon lit est fait ? demandait Juve.
– Naturellement ! répondit le vieux Jean.
Et c’était en effet exact, la couverture était même préparée.
Ce même jour où Juve devait débarquer du Jean-Bartà Bordeaux, rentrer à Paris et apprendre de la bouche même de M. Havard qu’il allait être chargé d’une affaire assez grave et délicate, à trois heures de l’après-midi, deux inséparables amis déambulaient bras dessus, bras dessous le long des berges de la Seine, s’intéressant à la tranquille patience des pêcheurs à la ligne trempant leur fil dans l’eau sans risquer, et pour cause, de pêcher un seul poisson.
Les deux inséparables amis n’étaient autres que Bec-de-Gaz et Œil-de-Bœuf.
Ils étaient tour à tour moroses, et tour à tour joyeux.
Bec-de-Gaz, d’un ton plaintif, déclarait :
– Moi, mon vieux, quand je vois tant d’eau, ça me fiche la pépie. Si qu’on allait s’offrir un verre de vin !…
À quoi Œil-de-Bœuf répliquait aimablement ;
– Parbleu, je n’y vois aucun inconvénient, ma vieille, seul’ment, tu m’as l’air d’oublier que j’suis nib de pèze en ce moment.
Le front de Bec-de-Gaz se rembrunit immédiatement.
– Ça, c’est bien vrai, déclarait-il. Depuis quelque temps, ce qu’on est fauchés tous les deux !…
Et, crachant de dégoût, Bec-de-Gaz poursuivait :
– Ah, elle est rien mauvaise, l’année !… Les bourgeois, y n’sortent plus !… L’commerce, ça n’donne rien !… J’ai pas seulement fait un mouchoir depuis trois jours !…
– Et moi, approuva Œil-de-Bœuf, j’ai pas même trouvé une thune et trois linvés dans le sac à or de la vieille que j’ai r’filé à la réunion !
Bec-de-Gaz et Œil-de-Bœuf s’étaient improvisés pickpockets et voleurs à la tire depuis quelque temps. Par malheur, comme ils le disaient eux-mêmes, le commerce n’allait pas et ils ne se trouvaient pas sur le chemin de la fortune. Il y avait à cela une raison, il est vrai, c’est que Bec-de-Gaz et Œil-de-Bœuf, depuis les tragiques affaires du Jockey masqué, étaient devenus des habitués du champ de course.
Ils prétendaient fréquenter le turf pour y visiter les poches des joueurs, mais en réalité ils jouaient eux-mêmes, risquant avec une véritable frénésie les pièces de cent sous qu’ils gagnaient et gardant tout juste assez de lucidité pour mettre de côté chaque jour de quoi s’enivrer copieusement.
Or, il y avait eu précisément, la veille, un malentendu entre Bec-de-Gaz et Œil-de-Bœuf. Chacun d’eux avait cru que l’autre gardait de l’argent, et chacun avait joué jusqu’au dernier centime, ce qui faisait qu’ils étaient à jeun et, n’étant pas ivres à cinq heures du soir, s’estimaient aux trois quarts malades.
Bec-de-Gaz et Œil-de-Bœuf, avançant sur les berges, sursautèrent tout d’un coup. On venait de les appeler.
– Eh là-bas, les aminches !…
– Quoi qu’y n’y a ? répondit Bec-de-Gaz, qui se retourna.
D’un tas de sable où il était vautré, un homme se levait qui appelait toujours :
– Radinez voir, quoi ! Non c’que vous avez l’air marioles, tous les deux… On r’connaît donc plus les poteaux ?
Alors Œil-de-Bœuf eut un grand cri, un cri de joie qui lui venait du cœur.
– Ah bon Dieu, commençait-il, Dégueulasse !…
Au même instant, une autre tête apparaissait, que Bec-de-Gaz identifia à son tour :
– Et Fumier ! dit-il.
Là-dessus, Œil-de-Bœuf et Bec-de-Gaz, au comble de la joie, s’envoyèrent des grandes claques sur les cuisses, en signe de satisfaction. Ils étaient évidemment très heureux de retrouver les deux amis Dégueulasse et Fumier avec qui, jadis, ils avaient fait de si bonnes parties.
Dégueulasse, cependant, était toujours aplati sur son tas de sable. Il invitait :
– Eh bien, montez-donc, rappliquez, les oiseaux ! Y a d’la place pour tout l’monde ! Et si c’est que vous n’êtes pas milliardaires, vous n’perdrez peut-être pas vot’temps…
L’invitation était séduisante, elle semblait sous-entendre une offre alléchante. Bec-de-Gaz et Œil-de-Bœuf ne se la firent pas répéter deux fois.
– Voilà, présents ! ripostait Bec-de-Gaz. On s’amène !…
Œil-de-Bœuf demandait en même temps :
– Mais qu’est-ce que vous foutez-là, bon sang, Dégueulasse et Fumier ?
Dégueulasse se découvrit :
– Nous, dit-il, on r’garde l’institut. Ah, et puis, encore, on s’inspire de la Beauté…
Et Fumier ajoutait avec un sourire :
– On a des dames, d’abord !…
De fait, il y avait des dames, il y avait une dame plutôt, avec Dégueulasse et Fumier. Elle était, comme ses compagnons, étendue tout de son long sur la pyramide de sable et elle se chauffait au soleil, les bras écartés, les jambes croisées, tout en couvant d’un œil attendri un grand diable qui, sale à faire peur, l’air voyou au possible, se grattait la tête avec conviction, se livrant évidemment à une chasse des plus fructueuses.
Œil-de-Bœuf, du coup, s’enthousiasma.
– Ah bien alors, fit-il, vous avez trouvé le bon coin, vous autres !… On est rudement bien, là-haut !… Et du moment qu’y a du sesque !…
Mais Dégueulasse rappelait déjà son ami aux convenances.
– Toi, disait-il gentiment, tâche de t’coller un bouchon ! Madame est à la colle solide avec monsieur ! Écoute voir un peu que j’fasse les présentations !
Et Dégueulasse faisait en effet les présentations.
– Madame, disait-il, c’est une garce qu’est rien gironde. C’est la Puce, qu’elle s’appelle, et son homme c’est Mon-Gnasse… Quant à c’qui est de leurs professions et de leurs titres, c’est exactement comme les nôtres, y n’s’en vantent pas…
Cela laissait entendre que ni Mon-Gnasse ni la Puce n’avaient un casier judiciaire rigoureusement vierge.
Bec-de-Gaz, en l’apprenant, eut un sourire satisfait.
– Bon, dit-il, dans c’cas, on est frangins.
Et, continuant à exprimer franchement sa pensée, Bec-de-Gaz ajoutait :
– Seul’ment, voilà, j’ai la pépie. Vous n’aureriez rien à boire, par hasard ?
Dégueulasse éclata de rire.
– C’te question ! remarquait-t-il.
Ses mains sales fouillèrent un instant le tas de sable, il exhiba un litre qui y était couché, dissimulé.
– Colle-toi ça dans l’alambic ! conseilla-t-il.
Bec-de-Gaz ne se le fit pas dire deux fois. Il donna une longue accolade à la bouteille, puis la passa à Œil-de-Bœuf.
– À toi, vieux frère !
Et Bec-de-Gaz claquait de la langue, satisfait.
– C’est du fameux ! déclarait-il. D’où diable que vous t’nez ça ?
Sans rire, Dégueulasse riposta :
– De not’travail.
Et comme Bec-de-Gaz et Œil-de-Bœuf haussaient les épaules plaisamment, marquant ainsi qu’ils ne coupaient pas dans le pont et qu’il ne fallait pas venir leur raconter qu’il s’agissait de bien licite, Fumier lui-même appuya les paroles de son copain :
– Mon vieux, tu t’la fourres dans l’œil… C’est comme j’ai l’honneur de t’le dire. C’est not’turbin qui nous rapporte ça. Et d’abord on embauche ! Œil-de-Bœuf et toi, c’est-y que vous voulez gratter avec nous ?
La Puce, en écoutant ces propos, avait relevé la tête. Elle tapa du pied dans le dos de Mon-Gnasse.
– Ouvre donc tes esgourdes, conseillait la Puce. Y a les frères qui jactent…
Cette remarque causa un certain malaise. Mon-Gnasse, en effet, s’était brusquement retourné. Il jetait à Dégueulasse et à Fumier un ordre impératif :
– La ferme, vous !… Bon Dieu, vous n’allez pas débiner l’truc ?
Sur quoi Bec-de-Gaz et Œil-de-Bœuf se vexèrent immédiatement.
Comment, il y avait un truc, et on ne voulait pas le leur confier ! Peut-être bien que c’était une manigance qui rapportait du pèze !… Eh ! mais, par exemple ! Ils n’entendaient pas qu’on leur fasse passer ça sous le nez !…
Une convoitise ardente se lisait désormais dans leurs yeux. Ils étaient prêts à se fâcher. Dégueulasse apaisa la querelle :
– Boucle, Mon-Gnasse, conseillait-il, c’est pas parce que t’es nouveau dans la bande qu’y faut en r’montrer aux vieux comme nous… Œil-de-Bœuf et Bec-de-Gaz c’est des frangins qu’on peut tout leur dire. Si l’patron était là, il les embaucherait, et y en a pour tout l’monde d’abord…
Mais Œil-de-Bœuf et Bec-de-Gaz ne comprenaient toujours pas de quoi il s’agissait, et quel mystère on voulait leur cacher.
Bec-de-Gaz interrogea :
– Enfin quoi… crachez donc dans la soupe, et que ça finisse ! De quel patron qu’vous parlez ? Pour qui qu’c’est qu’vous turbinez ?
Dégueulasse eut un ricanement. Il articula, très fier :
– Tu d’mandes le nom du patron ? Eh bien, voilà, Œil-de-Bœuf, tu vas comprendre tout d’suite que c’est du turbin intéressant. L’patron, c’est l’patron !…
Il disait cela d’un tel ton, que Œil-de-Bœuf roula des yeux effarés.
– Hein, fit-il, Fantômas ? C’est Fantômas qui vous a embauchés ?
– Soi-même ! fit Dégueulasse fièrement.








