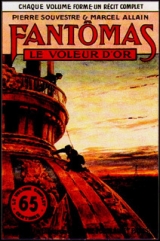
Текст книги "Le Voleur d'Or (Золотой вор)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
– L’enquête patauge, estimait Juve. Elle patauge terriblement. On ne trouve rien, on ne découvre pas davantage, et ce serait la bouteille à l’encre si le hasard ne fournissait pas un bouc émissaire dans la personne de Léon Drapier !
Celui-ci était encore là, répondait encore aux questions plus ou moins insinuantes que le juge d’instruction lui posait avec brusquerie, essayant de l’amener à se couper.
Léon Drapier, naturellement, se défendait avec désespoir. Il trouvait des réponses à tout. Peut-être d’ailleurs perdait-il un peu la tête, car il voulait expliquer l’inexplicable et, lorsque par hasard il restait court, il répétait docilement ce que lui soufflait le policier Mix, peut-être mieux intentionné qu’habilement inspiré.
Juve écouta sans mot dire cette dernière phase de l’enquête. Léon Drapier, à ce moment, s’efforçât d’établir sur le conseil de Mix qu’il y avait fort longtemps qu’il n’était venu voir sa maîtresse. Une telle prétention était inadmissible. Le service du Dr Bertillon, en effet, avait facilement relevé dans l’appartement des empreintes, des traces qui prouvaient tout au contraire que Léon Drapier y venait assez fréquemment.
Le directeur de la Monnaie, pourtant, s’entêtait à nier.
– L’imbécile ! pensa Juve. Et quel maladroit que ce policier Mix !
Mais, naturellement, Juve ne dit mot, ne voulant pas se compromettre, tenant surtout à ne pas heurter de front ce qui semblait être la conviction du magistrat, évidemment de plus en plus persuadé que le coupable n’était autre que le directeur de la Monnaie.
Juve pourtant, à ce moment, devait faire preuve, pour se taire, du plus méritoire des silences, de celui qui consiste à ne rien dire alors que les arguments se pressent en foule dans la pensée, alors que l’on se sent de taille à mener une discussion importante.
Par exemple si Juve se taisait, il ne pouvait s’empêcher de songer. Il s’en empêchait si peu qu’à midi et demi, lorsque enfin Léon Drapier se retirait, Juve avait peine à se retenir tant il avait envie de s’élancer sur Mix.
– L’animal ! jurait-il tout bas. Sans s’en apercevoir, il fait faire gaffe sur gaffe à son client !
Puis Juve souriait, interrogeait sa conscience.
– Après tout, n’était-il pas un peu partial ? Ne se montrait-il pas sévère à l’endroit de Mix surtout parce que celui-ci appartenait non pas à la classe des policiers officiels, mais bien à celle des détectives privés ?
Juve finit par hausser les épaules et se traiter lui-même d’imbécile.
– Allons ! se disait-il en faisant son examen de conscience. Est-ce que, par hasard, je serais atteint de la maladie du fétichisme ? Est-ce que je ne voudrais pas reconnaître qu’il y a d’excellents policiers en dehors de ceux qui sont inscrits sur les livres de la préfecture ?
Juve prit congé du magistrat qui se frottait les mains d’un air satisfait en prononçant des paroles de doute :
– Évidemment, disait Juve sans s’avancer, évidemment, il y a quelque chose de troublant dans toutes ces aventures, et la personnalité de Léon Drapier apparaît un peu inquiétante. Il faut attendre toutefois pour se prononcer.
Juve quitta le Palais de Justice, grimpa à la Sûreté.
Juve ne souriait plus. Il se doutait bien que M. Havard, encore vexé de son intervention de la matinée, le recevrait un peu fraîchement. Juve n’était pas homme, toutefois, à s’embarrasser pour si peu.
M. Havard, quelques instants après, recevait en effet Juve avec une certaine nervosité.
– Eh bien ? demandait le policier, où en sommes-nous, patron ? Est-ce aujourd’hui que l’on conduit Mon-Gnasse et la Puce au Cochon-Gras ?
– C’est aujourd’hui, répondit sobrement M. Havard.
– Tant mieux, très bien, approuva Juve qui se mettait en frais d’amabilité. Plus vite on en finira, et mieux cela vaudra !
– C’est évident, répondit laconiquement M. Havard.
Mais Juve insistait :
– À quelle heure les ferez-vous conduire là-bas ?
M. Havard se mit à écrire une lettre, il répondit en affectant d’être distrait :
– J’ai donné les ordres nécessaires. Mon-Gnasse et la Puce doivent être partis…
Juve fit la grimace.
– Déjà ! à deux heures de l’après-midi ! C’est bien tôt pour aller au Cochon-Gras !
– Non, riposta M. Havard. L’établissement a la clientèle des garçons de l’abattoir de la Villette. Il y a beaucoup de monde entre deux et trois heures.
Juve ne voulut pas, évidemment, engager une controverse sur ce point.
– Bon ! bon ! très bien ; fit-il. D’ailleurs, le rapport de Léon ou de Michel nous renseignera.
Juve parlait en toute sincérité, et sans voir malice à ses paroles. M. Havard, pourtant, dressait la tête d’un air peu satisfait.
– De quel rapport parlez-vous ? demandait-il.
– Mais du rapport qui sera déposé sur cette promenade dans les bouges…
M. Havard s’était remis à écrire. Il remarqua à mi-voix :
– Ah bon, très bien ! J’avais cru que vous parliez de Léon ou de Michel…
– Sans doute, dit Juve avec un peu d’impatience. Je suppose bien que c’est Léon que vous avez envoyé là-bas ?
– Non, dit M. Havard un peu sèchement. J’ai envoyé Nalorgne et Pérouzin.
Juve, cette fois, ne répondit pas. Brusquement, son visage s’était renfrogné, il se mordait les lèvres d’un air très peu satisfait.
Juve, en effet, ne se trompait pas sur l’importance des paroles qui venaient d’être dites. Si M. Havard avait chargé Nalorgne et Pérouzin de l’enquête, c’était évidemment pour infliger un blâme implicite à Juve. Celui-ci avait surtout confiance en Léon et en Michel. On choisissait d’autres hommes que ses préférés, c’était tout simplement pour lui être désagréable.
Juve, toutefois, avait trop bon caractère et se moquait trop parfaitement aussi des petits calculs et des petites jalousies de M. Havard pour attacher la moindre importance à un incident qui n’avait pas de valeur à ses yeux. Il n’eût donc pas relevé la chose s’il n’avait pas considéré que Nalorgne et Pérouzin étaient de parfaits imbéciles et qu’il était plus que dangereux de les charger d’une mission délicate.
Juve ne dit mot, se leva, prit congé de M. Havard et quitta le cabinet du chef de la Sûreté.
Dans le corridor, Juve se mit à courir. Il consultait sa montre, il fronçait les sourcils.
– Deux heures vingt ! murmurait-il. Une demi-heure pour aller là-bas, j’y serais tout juste à trois heures… Sera-t-il encore temps ? Ah ! sapristi, j’ai grand peur qu’il y ait du grabuge, du terrible grabuge !
Et Juve, en grommelant, descendit l’escalier, sortit dans la rue, héla le premier taxi-auto qu’il rencontrait.
– Mon vieux Nalorgne, disait Pérouzin, qui, depuis quelque temps, était un peu moins neurasthénique et voyait la vie en rose, mon vieux Nalorgne, ça, c’est significatif. Du moment qu’on nous choisit pour une mission pareille, c’est qu’on connaît enfin notre mérite, c’est que notre avancement est certain !
Nalorgne, qui, de gai qu’il était, était devenu pessimiste, hocha la tête avec accablement :
– Ou bien, murmurait-il, c’est que la mission est dangereuse et qu’on nous a choisis de préférence à tout autre, pour nous faire casser la figure !…
Les deux agents, à midi et demi, venaient tout juste de recevoir de M. Havard l’ordre d’avoir à conduire au Cochon-Gras, cabaret borgne de la rue de Flandre, le couple Mon-Gnasse et la Puce. Ils avaient d’ailleurs reçu des instructions précises. Ils prendraient un fiacre, ils seraient armés, ils ne quitteraient pas des yeux les prisonniers dont ils avaient la charge et dont ils étaient responsables. Nalorgne veillerait sur Mon-Gnasse et Pérouzin sur la Puce.
– Vous comprenez bien la situation ? avait dit M. Havard, qui ne se trompait pas beaucoup en estimant à zéro l’intelligence de ses sous-ordres. Il faut que ces gars-là puissent avoir l’air d’être libres, mais il faut aussi qu’ils ne puissent pas vous filer entre les doigts !
Nalorgne et Pérouzin avaient naturellement juré qu’ils comprenaient à merveille et qu’aucun danger n’était à craindre.
Dans le secret de leur âme, cependant, ils étaient flattés, mais inquiets. Rentrés chez eux, Nalorgne et Pérouzin se dépêchaient de se grimer. Avec une maladresse d’ailleurs complète, ils tentaient de se faire des têtes d’apache. Si la nature ne les avait pas doués l’un et l’autre de physionomies brutales et repoussantes, ils n’y seraient peut-être pas parvenus. Mais comme en réalité ils marquaient mal d’ordinaire, ils arrivaient à incarner assez bien leur rôle en se contentant de passer des vestes usées, de tourner autour de leur cou des foulards rouges, de se coiffer enfin de casquettes plates comme en portent tous les Remparts de tous les Sébastos du monde.
Ainsi accoutrés, Nalorgne et Pérouzin allaient chercher au Dépôt Mon-Gnasse et la Puce. Ceux-ci, à la vue de leurs nouveaux geôliers, ne cachaient pas leur satisfaction.
– Ah ! mince alors ! clamait Mon-Gnasse. V’là que c’est l’mardi gras à c’t’heure ! Et comment qu’ils dégotent, les frères !…
La Puce avait battu des mains.
– Vrai, déclarait-elle en examinant Nalorgne qui s’efforçât d’avoir l’air à l’aise et paraissait emprunté au possible. Vrai, mon fiston, si t’étais réellement un costaud, c’est pas encore toi que j’prendrais pour m’aider à faire le truc !
Là n’était pas la question. Nalorgne et Pérouzin rappelaient les prisonniers au respect des convenances.
– Taisez-vous, disait Nalorgne. On n’est pas là, mon collègue et moi, pour que vous vous payiez notre portrait !
À quoi la Puce répondait immédiatement :
– D’abord, y aurait rien d’fait, j’en voudrais pas !…
– On est là, continuait Nalorgne en roulant de gros yeux et visant à prendre un air terrible, on est là pour faire son devoir et pour vous forcer à réfléchir ! Il s’agit de nous conduire, paraît-il, au Cochon-Gras, et là, vous nous débinerez tous les trucs que vous connaissez.
– Bon, bon ! ça colle ! fit Mon-Gnasse.
– Seulement, continuait Pérouzin, on est là aussi avec des pleins pouvoirs. Si jamais vous tentez de faire les méchants, on vous mettrait proprement un pruneau dans la figure.
Et Pérouzin agitait un browning formidable qu’il avait acquis la veille même, car il avait le culte des armes et prétendait être toujours armé jusqu’aux dents.
Mon-Gnasse ne fut nullement impressionné par le browning de l’agent.
– Allons, l’enflé ! faisait-il familièrement en tapant sur le ventre de Nalorgne. C’est pas la peine de faire le croquemitaine, on s’ra sage !… Seul’ment, n’est-ce pas, si jamais les copains vous reconnaissaient et se fâchaient un peu, on déclare qu’on n’en est pas responsable !… Dame ! la rousse, au Cochon-Gras,n’est peut-être pas très bien vue !
C’était bien ce que pensaient Nalorgne et Pérouzin, et c’était bien ce qui les empêchait de se réjouir de la périlleuse mission qui venait de leur être confiée.
Ils étaient tout juste à demi rassurés, ils n’avaient peut-être pas tort.
Les deux agents cependant et leurs deux prisonniers sortaient bientôt des cellules du Dépôt, arrêtaient un fiacre et se faisaient conduire rue de Flandre.
Le Cochon-Gras, un cabaret d’assez proprette apparence, vu de la rue, un bouge ignoble pour ceux qui le connaissaient réellement, se trouvait tout à côté de la barrière, à quelque distance des abattoirs, ainsi que l’avait dit M. Havard.
C’étaient surtout les bouchers, les conducteurs de bestiaux qui fréquentaient l’endroit, mais à ces honnêtes travailleurs se mêlaient souvent quelques-uns des rôdeurs de barrière qui, on ne sait pourquoi, semblent affectionner le quartier.
Il y avait surtout une salle basse se trouvant derrière le mastroquet proprement dit, où le plus souvent, pendant la journée, dormaient, jouaient ou se disputaient toute une bande d’individus peu recommandables.
Nalorgne et Pérouzin ne l’ignoraient pas. Ils prirent ou voulurent prendre leurs dispositions en conséquence.
– Comment qu’on va faire ? demandait Nalorgne.
Pérouzin, tout aussi embarrassé, retourna la question à Mon-Gnasse.
– Allons, fripouille, demandait-il, comment penses-tu qu’il faut agir ?
C’était là une question si extraordinaire que Mon-Gnasse pensa rêver.
– Sûr qu’y sont piqués ! estima l’apache, glissant un coup d’œil à la Puce pour attirer son attention. V’là maint’nant qu’c’est les roussins qui m’demandent des conseils !… Oh ! mais alors, y a du bon !
Mon-Gnasse prit son air le plus innocent, il répondit, faisant assaut de politesse :
– M’sieur l’agent, ce s’ra juste au juste tout comme ça vous bottera !
Puis après une petite pause, et sans laisser aux inspecteurs le temps d’émettre une proposition, Mon-Gnasse commença :
– Une idée comme ça qui m’vient. Faudrait p’t’ête pas qu’on radine ensemble dans la tôle, histoire de pas s’faire remarquer ? La Puce et moi, s’pas, on entrerait comme des braves bourgeois tranquilles qui veulent s’caler les mâchoires… Vous, vous resteriez d’vant la porte. Une seconde après, naturellement, vous pourriez rappliquer à vot’tour…
Nalorgne hochait la tête, il questionna :
– Ouais ! mon garçon, tu nous crois trop bêtes !… Et si tu t’débinais, hein ?
Mais Mon-Gnasse avait une figure d’innocence absolue.
– Comment que j’me débinerais, murmurait-il, puisque vous seriez d’vant la porte et qu’il n’y a qu’une entrée !
Nalorgne, cette fois, ne répondit pas. Il ignorait à vrai dire si le bouge comportait plusieurs entrées. Il ne voulait pas convenir de son ignorance, et pourtant il tremblait à la pensée que Mon-Gnasse et la Puce pouvaient disparaître et s’évader.
À la fin, une réflexion décida Nalorgne.
– Parbleu ! songea-t-il, si Mon-Gnasse me dit qu’il n’y a qu’une entrée, c’est que c’est la vérité, il n’oserait pas me mentir ainsi !
Nalorgne était peut-être bien confiant, pourtant il se décida.
– Supposons que l’on fasse ainsi, dit-il. Après qu’est-ce qui se passera ?
La Puce répondit à son tour :
– Dame, on s’coll’ra à licher…
Et Mon-Gnasse complétait l’explication :
– Bien sûr, on aura pas l’air d’se connaître !… Puis, comme ça, quand c’est qu’viendra l’mec qui nous a r’filé les pièces d’or, la Puce et moi, on vous f’ra signe.
Pérouzin trouvait cela très bien. Il le déclara nettement.
– Affaire entendue ! disait-il. Nous allons procéder ainsi.
Et, pour se concilier les bonnes grâces des apaches, Pérouzin, qui était généreux à ses heures, décida sans hésiter :
– Vous pourrez boire d’ailleurs tant que vous voudrez, c’est Nalorgne et moi qui paierons les tournées.
Le petit groupe arrivait à ce moment devant le Cochon-Gras. Il était temps de se séparer.
Très fiers, ayant l’air parfaitement innocents, Mon-Gnasse et la Puce quittèrent les deux agents et entrèrent dans le cabaret. À ce moment, Nalorgne claquait des dents.
– Pourvu qu’ils ne s’enfuient pas ! murmurait-il.
Mais Pérouzin riait d’un grand rire de confiance.
– Ils n’oseraient pas ! répétait-il, ils n’oseraient pas !…
Et les deux inspecteurs, quelques instants plus tard, pénétraient à leur tour dans le bouge.
Quelle que fût d’ailleurs leur confiance dans Mon-Gnasse et la Puce, ils poussaient un véritable soupir de soulagement en constatant que les deux misérables étaient toujours là. Le gibier n’avait pas fui, il était encore à portée de leur main.
– Là ! vous voyez bien, Nalorgne ! souffla Pérouzin.
Pérouzin hochait la tête, cependant qu’il commandait d’autorité deux mominettes et de quoi écrire.
Les deux mominettes s’expliquaient assez bien. Pour être inspecteurs de la Sûreté on n’en est pas moins hommes, et Nalorgne et Pérouzin depuis quelque temps, à force de fréquenter les apaches, à force d’enquêter dans les bars, avaient fini par contracter la déplorable habitude de l’absinthe.
Si, d’autre part, ils demandaient en plus de leur consommation de quoi écrire, c’est que Juve leur avait appris récemment un truc policier qui les ravissait.
– Quand vous faites une enquête ensemble, avait dit Juve, et que, vous trouvant dans un milieu suspect, vous désirez vous communiquer des choses que personne ne doit entendre, vous n’avez qu’à les écrire, Nalorgne, par exemple, tracera quelques mots, passera la feuille à Pérouzin. Celui-ci, ayant l’air d’examiner le brouillon d’une lettre, lira le plus naturellement du monde ce que son collègue a écrit et, faisant mine de raturer, répondra tout ce qu’il voudra…
Nalorgne et Pérouzin, en possession de ce qu’il fallait pour écrire, commencèrent immédiatement à correspondre.
– Fichue clientèle ! écrivit Nalorgne.
Pérouzin, maladroit comme tout, lut immédiatement ce mot et écrivit en-dessous :
– Ils ont tous des têtes d’assassins !…
Puis il passa le porte-plume à Nalorgne et, souriant, attendit que celui-ci lui communiquât une nouvelle remarque.
La manœuvre était si simple et si grossièrement faite qu’il eût été véritablement impossible qu’elle échappât à la perspicacité du plus obtus des misérables.
Ce qui pourtant sauvait Nalorgne et Pérouzin, c’était tout bonnement qu’il n’y avait aucun misérable dans le cabaret du Cochon-Graset que Pérouzin se trompait complètement en imaginant voir des têtes d’assassins.
Il n’y avait là, en réalité, que de braves gens, d’honnêtes travailleurs des abattoirs, qui buvaient un coup en passant.
Comment cela se faisait-il ?
L’explication était bien simple.
Le Cochon-Gras, en réalité, ne recevait la clientèle louche qu’à partir de quatre heures du soir. Mon-Gnasse et la Puce, d’ailleurs, avaient donné l’adresse tout à fait au hasard. Ils n’avaient personne à voir, personne à rencontrer dans le bouge, et lorsque Juve avait dit qu’il fallait les y conduire, lors de l’interrogatoire qu’ils avaient subi le matin même, Mon-Gnasse et la Puce avaient été les premiers surpris de l’ordre du policier.
Mon-Gnasse avait parlé du Cochon-Graspour gagner du temps, et sans croire que cela allait prendre. Cela n’avait pas pris en effet, mais Juve, lui aussi, voulait gagner du temps, et c’est pourquoi il avait accepté la proposition.
Désormais, Mon-Gnasse et la Puce, séparés par quelques tables de Nalorgne et de Pérouzin, pouvaient causer sans être entendus.
– Quels ballots !… disait Mon-Gnasse. Ils coupent dans tous les ponts !… Et comment qu’on les balade en bateau ! Si on a un peu d’veine, demain, on d’mandera à aller dans un aut’caboulot…
La Puce approuvait.
– Ah, t’es rien bath, mon homme ! disait-elle avec admiration. T’as des idées de costaud tout d’même !… On contera comme ça qu’on a pas rencontré l’type en question et on s’f’ra vadrouiller ailleurs. C’est quinze jours de lichage aux frais d’la princesse… Veine, alors !
Le plan était très simple. Restait à le mettre à exécution, d’autant que, bien probablement, Mon-Gnasse l’estimait du moins, les agents se lasseraient de les promener et l’on finirait par les remettre en liberté.
Ils en étaient là de leurs projets lorsqu’un homme entrait brusquement dans le cabaret à la façon d’un habitué. Cet homme marchait droit à Mon-Gnasse et à la Puce.
– Tiens, les poteaux ! criait-il. Et comment qu’ça va, les vieux ? Ça circule toujours ?
À la vue de cet homme, Mon-Gnasse et la Puce se trouvaient fort interloqués. Qui diable était-ce ? Ils ne le connaissaient aucunement. Ils pensaient ne l’avoir jamais vu !
Mon-Gnasse, pourtant, ne perdait pas trop son sang-froid.
– Ça, y a pas d’doute, jugea-t-il en un instant de réflexion, c’est un trafalgar qui s’prépare ; c’est des copains qui nous envoient c’type-là, histoire de nous faire barrer !
Mon-Gnasse se fit aimable en conséquence.
– Eh oui, ça circule ! déclarait-il. On n’est pas bons encore pour les pissenlits !… Et toi, ma vieille, quoi d’neuf ?
Mon-Gnasse, d’un petit geste de la main, avait fait signe à Nalorgne et Pérouzin. Les deux agents tressaillaient d’aise.
– Cela doit être l’individu ! écrivit Nalorgne.
Pérouzin répondit :
– Ouvrons l’œil, et le bon !
Ils furent tout yeux, tout oreilles.
La conversation continuait.
– J’ai pas longtemps à moi, déclarait le poteau de Mon-Gnasse et de la Puce, tout juste le temps de faire un cafouillou. Ça colle-t-il ?
Mon-Gnasse n’ignorait pas qu’il n’y avait pas de billard dans l’établissement. La proposition de l’inconnu le confirma donc dans cette pensée qu’il avait des propositions à lui faire.
– Ça colle ! répondit-il.
– Alors, cavale dans la salle du fond !
L’inconnu se retournait vers le patron, il criait :
– Eh, tôlier ! On s’en va au cafouillou… Tu porteras les verres là-bas !
Le tôlier poussa un grognement qui pouvait être à la rigueur une réponse affirmative.
Mon-Gnasse et la Puce se levaient cependant. Ils suivaient l’inconnu, adressant toujours des petits gestes à Nalorgne et Pérouzin qui ne se tenaient pas d’aise. La correspondance reprit entre les deux personnages.
– Ça marche ! écrivait Nalorgne.
– Ça galope ! affirmait Pérouzin.
Et, prenant une feuille neuve, Nalorgne écrivait encore :
– Sûrement l’individu qui vient d’entrer est un apache intéressant. Ils ont fait des signes, attendons !
– Attendons ! acquiesça Pérouzin.
Ils attendirent, en effet, sans inquiétude, car ils étaient persuadés qu’il n’y avait point d’autre sortie, pendant un bon quart d’heure. C’était à peine s’ils trouvaient le temps long et s’ils commençaient à se demander s’il ne serait pas bon d’aller voir dans la salle basse ce qui se passait, lorsqu’un événement, à coup sûr imprévu, se produisit brusquement.
Enfoncée d’un coup d’épaule, la porte de la salle basse s’ouvrait.
Un homme apparaissait dans l’embrasure. C’était Juve !
Juve était livide, et Juve criait :
– À l’aide, nom d’un chien ! Nalorgne, allez vite chercher une voiture ! Pérouzin, aidez-moi !… On s’assassine là-dedans !
Alors, une scène horrible se passait.
Tandis que Nalorgne, affolé, obéissait machinalement, quittait le cabaret et courait chercher un fiacre, Pérouzin, accompagnant Juve, se précipitait dans la salle basse.
L’aspect de la pièce était épouvantable.
Par une fenêtre située à mi-hauteur, une fenêtre dont les grilles étaient arrachées et qui avait servi à Juve pour entrer, un jour pâle pénétrait. Il éclairait une scène abominable.
Le sol était couvert de sang. Le sang avait d’ailleurs giclé jusqu’au plafond, souillant les murs, écrivant un horrible carnage.
Mais ce n’était point le sang qui retenait les regards. Ce qui laissait Pérouzin muet d’effroi, ce qui l’épouvantait au point qu’il pensait défaillir, c’est qu’il apercevait, à l’instant même, deux formes humaines, deux corps qu’agitaient de convulsifs mouvements, le corps d’un homme, le corps d’une femme, le corps de deux malheureux qui étaient Mon-Gnasse et la Puce et qui, tous deux souillés de sang, râlaient à moitié !
– Mon Dieu ! gémit Pérouzin.
Et, machinalement, il cherchait un troisième personnage, le costaud qui avait accompagné Mon-Gnasse et la Puce.
– Imbéciles ! Brutes ! Comprenez-vous votre maladresse, au moins ? Vous les avez perdus de vue !… Ah, sang Dieu, dire que je suis arrivé trop tard !
Juve, en fait, était parvenu au Cochon-Grasjuste à l’instant où Mon-Gnasse et la Puce suivaient l’inconnu pour entrer dans la salle basse ; le policier, qui allait pénétrer dans le cabaret, avait vu, à travers la porte, Nalorgne et Pérouzin laissant tranquillement s’éloigner les deux apaches dont ils avaient la garde.
– Les imbéciles ! avait pensé Juve.
Sans perdre de temps alors, et soupçonnant qu’une évasion était possible, Juve, au lieu d’entrer dans le cabaret, s’était rejeté en arrière, voulant faire le tour de la maison.
Il avait perdu du temps à traverser des cours, à s’orienter. Quand il était arrivé sur la façade opposée du Cochon-Gras, il avait trouvé la fenêtre ouverte, avait compris que quelqu’un avait fui par là, s’était hissé jusqu’à cette lucarne et, par elle, avait aperçu les deux victimes étendues sur le sol…
Que s’était-il passé au juste, cependant ?
Juve ne le savait pas. Il avait vu que Mon-Gnasse et la Puce vomissaient le sang à flots. Ils étaient ligotés. Juve alors donnait l’alarme, envoyait chercher une voiture, puis s’occupait avec Pérouzin de transporter les blessés.
Juve, d’ailleurs oubliait complètement à cet instant qu’il s’agissait de misérables fort peu dignes d’intérêt. Il bousculait même Nalorgne et Pérouzin avec fureur :
– Hâtez-vous donc ! hurlait-il. Vous voyez bien que ces gens-là râlent !… Il faut les secourir ! C’est votre bêtise, que diable, qui vient de les faire assassiner !
Transportés dans un fiacre, Mon-Gnasse et la Puce, évanouis et perdant toujours leur sang, ne donnaient guère signe de vie. Juve prit lui-même les guides en main. À l’ahurissement du cocher, qui ne comprenait rien à la façon de faire de ce client, il fouettait la rosse et la lançait au galop dans la direction de l’hôpital.
Par bonheur, le policier était connu. Un interne accourait immédiatement.
– Grave, grave ! fit-il en hochant la tête. De terribles hémorragies !
Et il demandait :
– Que s’est-il donc passé ? Une rixe ?
– Je ne sais pas, dit Juve.
L’interne, aidé de deux infirmiers, déshabillait les blessés.
– Ils doivent avoir des coups de couteau ou une balle dans les poumons pour vomir le sang de cette façon !
Mais aucune blessure n’apparut sur les deux corps déshabillés.
– Sapristi ! déclara l’interne, qu’est-ce que cela signifie ?
De force, il ouvrit la bouche des deux victimes. Avec des tampons d’ouate, il étanchait le sang et soudain le jeune médecin poussait un cri d’horreur…
– Ah ! nom de Dieu ! c’est abominable !… On leur a coupé la langue !
Et, très pâle, l’interne répétait cependant qu’il cautérisait l’horrible blessure :
– Mais, bon Dieu ! qu’est-ce que tout cela signifie ? Qu’est-ce que cela signifie donc ?
Il interrogeait du regard Juve, Nalorgne et Pérouzin.
Les trois hommes se taisaient.
Nalorgne et Pérouzin n’y comprenaient rien du tout. Juve réfléchissait.
L’interne, à la fin, déclara :
– Ils en réchapperont peut-être, mais voilà des gens muets pour toujours !
Alors, brusquement, Juve se tordit les mains.
Les dernières paroles de l’interne venaient de lui faire deviner la vérité :
– Ah, c’est horrible ! soupira Juve. Sûrement, il s’agit encore d’un crime de Fantômas ! Il n’y a que Fantômas pour avoir osé rêver cela ! Fantômas, sans doute, se méfiait de leurs bavardages ! Oui, c’est bien cela, il a voulu les rendre muets, muets pour toujours !… C’est une terrible leçon de discrétion qu’il vient de donner à des complices trop bavards !
Et Juve, à ce moment, devinait en effet la vérité…
XVI
Sous un monceau d’or
– Il n’est pas encore arrivé ?
– Pas encore !
– Il est pourtant déjà neuf heures un quart, et d’ordinaire le patron est fort exact !
– M. le directeur est, en effet, fort exact à l’ordinaire, je ne comprends pas pourquoi il n’est point là ! Il y a une quinzaine de personnes qui l’attendent, et pour peu que ces gens aient bien des choses à lui dire, nous risquons fort d’aller déjeuner à une heure de l’après-midi !
Le personnage qui s’exprimait ainsi était un majestueux huissier, décoré de plusieurs ordres étrangers, dont le rôle consistait à défendre l’entrée du couloir attenant au cabinet de M. le directeur de la Monnaie.
Il échangeait ces propos et émettait ces craintes en présence d’un employé du personnel, M. Valleret, qui arrivait avec un gros dossier sous le bras.
M. Valleret reprit :
– Dites donc, mon brave, vous allez vous arranger pour m’introduire auprès du patron avant tous ces visiteurs ! Vous savez, nous, les employés, nous n’avons guère le temps d’attendre et j’ai une communication excessivement importante à lui faire !
– Ah ! fit l’huissier d’un air sceptique, vous êtes tous les mêmes ! Ce n’est pas que vous êtes pressé de retourner à votre travail, mais vous voulez en finir rapidement pour être libre à trois heures de l’après-midi !
M. Valleret protestait :
– Moi ? pas du tout, pas du tout !… Et la meilleure preuve, c’est qu’hier à sept heures et demie j’étais encore au bureau. Avec toutes les histoires qui se produisent depuis quelque temps, nous sommes écrasés de besogne et l’on fait des heures supplémentaires que l’on ne nous paie pas !
– Et vous croyez que l’on paie les nôtres ? interrompit l’huissier.
Tout en haussant les épaules, le personnage s’éloignait pour aller recevoir un nouveau venu qui lui tendait sa carte en lui recommandant de bien vouloir la faire passer à M. le directeur de la Monnaie.
L’huissier le toisa dédaigneusement.
– M. le directeur vous recevra à votre tour, s’il vous reçoit.
– Et quel est mon tour ? demanda le nouveau venu.
– Mettons, fit l’huissier, qu’il y ait une vingtaine de personnes à passer avant vous, et nous serons peut-être dans le vrai…
Le nouveau venu faisait une figure longue d’une aune, puis tournait les talons.
– Je repasserai demain ! grogna-t-il.
Et il s’en alla.
L’huissier était revenu s’asseoir à son bureau, auprès duquel se tenait M. Valleret.
– Avez-vous lu les journaux ? demanda-t-il au fonctionnaire.
– Oui, fit ce dernier. Il s’en passe de belles !
– Oh ! dit l’huissier, ce sont là des scandales épouvantables, qui véritablement ne devraient pas arriver.
« Notre police, voyez-vous, M. Valleret, est très mal organisée. Les services de la Sûreté fonctionnent quand ça leur passe par la tête… Paraît qu’ils se détestent les uns les autres, qu’ils se jouent des tours chaque fois qu’ils le peuvent !
– Comme chez nous, cher monsieur, interrompit M. Valleret, comme chez nous… comme d’ailleurs dans toutes les administrations !
– C’est possible, reconnut l’huissier, mais nous, ça ne fait de mal à personne, tandis qu’en procédant de la sorte, à la Sûreté, depuis le grand chef jusqu’au plus petit inspecteur, leur mésentente a pour résultat de laisser les crimes impunis et de permettre aux bandits de commettre leurs forfaits en toute liberté. Enfin, quand je pense que ces deux agents Nalorgne et Pérouzin, auxquels on avait confié deux prisonniers, n’ont pas été capables de les garder !…
– Les prisonniers, dit M. Valleret, doivent rudement le regretter ! Paraît qu’ils ont été affreusement mutilés, qu’on leur a arraché la langue !… Et dire qu’on ne sait pas l’auteur de ce crime monstrueux !
– Mais si, fit l’huissier, n’avez-vous pas lu qu’on attribuait ce forfait à Fantômas ?
– Oh, c’est facile à dire ! Fantômas ! toujours Fantômas !… Je commence à croire que Fantômas n’a jamais existé !
L’huissier prit une allure mystérieuse pour répondre :
– Fantômas existe, n’en ayez crainte, M. Valleret ! Même ce qui m’inquiète, c’est qu’il m’a l’air d’y avoir un lien plus ou moins direct avec les drames qui viennent de se passer hier et les incidents mystérieux qui se produisent ici depuis quelques jours !








