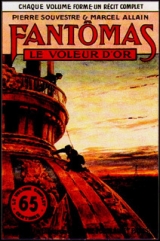
Текст книги "Le Voleur d'Or (Золотой вор)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
La rue s’était faite déserte, mais les guinguettes regorgeaient de monde. Il y avait des dîneurs dans tous les coins et à toutes les tables et, cependant que la brise fraîche du soir balançait les écriteaux qui annonçaient la présence du véritable arbre de Robinson, on entendait des cris, des rires perlés qui montaient des bosquets, descendaient des branches d’arbres où s’étageaient les belvédères et invariablement annonçaient que quelque cavalier galant serrait d’un peu près sa compagne.
C’était un dimanche soir. Dès midi, Robinson s’était vu envahi par la foule. On avait beaucoup bu, dansé plus encore, les chevaux en avaient vu de raides, les ânes avaient mis à l’épreuve leur patience, et désormais, si les têtes tournaient un peu, les cœurs, par un juste retour des choses, n’étaient pas éloignés de chavirer.
Aussi bien on avait le temps. Sur toute cette foule de midinettes, d’employés de bureau, de jeunes gens, séquestrés toute la semaine dans des bureaux noirs, la menace du lundi inexorable, de la reprise du travail pesait lourdement. On avait questionné les garçons, on savait que les trains partaient de quart d’heure en quart d’heure, qu’il y en avait jusqu’à minuit, et l’on éternisait les heures de ce jour heureux, goûtant la volupté des balançoires, le piquant des vins mousseux, le parfum de l’été aussi et toute la griserie qui s’échappait des boucles blondes un peu défaites, des grands yeux un peu meurtris qui n’avaient plus guère la force désormais de se fâcher ou de se faire méchants.
Si cependant les couples étaient heureux, et les amoureux étaient en majorité dans les restaurants de Robinson, si des arbres, de branche en branche, les éclats de rire dégringolaient en cascades, en averses de gaieté, il n’y avait point, ce dimanche-là à Robinson, que de tendres soupirants. À quatre heures, brusquement, un train avait amené, en effet, une foule d’individus, une dizaine de personnages qui n’appartenaient certainement pas à la clientèle ordinaire de ce pays du rire et de la gaieté.
Les hommes étaient coiffés de casquettes avachies, leurs vestons avaient une coupe étrange, leurs chemises de flanelle étaient déboutonnées au col, et leur seule élégance résidait en leurs bottines d’un jaune criard, aux tiges extravagantes, à la pointe des plus fines.
Les femmes qui les accompagnaient étaient pires qu’eux. Il y avait là deux ou trois brunettes dont le col s’ornait d’un ruban rouge, dont les jupons dégrafés tombaient perpétuellement, dont la gorge, dépourvue de tout corset, avait des houles inquiétantes et vraiment révélatrices.
Eux avaient fui les divertissements. Ils n’étaient entrés ni dans le bal musette, ni dans les tirs à la carabine. Ils avaient dédaigné le photographe qui opère à mi-côte et réussit en deux minutes votre portrait sur un aéroplane qu’il affirme véritable.
Ils n’avaient même pas eu un regard pour les chevaux étiques que malmenaient des cavaliers dont les culottes remontaient jusqu’aux genoux. À peine avaient-ils souri au passage de certaines amazones qui, dépourvues de toute notion d’équitation, se cramponnaient à leur selle sans souci du grotesque effet de leurs jupes relevées sur des jambes plus ou moins jolies, sur des bas à jours plus ou moins déchirés.
Tout simplement la bande, au sortir de la gare, avait tourné à droite, monté la côte, puis, obliquant à gauche à la fourche, s’était enfournée, engouffrée, engloutie dans un extraordinaire baraquement qu’il fallait assurément connaître pour croire que c’était là un mastroquet.
Nulle enseigne ne s’étalait à la porte, et pourtant, dès l’entrée, on était saisi par un âpre relent de boissons fortes. Il y avait là une petite salle dont les murs avaient été blanchis à la chaux, mais qui n’apparaissaient plus que noirs de crasse et surchargés d’inscriptions. On avait tant bu d’alcool en s’appuyant contre eux, tant de fois des doigts graisseux s’étaient essuyés sur leurs angles qu’ils paraissaient suinter le rhum et l’eau de vie.
Par contre, des flaques régnaient, indéfinissables, croupissantes, amoncelant des détritus, bouts de pain, ronds de saucisson, débris de cervelas, dans le carrelage absent qui laissait des trous sous les pas.
Le comptoir était chétif, il tenait à peine la largeur de la pièce. En revanche, il y avait deux tables boiteuses énormes, calées par des bouchons, et devant lesquelles se trouvaient deux bancs sur lesquels il était imprudent de s’asseoir, car leur solidité les reléguait depuis longtemps à un simple effet décoratif.
La bande entra là-dedans comme chez elle.
En tête venait un individu qui sitôt pénétré dans la boutique tapait un grand coup de poing sur le comptoir.
– Oh là, le tôlier !… Ous’que t’es, patron de malheur ?
On entendit un grand vacarme, des bruits de sabots qui se traînaient sur le sol, une porte s’ouvrit, laissant pénétrer une épouvantable odeur de pourriture ; le propriétaire du cabaret sortait de sa chambre.
Lui aussi valait d’être vu.
C’était un abominable bonhomme qui pouvait bien compter dans les quatre-vingts ans. Il portait une grande calotte noire, crasseuse à l’infini, qui recouvrait entièrement son front. Il avait un visage rouge et perpétuellement congestionné. Sur son nez, écrasé en pied de marmite, deux paires de lunettes chevauchaient. La bouche était édentée, le menton en galoche.
Ce bonhomme ne portait pas de veston, il était en bras de chemise. Mieux valait ne point contempler le reste de son accoutrement qui se dissimulait, d’ailleurs, derrière un tablier bleu, fort vieux décidément, et qui n’avait jamais dû connaître les soins du blanchisseur.
Tel quel, le propriétaire de ce bouge s’avançait avec un sourire et demandait d’une voix chevrotante :
– Oh ! mais, voilà de la compagnie !… Et qu’est-ce que c’est donc qu’il faut vous servir ?
– La ferme, tôlier de malheur !… On s’compte !
Et le personnage qui avait heurté le comptoir dénombrait en effet des compagnons :
– Combien qu’on est ? demandait-il.
Et il énonçait à voix haute :
– La Puce… Adèle… Marie-Salope… la Godasse… et c’est tout… Aux mecs, maint’nant.
Il nommait toujours son monde :
– Moi, d’abord, Mon-Gnasse… Œil-de-Bœuf et Bec-de-Gaz… Dégueulasse et Fumier… Qui encore ? Ah… Ma-Pomme… Tiens, où est donc Bouzille ?
Bouzille avait été vu au départ, mais personne ne savait s’il avait réellement pris le train ou s’il était resté à Paris.
– Ça ne fait rien ! conclut Mon-Gnasse, Bouzille se retrouvera bien toujours !… De la graine comme ça, ça pousse tout seul !… Sûr’ment que l’bonhomme arrivera à ses cent ans sans qu’on l’aide à manger sa soupe…
Ayant cependant vérifié ceux qui l’accompagnaient, Mon-Gnasse se retournait vers le patron :
– Et alors, vieil idiot, commençait-il, qu’est-ce qu’il y a dans ta cambuse ?
Le patron du bouge semblait ahuri quelque peu. Il n’avait peut-être jamais vu une clientèle si nombreuse en son établissement.
– Il y a d’tout, mon bon monsieur, il y a d’tout !
– Bon ! riposta Mon-Gnasse. Il y a d’tout en trois bouteilles, alors, car ta bibliothèque a plutôt l’air mal garnie…
Puis sans consulter personne, car il connaissait bien les goûts de chacun, Mon-Gnasse commanda :
– Des mominettes pour tout l’monde ! Sans sucre pour les gonces et avec du fondant pour les juponnées… Allez, grouille, foutriquet !
Le patron du bouge, cependant, commençait à perdre littéralement la tête.
– C’est que… commença-t-il, je ne sais pas si…
– Attends, vieux fourneau, repartit Mon-Gnasse, tu vas voir si je te vas t’écraser les puces pour t’apprendre à faire subito !… Qu’est-ce que t’as ?
Mon-Gnasse achevait sa commande en la ponctuant d’une bourrade qui coupait en deux la respiration au chétif vieillard.
Cela fait, Mon-Gnasse revenait vers le milieu de la boutique, empoignant la Puce par les hanches, la soulevant en l’air, et la forçant à valser.
– Non, mais laisse-moi donc ! hurla la fille. T’es pas piqué, des fois ? Tu m’fais mal, eh ! veau !
– Bon, bon, j’ai rien senti ! rétorquait-il. Et puis, c’est pas tout ça, c’est l’printemps qui m’travaille, j’ai des fourmis dans les guibolles… Vive le sexe !…
Marie-Salope, précisément, s’occupait dans un coin à nouer son chignon, qui s’était défait. Cela mettait en gaieté Mon-Gnasse, qui était d’excellente humeur.
– Mince de tifs ! s’écriait-il. C’est ça qui f’rait d’la mèche pour mes lanternes quand j’marche à la cambriole !
Et il plaqua un gros baiser sur la nuque de la pierreuse, ce qui manqua immédiatement de déchaîner une dispute. La Puce bondit sur son homme.
– Non, mais, dégoûtant ! commençait-elle. Si c’est qu’tu veux plus d’moi comme femme, faut l’dire !
La Puce était furieuse et roulait des yeux terribles, cependant que, très flattée, Marie-Salope, qui n’appartenait à personne, étant un peu la femme de tout le monde, plastronnait avantageusement.
– Vas-y, Mon-Gnasse ! Fais-lui fermer l’bec… Non, mais, elle n’te f’ra pas peur, hein, mon homme ?
On crut qu’une dispute aller naître, mais, à ce moment, une diversion heureuse naquit par le fait du patron du bouge qui apportait sur la table quelques verres en compagnie d’une bouteille d’absinthe entamée.
Œil-de-Bœuf, immédiatement, commença une chanson bachique.
Plus pratique, Bec-de-Gaz reniflait la bouteille. Dégueulasse et Fumier, à ce moment, tournaient autour de la table en se menaçant de s’étriper.
– Attends voir, salaud, commençait Dégueulasse qui fuyait devant Fumier. Attends voir un peu que j’m’en vas t’laisser mon absinthe ! Plus souvent qu’tu la licherais à ma place. J’aimerais mieux m’en extirper le nombril !
Il y eut des explications orageuses, on comprit enfin le motif de la querelle.
Dégueulasse et Fumier avaient joué le matin même au dé la tournée du soir. Il s’était trouvé que Fumier avait gagné, il venait de rappeler la chose à Dégueulasse, et il émettait la prétention de boire les deux absinthes. Naturellement, Dégueulasse protestait avec énergie.
Ma-Pomme, heureusement inspiré, trouva le mot de la situation.
– Eh, fichez-nous la paix ! commença-t-il. Y en aura pour tout le monde ! D’accord, c’est pas soi qu’on paye.
Ma-Pomme s’avançait beaucoup. Il avait pris la bouteille d’absinthe en main, il remplissait les verres, que l’on s’était répartis. Ma-Pomme n’était pas chiche d’absinthe. Il n’aimait, pour sa part, que les mominettes bien tassées, les purées épaisses, il servait royalement.
Or, comme il emplissait le quatrième verre, il arriva que la bouteille d’absinthe était vide.
– Hé ! tôlier ! cria Ma-Pomme, rapplique voir ici, cousin d’andouille… Une aut’bouteille !
Le patron du mastroquet blêmit en tordant ses mains sèches.
– Mais je n’en ai pas, mon bon monsieur… J’vous ai donné tout c’que j’avais… Voulez-vous de l’orgeat ?
Alors une dispute formidable éclata. Ma-Pomme et Mon-Gnasse secouaient le bonhomme, l’un le tirant à droite, comme l’autre le poussait à gauche.
Ils n’étaient pas dupes de la déclaration. Le patron du bouge, qui ne les connaissait pas, devait être inquiet sur le paiement des consommations. C’était pour cela qu’il prétendait n’avoir rien d’autre, car il était inadmissible qu’en pareil endroit il n’y eût en vérité qu’une demi-bouteille d’absinthe…
– Toi, mon vieux, proposait Mon-Gnasse, je t’offre deux choses au choix : ou tu vas déballer de la marchandise, ou j’te saigne comme un lapin !
Œil-de-Bœuf était tout aussi explicite :
– On va la crever, la bourrique ! tonnait-il.
Ma-Pomme, de son côté, avait trouvé un divertissement plaisant. Pour faire rire Marie-Salope, qui était secouée d’ailleurs d’un irrésistible accès de gaieté, il était passé derrière le patron du bouge et il lui flanquait une dégelée de coups de pied très bas placés dans le dos.
Abruti, le pauvre homme avait des contorsions effarantes.
– Ou's qu’est ta cave ? répétait inlassablement Ma-Pomme.
Et chaque question s’accompagnait d’un coup de pied.
À ce moment, une nouvelle discussion s’éleva dans le bouge.
Ça, c’était plus fort que tout… C’était à dégoûter des hannetons… à faire fuir des punaises, à faire avorter des cancrelats !
Dégueulasse et Fumier ne venaient-ils pas de commettre une véritable infamie ?
Les deux compagnons, qui se disputaient un moment plus tôt pour savoir qui boirait l’absinthe perdue le matin au zanzibar, s’étaient brusquement raccommodés en effet. Ils n’avaient plus fait de bruit, mais ils n’avaient pas perdu leur temps.
S’ils avaient cessé, en effet, de vouloir s’assassiner, c’était tout bonnement qu’ils avaient avisé les absinthes déjà versées dans les différents verres et qu’avec une gloutonnerie rapace, ils en avaient fait justice.
– Eh bien, c’est du propre ! hurlait Adèle très excitée. Et c’est d’la bonne copinerie !… On s’en fout, des poteaux, n’est-ce pas ? Ils peuvent s’serrer la ceinture, et boire, s’ils ont soif, du cru de la fontaine !… Non, mais, y aura donc pas un homme pour leur en fout’une flopée à ces cocos-là ?
À ce moment, et comme le vacarme devenait assourdissant dans le bouge, une voix grave ordonna :
– La paix !
Et comme par enchantement, chacun se tut. Un silence profond régna, entrecoupé seulement par les hoquets époumonés du malheureux patron qui se frottait avec conviction, car le soulier ferré de Ma-Pomme l’avait cruellement molesté.
– La paix !… Asseyez-vous !
Personne ne rechigna, on s’assit. L’homme qui parlait s’était lui-même attablé dans l’ombre. Il avait posé devant lui un coffre, il promenait sur l’assistance un regard courroucé. Brusquement, il éclata en colère :
– Vraiment, déclarait-il, j’ai honte de vous, et je regrette de vous connaître ! Jamais on ne vous décrassera ! Jamais on ne vous fera comprendre que votre conduite est stupide !… Ce n’est pas agissant comme vous le faites, à la façon de rôdeurs imbéciles, que vous parviendrez jamais à quelque chose ! Vous êtes du gibier de prison, voilà tout… Pas un de vous, peut-être, ne finira grand ouvrier. Je vous renie !
La bande tremblait, ne soufflait mot. On n’osait point même regarder celui qui parlait ainsi, à peine chuchotait-on son nom, sur un ton de respect et d’effroi à la fois :
– Fantômas !… Fantômas !… C’est lui ! C’est Fantômas !…
C’était bien Fantômas, en effet.
Le bandit, probablement désireux de dépister la police, avait donné rendez-vous à toute sa bande à Robinson, indiquant le modeste bouge qu’il connaissait comme lieu de réunion. Il était entré au milieu du vacarme, il avait assisté aux querelles. Maintenant qu’il avait forcé chacun à se tenir tranquille, il continuait à promener un long regard sur ceux qui l’entouraient.
Dans le regard de Fantômas, on devinait alors comme un véritable dédain, comme un cinglant mépris.
Assurément, l’énigmatique tortionnaire, le Maître de l’effroi, le Roi de l’épouvante et du crime, n’était pas de cette race-là. Il n’avait rien de commun avec la canaille dont il se servait parfois.
Ces gens pouvaient être des complices, ils ne seraient jamais des amis, des confidents…
Un froid sourire passa sur le visage de Fantômas, cependant que, d’un air infiniment las et véritablement écœuré, il haussait les épaules.
Fantômas alors appela :
– Le patron de l’établissement !
– C’est moi, déclara l’humble mastroquet.
Fantômas ouvrit son coffre, prit quelque chose à l’intérieur, il dit encore :
– Avance, bonhomme ! Prends cela et va-t-en ! Tu n’as rien vu, tu n’as rien entendu, tu ne nous connais pas !
Avec un geste rapace, le vieillard avait déjà saisi ce que lui tendait Fantômas.
Ses doigts noueux, qui tout à l’heure encore tremblaient, avaient en réalité brusquement retrouvé une souplesse extraordinaire. Sa voix ne chevrotait plus d’ailleurs, tandis qu’il se courbait en révérences.
– Ah, merci bien ! disait-il, tu es bien toujours le même… Merci, merci… Je ne savais pas que c’était des amis, vois-tu, sans quoi… Mais ça n’as pas d’importance, je ne sais rien, ah non, je ne sais rien, je ne saurai jamais rien !
Et il s’éloignait, traînait ses galoches, en multipliant les courbettes.
Fantômas, cependant, avait tiré de sa poche un portefeuille et il étalait sur sa table, devant lui, un grand papier qu’il consultait du regard.
– Voici, déclara le bandit, je paye.
Et comme un frémissement semblait galvaniser tous les apaches réunis dans le bouge, Fantômas poursuivait avec sa coutumière tranquillité :
– Les comptes ne sont pas compliqués, d’ailleurs. À chacun selon son dû. Les femmes ont droit à dix louis, sauf la Puce qui a fait le guet aux Invalides et qui aura pour cela une gratification de cinq louis supplémentaires… Œil-de-Bœuf et Bec-de-Gaz ont à peine travaillé, voilà quinze louis pour eux. Dégueulasse et Fumier ont fait merveille, cinquante louis… Je tiens à récompenser Ma-Pomme qui, récemment, s’est distingué, lui aussi, vingt louis pour lui… Je ne dois plus rien. Mais…
À l’instant où Fantômas avait dit : « Je ne dois plus rien », des sourcils s’étaient froncés. On escomptait plus, on trouvait qu’il était chiche.
Or, Fantômas ne laissait pas le temps au mécontentement de s’exprimer. Il tirait du coffret qu’il avait placé devant lui une nouvelle poignée de pièces d’or, il ajoutait :
– Mais, les comptes faits, je tiens à ce que vous soyez, les uns et les autres, sages… Je ne veux pas d’aventures en ce moment. Voilà de l’argent pour que vous soyez tranquilles, prenez !
Et alors, dans l’étroite guinguette, ce fut un spectacle fantastique. L’un après l’autre, Fantômas appelait les apaches, il prenait alors dans sa cassette, par poignées, des louis d’or de vingt francs. Il les remettait sans compter à ses complices.
– Empoche, toi, va-t’en !
Et ce fut, dans la pièce sombre, comme un rutilement extraordinaire, comme une débauche d’or…
Des louis tombaient à terre, avec un tintement joyeux. Ils roulaient sur le sol et les misérables, éblouis, les mains pleines, dédaignaient, avec des airs de grands seigneurs, de les ramasser.
– Ça s’ra pour l’garçon, disait Marie-Salope qui enfouissait sa part dans ses bas.
Ils avaient tous à ce moment les poches pleines, ils se regardaient avec des airs béats, rêvant déjà des noces prochaines, des saouleries certaines qu’ils allaient assurément s’octroyer, des caprices qu’ils se passeraient.
Précisément, le patron du cabaret rentrait. Il connaissait évidemment Fantômas, mais Fantômas à coup sûr, désireux de se ménager ses faveurs, de s’assurer aussi de sa discrétion, l’avait royalement payé. Le bonhomme qui avait peut-être, lui aussi, ses raisons d’être aimable, reparaissait, portant trois bouteilles pleines d’absinthe.
– Voilà, voilà, commençait-il, j’en ai retrouvé !…
Il n’avait pas posé les litres sur la table que tous se bousculaient vers eux…
– Ah ! ça, c’est fameux, par exemple, grommelait Œil-de-Bœuf. Quelle biture qu’on va s’envoyer !
Mais Fantômas intervenait encore :
– Halte ! leur ordonnait le bandit.
Et comme un piqueur qui, brandissant son fouet, arrête la meute aboyante à l’heure de la curée, Fantômas, le bras tendu, immobilisait ses compagnons.
– Pas un de vous ne boira ici ! ordonnait-il. Ma parole, si je vous laissais faire, vous seriez gris dans cinq minutes et bavards dans une heure… Dehors, vous tous, je ne veux même pas que vous rentriez ensemble… Allez, les uns à droite, les autres à gauche. Vous vous saoulerez ce soir s’il vous plaît, brutes que vous êtes, mais vous le ferez quand vous serez loin et quand vous ne pourrez pas me compromettre…
Il y eut de sourds grognements, des jurons étouffés, des protestations coléreuses.
C’était assommant, à la fin, avec Fantômas, c’était pire que dans un couvent ! On ne pouvait pas seulement bosser un quart d’heure tranquille… On avait la langue d’amadou, et il vous empêchait d’licher ! C’était pas Dieu possible !
Mais tout cela se disait à voix basse, sournoisement. Nul n’eût osé braver le Maître en face, nul n’eût osé lui désobéir.
Le regard de Fantômas, d’ailleurs, ne permettait pas aux autres de le fixer.
La force du bandit, la mystérieuse autorité qu’il exerçait si facilement, l’ascendant irrésistible qu’il prenait sur tous résidait peut-être même en ce regard, ce regard extraordinaire, perçant, volontaire, qui n’autorisait aucune discussion, qui forçait tous les yeux à se baisser.
– Dehors ! répétait Fantômas. Allez vous-en !
Ils partirent les uns après les autres. Dégueulasse et Fumier se hâtaient vers la gare, avides de retourner à Paris où ils iraient tout de suite s’enfermer dans un caveau des Halles pour tirer une bordée colossale.
Œil-de-Bœuf et Bec-de-Gaz, eux, décidaient tout d’abord d’aller danser un peu dans un des bals de l’endroit. Cela n’empêchait pas, parbleu, de vider trois ou quatre bouteilles ; ils emmenaient Marie-Salope et Adèle.
Sans mot dire, la Puce et Mon-Gnasse descendirent vers le tramway qui se dirigeait vers Montrouge.
Pour Fantômas, il sortait le dernier, s’enfonçait dans les bois. Il avait murmuré deux mots à l’oreille du patron du bouge, et celui-ci, resté seul, à genoux, riant d’aise, promenait désormais dans la salle ses mains crochues, repêchant de temps à autre, enfoui dans les détritus, un louis d’or dont il éprouvait l’authenticité en le mâchant immédiatement du bout des dents !
Deux heures plus tard, la Puce et Mon-Gnasse se trouvaient sur les boulevards extérieurs à la hauteur des Entrepôts, au coin de la rue de Flandre, tout juste à l’endroit où se tenait une fête foraine dont les orgues et les chevaux de bois causaient un véritable tintamarre.
La Puce était grise et Mon-Gnasse était amoureux.
– T’es rien gironde, ma poule, disait tendrement l’apache à sa maîtresse. Ah ! c’est pas pour dire, mais dans Pantruche, y en a pas beaucoup encore qui te f’raient la l’çon…
Ils allaient de baraque en baraque. L’or qui tintait dans leurs poches semblait les embarrasser, il les grisait au moins autant que les liqueurs qu’ils avaient absorbées. La Puce voulait tout voir ; elle avait fait six tours de chevaux de bois, elle avait tiré à la carabine, elle était entrée, poussant des éclats de rire énervants, dans une baraque où l’on admirait la femme chameau. De là, elle s’était précipitée dans une boutique de charcuterie, où, sur un pari de Mon-Gnasse, elle avait avalé du boudin cru. Par là-dessus, elle avait d’ailleurs dévalisé un marchand de pain d’épices, et son corsage s’ornait de quatre cochons roses sur lesquels le prénom de Mon-Gnasse avait été dessiné avec du sucre fondu.
– Ah ! c’que c’est chouette !… Ah ! c’que c’est bath !… C’qu’on rigole !…
La Puce dansait le cancan, cependant que Mon-Gnasse, qui avait le vin sentimental, s’arrêtait à tout bout de champ pour l’embrasser et pour lui proposer de l’épouser.
– Tiens, on f’ra ça d’main, disait-il, rien que pour voir la gueule des poteaux… M. l’maire, qu’on l’y dira, au bonhomme qu’a l’ruban en travers, M. l’maire, c’est pas la peine de faire du chichi !… Puisqu’on est ensemble, on s’marie ; c’est rapport à c’qu’on a des sous, maint’nant ! Tu veux, dis ?
Mais la Puce voulait tout autre chose. Contre les arcades du métropolitain, elle venait précisément d’apercevoir une baraque qui la faisait se pâmer d’aise.
– Ah ! ça, c’est rien farce ! hurlait-elle. J’veux y entrer ! Mène-moi là !
L’écriteau annonçait : Manège des Puces savantes.
Il était évidemment tout indiqué que la maîtresse de Mon-Gnasse allât voir celles dont elle usurpait le nom.
– Des puces savantes ! s’exclamait-elle. Non mais des fois !… Elles vont p’t’être me donner des conseils pour mieux y faire !
Elle lançait des regards langoureux à Mon-Gnasse qui la serrait de plus en plus.
Ils entrèrent dans la baraque. On n’y voyait pas très clair. Mon-Gnasse, qui perdait la tête et commençait à parler de radiner vers la tôle, histoire de voir si l’plumard n’avait pas déménagé, embrassa la Puce.
– T’es rien chouette ! disait-il.
Juste à ce moment, la Puce et Mon-Gnasse sursautèrent. Ils venaient, l’un et l’autre, de se sentir empoignés par le bras.
En même temps, deux voix rudes murmuraient :
– Allons, pas de scandale… Suivez-nous de bonne grâce, ou l’on vous colle le cabriolet !
Évidemment, on les arrêtait. Mon-Gnasse, de stupéfaction, voulut protester.
– Non, mais, de quoi ? protesta-t-il. Je l’embrasse, c’est vrai, mais ça r’garde personne… Le pape pas plus qu’un autre… C’est ma gerce, d’abord, et si j’veux, elle s’ra ma femme demain !
On ne lui répondait pas, et Mon-Gnasse, qui prétendait connaître le Code, insistait de plus en plus :
– J’l’embrasse, quoi… c’est pas défendu ! J’vous défie bien d’jacter l’contraire ! Le baiser, c’est permis, c’est pas des attentats !
L’un des deux hommes qui entraînait le couple au-dehors, sans que d’ailleurs personne ne parût s’émotionner parmi les admirateurs des puces savantes, finit pas déclarer sur un ton d’impatience :
– Mais ce n’est pas pour cela qu’on vous arrête…
– C’est pourquoi, alors ? demanda Mon-Gnasse… Non, mais, c’est pourquoi ?
L’ivresse aidant, il pleurait maintenant à grosses larmes, il était très doux mais il s’entêtait :
– C’est pourquoi ? J’voudrais l’savoir… Justement qu’on était aux oignons ce soir, qu’on f’sait douc’ment les amoureux, et v’là qu’on nous poisse !… M’sieur l’agent, c’est pourquoi qu’on m’arrête ?
L’agent appelait un fiacre, on y poussait les deux apaches :
– À la Sûreté ! commandaient les inspecteurs.
Et comme Mon-Gnasse s’entêtait à demander pourquoi on l’arrêtait, l’agent, brusquement, finit par lui répondre :
– Eh ! parbleu, tu le sauras demain ! C’est pas pour avoir fait des pieds-de-nez aux moineaux, bien sûr !…
Mon-Gnasse ne devait pas en apprendre davantage ce soir-là.
XIV
Bavardages
Nerveusement, M. Havard, qui, ce matin-là, se trouvait seul dans son bureau, rangeait les pièces à conviction dans les dossiers, toute la série de documents qui paraissaient encombrer sa table de travail, et qui, en réalité, venaient de lui servir pour expédier une première enquête fort troublante.
M. Havard s’était mis sur son trente et un. Lui qui, d’ordinaire, traînait d’un bout de l’année à l’autre un chapeau haut de forme cabossé, un veston éculé, des pantalons qui faisaient des poches aux genoux, lui qui se moquait pas mal d’être bien habillé, avait, ce matin-là, revêtu un complet tout battant neuf, ce qui l’impressionnait lui-même et parfois le contraignait à se regarder d’un coup d’œil furtif dans la glace ornant la cheminée.
M. Havard s’était rasé de frais. Il avait soigneusement peigné ses cheveux, sa raie était parfaitement droite, et ses manchettes elles-mêmes étaient immaculées.
Cela annonçait quelque chose, et cela l’annonçait d’autant plus qu’il n’était pas davantage dans ses habitudes de mettre de l’ordre dans son bureau, de veiller à ce que rien ne traînât, de prendre enfin grande attention à ce que la pièce fût dans un état parfait.
Que se passait-il donc ?
De temps à autre, le chef de la Sûreté tirait sa montre, vérifiait l’heure, puis se frottait les mains.
– Voyons ! murmurait-il. Tout est-il bien ?… Oui. Alors, ils peuvent venir…
Et l’examen rapide qu’il passait de lui-même et de ses appartements devait assurément le rassurer, car M. Havard se répondait à lui-même avec un air de satisfaction étalé sur son visage :
– Vraiment, tout est très bien !
Au bout de quelques minutes, M. Havard appuyait sur un timbre placé sur son bureau.
Immédiatement, un huissier parut. C’était un vieux bonhomme qui était depuis de longues années attaché au cabinet du chef de la Sûreté. Il ne prenait jamais rien au tragique, était toujours souriant et accomplissait son service avec une négligence apparente qui ne l’empêchait point d’être au fond très ponctuel.
L’huissier accourait, tenant, sans même le dissimuler, un journal à la main. Il était évidemment occupé à lire lorsque le timbre l’avait arraché à ses loisirs.
Voyant cela, M. Havard ne se retint pas de froncer les sourcils.
– Cuche, jetez-moi ce journal ! ordonnait-il. On n’a pas idée de lire comme ça dans les antichambres !… Vous faites bien mal votre service !
L’huissier Cuche, à cette réprimande, ouvrait des yeux extraordinaires. Il n’avait pas l’habitude de recevoir des reproches, et celui-ci, entre autres, lui paraissait complètement injustifié.
Il y avait bien vingt ans en effet que Cuche occupait la petite table placée dans le couloir, et depuis vingt ans Cuche lisait le journal ostensiblement du matin au soir sans que jamais on eût trouvé ça mal, sans que jamais M. Havard se fût formalisé de la façon dont il occupait son poste.
Le chef de la Sûreté pourtant continuait :
– Et qu’est-ce que c’est que ce gilet déboutonné ? En vérité, vous vous moquez du monde ! Ma parole, c’est à se demander à quoi vous pensez ! Fermez donc votre gilet, Cuche !
Cuche, de plus en plus abasourdi, donna satisfaction à M. Havard, ce qui n’était pas sans mérite pour lui, car il possédait une grosse bedaine et n’aimait pas à être serré.
M. Havard, cependant, continuait à dévisager l’huissier.
– Vous me ferez le plaisir, commandait-il, de mettre en ordre également votre table dans le couloir. Je lui ai jeté un coup d’œil en passant, c’est inimaginable de voir dans quel état vous laissez ça !
Cuche roulait toujours des yeux effarés, se demandant d’où venait l’énervement de M. Havard. Il hasarda :
– Oui, monsieur le chef, je ferai cela ce soir.
Or, à ces mots, M. Havard sursauta :
– Ce soir ! disait-il, jamais de la vie ! Vous allez me faire le plaisir de faire ça tout de suite, immédiatement… Je veux que dans dix minutes il n’y ait plus rien qui traîne. Vous m’avez entendu ?
Cuche avait entendu mais ne comprenait pas.
Il fut brusquement renseigné.
– Parbleu ! continuait M. Havard, nous n’allons pourtant pas recevoir le ministre de l’intérieur et le ministre de la Justice dans un service abominable ! J’entends que rien ne cloche !
À ce moment, le visage de Cuche exprima une soudaine satisfaction.
– Ah bon !… Très bien ! fit-il d’une voix de surprise contentée. Je comprends, maintenant… Il y a le ministre qui vient… Ah ! parfaitement !
L’exclamation de Cuche était si naturelle que M. Havard lui-même ne put se retenir de sourire.
Cuche était un philosophe. Cuche ne s’était pas formalisé de ses réprimandes. Cuche, désormais, comprenait à merveille leur motif et trouvait tout naturel qu’on exigeât de lui des soins et des précautions auxquels il n’était pas habitué.
M. Havard conclut tout cela de l’exclamation de l’huissier.








