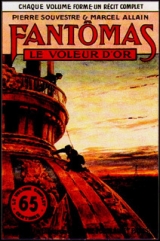
Текст книги "Le Voleur d'Or (Золотой вор)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Justement, le numéro quatre revenait, traînant un seau plus lourd que lui et s’apprêtant à aller donner à manger aux lapins que le ménage Martin élevait.
– Tenez, c’morveux-là… continuait le père Martin en désignant le gosse du doigt. Précisément, c’est pas un gosse de l’Assistance, il est à trente francs de pension, ici. Eh bien ! c’est l’diable pour arriver à avoir les thunes de sa mère… Oh ! mais, aussi, ça ne va pas durer comme ça !
Le facteur pâlit un peu, car il croyait deviner chez son interlocuteur quelque lugubre projet.
– Vous allez… ? demandait-il.
Mais le père Martin lui coupa la parole.
– Non, pas avec les gosses de bourgeois. Ça fait des ennuis et il n’y a pas de combine… Tout simplement, je m’en vais le rendre à sa mère, celui-là… si elle ne raque pas !
Le facteur, cependant, avait soulevé sa boîte pour rejeter la courroie sur ses épaules.
– Eh bien ! bonne chance ! souhaitait-il. Moi, faut que je m’en aille, j’ai ma tournée…
– Comme de juste ! approuva le père Martin. Chacun ses embêtements !
Et, à l’instant où le facteur s’éloignait, le père Martin appelait :
– Le un !… le deux !… Où diable êtes-vous, vermine ? Arrive ici, numéro six !
Le père Martin habitait une sorte de baraquement tenant de la maisonnette et de la ferme de campagne. Cela ne comportait qu’un étage, était sale à faire frémir. La porte ouverte laissait s’exhaler des odeurs de boue, de crasse et de victuailles mal cuites. Tout autour de la maison, et close par une grande haie, se trouvait une sorte de courette dont le sol, fait de terre battue, était défoncé par endroits, ce qui faisait que les eaux de pluie stagnaient, verdissaient, croupissaient en paix. Des canards barbotaient dans ces flaques, des poules picoraient à droite et à gauche, tout un peuple de bêtes se sauvait en poussant des criaillements effarés dès qu’apparaissait le père Martin.
Aux appels de celui-ci, cependant, une série de bambins étaient arrivés. Ils sortaient on ne savait d’où, des coins les plus extraordinaires. Tout leur paraissait bon, en effet, pour devenir une cachette, un endroit tranquille où se terrer, de façon à éviter le plus possible les taloches et les coups de pied dont ils étaient incessamment gratifiés.
Le père Martin les examina d’un coup d’œil et tout de suite s’emporta :
– Alors, quoi, faisait-il, il suffit qu’on cause deux minutes pour que vous vous débiniez tous !… Ah ! mais… j’en ai assez, moi, à la fin !… Si vous ne voulez pas gratter, sûr que les verges vont parler !…
Et après une pause destinée à laisser comprendre sa menace, menace qui était fréquente d’ailleurs et que souvent il exécutait, le père Martin continuait :
– Allez, vermine !… Grouillez, nom d’un chien ! Faut que dans une heure ça soye épluché…
Il occupait les gosses à écosser des petits pois qui étaient livrés ensuite à une fabrique de conserves.
Les pauvres enfants, du matin au soir, devaient travailler. Les inspecteurs de l’Assistance n’avaient évidemment rien à redire à cette besogne qui paraissait douce et bien appropriée à la force des bambins ; ils ne se doutaient pas que ceux-ci y étaient astreints de cinq heures du matin à six heures du soir et que ce perpétuel labeur devenait horriblement fatigant, abêtissant même, pour leur jeunesse privée ainsi de toute récréation.
À l’ordre du père Martin, cependant, tous les petits pupilles s’étaient précipités vers un tas de cosses pleines qui se trouvaient à quelque distance, jetées sur le sol, devant une bassine où l’on mettait les petits pois préparés.
Ils s’agenouillaient dans la boue et travaillaient avec ardeur. Le père Martin approuva d’un signe de tête, redressa d’un coup de pied un gosse qui paraissait ne pas aller assez vite, puis il appelait encore :
– Numéro quatre !
Celui-ci revenait précisément, traînant son seau vide, ayant soigné les lapins.
En s’entendant nommer, instinctivement, il levait son bras à la hauteur de son visage, se gardant bien d’approcher davantage.
– Où est la mère ? demanda le père Martin.
Le gosse, qui tremblait, eut un air d’ignorance.
– Je ne sais pas, patron… derrière la maison, je crois…
– C’est bon, au turbin !
Le numéro quatre rejoignit ses compagnons et entama le tas de petits pois.
Le père Martin, cependant, appelait à pleins poumons :
– Eh là… toi, ma femme !… Ous’que t’es ?
Un grognement parvint, on entendit le bruit de galoches traînées sur le sol, au coin de la maison une grosse femme apparut.
C’était la mère Martin.
Elle pouvait avoir une quarantaine d’années et, certes, la gourmandise devait être son péché mignon, car perpétuellement elle avait la bouche pleine et mâchonnait quelque chose.
Blonde décolorée, les yeux éteints, la bouche tordue, elle était sale à faire frémir et sentait le vin à dix mètres. Sa voix avait quelque chose d’éraillé, de cassé, d’ignoble, les gosses la craignaient plus encore que son mari.
– Quoi que tu veux ? fit la femme.
Le père Martin entrait dans la maison.
– Aboule !… J’ai à te parler !
La mère Martin continua d’avancer, gifla au hasard l’un des petits travailleurs, puis pénétra à son tour dans la pièce basse de la maison.
– Quoi que tu m’veux ! répétait-elle.
Le père Martin était debout devant une sorte de placard dont sa femme gardait la clé.
– Donne des sous ! demandait-il.
– Pour quoi faire ?
– Ça te r’garde ?
– Probable, mon vieux !
Le père Martin ne résista pas plus longtemps. Il savait aussi bien que sa femme ne lui donnerait pas cinquante centimes s’il n’en justifiait point l’emploi. Elle était encore plus avare que lui, plus grippe-sou, s’il était possible, ne se montrant généreuse que lorsqu’il s’agissait d’aller chez le marchand de vin ou encore d’acheter à l’épicier quelque douceur qu’elle goinfrait en cachette pour ne pas avoir à amoindrir sa part en faveur de son mari.
– Eh bien, voilà ! commença le père Martin. C’est rapport au numéro quatre… J’en ai assez du fils Poucke !… J’suis d’avis qu’on l’sème…
La mère Martin hocha la tête, hésita :
– Dame, fit-elle, c’est selon… C’est qu’il est à quarante francs par mois, ici !…
– À trente ! rectifia le père Martin.
La mégère se mordit les lèvres, elle venait de faire une imprudence. La pension du numéro quatre était bien de quarante francs par mois, mais elle ne la comptait qu’à trente francs à son mari. Les dix francs de supplément filaient régulièrement chez le mastroquet voisin.
– Bon, bon, ça va bien ! fit-elle. Trente ou quarante, c’est la même chose !… C’est toujours mieux que les autres !…
– Si ça payait, oui, fit le père Martin.
Et, brusquement, sa colère crevait dans un flot de paroles, dans une série d’imprécations.
– Aussi, c’est vrai, disait-il, je ne sais pas qu’est-ce que t’as dans l’ciboulot pour ce morveux-là, mais j’peux pas t’décider ! C’est trente balles que tu dis !… Avec ça, que c’est trente balles !… Quand c’est-y qu’on touche ?… À la saint Tralala !…
Et, décochant à la table un coup de poing qui la faisait trembler, le père Martin jurait :
– Moi, nom de Dieu ! j’en ai marre, de ce morveux-là ! Des gosses comme ça, y ne m’en faut plus !… Et si tu veux mon opinion, la mère, eh bien, le fils Poucke, on le rendra à ses auteurs…
– On perdra trente francs, fit sentencieusement la mère Martin.
Mais le père nourricier n’admettait pas la réplique.
– Ta bouche ! faisait-il. Et d’abord, comptons voir : combien que t’as touché, ce mois-ci ? Zéro… Et le mois d’avant ? Zéro encore… Et l’aut’mois ? Vingt-cinq francs tout juste… Tiens, veux-tu que j’te dise ? Eh bien, on est des gourdes, de l’avoir gardé si longtemps, le mômignard !… Faut l’renvoyer, et illico ! S’il était parti, on en aurait eu un autre de l’Assistance et à quinze francs par mois, ça ferait tout juste six thunes qu’on aurait de plus dans l’portefeuille.
La mère Martin n’osait pas répondre.
En réalité, son mari eût eu un raisonnement fort juste si celui-ci n’était point parti d’une donnée absolument fausse. En réalité, on avait toujours payé, en effet, et fort régulièrement, les mois de nourrice. Seulement, la mère Martin avait eu l’idée, mise en goût par un premier mensonge, d’escamoter ces mois à son homme.
Or, voilà que ça tournait mal. Furieux de n’avoir pas été payé, le père Martin voulait rendre le gosse !… Ça, c’était vraiment un détestable projet ! La mère Martin se sentait toute chose en y pensant. Trente francs qu’elle aurait à dépenser en moins ! Vingt sous par jour qu’elle ne licherait plus… Ah ! non, elle ne pouvait pas admettre ça !
La mégère, d’autre part, n’avait nulle envie d’avouer à son mari qu’elle avait escamoté les mois de nourrice. Le père Martin, en effet, n’aimait point les discussions et ne perdait jamais son temps en querelles ou en criailleries. Elle savait d’avance quelle conduite il tiendrait : dans un coin il y avait une trique qu’il prendrait, et sûrement elle attraperait une roulée formidable qui lui apprendrait, pour l’avenir, à ne point dissimuler les recettes du ménage.
Pourtant, la mère Martin ne pouvait pas se résigner. Elle voulut tergiverser encore :
– On pourrait peut-être écrire à la mère ? proposait-elle.
Mais son homme ne voulait point accepter ce projet.
– Oui, faisait-il. Pour perdre les deux sous de timbre et toucher des nèfles !… C’est encore une idée, cela !
Et il devenait encore plus brusque.
– Allez, j’avance des sous ! J’te dis que j’ai mon projet… J’prends l’gosse par la peau du cou, je le rapplique à sa maman, je lui dis : Voilà l’gamin, faut m’payer ou je le laisse !
Et le père Martin riait, se frottait les mains.
– Alors, disait-il, de deux choses l’une : ou la mère raque et je ramène le morveux, ou bien elle ne raque pas et je lui laisse… Demain, on en aura un autre de l’Assistance. Non, mais des fois !… J’suis pas chargé de l’élever, le fils Poucke !
Et il riait, il riait même de bon cœur, étant à cent lieues de se douter des angoisses de sa femme.
Celle-ci, toutefois, se décidait :
– Bon, fit-elle, j’vas te donner de quoi radiner jusqu’à Paris. Débrouille-toi, après tout ! P’têt’bien que la mère raquera, p’têt’bien même que c’est les mandats qui n’arrivaient pas, car enfin, jusqu’à y a trois mois, elle payait régulièrement.
La mère Martin lançait cela d’un ton doucereux, sans insister, avec l’espoir que son homme s’y tromperait, et que cela fournirait, pour plus tard, une base d’explication.
Péniblement, elle ouvrait le fameux placard, prenait une thune qu’elle remettait à son mari.
– Tu pars maintenant ? demandait-elle.
– Et comment !… J’m’en vais pas moisir !… Fais l’ballot et je l’porte.
Le ballot n’était pas difficile à faire. En quelques instants, la mère Martin eut plié dans un grand tablier les quelques affaires qui appartenaient au gosse, elle remit le tout à son mari.
– Voilà, déclarait-elle. Mais tâche tout d’même de le ramener. Après tout, quand elle payait, la mère, c’était pas une si mauvaise affaire que ça !…
Le père Martin ne répliquait pas. Déjà il était dans la cour, déjà il appelait :
– Numéro quatre, arrive ici !
Une demi-heure plus tard, le numéro quatre avait quelque peu changé d’aspect. Chose qui n’arrivait que bien rarement, on l’avait à peu près peigné, lavé, on avait même poussé le soin jusqu’à s’assurer qu’il avait des bas et que ses souliers comportaient des lacets.
– Radine, maintenant, mômignard ! commandait le père Martin, qu’on te rapplique à ta daronne…
Ils prirent le tramway, descendirent à la barrière de Paris, et le père Martin commença par aller boire un verre.
Il y a loin, cependant, de la barrière du tramway à Montmartre où habitait précisément Paulette de Valmondois, c’est-à-dire la fille Poucke, mère du petit Gustave.
Le père Martin pensa n’arriver jamais. Le gosse trottinait à ses côtés, mais se mourait de fatigue et il n’avançait pas. Il pleurait tout le temps.
– Sale môme ! grondait le père Martin. En voilà un chignard !… On peut même pas cogner dessus, il chiale à la minute !
Place Saint-Michel, cependant, malgré son avarice extrême, le père Martin se fendit d’un omnibus. Il pleura mentalement, lui aussi, sur les six sous qu’il fallait dépenser encore, mais une demi-heure plus tard il arrivait à Montmartre, non sans satisfaction.
– Maintenant, pensait le père Martin, s’agit voir à voir à trouver un moyen de se débrouiller !… Sûrement que ça ne sera peut-être pas commode, mais, tout de même, ça doit pleuvoir des sous, cette histoire-là !
Le père Martin, en effet, n’avait confié à sa femme que la moitié de ses projets. Il avait bien l’intention d’abandonner le gosse si la mère ne voulait point raquer, mais il gardait l’espoir qu’elle raquerait, et gros encore !
– Je m’en vas m’faire bonnasse, pensait-il, je lui dirai comme ça qu’on s’est attaché à son fiston, qu’on veut bien l’garder encore, mais qu’y faut qu’elle donne un louis de plus. Ce louis-là, parbleu, la mère, elle n’en saura rien !…
Le père Martin, en somme, tout comme sa femme, avait bien l’intention de faire délicatement sauter le plus d’argent possible et de profiter de son voyage à Paris pour s’amuser un brin.
Rue Blanche, cependant, le nourricier devait déchanter. Il se heurtait, en effet, à une concierge qui n’avait pas l’air commode.
– Voilà ! expliquait Martin. C’est rapport à c’gosse-là que j’viens. C’est bien ici qu’habite M me Poucke ?
La concierge considérait Martin avec des yeux étonnés.
– M me Poucke ? disait-elle, on n’a pas ça dans la maison…
Alors Martin se frappa le front d’un air d’intelligence.
– Ah mais, c’est vrai ! reprenait-il, je m’gourre… on m’a donné un aut’nom, attendez voir…
Il sortit de sa poche un carnet crasseux, il mouilla son doigt, feuilleta longuement les pages. Soudain, il tressaillit de satisfaction.
– Ah, voilà !… fit-il. Pardon, erreur, excuse… C’est moi que j’me gourrais en effet. C’est pas M me Poucke que j’viens voir, c’est une dame Paulette, Paulette de Valmondois.
La concierge, cette fois, parut fort intéressée.
– Tiens ! fit-elle, curieusement. Pourquoi alors que vous l’appeliez Poucke ?
– Parce que c’est le nom de son gosse, fit le père Martin. La dame nous a prévenus, rapport à la déclaration. Mais elle… c’est pas Poucke, qu’elle s’appelle, c’est Valmondois…
Et il disait cela en riant, l’air amusé, tout gaillard à la pensée qu’évidemment M me de Valmondois s’appelait Poucke en réalité et qu’elle avait pris un nom de guerre.
La concierge, de son côté, examinait le gosse avec des airs intéressés, des regards qui luisaient d’amusement.
– Et c’est son fils ? demandait-elle. Tout d’même, c’est-y rigolo, quand on a des gosses, de n’pas les élever soi-même !… Moi, tenez j’ai qu’un chien, mais j’m’en séparerais pas !
Le père Martin, à ce moment, ne savait trop que répondre. Il ne voulait pas s’engager.
– Oh, c’est selon ! fit-il. Chez nous, l’môme, n’était pas malheureux. D’abord, on aime les gosses. Hein, c’est pas vrai, ça ? Dis bonjour à la dame, Gustave !
L’enfant ne broncha pas naturellement. Il était si bien habitué à être appelé numéro quatre qu’il ignorait à peu près son prénom.
Martin, pourtant, s’entêtait. Par habitude, il gifla le môme.
Mais la concierge, à ce moment, l’interpellait :
– Eh, laissez-le donc ! faisait-elle. On ne connaît pas la politesse, à son âge !
Puis, appuyée sur son balai, elle demandait encore :
– Alors, comme ça, vous le menez voir sa mère ? Vous vouliez parler à M me de Valmondois ?
– Oui. Elle est là ?
– Non, riposta tranquillement la concierge. Elle a été assassinée, elle est à l’houstot.
– Nom de Dieu !… s’étonna Martin. Elle est à l’hôpital !… Ah ! c’est bien ma veine !
Et, de colère, il asséna au gosse une formidable gifle.
– Bon sang ! vas-tu finir de chialer, toi ?… Que j’t’entende encore et tu vas pleurer pour quelque chose !
Puis il interrogea, la voix tremblante :
– Non, vrai, c’est pas des blagues ? Vous dites qu’elle est à l’houstot ?
Une heure plus tard, dans un bouge du boulevard de la Chapelle, on faisait vacarme, on applaudissait, on riait, on semblait s’amuser ferme.
Il y avait là toute une bande de braves gens qui n’étaient autres que : Œil-de-Bœuf, Bec-de-Gaz, Dégueulasse, Fumier, Mon-Gnasse, d’autres encore.
Les femmes n’étaient pas les moins nombreuses. La Puce s’appuyait sur l’épaule de Gueule-de-Bois. Adèle, un peu plus loin, se disputait ferme avec la Grande Lucie, qui, la veille au soir, avait voulu lui prendre sa place sur le trottoir.
Au comptoir, enfin, l’Empoisonneur trônait, les manches relevées jusqu’au coude, remuant d’un air las, dans une cuve pleine d’eau sale, de petits verres.
Il régnait chez ce mastroquet une chaleur étouffante. Un parfum de tabac se mélangeait à des relents d’alcool et tout semblait poisseux, comme humide de liqueur renversée.
Quelques instants plus tôt, l’assemblée avait accueilli avec des cris de satisfaction l’entrée de deux personnages qui n’étaient autres que Martin et le numéro quatre.
Martin n’avait pas toujours été le nourricier de Longjumeau. Longtemps, il avait, aux Halles, rempli les fonctions de balayeur. Il était connu, estimé, on savait que par deux fois il avait fracturé la caisse d’un maraîcher et que, s’il avait été cassé de son emploi, c’était qu’un beau soir, étant ivre, il avait, pour un pari ridicule, à moitié assommé un bourgeois en lui jetant sur la tête, du haut du pavillon, un énorme sac de carottes.
Martin avait conservé des amis parmi les poteaux de la Villette, comme parmi les gars des Halles. On le voyait rarement, mais quand il apparaissait on lui faisait toujours fête.
– Ah ! bon Dieu ! criait l’Empoisonneur, patron du bouge, qui possédait une extraordinaire voix et ne quittait jamais l’abri de son comptoir de zinc. Voilà l’Ours !
On s’était alors levé en désordre, on avait couru au père Martin dont le sobriquet était évidemment assez compréhensible.
– Non, ma vieille ! criait-on. Pas possible !… C’est toi qui rappliques ?… Et alors, quoi de neuf ? Et ta gonzesse ?… Et tes mômes ?… C’est un produit, que tu nous amènes ?
Tout heureux de se retrouver dans une atmosphère amicale, Martin avait serré les mains tendues, affirmé qu’il n’y avait rien de neuf, que sa gonzesse engraissait toujours et que le numéro quatre était en effet un produit de son élevage.
– Et puis, c’est pas tout ça ! concluait-il. J’ai une thune qu’y faut que j’casse, aboulez des vertes, l’Empoisonneur ! C’est ma tournée pour les aminches !
Instantanément, une formidable beuverie s’organisait alors. L’absinthe remplissait les grands verres, on trinquait, on causait, on échangeait des nouvelles, cependant que les tournées succédaient aux tournées, personne ne voulant être en reste et chacun tenant à offrir la sienne.
Le gosse, cependant, étourdi par l’odeur d’absinthe, effaré par les cris qu’il entendait, était demeuré debout au milieu du cabaret avec sa petite figure timide, son air d’enfant battu qui n’ose risquer un mouvement sachant bien que le moindre de ses gestes lui vaut une taloche.
Une pierreuse l’aperçut :
– Ah ! le Jésus ! s’écriait-elle. Est-il mignard !
Et, brave fille, s’échappant du banc sur lequel l’avait poussé brutalement peut-être son homme, elle courait au numéro quatre.
– Hein, faisait-elle. On est sage ? Comment que tu t’appelles, dis-voir ?
Le gosse ne répondait pas, le bras levé au-dessus de sa tête, prêt à pleurer encore, escomptant surtout quelque gifle formidable…
La pierreuse, pourtant, le cajolait avec douceur :
– C’est qu’il est mignon comme tout ! faisait-elle. On dirait un page ! Bon sang, elle n’t’a pas raté, ta mère, quand elle t’a fait !
Maintenant, elle avait pris le gosse dans ses bras, elle revenait s’asseoir à sa table, elle demandait :
– Dis, mon gros, t’as soif ? T’as faim ?
Et, bonne âme, sans attendre la réponse, elle appelait déjà :
– Eh ! l’Empoisonneur, la tournée du môme ! Donne-nous de l’orgeat, des cornichons et du pain.
Le mélange était bizarre, la pierreuse ne connaissait rien au-dessus, raffolant, pour sa part, des cornichons, dont elle eût fait sa nourriture du premier janvier à là Saint-Sylvestre.
Les autres filles, d’ailleurs, s’étaient groupées autour d’elle. Toutes se passaient le bambin, l’embrassaient, jouaient avec lui, dans un soudain renouveau de maternité qui s’épuisait en phrases touchantes comme en gestes maladroits.
– Attends voir, mon Jésus, que j’te peigne ! T’as tes boucles tout emmêlées !
– Fais voir, mon bonhomme, que j’te tire tes chaussettes !
– Donne ta main ! là… Dis bonjour !
Elles l’étourdissaient un peu, mais il se laissait faire cependant, le visage déjà tout barbouillé d’orgeat, et suçant un cornichon qu’il trouvait mauvais sans oser le montrer.
– Eh ben, ma fille, clamait derrière Adèle un maigre individu qui n’était autre que Fumier, c’est pas pour dire, mais quand il aura dix-huit ans, celui-là, y fera rudement tourner les têtes !… Quels châsses il a, bon Dieu !
Alors ce furent des exclamations sans fin. Chacune d’elles découvrait au gosse des beautés extraordinaires. Il avait une bouche que c’était un plaisir de le voir croquer son cornichon. Son nez était rigolo en diable…
– Et ses mains ! clamait Adèle. Avez-vous vu ses mains ? On dirait des mains de poupée !
Elles s’enthousiasmaient les unes après les autres, étant restées enfant, prenant vraiment plaisir à jouer avec le gosse tout comme elles eussent joué avec une véritable poupée.
Il y eut une ambassade. Adèle quitta le groupe des filles pour aller trouver l’Ours. Elle lui tapait sur l’épaule, elle lui passait la main dans les cheveux, jusqu’à ce qu’il daigne écouter :
– Dis voir, ton mômignard, comment qu’y s’appelle ?
L’Ours, qui en était à sa quatrième absinthe, répondit d’une voix fort empâtée :
– Y s’appelle Gustave. Gustave Poucke… Ah ! nom de Dieu ! Y s’appelle aussi Gustave de Valmondois, même que je ne sais pas qu’en fiche !
Et, avec un entêtement d’ivrogne, Martin voulait à toute force contraindre les copains à écouter son histoire :
Il en avait du malheur, bon Dieu !… Le gosse, comme ça, était un gosse d’une femme de luxe, même qu’elle payait pas ses mois de nourrice, qu’il avait rappliqué à Paris, histoire de lui reflanquer l’enfant dans les mains…
– Seul’ment, ça, c’est pas d’veine, continuait l’Ours, paraît que la gerce, elle est à l’houstot, rapport à ce qu’on l’a esquinté aux trois quarts. Alors, moi, j’sais pus qu’en faire, du mômignard… Le garder, non, j’veux pas ! Très peu de me ruiner pour lui ! Le fout’ à la Seine, c’est dangereux !… Le coller à l’Assistance, ça me ferait du tort pour mon commerce !… Ah ! vingt cent mille diables !… Je le donnerais pour pas cher ! Qui qu’en voudrait ?
Depuis un instant, un homme était entré dans le bouge, un apache, au visage sévère, qui avait échangé un signe de tête avec l’Empoisonneur et, debout, appuyé contre un mur, fumait en regardant le plafond sans avoir l’air de prêter attention aux paroles qui s’échangeaient près de lui.
Cet homme, en réalité, ne perdait pas un mot des paroles de l’Ours. Il les écoutait si bien, il les observait avec tant d’attention qu’à deux reprises il avait même vivement tressailli.
Brusquement, il se départit de l’attitude flegmatique qu’il s’imposait.
– Dégueulasse ! appelait-il.
Dégueulasse, qui buvait sans penser à mal, le nez dans son verre, calculant qu’on était douze poteaux, qu’on avait déjà prix cinq tournées et qu’il en restait encore sept à boire, releva la tête de surprise.
– Quoi ? demandait-il. Qui c’est qui m’siffle ?
Dégueulasse perdit son assurance et parut fort surpris en apercevant celui qui l’avait appelé.
– Ah ! par exemple !… commença-t-il.
Il se levait, courait à l’homme.
– C’est vous, patron ?
– Chut ! fit l’autre. Ne me nomme pas, écoute…
Et Dégueulasse et son interlocuteur échangèrent quelques mots. Dégueulasse paraissait au comble de la stupéfaction.
– Bon sang ! répondit-il enfin, j’vais vous obéir, mais, tout d’même, je me d’mande à quoi que vous pensez et qu’est-ce que vous en f’rez ?
Dégueulasse jetait de furtifs coups d’œil vers les tables du bouge où les pierreuses s’étaient groupées, se disputant pour prendre le petit gosse sur leurs genoux et le faire sauter en lui racontant des histoires.
Dégueulasse ne posa pas d’autre question. L’homme qui lui parlait avait brusquement froncé les sourcils.
– Je n’aime pas les curieux, déclarait-il. J’aime encore moins les bavards ! Obéis, et ne cherche pas à comprendre !
– Bon, bon, ça va !…
L’oreille basse et faisant piètre mine sous la réprimande qu’il venait de recevoir, Dégueulasse s’approchait du comptoir où l’Empoisonneur demeurait maintenant immobile, dans une pose d’engourdissement qui cachait en réalité sa satisfaction devant la marche des affaires.
– Passe-moi les dés ! demandait Dégueulasse.
– Pourquoi faire ?
– Pour un zanzi.
En possession de deux cornets de cuir dans lesquels trois dés cliquetaient, Dégueulasse revint vers le fond du bouge, se pencha vers l’Ours.
– Eh vieux ! commençait-il. Y t’gêne, ton gosse ? Veux-tu me l’refiler ?
La proposition fit stupeur.
– Non, commençait Fumier, t’es piqué, des fois, camarade !
Œil-de-Bœuf, à son tour, protestait :
– Quoi, tu veux t’fout’nourrice, maint’nant ?
L’Ours lui-même paraissait abasourdi.
– Vrai ? faisait-il. Tu veux l’môme ? Qu’est-ce que tu l’payes ?
L’instinct d’avarice se réveillait déjà chez le père Martin.
Il ne savait que faire du numéro quatre, il le trouvait plus gênant qu’utile, mais il n’entendait pas le donner. Dégueulasse, d’ailleurs, ne marquait aucune surprise en entendant cette question.
– Ah bien, voilà, commençait-il. C’que j’en veux faire, c’est moi que ça r’garde ! Les autres ont pas à s’en mêler. Dis donc, l’Ours, j’te l’achète pas, mais j’te l’joue… Ça colle-t-y ?
– Tu me l’joue ? répéta l’Ours, qui n’avait plus les idées très nettes. Comment c’est que tu me l’joues ?
– En quarante points au zanzi. Tu marches ?
– Je marche.
Ils prirent chacun un cornet, la partie commença.
– Six ! annonça l’Ours.
– L’as ! riposta Dégueulasse.
On applaudit.
– Mon vieux, si tu y vas de ce train, tu n’es pas près d’avoir le môme !…
Mais la chance tournait : Dégueulasse, peut-être bien d’ailleurs, connaissait le secret de ces cornets qui n’étaient pas parfaitement ronds et de ces dés qui n’avaient rien de cubique. Il perdait encore deux ou trois fois, puis il se mettait à gagner de façon insolente. En douze coups, c’était une affaire faite.
– Quarante ! annonça Dégueulasse. Le môme est à moi !…
Et il battait un entrechat, dansait deux ailes de pigeon, puis allait prendre le numéro quatre par la main.
– Viens ici, chien d’ivrogne !
On n’était pas encore revenu de l’étonnement que causait cette partie que Dégueulasse emmenait hors du bouge l’enfant qu’il venait de gagner.
Derrière lui, la Puce et l’apache grave sortirent précipitamment…
XI
Crime horrible
Avec ses bâtiments s’étendant sur un énorme espace, avec ses murs noircis par les cheminées des usines environnantes, avec ses grandes cours entourées de galeries couvertes, ses inquiétants petits pavillons vitrés, l’hôpital Lariboisière avait l’air d’une ville énorme ou plus encore d’un monstre accroupi sur le sol, écrasé pour quelque sommeil gigantesque et tout vivant cependant, comme animé de colère contenue.
On voyait, à droite et à gauche, trouant la façade des murailles, des fenêtres ouvertes par où s’échappaient par moments des cris, des sanglots, des plaintes, de véritables bouffées de douleurs humaines, de désespoirs et de larmes.
Il flottait sur tout l’énorme quadrilatère un âcre parfum de remèdes violents, une odeur caractéristique d’iodoforme et d’acide phénique et l’on voyait voltiger dans le vent, malgré l’ordre minutieux des cours, des tampons d’ouate, des lambeaux de bandages, toutes les miettes de l’appareil de la souffrance.
Le seuil s’ouvrait par une entrée monumentale sur laquelle on cherchait, malgré soi, une inscription de désespérance. La voûte franchie, on trouvait de longs corridors étiquetés à toutes les calamités qui peuvent fondre sur l’organisme humain : maladies des yeux, maladies des oreilles, maladies contagieuses, services de chirurgie, clinique opératoire…
Le passant qui entrait là avait l’impression de pénétrer dans quelque enfer où tout un peuple de damnés, tracassé par le mal, souffrait, hurlait, s’acheminait lentement vers un destin fatal…
L’hôpital aux âcres odeurs, l’hôpital bruyant de cris, de larmes et de sanglots avait pourtant sur sa façade intérieure, du côté des boulevards, proche des arcades du métropolitain, un coin d’ombre et de silence. Relégué là, bâti de quatre planches, un baraquement se dressait, peinturluré de rouge, clos de volets qui ne s’ouvraient jamais. C’était le dépôt mortuaire. Chaque jour, on portait là, sur une civière que les infirmiers nommaient la boîte aux dominos, les pauvres bougres qui avaient rendu l’âme dans le vacarme indifférent des salles.
On n’attachait guère d’importance à eux. Ils étaient le déchet de la science médicale, ils représentaient aux yeux de tous un pourcentage, le chiffre de la mort triomphante sur les soins guérisseurs.
Or, par un phénomène curieux, c’était en réalité près de ce pavillon de la mort, où s’entassaient les cadavres, couchés les uns à côté des autres, immobiles et encombrants, qu’il faisait le meilleur pour se promener.
Les malades convalescents n’allaient jamais traîner là. On parquait leurs pas hésitants dans des cours spéciales ; seuls les infirmiers et les infirmières pouvaient gagner l’enclos, aller fumer une cigarette ou bavarder un peu, à l’abri des murs tiédis par le soleil, dans le voisinage des moineaux qui, aimant ce coin tranquille, piaillaient, faisaient vacarme et nichaient le long des gouttières sans s’inquiéter du mouvement lent et grave des infirmiers fossoyeurs.
De l’autre côté du mur, la souffrance reprenait ses droits. On comprenait, à pénétrer dans l’enclos, ce qu’a d’auguste et de consolant la mort, qui incarne, en somme, la suprême guérison de la vie mauvaise où chacun souffre et se débat.
Dans l’enclos, ce matin-là, une infirmière, vêtue de blanc, le bonnet pimpant épinglé sur sa chevelure brune, arrivait en fredonnant. Elle venait des salles de chirurgie. Elle n’était point de service à la salle d’opération ; un médecin l’avait envoyée à l’économat chercher quelque objet de pansement nécessaire, elle allongeait le chemin en passant par la morgue, histoire de rire un peu, si d’aventure quelque camarade était là, flânant pareillement.








