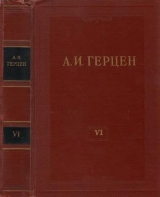
Текст книги "Том 6. С того берега. Долг прежде всего"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц)
Il est fâcheux que Pierre Ier n'ait eu devant les yeux d'autre idéal que le régime européen. Il ne vit pas que ce qu'il admirait dans la civilisation de l'Europe, n'était en aucune façon attaché aux formes politiques alors subsistantes, mais se soutenait bien plutôt en dépit de ces formes; il ne vit pas que ces formes elles-mêmes ne représentaient rien autre chose que le résultat de deux mondes déjà passés, et qu'elles étaient marquées du sceau de la mort, comme le byzantisme moscovite.
Les formes politiques du dix-septième siècle étaient le dernier mot de la centralisation monarchique, le dernier résultat de la paix de Westphalie. C'était le temps de la diplomatie, de la chancellerie et du régime de caserne; le commencement de ce froid despotisme, dont les allures égoïstes ne purent être anoblies, même par le génie de Frédéric II, le prototype de tous les caporaux petits et grands.
Ces formes politiques n'attendaient elles-mêmes, pour disparaître, que leur Pierre Ier: la Révolution française. Afranchi des traditions, vainqueur de la dernière, Pierre Ier jouissait de la plus grande liberté. Mais son âme manquait de génie et de puissance créatrice: il était subjugué par l'Occident et il en devint le copiste. Haïssant tout ce qui était de l'ancienne Russie, bon et mauvais, il imita tout ce qui était européen, mauvais et bon. La moitié des formes étrangères qu'il transplanta en Russie, était complètement antipathique à l'esprit du Peuple russe.
Sa tâche n'en devint que plus difficile, et cela sans aucun profit. Il aimait par instinct prophétique la Russie de l'avenir; il caressait l'idée d'une puissante monarchie russe, mais il ne faisait aucun compte du Peuple. Indigné de la stagnation et de l'apathie générales, il voulut renouveler le sang aux veines de la Russie, et, pour opérer cette transfusion, il prit un sang, déjà vieux et corrompu. Et puis, avec tout le tempérament d'un révolutionnaire, Pierre Ier fut toujours néanmoins un monarque. Il aimait passionnément la Hollande et reconstruisait sa chère Amsterdam sur les bords de la Néva, mais il empruntait fort peu de choses aux libres institutions des Pays-Bas. Non seulement il ne restreignit pas la puissance des tzars, mais il l'agrandit encore en lui livrant tous les moyens de l'absolutisme européen et en renversant toutes les barrières qu'avaient élevées jusqu'alors les mœurs et les coutumes.
En même temps qu'il se rangeait sous les bannières de la civilisation, Pierre Ier empruntait néanmoins à un passé, qu'il répudiait, le knout et la Sibérie, pour réprimer toute opposition, toute parole courageuse, tout acte de liberté.
Représentez-vous maintenant l'union du tzarisme moscovite avec le régime des chancelleries allemandes, avec la procédure inquisitoriale empruntée au code militaire prussien, et vous comprendrez comment l'autorité impériale en Russie a laissé loin derrière elle le despotisme de Rome et de Byzance.
L'agreste Russie se pliant à tout en apparence, n'a réellement rien accepté de cette réforme. Pierre Ier sentait cette résistance passive; il n'aimait pas le paysan russe et n'entendait rien non plus à sa manière de vivre. Il a fortifié, avec une légèreté coupable, les droits de la noblesse et resserré encore la chaîne du servage; il a tenté le premier d'organiser ces absurdes institutions; or, les organiser, c'était en même temps les reconnaître et leur donner une base légale. Dès lors, le paysan russe se renferma plus étroitement que jamais au sein de sa commune, et ne s'en écarta qu'en jetant autour de lui des regards défiants et en faisant force signes de croix. Il cessa de comprendre le gouvernement; il vit dans l'officier de police et le juge un ennemi; il vit dans le seigneur terrien une puissance brutale contre laquelle il ne pouvait rien faire.
Il commença dès lors à ne voir dans tout condamné qu'un malheureux: seul mot qui désigne tout condamné dans ce pays, où il semble ne plus y avoir que des victimes et des bourreaux; à mentir sous le serment et à nier tout, quand il était interrogé par un homme qui se présentait en uniforme et qui lui semblait lé représentant du gouvernement allemand. Cent cinquante ans, loin de les réconcilier avec le nouvel ordre des choses, l'en ont encore éloigné davantage. Que nous autres, nous ayons été élevés dans la réforme de Pierre; que nous ayons sucé le lait de la civilisation européenne; que la vieillesse de l'Europe nous ait été inoculée, de telle sorte que ses destins soient devenus les nôtres, à la bonne heure! mais il en est tout autrement du paysan russe.
Il a beaucoup supporté, beaucoup souffert, il souffre beaucoup à cette heure, mais il est resté lui-même. Quoique isolé dans sa petite commune, sans liaison avec les siens, tous dispersés sur cette immense étendue du pays, il a trouvé dans une résistance passive, et dans la force de son caractère, les moyens de se conserver; il a courbé profondément la tête, et le malheur a passé souvent sans le toucher, au-dessus de lui; voilà pourquoi, malgré sa position, le paysan russe possède tant de force, tant d'agilité, tant d'intelligence et de beauté, qu'à cet égard il a excité l'étonnement de Custine et d'Haxthausen.
Tous les voyageurs rendent justice aux paysans russes, mais ils font grand bruit de leur impudente friponnerie, de leur fanatisme religieux, de leur idolâtrie, pour le trône impérial.
Je crois, qu'on peut trouver quelque chose de ces défauts dans le Peuple russe, et je me fonde en particulier sur ce que ces défauts sont communs à toutes les nations européennes. Ils tiennent étroitement à notre civilisation, à l'ignorance des masses et à leur pauvreté. Les Etats européens ressemblent au marbre poli, ils ne brillent qu'à la surface, mais, au fond et dans leur ensemble, ils sont grossiers.
Je comprends qu'on puisse accuser la civilisation, les formes sociales actuelles, tous les Peuples ensemble, mais je trouve qu'il y a inhumanité sans profit à s'attaquer à un Peuple en particulier, et à condamner en lui les vices de tous les autres; c'est d'ailleurs une étroitesse d'esprit, qui n'est permise qu'aux Juifs, de tenir sa nation pour un Peuple choisi. A cet égard les derniers événements politiques ont dû être pour nous une grande leҫon; presque tous les écrivains n'ont-ils pas, naguère, accusé de ces mêmes défauts, les Romains et les Viennois, en y ajoutant même le reproche de lâcheté?
La révolution d'octobre et le triumvirat romain ont réhabilité la réputation de ces villes. Mais ce n'est pas tout. Il est très vrai que le paysan russe, toutes les fois qu'il le peut, trompe le gentilhomme et l'officier public, qui ne s'abstiennent de le tromper à leur tour que parce qu'ils trouvent beaucoup plus simple de le dépouiller. Tromper ses ennemis, en pareil cas, c'est faire preuve d'intelligence. Au contraire, les paysans russes, dans leurs rapports entre eux, se montrent pleins d'honneur et de loyauté. La preuve, c'est que jamais ils ne dressent entre eux de contrat par écrit. La terre est partagée dans les communes, et l'argent dans les associations de travailleurs. A peine, dans l'espace de dix années et plus, se produit-il à cet égard, deux ou trois procès.
Le Peuple russe est religieux parce qu'un Peuple, dans les circonstances politiques actuelles, ne peut pas être sans religion. Une conscience éclairée est une conséquence du progrès; la vérité et la pensée, jusqu'à présent, n'existent que pour le petit nombre. Au Peuple, la religion tient lieu de tout; elle répond à toutes ses questions d'esthétique et de philosophie qui se rencontrent à tous les degrés dans l'âme humaine. La poésie fantastique de la religion sert de délassement aux travaux prosaïques de l'agriculture et de la coupe des foins. Le paysan russe est superstitieux, mais indifférent à l'égard de la religion, qui, d'ailleurs, est pour lui lettre close. Il observe exactement toutes les pratiques extérieures du culte, pour en avoir le cœur net; il va le dimanche à la messe, pour ne plus penser de six jours à l'église. Les prêtres, il les méprise comme des paresseux, comme des gens avides qui vivent à ses dépens. Dans toutes les obscénités populaires, dans toutes les chansons des rues, le héros, objet de ridicule et de mépris, est toujours le pope et le diacre ou leurs femmes.
Quantité de proverbes témoignent de l'indifférence des Russes en matière de religion: «Tant que le tonnerre ne gronde pas et que l'éclair ne frappe pas, le paysan ne se signe pas». «Fie-toi en Dieu, mais encore plus en toi». Custine raconte que le postillon qui défendait, en plaisantant, son penchant à de petits larcins, disait: «C'est une chose innée dans l'homme, et si le Christ n'a pas volé, c'est qu'il en était empêché par les blessures de ses mains». Tout cela montre que l'on ne rencontre chez ce Peuple ni le fanatisme farouche que nous trouvons en Belgique et à Lucerne, ni cette foi austère, froide et sans espérance, que l'on remarque à Genève et en Angleterre, comme en général chez les Peuples qui ont été longtemps sous l'influence des jésuites et des calvinistes.
Dans le sens propre du mot, les schismatiques seuls sont religieux. La raison n'en est pas seulement dans le caractère national, mais dans la religion elle-même. L'Eglise grecque n'a jamais été extraordinairement propagandiste et expansive; plus fidèle que le catholicisme à la doctrine évangélique, sa vie, par cela même, s'est répandue moins au dehors; mûrie sur le sol putréfié de Byzance, elle s'est concentrée dans l'intérieur des cellules monastiques, elle s'est occupée, surtout, de controverse théologique et de questions de théorie; subjuguée par le pouvoir temporel, elle s'est éloignée, en Russie, plus encore que dans l'empire byzantin, des intérêts de la politique. A partir du dixième siècle jusqu'à Pierre Ier on ne connaît qu'un seul prédicateur populaire, et, à celui-là, le patriarche lui imposa silence.
Je regarde comme un grand bonheur pour le Peuple russe, Peuple aisément impressionnable et doux de caractère, qu'il n'ait pas été corrompu par le catholicisme. Il a ainsi échappé en même temps à un autre fléau. Le catholicisme, comme certaines affections malignes, ne peut se traiter que par des poisons; il traîne fatalement après lui le protestantisme qui n'affranchit d'un côté les esprits que pour les mieux enchaîner de l'autre. Enfin la Russie, n'appartenant pas à la grande unité de l'Eglise d'Occident, n'a pas besoin non plus de se mêler à l'histoire de l'Europe.
Je n'ai pas trouvé davantage dans le Peuple russe qu'il fût bien affectionné au trône et prêt à se dévouer pour lui. Il est vrai que le paysan russe voit dans l'empereur un protecteur contre ses ennemis immédiats; qu'il le considère comme la plus haute expression de la justice, et qu'il croit à son droit divin, comme y croient plus ou moins tous les Peuples monarchiques de l'Europe. Mais cette vénération ne se manifeste par aucun acte, et son attachement à l'empereur n'en ferait ni un vendéen, ni un carliste espagnol; cette vénération ne va pas jusqu'à ce touchant amour qui naguère encore ne permettait pas à certain Peuple de parler de princes sans verser des larmes.
Il faut aussi avouer que le Peuple russe s'est refroidi dans son amour pour le trône, depuis que, grâce à la bureaucratie européenne, il s'est détourné du gouvernement. Un mouvement dynastique, comme celui qui éclata, par exemple, en faveur du faux Démétrius, est aujourd'hui tout à fait impossible. Depuis Pierre Ier, le Peuple n'a pris aucune part à toutes les révolutions de Pétersbourg. Quelques prétendants, une poignée d'intrigants et de gardes prétoriennes ont, de 1725 à 1762, fait passer de main en main le trône impérial. Le Peuple s'est tu impassible et sans s'inquiéter que la princesse de Brunswick ou de Courlande, le duc de Holstein ou sa femme, de la famille d'Anhalt-Zerbst, fussent reconnus par la camarilla comme empereurs et Romanoff: ils lui étaient tous inconnus, et de plus ils étaient Allemands.
L'insurrection de Pougatcheff eut un tout autre sens: ce fut la dernière tentative, l'effort suprême du Cosaque et du serf pour s'affranchir du cruel joug qui s'appesantissait visiblement sur eux chaque jour davantage. Le nom de Pierre III ne fut rien qu'un prétexte; ce nom seul n'eût pas eu la vertu de soulever quelques provinces. Pour la dernière fois, en 1812, un intérêt politique anima le Peuple russe. Ce Peuple est persuadé qu'il est impossible de le vaincre chez lui; cette pensée est au fond de la conscience de tout paysan russe, c'est là sa religion politique. Lorsqu'il vit l'étranger apparaître en ennemi sur son territoire, il laissa reposer sa charrue et saisit le fusil. En mourant sur le champ de bataille «pour le blanc tzar et la sainte mère de Dieu», comme il disait, il mourait en réalité pour l'inviolabilité du sol russe.
La classe avec laquelle le Peuple russe se trouve en rapport immédiat, est la noblesse provinciale et le corps des employés, qui forment le dernier degré de la Russie civilisée. Les employés, profondément corrompus par l'interdiction de toute publicité, représentent la classe la plus servile en Russie; son sort est complètement à la merci du gouvernement. La noblesse provinciale, de son côté, non moins corrompue par son droit d'exploitation sur les paysans, est cependant plus indépendante, et, par suite, un peu moins machine que le corps des employés. Il y a encore un peu de vie dans les assemblées provinciales, la noblesse fait ordinairement opposition aux gouverneurs et à leurs officiers: les moyens ne lui manquent pas pour cela.
Catherine II continua le système de Pierre Ier, elle accrut et fortifia encore les droits de la noblesse; en même temps elle précipita des millions de paysans dans le servage, et paya avec des communes de paysans ses nuits de Cléopâtre. La noblesse de chaque province a le droit de tenir ses assemblées particulières, d'élire ses maréchaux et, ce qui est encore plus important, les juges dans les deux premières instances, les présidents de ces tribunaux et tous les officiers d'administration et de police des districts.
Il est vrai que les autres classes du Peuple ont part à ces droits, mais la majorité reste à la noblesse, à l'exception des autorités municipales et des bourguemestres qui sont élus par les marchands et les bourgeois de la ville. Le gouvernement envoie dans chaque.province un gouverneur, un conseil d'administration et de finances, dans chaque ville un officier de police, et pour chaque tribunal un procureur. La noblesse a le droit de contrôler le gouverneur dans toutes les affaires d'argent; tout gentilhomme peut, dans sa province et sans aucune restriction, être élu juge, président et maréchal. C'est à cela que se réduisent toutes les institutions libres.
Si nous passons de la constitution provinciale à la constitution de l'Etat, à chaque pas, à mesure que nous remonterons l'échelle hiérarchique, s'effaceront davantage les droits de l'homme et la part des gouvernés au gouvernement. La centralisation de Pétersbourg, comme la cime neigeuse d'une montagne, écrase tout de son poids glacial et uniforme; plus on s'en approche, moins on découvre de traces de vie et d'indépendance. Le sénat, le conseil d'Etat, les ministres, ne sont rien que des instruments passifs; les plus hauts dignitaires ne sont rien que des scribes, des sbires, en un mot, des bras télégraphiques, au moyen desquels le Palais d'hiver de Pétersbourg annonce au pays sa volonté.
La noblesse russe, dans la forme qu'elle conserve depuis Pierre Ier, représente plutôt une prime pour des services rendus, qu'une caste existant par elle-même; on perd même la noblesse, d'après la loi, quand, dans une famille, deux générations successives ne sont pas entrées au service de l'Etat. Les chemins qui conduisent à la noblesse sont ouverts de tous côtés. Il y a cinq ans qu'on a élevé, à cet égard, quelques difficultés; mais elles appartiennent au nombre de ces mesures qui disparaissent sans conséquence le jour qui suit l'investiture impériale.
Pierre Ier, avec toute sa puissance, n'aurait pu rien exécuter s'il n'avait pas rencontré déjà une foule de mécontents. Ces mécontents lui vinrent en aide; c'est d'eux et de tout ce qui servait le nouveau gouvernement, que s'est formée la Russie européenne. Pierre Ier anoblit cette partie de la nation pour l'opposer à la Russie agreste. Mais outre que cette classe n'a produit aucune aristocratie ayant force et vigueur, elle a encore absorbé en elle l'aristocratie, autrefois puissante, de l'ancienne noblesse, des boyards et des princes[83]83
Le droit d'aînesse est complètement inconnu en Russie.
[Закрыть]. La nouvelle noblesse, se recrutant sans cesse dans toutes les classes, n'acquit un caractère aristocratique qu'à l'égard du paysan, aussi longtemps qu'il restait paysan, c'est-à-dire à l'égard de cette portion du Peuple qui se trouvait aussi placée par le gouvernement en dehors de la loi.
Probablement, dans les premiers temps qui suivirent la réforme, tous ces lourds et grossiers boyards, avec leur perruque poudrée et leurs bas de soie, ressemblaient fort à ces élégants d'Otaïti qui se pavannent en uniforme rouge anglais avec des epaulettes, sans culottes ni chemises. Mais grâce à notre talent d'imitation, la haute noblesse s'est bientôt appropriée les manières et la langue des courtisans de Versailles. En adoptant la délicatesse des formes et des mœurs de l'aristocratie européenne, elle ne perdit pas tout à fait les siennes propres, et, par suite, sa manière de vivre, au temps de Catherine II, offrait un mélange original de sauvage indiscipline et d'éducation de cour, de morgue aristocratique et de soumission semi-orientale. Ces mœurs étaient cependant plutôt originales et anguleuses que caricature; elles n'avaient rien de ce ton banal et sans goût qui a toujours distingué l'aristocratie allemande.
Entre la haute noblesse qui habite presque exclusivement Pétersbourg, et le prolétariat noble des employés et des gentilshommes sans propriété, se trouve l'épaisse couche de la moyenne noblesse, dont le centre moral est à Moscou. Abstraction faite de la corruption générale de cette classe, il faut avouer que c'est en elle que résident le germe et le centre intellectuel de la prochaine Révolution. La position de la minorité instruite de cet ordre (cette minorité est assez considérable) est fort tragique; elle est séparée du Peuple parce que, depuis quelques générations, ses pères se sont attachés au gouvernement civilisateur, et séparée du gouvernement parce qu'elle s'est civilisée. Le Peuple voit en eux des Allemands, le gouvernement des Français.
Dans cet ordre si absurdement placé entre la civilisation et le droit de planteur, entre le joug d'un pouvoir illimité et les droits seigneuriaux qu'il possède sur les paysans; dans cet ordre, où l'on rencontre la plus haute culture scientifique de l'Europe, sans la liberté de la parole, sans autre affaire que le service de l'Etat, s'agitent une masse de passions et de forces qui, pré-cisément par défaut d'issue, fermentent, grandissent et souvent se font jour en produisant quelque individualité éclatante, pleine d'excentricité.
C'est de cet ordre qu'est provenu tout le mouvement littéraire; c'est de lui qu'est sorti Pouchkin, ce représentant le plus complet de l'ampleur et de la richesse de la nature russe, c'est en lui qu'on a vu naître etgrandir, le 26 décembre 1825, cette indulgentia plenaria de toute la caste, son arrêté de compte pour tout un siècle.
Dix ans de travaux forcés, vingt-cinq ans d'exil, n'ont pu rompre et courber ces hommes héroïques, qui, avec une poignée de soldats, descendirent sur la place d'Isaac pour y jeter le gant à l'impérialisme, et faire entendre publiquement des paroles qui, jusqu'à cette heure, et encore aujourd'hui, se transmetten! d'âme en âme, au sein de la nouvelle génération.
L'insurrection de 1825 clôt la première époque de la période de Pétersbourg. La question était résolue La classe intruite, cette classe du Peuple, qui reste conséquente à l'impulssion donnée par Pierre Ier, prouva alors, par sa haine active, contre le despotisme, qu'elle avait rattrapé ses frères d'Occident. Ils se sont trouvés en complète communauté de sentiments et d'opinions avec Riégo, Gonfaloniéri et les Carbonari. L'effroi du gouvernement fut d'autant plus grand, qu'il trouva, d'un côté, tous les éléments de la noblesse et de la hiérarchie militaire impliqués dans l'insurrection, et que, de l'autre, il se souvint qu'aucun lien réel ne l'attachait à l'ancien Peuple, resté russe.
Le 26 décembre a révélé tout ce qu'il y avait d'artificiel,' de fragile et de passager dans l'impérialisme de Pétersbourg. Le succès de la Révolution a tenu à un cheveu… Qu'en serait-il advenu? Il est difficile de le dire: mais quel qu'eût été le résultat, on peut hardiment affirmer, que le Peuple et la noblesse auraient tranquillement accepté le fait accompli.
C'est là précisément ce que le gouvernement comprit avec terreur. Dans sa défiance de la noblesse, il voulait se rendre national, et ne réussit qu'à se faire l'ennemi de toute civilisation. La veine nationale lui manquait complètement. Le gouvernement se montra, tout d'abord, sombre et défiant; tout un corps de police secrète organisé à neuf, environna le trône. Le gouvernement renia alors les principes de Pierre Ier, développés pendant cent ans. Ce fut une succession de coups, portés à toute liberté, à toute activité intellectuelle; la terreur se déploya chaque jour davantage. On n'osait faire rien imprimer; on n'osait écrire une lettre; on allait jusqu'à craindre d'ouvrir la bouche, non seulement en public, mais même dans sa chambre: tout était muet.
Les gens instruits sentirent alors, de leur côté, que le sol au-dessous d'eux n'était pas celui de la patrie; ils comprirent toute leur faiblesse, et le désespoir les saisit. Cachant au fond de leur âme leurs larmes et leurs douleurs, ils se dispersèrent dans leurs campagnes et sur toutes les grandes routes de l'Europe. Pétersbourg, à l'exemple du gouvernement, prit un tout autre caractère; ce fut une ville en état de siège perpétuel. La société rebroussa chemin à grands pas. Les sentiments aristocratiques de la dignité humaine qui, sous Alexandre, avaient gagné beaucoup de terrain, furent refoulés jusqu'à rendre possible une loi pour les passeports à l'étranger, jusqu'à rendre possible ces mœurs que vous dépeint Custine.
Mais le travail intérieur se continua, d'autant plus énergique dans ses profondeurs qu'il ne trouvait aucune occasion de se révéler par des faits à la surface. De temps en temps retentissaient des voix qui faisaient tressaillir toutes les fibres du cœur humain: c'était un cri de douleur, un gémissement d'indignation, un chant de désespoir, et, à ce cri, à ce gémissement, à ce chant, se mêlait la triste nouvelle du sort encouru par quel-qu'audacieux, forcé de chercher l'exil dans les contrées du Caucase ou de la Sibérie. C'est ainsi que, dix ans après le 26 décembre, un penseur a jeté dans le monde quelques feuilles qui, partout où se trouvent, en Russie, des lecteurs, produisirent une secousse électrique.
Cet écrit était un reproche calme et sans amertume; il ressemblait à un examen sans passion de la situation des Russes, mais c'était le coup d'œil irrité d'un homme profondément offensé dans les plus nobles parties de son être. Sévère et froid, il demande compte à la Russie de toutes les souffrances qu'elle prépare à l'homme pensant, et, après les avoir analysées toutes, il se détourne avec horreur, il maudit la Russie dans son passé, il dédaigne son présent, et ne prophétise que malheur à son avenir. On n'entendait pas de ces voix-là pendant la brillante époque du libéralisme un peu exotique d'Alexandre, – elles n'éclatèrent même pas dans les poésies de Pouchkin; pour les arracher d'une poitrine humaine, il a fallu le poids intolérable d'une terreur de dix ans: il nous a fallu voir la ruine de tous nos amis, la gloire du siège de Varsovie et la pacification de la Pologne.
Tschaadaeff avait tort en beaucoup de points, mais sa plainte était légitime et sa voix avait fait entendre une terrible vérité. C'est là ce qui explique son immense retentissement. A cette époque, tout ce qui est de quelque importance en littérature prend un nouveau caractère. C'en est fait de l'imitation des Français et des Allemands, la pensée se concentre et s'envenime; un désespoir plus amer et une plus amère ironie de son propre destin éclate partout, aussi bien dans les vers de Lermontoff que dans le rire moqueur de Gogol, rire, sous lequel, suivant l'expression de l'auteur, se cachent les larmes.
Si les éléments de la vie nouvelle et du mouvement restèrent alors isolés; s'ils n'arrivèrent pas à cette unité qui régnait avant le 26 décembre, c'est, avant tout, que les questions les plus importantes devinrent beaucoup plus complexes et plus profondes. Tous les hommes sérieux comprirent qu'il ne suffisait plus de se traîner à la remorque de l'Europe, qu'il existe en Russie quelque chose qui lui est propre et particulier, et qu'il faut nécessairement étudier et comprendre dans le passé et dans le présent.
Les uns, dans ce qui est propre à la Russie, ne virent rien d'hostile ni d'antipathique aux institutions de l'Europe; loin de là, ils prévoyaient le temps, où la Russie, au-delà de la période de Pétersbourg, et l'Europe, au-delà du constitutionnalisme, viendraient à se rencontrer. Les autres, au contraire, rejetant sur le caractère antinational du gouvernement tout le poids de la situation présente, confondirent dans une même haine tout ce qui tient à l'Occident.
Pétersbourg enseigna à ces hommes à mépriser toute civilisation, tout progrès; ils voulaient retourner aux formes étroites des temps qui avaient précédé Pierre Ier, et dans lesquels la vie russe se trouverait de nouveau à peu près étranglée. Heureusement, le chemin, pour revenir à la vieille Russie, s'est depuis longtemps couvert d'une épaisse forêt, et ni les slavophiles ni le gouvernement ne réussiront à la raser.
La lutte de ces partis, a, depuis dix ans, donné à la littérature une nouvelle vie; les journaux ont vu s'accroître considérablement le nombre de leurs souscripteurs, et, aux cours d'histoire, les bancs de l'université de Moscou rompaient sous la foule des auditeurs. N'oubliez pas que, dans l'excessive pauvreté d'organes de l'opinion publique, les questions de littérature et de science se sont transformées en une arène pour les partis politiques. Tel était l'état de choses lorsque la Révolution, de Février éclata.
Le gouvernement, d'abord étourdi, ne fit rien, mais lorsqu'il vit l'allure humble et soumise de la modeste République, il reprit bientôt ses sens. Le gouvernement russe déclara hautement qu'il se considérait comme le champion du principe monarchique et, présageant la solidarité de la civilisation avec la Révolution (à l'exemple de l'Assemblée Nationale française) il ne cacha pas qu'il était prêt à tout sacrifier pour la cause de l'ordre. Le gouvernement russe, avec plus d'énergie que cette Assemblée, marcha, dans sa cynique hardiesse, à l'anéantissement de la civilisation et du progrès.
Qu'en adviendra-t-il?.. En Russie, peut-être, la ruine de tout élément civilisateur. Epouvantable résultat! Mais la Russie n'en sera pas abîmée pour cela. Il est même fort possible que ce résultat devienne, pour le Peuple, le signal du réveil, et que s'ouvre alors une nouvelle ère pour la justice et les droits du Peuple.
Le gouvernement, en attendant, semble avoir oublié, qu'il est né à Pétersbourg, qu'il est le gouvernement de la Russie civilisée; qu'il est lié, lui aussi, par les gages qu'il a donné à la civilisation européenne, et qu'en dépit de ses airs actuels d'orthodoxie et de nationalité, le paysan russe le regarde toujours comme allemand.
Le sort du trône de Pétersbourg – admirez la sublime ironie! – est lié à la civilisation; en l'anéantissant il se précipite dans un abîme effroyable, et s'il la laisse grandir, il tombe dans un autre abîme. – Il est possible, d'ailleurs, que la Russie, par suite d'une oppression intolérable, se décompose en un grand nombre de parties; peut-être aussi se précipitera-t-elle tout simplement en avant, et, dans son impatience, secouera-t-elle, de dessus son dos vigoureux, les cavaliers maladroits. Tout cela est encore dans l'avenir, et je ne suis pas maître dans l'art de la divination.
Après tout ce que j'ai dit, voilà la question que l'on s'adresse involontairement. Quelle idée, quelle pensée apporte donc ce Peuple dans l'histoire? Jusqu'à présent, nous voyons seulement qu'il se présente lui-même, et c'est là, d'ordinaire, la condition de tout ce qui n'a pas encore mûri. Quelle idée apporte un enfant dans la famille? Rien autre chose que la faculté, la disposition, la possibilité d'un développement. Quant à savoir si cette possibilité existe, si les mucles de l'enfant sont vigoureux, si ses facultés y répondent, ce sont là des questions abandonnées à notre examen. Et voilà précisément pourquoi j'insiste aujourd'hui plus que jamais sur la nécessité d'étudier la Russie.
En face de l'Europe, dont les forces se sont épuisées à travers les luttes d'une longue vie, se pose un Peuple, dont l'existence commence à peine, et qui, sous la dure écorce extérieure du tzarisme et de l'impérialisme, a grandi et s'est développé, comme les cristaux croissent sous une géode; l'écorce du tzarisme moscovite est tombée, aussitôt qu'elle est devenue inutile; l'écorce de l'impérialisme adhère encore moins fortement à l'arbre.
Il est vrai que, jusqu'à présent, le Peuple russe ne s'est en rien occupé de la question de gouvernement; sa foi a été celle d'un enfant, sa soumission toute passive. Il ne s'est réservé qu'un seul fort, resté debout à travers tous les âges: c'est sa commune rurale, et par là il est plus près d'une Révolution sociale que d'une Révolution politique. La Russie naît à la vie comme Peuple, le dernier de tous, encore plein de jeunesse et d'activité à une époque, où les autres Peuples veulent du repos; il apparaît dans l'orgueil de sa force à une époque, où les autres Peuples se sentent fatigués et sur leur déclin. Son passé a été pauvre, son présent est monstrueux; il est vrai que cela ne constitue encor aucuns droits.








