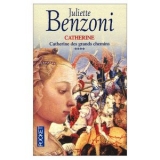
Текст книги "Catherine des grands chemins"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
– Ayez patience, mon ami... Il faut me laisser un peu de temps encore.
– Pourquoi ? Vous serez à moi, je le sens, j'en suis sûr. Tout à l'heure, vous avez frissonné quand je vous ai embrassée. Catherine, nous sommes jeunes tous les deux, ardents tous les deux... pourquoi attendre, pourquoi gâcher les heures si belles que le temps nous accorde ? Bientôt, il faudra que je parte. Beaucoup de mes compagnons sont déjà retournés au combat, je suis presque seul à m'attarder et l'Anglais tient toujours les meilleures places du Maine et de Normandie. Épousez– moi, Catherine...
Elle secoua la tête.
– Non, Pierre... pas encore ! C'est trop tôt...
– Alors, soyez au moins à moi, je saurai attendre que vous me tendiez enfin la main. Car vous me la tendrez. Vous serez ma femme et moi je passerai mes jours à vous adorer. Catherine, ne me laissez pas partir sans vous avoir faite mienne. L'image de vous que je garde, cette image de notre première rencontre, elle me brûle chaque fois que je ferme les yeux.
Catherine se sentit rougir. Elle aussi se souvenait de l'entrée tumultueuse de Pierre dans sa chambre tandis qu'elle prenait son bain.
Il l'avait déjà vue sans vêtements et, curieusement, cela le rapprocha d'elle comme s'il l'avait connue depuis longtemps. Elle s'abandonna plus mollement contre sa poitrine. Il avait repris ses lèvres sans qu'elle s'en défendît. D'une main, il la retenait contre lui, mais son autre main, libre, dénouait doucement les minces rubans d'argent de sa gorgerette, élargissant le décolleté encore sévère de la robe, cherchant la douceur de la peau. Elle le laissait faire, passive, déjà heureuse, attentive seulement au trouble qui l'envahissait, montant des profondeurs mystérieuses de sa chair.
D'un geste vif, il ôta la gorgerette, dénudant les épaules. La robe, largement ouverte, bâillait sur la gorge ronde qu'il se mit à caresser lentement, cherchant à éveiller le plaisir dans ce corps si longtemps désiré. Il plia ses reins, la fit couler doucement à terre, s'étendit contre elle.
Tous les parfums de l'été se liguaient contre la pudeur de Catherine et elle se laissait aller dans l'herbe douce, les yeux clos, vibrant déjà sous les lèvres de Pierre qui couraient de ses yeux à sa gorge. Il cherchait à dénouer la large ceinture de la robe dont ses mains impatientes, rendues maladroites, ne venaient pas à bout. Elle se mit à rire doucement, se redressa pour l'aider. Mais son rire s'étrangla, devint cri d'effroi. Une silhouette d'homme se tenait debout devant eux, l'épée nue à la main. Elle reconnut les oreilles de faune, la courte barbe de Bernard d'Armagnac !
– Debout, Pierre de Brézé, et rendez-moi raison !
– De quoi ? fit le jeune homme en se relevant sur un genou.
Catherine n'est pas votre femme, que je sache, ni votre sœur.
– De l'atteinte portée à l'honneur d'Arnaud de Montsalvy, mon frère d'armes, mon ami de toujours. En son absence, c'est à moi de veiller sur son bien.
– Le bien d'un mort ? fit dédaigneusement Brézé. Catherine est libre, elle sera ma femme. Laissez-nous en paix !
Catherine devina la tentation qui étreignait le Gascon de tout dire, de crier la vérité. Elle eut peur, supplia :
– Bernard, par pitié !
Il y eut une toute légère hésitation encore dans la voix sèche du comte, mais il dit, avec une sorte de lassitude :
– Vous ne savez pas ce que vous dites ! Battez-vous si vous ne voulez pas que je vous traite de lâche.
– Bernard, répéta Catherine épouvantée, vous n'avez pas le droit... Je vous défends !
Elle s'accrochait au cou de Pierre, inconsciente de sa semi-nudité, folle à l'avance en pensant que le sang allait couler. Mais il l'écarta, fermement.
– Laissez-moi, Catherine ! Ceci ne vous regarde plus. J'ai été insulté !
– Pas encore. Et je vous défends de vous battre. Bernard ne peut rien contre vous. Je suis libre de me donner à vous si bon me semble.
– Je voudrais, gronda Bernard avec rage, que La Hire ou Xaintrailles puissent vous voir, à demi nue comme une ribaude, accrochée au mâle que vous avez peur qu'on vous tue ! Ils vous étrangleraient sur place. Je vous aimais mieux sur le bûcher de Montsalvy.
– Pour cette insulte, Pardiac, je vais te tuer ! hurla Pierre furieux en ramassant son épée dans l'herbe. Défends-toi !
Le premier choc des armes arracha des étincelles. Catherine, tremblante, malade de honte, s'était reculée sous un arbre et machinalement réparait le désordre de sa toilette. Elle se haïssait à cette minute précise, confuse et gênée à la pensée de ce qu'avait vu Bernard.
Le combat était acharné. Les deux hommes semblaient de force sensiblement égale, Pierre de Brézé avait l'avantage de la taille, d'une puissance sans doute supérieure, mais Cadet Bernard se rattrapait grâce à une souplesse étonnante. Il avançait et reculait avec la rapidité d'un serpent. La lourde épée semblait le prolongement même de son corps maigre. Les souffles rapides des combattants emplissaient la nuit.
Adossée au tronc rugueux de l'arbre, Catherine tentait de calmer les battements désordonnés de son cœur. Si Pierre était tué, elle ne se le pardonnerait pas, et pas davantage si c'était Cadet Bernard car elle aurait l'impression d'avoir atteint Arnaud à travers lui. De toute manière, si l'un d'eux mourait elle serait déshonorée, chassée de la cour. Tout le poids de sa faute retomberait sur son fils... L'avenir de Michel ferait les frais de la conduite de sa mère.
Elle se tordit les mains, réprimant un sanglot.
– Ayez pitié, Seigneur ! supplia-t-elle. Faites quelque chose pour arrêter ce combat.
Mais rien ne venait du château muet, à peine éclairé à cette heure tardive. Pourtant le choc des larges lames avait l'air d'emplir la nuit. Il sonnait aux oreilles de Catherine affolée comme un bourdon de cathédrale. Comment pareil vacarme n'attirait-il pas de curieux, ne fût-ce que la ronde des guetteurs ?
Et, soudain, il y eut un faible cri auquel celui de Catherine fit écho.
Pierre, touché à l'épaule, venait de glisser dans l'herbe. Cadet Bernard recula, baissa son épée. Déjà Catherine se précipitait vers le blessé. Il avait porté la main à la blessure et des filets de sang striaient déjà cette main tandis qu'une grimace de souffrance tordait son beau visage.
– Vous l'avez tué ! balbutia la jeune femme désespérée. Il va mourir.
Mais Pierre se redressait sur un coude, essayait de sourire.
– Non, Catherine !... Il ne m'a pas tué. Rentrez au château, rentrez vite et ne dites rien à personne.
– Je ne vous laisserai pas.
– Mais si ! Je n'ai rien à craindre... Il m'aidera, ajouta-t-il en désignant son adversaire de la tête.
– Pourquoi vous aiderait-il alors qu'il désire uniquement votre mort ?
Dans l'ombre, les dents de loup du Gascon étincelèrent.
Froidement, il essuyait son épée, la remettait au fourreau.
– Vous ne connaissez vraiment rien aux hommes, ma chère.
Insinuez-vous que le pourrais l'achever ? Vous me prenez pour un boucher ! Votre amoureux a eu la leçon qu'il méritait, j'espère qu'il se le tiendra pour dit, voilà tout ! Rentrez chez vous et taisez-vous. Je m'occuperai de lui.
Il se penchait déjà pour aider le blessé à se relever. Mais Pierre le retint d'un geste.
– Dans ce cas, je refuse. Jamais je ne renoncerai à elle, sire Bernard. Aussi bien, il vous faudra me tuer.
Eh bien je vous tuerai plus tard !... quand vous serez remis, fit tranquillement Bernard. Rentrez maintenant, dame Catherine, ajouta-t-il sèchement, et laissez-moi faire ! Je vous souhaite la bonne nuit.
Domptée par cette voix impérieuse, elle s'éloigna lentement, quitta le verger, clos de murs, franchit le haut portail encore ouvert qui le faisait communiquer avec la cour du château sans trop savoir où elle allait. Elle brûlait de honte et d'humiliation. Son instinct seul la guidait, mais, en arrivant chez elle, ce fut pour trouver Sara debout au seuil de la porte. La honte se changea en colère à cette vue.
Elle lui jeta un regard furieux.
– Qui a envoyé Cadet Bernard au verger ? Est-ce toi ?
Sara haussa les épaules.
– Tu es folle ? Je ne savais même pas qu'il était revenu.
Décidément, ce Brézé t'a tourné la tête. Tu déraisonnes et, ma parole...
– Je te fais grâce de tes remarques. Oui, on a tenté de me le tuer ce soir. Cadet Bernard s'est battu avec lui... il l'a blessé. Mais vous perdez votre temps, tous tant que vous êtes, parce que vous ne nous séparerez pas ! Je l'aime, tu entends ? Je l'aime et je serai à lui quand je voudrai. Et le plus tôt sera le mieux !
– C'est bien mon avis, jeta Sara froidement. Tu te comportes exactement comme une bête en chaleur. Il te faut un homme, tu as trouvé celui-là : garde-le ! Quant à ton amour pour lui, je n'en crois rien. Tu te joues la comédie à toi-même, Catherine. Et tu sais bien que tu mens.
Tournant les talons, Sara regagna sa petite chambre dont elle ferma soigneusement la porte derrière elle. Stupéfaite par la violence de sa sortie, Catherine regarda cette porte close avec une sorte d'hébétude.
Quelque chose se noua dans sa gorge. Elle eut envie de courir à ce battant muet, de l'ébranler à coups de poing, de faire sortir Sara... Elle avait une envie enfantine de pleurer, de retrouver un instant le sûr asile des bras de sa vieille amie. Cette brouille qui les séparait lui faisait plus de mal qu'elle ne voulait l'admettre. Elle s'en était défendue par l'orgueil et voilà que, tout à coup, l'orgueil paraissait bien fragile. Il y avait, entre elles, tant d'années d'affection, tant d'épreuves subies ensemble, tant de vraie tendresse ! Sara, peu à peu, avait pris la place de sa mère et Catherine avait l'impression d'être amputée d'une partie d'elle-même.
Elle fit quelques pas vers la porte, leva la main pour frapper. Aucun bruit ne se faisait entendre de l'autre côté... Mais, sur l'écran de sa mémoire, elle revit Pierre blessé, elle entendit sa voix qui parlait d'amour... Si elle laissait faire Sara, celle-ci saurait l'arracher au jeune homme. Or Catherine ne voulait pas perdre ce fragile bonheur qu'elle n'attendait plus. Lentement, sa main retomba le long de sa robe.
Demain, elle irait au chevet de Pierre, elle le soignerait elle-même et tant pis si l'on voyait dans son attitude un présage d'union prochaine.
Après tout, qui donc pourrait l'empêcher de devenir la dame de Brézé
? Pierre la suppliait d'accepter et elle finissait par en avoir envie, ne serait-ce que pour mettre l'irréparable dans sa vie. Murée dans son entêtement, elle revint vers son lit, s'y laissa tomber.
Le dernier regard qu'elle jeta vers la porte close était un regard de défi.
L'après-midi était déjà bien avancé lorsque Catherine, quittant sa chambre, se dirigea vers la tour polygonale où Pierre de Brézé avait son logis. Elle avait prétexté une migraine pour ne pas suivre la reine Marie et les autres dames dans le verger, où elles avaient projeté de passer quelques heures en écoutant les chansons d'un ménestrel et en jouissant de la douceur du soleil.
À vrai dire, la migraine n'était même pas un mensonge. Depuis le matin, un cercle de fer serrait les tempes de Catherine. Elle avait affreusement mal dormi et le réveil tard dans la matinée avait été pénible. En effet, elle avait eu beau appeler Sara, personne n'avait répondu et quand, inquiète sans vouloir l'avouer, elle s'était décidée à franchir la porte si bien close la veille, elle avait trouvé le réduit à robes vide de toute présence humaine. Il n'y avait personne, mais, sur un coffre, bien en évidence, un morceau de parchemin.
Elle n'avait d'abord osé le toucher qu'à peine du bout des doigts, le cœur soudain serré, comme si elle avait craint ce qu'il renfermait... ce qu'elle devinait déjà. Les quelques mots tracés par Sara, d'une grosse écriture maladroite l'avaient à peine surprise : « Je retourne à Montsalvy... Tu n'as plus besoin de moi... »
La douleur qui l'avait traversée avait été si cruelle qu'elle avait dû s'adosser au mur, les yeux fermés pour la laisser se calmer. Mais sous les paupières closes les larmes avaient débordé, brûlantes, pressées...
Comme elle se sentait seule, tout à coup, abandonnée... presque méprisée ! Hier, elle avait dû supporter le regard vert, chargé de dédain du comte de Pardiac. Et, ce matin, Sara la fuyait ; comme si, d'un seul coup, le lien qui les unissait l'une à l'autre avait été tranché...
Ce lien, Catherine comprenait maintenant qu'il avait ses racines au plus sensible de son cœur. Sa rupture la laissait amputée d'une partie d'elle-même... une partie qui pouvait bien être l'estime de soi.
Son premier mouvement avait été de se jeter hors de sa chambre.
Elle voulait faire poursuivre Sara, la faire ramener au besoin par la force. Depuis le petit matin où elle avait dû fuir, depuis l'ouverture des portes, elle n'avait pas pu faire beaucoup de chemin. Mais Catherine se ravisa. Lancer les gens d'armes du Roi sur la piste de l'excellente femme comme derrière un malfaiteur ? Elle ne pouvait pas lui faire cela. L'orgueil natif de Sara ne le lui pardonnerait jamais et plus rien, alors, ne redeviendrait possible entre elles. La seule solution, c'était de courir elle-même à sa recherche... Elle y était décidée. Pourquoi avait-il fallu qu'au moment où elle achevait de s'habiller un page ait frappé à sa porte et, genou en terre, ait remis un nouveau message... un message qui, cette fois, venait de Pierre.
« Si vous m'aimez un peu, ma bien-aimée, venez... venez cet après-midi me voir. J'éloignerai tout le monde... Mais venez ! La fièvre de vous me brûle plus que ma blessure. Je vous attends... Ne refusez pas.
»
Les mots brûlaient ses yeux comme le souffle du jeune homme avait, la veille, enflammé ses lèvres. Une brutale envie de courir tout de suite vers lui, de pleurer dans ses bras, lui vint. Elle la repoussa.
Mais le charme du billet avait opéré. Catherine n'avait plus le désir de courir après Sara et, pour cela, se donnait toutes les raisons... Après tout, sa vieille amie ne s'en allait pas au bout du monde, là où elle ne pourrait jamais la retrouver. Elle ajlait simplement à Montsalvy...
Cette histoire s'arrangerait, un jour ou l'autre. De plus, courir après Sara serait lui donner une telle importance que Catherine s'en trouverait amoindrie. Le même sentiment qui l'avait, la veille, empêchée de frapper à la porte, la retint de faire seller un cheval.
À vrai dire, Catherine évitait de s'examiner de trop près.
Inconsciemment, elle n'était pas fière d'elle– même, mais plus sa nature réelle protestait, plus elle s'ancrait dans sa révolte. Le sourire de Pierre avait mis un bandeau sur ses yeux. Il représentait quelque chose qu'elle croyait ne plus jamais pouvoir atteindre : l'amour, le plaisir, la douceur de se laisser adorer, de vivre agréablement dans un monde sans souffrances, tout ce qui, en somme, était l'apanage de la prime jeunesse. Elle était comme l'alouette fascinée par l'étincelant miroir. Ses yeux ne voulaient, ne pouvaient plus rien voir d'autre...
Au seuil de la tour où logeait Brézé, le même page que le matin l'attendait pour la conduire chez son maître. Il salua profondément, puis s'acquitta en silence de sa mission. Une porte s'ouvrit sous sa main et Catherine, un peu éblouie, se retrouva dans une pièce inondée des feux du soleil couchant, où Pierre était étendu dans son lit.
– Enfin ! s'écria-t-il en tendant les deux mains vers elle tandis que le page s'éclipsait discrètement et que la jeune femme s'avançait jusqu'auprès du lit. Voilà des heures que je vous attends !
– J'hésitais à venir, murmura-t-elle, troublée de le trouver dans ce lit.
Jamais il ne lui avait paru plus beau, plus attirant qu'à cet instant. La puissance de son torse nu se détachait sur la courtepointe et les oreillers de soie rouge. Un pansement couvrait son épaule gauche, mais il ne semblait pas souffrir outre mesure. Son visage était un peu pâle, peut-être, mais ses yeux brillaient. Et si la fièvre était sans doute pour quelque chose dans la chaleur insolite des mains qui tenaient celles de Catherine, elle n'en était pas la seule cause.
– Vous hésitiez ? reprocha-t-il doucement en cherchant à l'attirer à lui. Pourquoi ?
Elle résista, saisie d'une gêne subite. L'insolite de sa présence dans cette chambre d'homme lui apparut tout à coup.
– Parce que je ne devrais pas être là. Songez à ce que l'on dirait si l'on m'y surprenait. Après ce qui s'est passé hier...
– Il ne s'est rien passé hier. Je me suis démis l'épaule en tombant dans un escalier. J'ai un peu de fièvre, je suis resté à la chambre. Quoi de plus normal ? Vous êtes venue, charitable comme un ange, prendre de mes nouvelles ? Quoi de plus naturel ?
– Et... Cadet Bernard ?
– Il chasse avec le Roi qui, comme vous le savez sans doute, courre le sanglier depuis ce matin. Et puis, est-ce que vous croyez que je vais me laisser intimider par lui ? Venez vous asseoir là. Vous êtes trop loin... Et puis, ôtez le voile qui cache votre ravissant visage.
Elle lui obéit en souriant, attendrie de lui voir ces exigences d'enfant gâté qui contrastaient si fort avec sa vigueur orgueilleusement épanouie.
– Voilà, dit-elle. Mais je ne reste qu'un instant. Le Roi ne va pas tarder à rentrer et Cadet Bernard avec lui.
– Je ne veux plus entendre son nom, Catherine ! s'écria le jeune homme qui rougit de colère. Encore une fois, vous êtes libre et il n'a rien à voir entre nous. Il vous a traitée indignement. Il aura encore à m'en rendre raison !... Mais, douce amie, ajouta-t-il, donnez-moi le droit de veiller sur vous.
– Mais... je ne vous en empêche pas, fit Catherine avec un soupir.
Veillez sur moi, mon ami... J'en ai grand besoin !
Et moi je le désire de toutes mes forces. Vous n'avez pas encore compris combien je vous aime, Catherine ; sinon vous m'auriez déjà dit oui.
Tout en parlant, il l'attirait insensiblement à lui et, tout doucement, avait posé ses lèvres sur les paupières qu'elle baissait. Sa voix se faisait berceuse, presque ronronnante.
– Pourquoi attendre ? Depuis votre rentrée en grâce, il n'est personne ici qui ne s'attende à ce que nous annoncions nos fiançailles.
Le Roi lui-même...
– Le Roi est bien bon... mais je ne saurais, si tôt...
– Si tôt ? Tant de femmes se remarient à peine un mois après la mort de leur époux. Vous ne pouvez demeurer ainsi, seule en face du monde, vainement belle. Il vous faut une épée, un défenseur, comme il faut un père à votre enfant.
Ses lèvres descendaient, à petits baisers rapides, jusqu'à celles de la jeune femme. Il s'en empara avec passion et, sous le baiser, elle ferma les yeux, envahie d'un délicieux bien-être, toute sa tristesse envolée.
– Dites que vous voulez bien, mon amour, pria-t-il tendrement.
Laissez-moi vous faire mienne à la face de tous ! Dites oui, Catherine, ma mie.
Le mot tendre creva l'ensorcelant brouillard dans lequel Catherine se laissait couler avec bonheur. « Ma mie ! » Arnaud l'appelait comme cela... et avec quel amour ! Elle crut entendre encore la voix de son époux lorsqu'il murmurait ces mots à son oreille. « Catherine, ma mie. » Personne ne savait le dire comme lui... Les yeux soudain humides mais les lèvres sèches, elle balbutia :
– Non... C'est impossible !
Elle s'écartait de lui, l'obligeait à dénouer les bras qui l'instant précédent la serraient si fort. Il se plaignit, avec une pointe d'irritation
: – Mais pourquoi impossible ? Pourquoi non ? Cela ne surprendra personne, je vous l'ai déjà dit. Pas même les vôtres. La dame de Montsalvy, elle-même, s'attend à ce que vous deveniez ma femme.
Elle comprend que vous ne pouvez demeurer seule.
Brusquement, Catherine s'était levée. Pâle jusqu'aux lèvres elle regardait Pierre avec des yeux à la fois incrédules et terrifiés.
– Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai mal entendu.
Il se mit à rire, tendant de nouveau les mains vers elle.
– Comme vous voilà effarée ! Mon cœur, vous faites une montagne de choses bien naturelles et...
– Répétez ce que vous avez dit, articula durement Catherine.
Qu'est-ce que ma belle-mère a à faire dans tout ceci ?
Pierre ne répondit pas tout de suite. Le sourire s'était effacé de ses lèvres, ses sourcils se froncèrent légèrement.
– Je n'ai rien dit d'extraordinaire ! Mais quel ton vous employez, ma chère !
– Laissez le ton que j'emploie et, pour l'amour de Dieu, répondez-moi. Que vient faire ici la dame de Montsalvy ?
– Peu de chose, en vérité. Je vous ai seulement dit qu'elle s'attendait à ce que vous deveniez ma femme. Lors de mon voyage là-bas, je lui ai confié le grand amour que vous m'avez inspiré, je lui ai dit mon désir ardent de vous épouser et la foi que j'avais dans ma victoire auprès de vous. C'était normal... je craignais tellement qu'elle ne voulût vous obliger à vivre dans le souvenir et dans ce vieux pays d'Auvergne. Mais elle a fort bien compris.
– Elle a compris ? fit Catherine douloureusement, en écho... Mais à quoi pensiez-vous pour oser lui dire cela ? Qui vous avait permis d'annoncer une chose pareille ?
– Le visage décomposé de la jeune femme impressionna Pierre.
Sentant instinctivement qu'il lui fallait se défendre contre un danger imprévu, il se drapa dans la courtepointe et sauta à bas de son lit.
Catherine s'était laissée tomber sur un banc, les yeux lourds de larmes contenues, les doigts froids et tremblants. Elle répétait : Pourquoi...
mais pourquoi avez-vous fait cela ? Vous n'en aviez pas le droit...
Il s'agenouilla auprès d'elle, prit entre les siennes les mains glacées.
– Catherine, chuchota-t-il, je ne comprends pas votre désolation.
J'admets que je me suis un peu trop hâté, mais je voulais savoir si vous n'auriez pas d'obstacles au cas où vous accepteriez de m'épouser.
Et puis, un peu plus tôt un peu plus tard...
Il était sincèrement désolé, elle le comprit et n'eut pas, sur le moment, le courage de lui en vouloir. Brutalement réveillée de l'état de rêve où elle vivait depuis des semaines, elle n'accusa pourtant qu'elle-même... Mais elle le regarda avec des yeux désolés.
– Et que vous a dit ma belle-mère ?
– Qu'elle espérait que nous serions très heureux, que je saurais vous donner le rang, la vie dont vous êtes digne.
– Elle a dit ça ? fit Catherine d'une voix étranglée.
– Mais oui... Vous voyez bien que vous vous désolez pour rien.
Repoussant les mains qui tentaient de la retenir, Catherine se leva.
Elle eut un petit rire sec.
– Pour rien... Écoutez bien, Pierre : vous avez eu tort de dire cela à cette noble femme sans raison.
D'un bond il se releva. Cette fois il était furieux et l'empoigna aux épaules.
– Quittez cet air de somnambule ! Regardez-moi ! Ce que vous dites est stupide. Je ne lui ai pas fait de mal et vous n'avez pas le droit de nous en punir tous les deux. C'est de l'orgueil, Catherine ! La vérité, c'est que vous craignez d'être mal jugée. Mais vous avez tort.
Vous êtes libre, je vous l'ai dit et redit cent fois. Votre mari est mort...
– Non ! jeta Catherine farouchement.
Ce fut à Pierre de vaciller sous le choc. Ses mains retombèrent sans forces tandis qu'il regardait la jeune femme dressée devant lui, les dents serrées, les poings crispés.
– Non ? Que voulez-vous dire ?
– Rien d'autre que ce que je dis. Mon époux, s'il est mort pour la loi humaine, pour tous les hommes de ce monde, ne l'est pas sous le regard de Dieu.
– Je ne comprends pas... Expliquez-vous.
Alors, une fois encore, elle fit le lamentable récit, elle avoua l'affreuse vérité, mais, à mesure qu'elle parlait, elle éprouvait une sorte de délivrance. C'était comme si elle dépouillait la griserie des derniers temps, cette attirance à la fois romantique et sensuelle qui l'avait jetée un instant dans les bras de ce garçon. En affirmant la réalité vivante d'Arnaud, elle reprenait conscience de son amour pour lui. Elle avait cru pouvoir se détourner de lui, l'oublier, mais voilà qu'il se dressait de nouveau, incroyablement présent, entre elle et l'homme qu'elle avait cru aimer. Lorsqu'elle eut tout dit, elle planta son regard violet droit dans celui de Pierre.
– Voilà. Maintenant, vous savez tout... Vous savez surtout qu'en parlant mariage à cette pauvre mère vous avez commis une mauvaise action... mais dont je suis entièrement responsable. Je n'aurais pas dû vous laisser le moindre espoir.
Il se détourna, resserrant machinalement autour de ses reins l'étoffe rouge qui glissait en un geste dérisoire qui avait quelque chose de touchant. Tout à coup, il semblait avoir vieilli de dix ans.
– Je m'en rends compte trop tard, Catherine... et je le regrette...
C'est une affreuse histoire. Mais j'ose vous dire que cela ne change rien à mon amour, rien à ma décision de vous épouser tôt ou tard. Ma mie, je vous attendrai aussi longtemps qu'il faudra.
– Ma mie, murmura-t-elle. Il m'appelait ainsi... Et il le disait si bien.
Il se raidit sous cette comparaison qu'il devinait à son désavantage.
Moi, je le dis avec tout mon cœur... Catherine, fit-il, offensé, réveillez-vous ! Vous avez souffert abominablement, mais vous êtes jeune, vous êtes vivante. Vous avez aimé votre époux autant qu'il était possible d'aimer. Mais vous ne pouvez plus rien pour lui... et c'est moi que vous aimez.
Alors pour la seconde fois, avec la même détermination, Catherine répondit :
– Non !
Et, comme il reculait d'un pas, les traits crispés mais une lueur de colère dans les yeux, elle répéta :
– Non, Pierre, je ne vous aimais pas vraiment... Je l'ai cru un instant, je le confesse, et, voici une heure, je le croyais encore. Mais, sans le vouloir, vous m'avez ouvert les yeux. J'ai cru pouvoir vous aimer, je me trompais... Jamais je n'aimerai un autre homme que lui...
– Catherine ! gémit-il douloureusement.
– Vous ne pouvez pas comprendre, Pierre. Je n'ai jamais aimé que lui, jamais respiré que par lui, pour lui... Je suis la chair de sa chair et, quoi qu'il lui arrive, quelques ravages que puissent faire en lui le mal maudit, il demeurera toujours pour moi l'unique... le seul homme au monde. Ma vieille Sara, qui m'a quittée ce matin à cause de vous, ne s'était pas trompée. J'appartiens à Arnaud, à lui seul...
Tant qu'il me restera un souffle de vie, il en sera ainsi.
Il y eut un silence. Pierre s'était écarté d'elle et s'approchait de la fenêtre. Le soleil achevait de se coucher, la lumière dorée devenait peu à peu violette... Au– delà de la rivière, une trompe sonna, puis une autre auxquelles répondirent les aboiements d'une meute.
– Le Roi, fit Pierre machinalement. Il revient...
Sa voix avait un son fêlé qui fit tressaillir Catherine.
Elle se tourna vers lui. Il ne la regardait pas... Debout devant la fenêtre sur laquelle se découpait sa silhouette vigoureuse, il ne bougeait pas. La tête baissée, il paraissait réfléchir, mais soudain Catherine vit remuer ses épaules. Elle comprit qu'il pleurait...
Une profonde pitié s'empara d'elle. Lentement, elle vint vers Brézé, leva la main pour la poser sur l'épaule du jeune homme, mais n'osa pas.
– Pierre, murmura-t-elle, je voudrais que vous n'ayez pas de peine.
– Vous n'y pouvez rien, répondit-il durement.
De nouveau le silence s'appesantit entre eux puis, toujours sans se retourner, il demanda :
– Qu'allez-vous faire ?
– Repartir, répondit-elle sans hésiter. Repartir là– bas, leur dire à tous que je n'ai pas changé, que je suis toujours « sa » femme...
– Et ensuite ? fit-il amèrement, vous vous enfermerez dans vos montagnes pour attendre la mort ?
– Non... Ensuite, j'arracherai Arnaud à cette léproserie infâme où j'ai dû le laisser entrer, je l'emmènerai dans un endroit reculé, tranquille et je resterai avec lui jusqu'à ce que...
Un frisson d'horreur secoua Brézé. Il se retourna brusquement, montrant à la jeune femme un visage ravagé.
– Vous ne pouvez pas faire ça... Vous avez un fils, vous n'avez pas le droit de vous suicider, surtout de cette manière atroce...
– C'est la vie sans lui qui est un suicide... J'ai rempli mon rôle ici.
Les Montsalvy sont redevenus ce qu'ils n'auraient dû cesser d'être. La Trémoille est abattu... Maintenant, je peux songer à moi... à lui.
Sans faire le moindre bruit, elle marcha vers la porte, l'ouvrit. Le page attendait au-dehors, mais, au seuil, elle se retourna. Toujours debout devant la fenêtre, Pierre esquissa le geste de lui tendre les bras.
– Catherine, supplia-t-il... Revenez à moi !
Mais elle secoua la tête, lui sourit avec une sorte de tendresse.
– Non, Pierre... Oubliez-moi. C'est mieux ainsi...
Puis, comme si, malgré tout, elle craignait de se laisser attendrir, d'entendre encore cette voix qui avait su l'émouvoir si dangereusement, elle tourna les talons et descendit l'escalier en courant. Quand elle déboucha dans la cour, les chasseurs sonnant du cor à s'arracher la gorge passaient la voûte en trombe. Elle vit le Roi au milieu d'eux et, auprès de lui, la mince silhouette de Bernard d'Armagnac qui riait. D'un seul coup, le vaste enclos fut grouillant d'une vie chaude, colorée. Quelques dames accoururent, d'autres s'accoudèrent aux fenêtres, échangeant des plaisanteries avec les chasseurs. Des appels retentirent, des éclats de rire fusèrent. Mais, cette fois, Catherine n'eut pas envie de se mêler à eux. Arnaud l'avait reprise. Entre elle et ces gens, un fossé s'était creusé, trop profond pour qu'elle pût le franchir. Une seule main aurait pu la ramener dans ce monde dont, déjà, elle se sentait détachée. Et cette main n'avait plus le droit, ni la possibilité de le faire. Mais, au fond, c'était sans importance. Il lui fallait aller où était son destin et elle avait hâte, maintenant, de retourner vers les siens.
Le lendemain matin, Catherine fit ses adieux au Roi, après avoir obtenu, non sans peine, la permission de partir auprès de la reine Marie qui ne comprenait pas sa hâte de quitter la cour.
– Vous venez seulement d'arriver, ma chère, lui dit– elle. Etes-vous déjà lasse de nous ?
– Non, Madame... mais je languis de mon fils et je me dois à Montsalvy.
– Alors, allez. Mais revenez dès que cela vous sera possible avec l'enfant. Vous demeurez de mes dames d'honneur et le Dauphin aura bientôt besoin de pages.
Charles VII tint à peu près le même langage à la jeune femme, mais il ajouta :
– Les très jolies femmes sont rares et voilà que vous voulez partir
? Qu'a-t-elle de si attirant cette Auvergne que vous désirez tant la retrouver ?
– C'est un admirable pays, Sire, et vous l'aimeriez. Quant à ce qui m'attire là-bas, que Votre Majesté me pardonne de lui dire que ce sont d'abord mon fils et ensuite des ruines.







