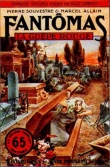Текст книги "Le mariage de Fantômas (Свадьба Фантомаса)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
Le gardien du cimetière, plus aguerri peut-être que les autres, eu égard à sa profession et à l’accoutumance qu’il avait contractée de vivre comme chez lui parmi les morts, s’était mis au premier rang et, prenant le bras de Barnabé, il l’entraînait avec lui.
– Viens voir, dit-il, c’est pas possible, il faut tirer cette affaire au clair.
Barnabé n’était pas plus rassuré que cela, d’autant qu’il venait de remarquer quelque chose qui n’était guère pour lui convenir.
La dernière apparition du spectre mystérieux venait de se produire à droite du carrefour de l’avenue de l’Ouest. Or Barnabé savait que c’était là que se trouvait le caveau de la famille de Gandia, que c’était là que, quelques jours auparavant, on avait enseveli la bière remplie de sable dont il avait si mystérieusement dissimulé le contenu au commissaire des morts, d’accord avec le père Teulard. S’agissait-il là d’une pure coïncidence, ou bien alors fallait-il y voir un rapprochement avec cette louche aventure ?
Barnabé se laissa entraîner par le gardien. Il se rapprocha de l’endroit où le spectre venait d’apparaître, mais dont il avait aussitôt disparu. Avec les agents et quelques personnes, il fit le tour du caveau de la famille de Gandia. Les investigations se poursuivaient sans le moindre résultat. Décidément, le spectre, s’il y en avait un, semblait s’être évanoui pour de bon, ou alors il avait fui devant l’attitude énergique de ceux qui semblaient décidés à le poursuivre.
Pendant quelques minutes, les uns et les autres cherchèrent dans l’entourage des tombes et des caveaux, lorsque soudain un cri de surprise s’éleva un peu plus loin. On accourut, on se trouva en présence d’un homme que déjà l’on avait remarqué à l’entrée du cimetière, se mêlant à la foule qui voulait y pénétrer. Puis, cet homme avait disparu, mais on le reconnaissait maintenant. Barnabé, les agents se souvenaient de lui, c’était le domestique de bonne maison, c’était le cocher qui avait été, lui aussi, des premiers à découvrir le spectre du pont Caulaincourt.
Cet homme, insoucieux des questions qu’on lui posait, n’y répondait point. Il demeurait à demi penché vers le sol, regardait avec la plus grande attention quelque chose qui gisait par terre, précisément au pied du monument funéraire de la famille de Gandia.
Le gardien du cimetière se pencha et prit dans ses mains quelque chose d’insolite, qui se trouvait sur le sol. On se précipita autour de lui pour voir, chacun s’exclama :
– Des vêtements.
C’étaient des vêtements, en effet. Il y avait là un pantalon d’homme, un gilet largement échancré, une chemise blanche molle et une sorte d’habit noir, d’une coupe excellente. Le drap était d’une finesse extrême. À en juger par leurs dimensions, les vêtements allaient à un homme de taille moyenne, mais cependant, à les toucher, il semblait qu’ils devaient « fondre » dans la main, pouvoir se plier et se dissimuler dans une poche, tant ils étaient souples et peu consistants.
On s’efforçait de les étendre. Ils avaient été chiffonnés, on voulait leur rendre leur forme première. Aidé du fossoyeur et du gardien, le cocher y parvint. Sur la pierre tombale la plus voisine, on avait étendu cette étrange dépouille masculine et, dès lors, les assistants poussaient un murmure de stupéfaction : c’étaient bien là les vêtements que portait le spectre qu’ils avaient vu. Ils avaient les habits du revenant, mais qu’était devenu celui-ci, comment avait-il pu disparaître ?
Pendant une bonne heure encore, on fouilla le cimetière. Ce fut en vain. Les gens qui perquisitionnaient dans la nécropole en furent pour leur curiosité et leur angoisse ; depuis qu’il avait abandonné ses vêtements aux vivants, le fantôme ne réapparaissait plus.
Qu’est-ce que tout cela signifiait ?
Découragés, lassés, troublés aussi par cette heure mystérieuse, affolante qu’ils venaient de vivre, les uns et les autres avaient hâte de s’en aller,
– Pourvu, proférait le gardien du cimetière, qu’il n’y ait pas de scandale.
Et il s’efforçait d’expliquer la présence de ces vêtements, en affirmant naïvement :
– C’est quelqu’un qui, en passant, a dû les oublier là.
On faisait semblant d’être de son avis, on hochait la tête, et les agents eux-mêmes, satisfaits de voir que personne dans la foule ne tenait à soutenir l’opinion première, à savoir que l’on avait bien vu une apparition surnaturelle, se rangeaient à l’avis du gardien. L’un d’eux affirma, sentencieux :
– C’est pas la peine de faire une histoire avec cet incident, comme vous le dites, monsieur le gardien, c’est sûrement des vêtements qu’un passant a oubliés dans le cimetière, ou, alors, des habits qu’un farceur a jetés par-dessus le pont. On ne fera pas de rapport pour une semblable bêtise.
Cette déclaration faite, les agents se retiraient, regagnaient rapidement l’avenue Rachel. Le gardien referma sa porte, après avoir recommandé à Barnabé :
– Tâche de tenir ta langue, mon vieux, inutile d’ébruiter cela.
Barnabé hocha la tête, certifia que tel était bien son avis. Et, en effet, pour rien au monde, le fossoyeur qui, cependant, était effroyablement troublé, n’aurait été désireux d’attirer encore l’attention sur le phénomène incompréhensible dont il avait été, pour ainsi dire, le premier témoin.
10 – PRISONNIER DE FANTÔMAS
Juve venait de pénétrer dans le petit cabinet qui lui était réservé à la Préfecture de police et qui formait en quelque sorte son bureau particulier.
Grâce à ses nombreuses enquêtes policières, grâce à sa renommée, à sa popularité, à l’estime toute particulière où le tenaient ses chefs, Juve jouissait d’une liberté absolue et n’avait jamais à justifier de l’emploi de son temps. Quand il passait à la Préfecture, c’était fort bien. Quand il n’y passait pas, nul ne s’en étonnait, car on savait que, comme toujours, la raison de son absence était une enquête difficile, une poursuite périlleuse.
Juve, ce jour-là, en arrivant, avait trouvé au bureau un formidable amoncellement de courrier, disposé sur sa table par petits tas bien réguliers.
– Oh, oh, s’écria-t-il, en examinant, sans y toucher, les piles de lettres, il y a décidément bien des gens qui éprouvent le besoin de me faire des confidences. Si jamais j’entreprends de lire toutes ces lettres, j’en ai pour huit jours de travail.
La perspective souriait peu à Juve et il hésitait à commencer ce dépouillement, lorsqu’il se prit à sourire.
– Que je suis bête, murmurait-il. Parbleu, les lettres anciennes ne sont plus intéressantes. Les lettres récentes seules peuvent m’apprendre quelque chose d’utile. Les lettres anciennes, ce sont assurément celles qui sont recouvertes d’une épaisse couche de poussière, je les laisserai de côté. Mais voyons sans plus tarder le courrier de ces derniers jours.
Juve s’était débarrassé de son chapeau, avait jeté son pardessus sur une chaise. Il alluma une cigarette, commença d’ouvrir sa correspondance.
Le courrier de Juve était une chose curieuse, tragique aussi. Il y avait de tout dans les lettres que l’on envoyait au célèbre policier. Des correspondants anonymes le suppliaient de s’occuper de certaines affaires dont ils lui signalaient, avec une remarquable maladresse, les détails qui leur semblaient mystérieux. D’autres l’appelaient au secours. D’autres encore, et ceux-là, il n’était pas besoin de chercher longtemps, pour deviner leur qualité d’apaches, lui faisaient d’épouvantables menaces.
Juve avait déjà dépouillé une bonne partie de sa correspondance récente lorsqu’il tomba sur une toute petite enveloppe, presque une enveloppe de carte de visite où, d’une écriture renversée, ferme et intelligente, on avait tracé à l’encre rouge :
Pour Monsieur Juve, inspecteur de police, et pour lui seul.
– Bigre, fit Juve, en considérant cette enveloppe, le particulier qui a écrit ça m’a l’air de tenir à la discrétion. Encore une histoire de femmes, sans doute.
Juve se leva, alla chercher dans la poche de son pardessus une nouvelle cigarette, revint à sa table de travail, et, sans se dépêcher, l’esprit ailleurs, ouvrit la petite enveloppe qu’il avait d’abord repoussée.
Il en tira une feuille de papier visiblement détachée d’un carnet, une feuille de papier assez commune quadrillée de bleu en tous sens.
– Mon correspondant n’est pas riche, sourit Juve en ouvrant la lettre.
Tiens, que se passait-il ? La feuille de papier tremblait maintenant dans sa main, il mordait ses lèvres, il ponctua sa lecture d’un furieux juron quand il l’eut terminée :
– Ah, crédibisèque, qu’est-ce que cela veut dire ?
Il se tut quelques instants, puis il répéta :
– C’est à devenir fou, En tout cas, je dois y aller voir.
Juve marchait de long en large dans son bureau, les mains derrière le dos, la tête penchée en avant, puis sembla prendre une résolution. Il bondit plus qu’il ne courut vers son pardessus, l’enfila avec une rapidité fébrile, puis s’arrêta net, demeurant immobile :
– Ah ça, murmura Juve, je deviens fou, c’est par trop violent, comment aurait-il pu jeter cette lettre à la poste ?
Juve revenait sur ses pas, s’approcha de son bureau, reprenait la lettre qui l’avait si fort ému et il relut à voix haute et intelligible :
Monsieur Juve,
Je suis aux mains de Fantômas, prisonnier de ce sinistre bandit Sans doute, je suis condamné à mort. En tout cas, dès maintenant, le misérable me fait subir d’affreux sévices. J’ai été mutilé, on m’a coupé les deux oreilles. J’ignore ce que demain me réserve, chaque jour je m’attends aux plus horribles supplices, sauvez-moi monsieur Juve. Je vous écris avec mon sang, sauvez-moi. Où suis-je ? je ne sais trop. J’ai entendu dire que ma prison s’appelait le Château Noir. Cela ne doit pas être loin de Rambouillet. Enfin j’ai confiance en vous. Si vous pouvez venir, venez, vous arracherez à une mort trop certaine, votre affectionné
Backefelder.
Juve, ayant lu, murmurait :
– Backefelder, c’est Backefelder qui m’envoie cela ? mais c’est impossible voyons, pourquoi Backefelder serait-il torturé par Fantômas ? Sans doute, Fantômas sait qu’il est riche, il le sait millionnaire, mais ce n’est pas en le torturant qu’il en tirera de l’argent. De plus, Backefelder a rendu des services à Fantômas. Et puis, enfin, comment, mon Dieu, Backefelder m’aurait-il envoyé cette lettre ?
Les deux oreilles coupées provenaient donc de l’ex-ambassadeur de Fantômas ? songea-t-il.
Puis, avec la brusquerie qui lui était coutumière, Juve enfonça son chapeau sur sa tête, sortit de son cabinet de travail dont il claqua la porte, quitta la Préfecture de Police.
Juve longea le quai sur quelques centaines de mètres, tourna dans la caserne de Gardes Républicains qui se trouve en face du Palais de Justice et dans la cour de laquelle sont installés les laboratoires officiels de la ville de Paris.
Juve, connu comme il l’était, obtint aussitôt d’être mis en présence de l’un des savants qui dirigent le Laboratoire municipal. D’un geste brusque, car il était sous le coup d’un énervement profond, il tendit au maître de la science la lettre qu’il venait de recevoir.
– Ne lisez pas, disait-il, ce qu’il y a d’écrit n’a aucun intérêt. Je voudrais savoir seulement si réellement cette lettre a été écrite avec du sang.
Le savant s’inclina sans répondre, et commença à préparer un réactif.
Quelques instants plus tard, il se tournait vers Juve :
– Il n’y a aucun doute à avoir, c’est bien du sang qui a servi à écrire cette lettre, et du sang humain.
– Je vous remercie.
Juve avait déjà pivoté sur ses talons et sans même dire au revoir au savant qui pensait à part lui : Quel original ! il quittait le laboratoire.
Dehors, Juve avisait un taxi-auto :
– Combien pour me mener à Chevreuse ?
Le chauffeur demandait cent francs.
– Allez, répondit Juve.
Et il se jeta sur les coussins de la voiture.
Juve n’hésitait nullement à se rendre à Chevreuse, pour la bonne raison qu’il connaissait parfaitement ce que Backefelder, dans sa lettre, appelait : le Château Noir. Jadis, à la suite d’une fracture qu’il avait reçue au cours d’une arrestation périlleuse, alors qu’il n’était encore que tout jeune brigadier attaché au service des garnis, Juve avait été se reposer quelques jours dans la délicieuse vallée de Chevreuse.
Comme il était naturel de sa part, il avait alors passé son temps à étudier le pays. Et il se rappelait parfaitement que les paysans désignaient sous le nom de Château Noir une vaste propriété entourée de hauts murs, alors abandonnée.
– Parbleu, se disait maintenant Juve, il ne doit pas y en avoir des quantités, de Châteaux Noirs dans les environs. C’est le hasard qui me sert pour une fois, ce doit être là que Backefelder est enfermé. Si vraiment Backefelder est prisonnier…
Le taxi-auto qu’avait pris Juve était par exception en parfait état de marche. Sans incident ni ennui, il amenait Juve jusqu’à quelques kilomètres du Château Noir et le policier, quittant la voiture, paya puis s’enfonça à pied dans les bois qui allaient lui permettre d’approcher du Château Noir sans se montrer.
Il était à cet instant près de trois heures après-midi, la lumière du soleil inondait les champs. Juve hésita quelques instants. Devait-il tenter d’entrer dans le château avant la nuit tombée ? puis il se décida, après réflexion, à agir au contraire le plus vite possible.
– Marchons, marchons, se répétait-il. De deux choses l’une : ou je cours à un piège de Fantômas, ou je cours sauver Backefelder. Si je veux sauver Backefelder, il faut que j’arrive le plus vite possible. Qui me dit que le malheureux ne compte pas les secondes en m’attendant ?
Juve s’orientait facilement grâce à une prodigieuse mémoire des lieux, et il parvint sans encombre à l’enceinte même du Château Noir. Rien n’avait été changé depuis que Juve avait passé quelque temps dans la vallée de Chevreuse. La propriété était toujours à l’abandon, des lierres grimpants recouvraient presque les murailles, le parc que l’on apercevait par moments, à travers les petites portes grillées paraissait inculte, envahi par les mauvaises herbes et la broussaille.
Juve, lentement, fit le tour du château. Il y avait bien près de deux kilomètres de murailles et cependant, patiemment, il les longea, inspectant et regardant de tous côtés.
– Il ne s’agit pas d’escalader à la légère, murmurait Juve. Si je pénètre là-dedans par la grande entrée et si le château est habité, il est bien probable que je n’arriverai pas jusqu’à celui que je veux sauver. Si, d’autre part, j’escalade le mur à un point quelconque, je peux très bien me trouver aux prises avec des difficultés que je ne soupçonne pas.
Le tour du château fait, Juve, qui ne sentait pas la fatigue, encore que depuis deux heures il piétinât sur le sol boueux du bois, tint conseil avec lui-même :
– Voyons, disait le policier, j’ai noté, outre la grande entrée, quatre petites portes de fer cadenassées, mais faciles à ouvrir. Dois-je entrer par là ? Hum ! si véritablement Fantômas a fait une prison du Château Noir, il est à présumer qu’il a établi des travaux de défense, les portes sont peut-être munies d’un signal électrique. Allons, prenons-en notre parti, sautons ce mur.
Lestement, en gymnaste habile qu’il était, le policier s’agrippait au lierre, s’aidait d’un arbre, et parvenait à franchir la muraille. Du faîte, il sautait sur le sol. Il était en plein parc, à cent mètres peut-être de la grande entrée, c’est-à-dire du côté de la façade du château.
Juve, une fois entré dans le parc, avait naturellement prêté l’oreille : aucun bruit.
– De mieux en mieux, pensa-t-il, si Fantômas est là, il doit y être seul et n’attend pas ma visite !
Par crainte de s’égarer dans le parc, d’ailleurs, Juve, toutes réflexions faites, décida de s’engager dans une sorte d’allée qui longeait la grand-route et menait au perron du château.
– On ne doit pas me voir de l’habitation, murmurait-il.
Mais cependant, par acquit de conscience, il longeait les fourrés. Juve, à ce moment, arrêtait dans sa tête un plan d’opération.
– Je vais tout tranquillement, pensait-il, me rendre à la porte des cuisines. Je sonnerai, je frapperai, et de deux choses l’une : ou l’on viendra m’ouvrir et, dans ce cas, j’aurai à m’expliquer avec le personnage qui me recevra, ou bien on ne répondra pas à mes appels, et ma foi, tant pis, je fracture la porte.
Hélas, au moment même où Juve établissait son plan de bataille, il poussait un juron formidable :
– Ah, nom de Dieu ! Qu’arrivait-il donc ?
Absorbé par ses réflexions, Juve, suivant le petit sentier qu’il avait choisi, avançait sans prendre garde, pour tout dire, sans se méfier. Or, au moment où il posait le pied à terre, sur un lit de mousse, voilà qu’il avait senti que le sol se dérobait sous lui, que son pied enfonçait dans le vide, que la mousse s’écroulait, qu’il tombait.
Juve eut beau se jeter en arrière, se débattre, vouloir s’accrocher coûte que coûte au sol, il ne pouvait y réussir. La mousse sur laquelle il marchait lui avait voilé un piège épouvantable. Il tombait au fond d’un trou, profond de quelques mètres, creusé en forme d’entonnoir renversé, et le policier, en constatant la forme spéciale de ce précipice avait eu immédiatement l’impression qu’il ne parviendrait pas à remonter seul jusqu’au niveau du sol.
Juve, d’ailleurs, après avoir roulé sur les parois du précipice se meurtrissait et s’écorchait, s’affalant lourdement au fond. Il n’était pas tombé de haut, mais il était tombé en se débattant et sa tête avait porté si violemment contre une grosse pierre qu’il en était encore tout étourdi.
– Hum ! pensa Juve, en regardant l’extraordinaire ravin dans lequel il venait de choir, je ne peux guère me faire d’illusion, je viens de rouler dans une fosse qui doit être destinée à me servir de tombeau.
Juve, d’ailleurs, eut peu de temps pour réfléchir à l’horreur de sa situation. Il venait à peine de se relever, il avait à peine repris conscience, qu’une voix railleuse l’apostrophait :
– Décidément, mon cher Juve, vous avez lourdement manqué de flair depuis ce matin et vous accumulez les gaffes !
Oh, cette voix, cette voix qui parlait, qui appartenait à un homme invisible, Juve la reconnaissait à la minute. Il n’y avait qu’un être au monde qui pût rire de ce rire.
– Fantômas, hurla Juve, finissons-en ! Vous m’avez pris, tuez-moi, j’aime mieux périr en tombant dans un piège dressé à ma pitié que vivre en étant lâche ; je me doutais bien que Backefelder n’était pas votre prisonnier, je pensais bien que la lettre de ce matin était une ruse, tant pis, je ne pouvais pas risquer la possibilité de ne point aller au secours d’un malheureux.
Mais la voix de Fantômas interrompit Juve :
– La paix ! ordonnait rudement le bandit, nous ne sommes pas ici pour faire des phrases. Et je n’ai nullement l’intention de vous tuer.
– Vraiment ?
– Je vous en donne ma parole.
– Juve, poursuivit Fantômas – mais désormais sa voix était devenue plus douce, moins sarcastique – Juve je veux que vous viviez.
– Grand merci, Fantômas, mais vos désirs ne seront pas réalisés, j’ai un revolver dans ma poche qui me permettra…
– Vous n’avez pas de revolver.
Avant même que Fantômas lui eût affirmé qu’il n’avait pas de revolver, Juve s’était aperçu, en effet, en se fouillant fébrilement, qu’il n’avait pas son fidèle browning. La poche de son veston avait été fendue, l’arme avait dû tomber. Juve avait été dépouillé de son seul moyen de défense sans qu’il s’en fût même rendu compte.
– Vous n’avez pas de revolver, poursuivait Fantômas, parce que j’ai fait en sorte que vous soyez désarmé, pour vous éviter toute pensée funeste. En revanche, Juve, vous avez dans la poche de votre pardessus une excellente paire de menottes, du système breveté récemment adopté par la Sûreté. Est-ce exact ?
– C’est exact.
– Alors, continuait Fantômas, voici ce que j’ai à vous proposer, Juve : vous êtes mon prisonnier, il vous est matériellement impossible de vous échapper de ce piège où vous avez eu la maladresse de tomber. D’autre part, je suis bien résolu à ne vous rendre la liberté que le jour où vous m’aurez dit où se trouve Hélène. Donnant, donnant. Jadis, en Angleterre, nous avons déjà fait un pacte et nous l’avons respecté. Faisons-en un nouveau. Dites-moi où est ma fille et vous êtes libre.
Fantômas faisait une pause. Juve, avec le flegme qu’il eût mis à discuter de questions totalement indifférentes, en profita pour remarquer :
– Mais tout cela n’a rien à faire avec mes menottes. D’ailleurs, Fantômas, je vous ai dit à maintes reprises déjà, je vous l’ai fait dire par Backefelder au moins, et Fandor vous l’a répété, que j’ignorais où était Hélène.
– Sans doute, mais je ne l’ai pas cru.
La discussion se poursuivait, surprenante, tragique et cependant fort calme. Juve jouait sa vie en répondant à Fantômas qu’il ne savait point où était Hélène. Fantômas, à coup sûr, qui recherchait sa fille avec tant d’ardeur, souffrait terriblement en entendant cette affirmation, et pourtant, ni lui ni le policier ne haussaient le ton, on eût cru qu’ils se trouvaient dans un salon, et qu’ils causaient de choses sans importance :
– Juve, je ne vous crois pas. Je sais que vous prétendez ignorer où est Hélène, mais peu m’importe. Je suis persuadé que vous pouvez retrouver ma fille ou m’aider à la retrouver. Voulez-vous vous allier pour cela avec moi ?
– Non.
– Vous préférez demeurer mon prisonnier ?
– Oui.
Et Juve était sincère, car, sachant l’amour que Fandor éprouvait pour Hélène, il ne pouvait admettre que la fille de Fantômas retombât jamais aux mains de son père, ce qui eût été évidemment le pire des malheurs pour la malheureuse jeune fille.
Or, à la réponse catégorique du policier, Fantômas avait paru pris d’une rage subite :
– Alors, hurlait-il, apprêtez-vous, Juve, à pourrir dans la prison que je vous choisirai. Au surplus, je suis persuadé que six mois, un an de captivité, vous feront changer d’avis. Et puis, il ne s’agit pas de cela, Juve. Pourquoi avez-vous voulu venir au secours de Backefelder ?
– Est-il donc votre prisonnier ? interrogea Juve.
– Sans doute, et ce sont bien ses deux oreilles que je vous ai envoyées à vous et à Fandor.
– Pourtant, la lettre était fausse, j’imagine ?
– Elle était écrite par moi, riposta Fantômas.
Mais le bandit s’interrompit :
– Ah ça, faisait-il, Juve, je vous trouve extraordinaire, ma parole. Vous m’interrogez, je n’ai plus à vous répondre. Taisez-vous. Mort de Dieu ! c’est moi qui commande. Vous devriez vous souvenir Juve, que les ordres de Fantômas sont sans réplique.
Juve se tut, attendant les événements.
Du fond de son trou, Juve entendait, sans le voir, Fantômas qui marchait de long en large, à quelque distance du piège. Brusquement le bandit s’arrêta, se rapprocha du précipice :
– Juve.
– Fantômas ?
– Je vous ordonne de vous passer les menottes que vous avez dans votre poche. Quand vous les aurez, vous me donnerez votre parole d’honneur qu’elles sont réellement cadenassées et vous me jetterez la clé.
– Et pourquoi ferais-je cela, Fantômas ?
– Parce que, faisait le bandit, j’ai l’intention de vous transférer de ce trou dans une autre prison où vous serez mieux, Juve. Juve, je ne veux pas que vous mourriez. Il faut que vous me disiez où est ma fille. Il faut que vous m’aidiez à la retrouver.
– Jamais !
– Si, vous aurez pitié.
– Pitié ? Je croyais que vous ne connaissiez pas le sens de ce mot, Fantômas ?
Ce fut le bandit qui n’osa point répondre. Juve, pourtant, au même moment songeait :
– Après tout, n’ai-je pas intérêt à être transféré hors de ce piège ? Je suis certain de ne pouvoir en sortir seul, qui sait si ailleurs je n’arriverai pas à fuir ?
Juve se passa les menottes, jeta la clé à Fantômas.
– Je suis prisonnier, déclara-t-il, emmenez-moi si vous le voulez.
Fantômas répondait :
– Aurez-vous pitié, Juve ?
Et il semblait, en vérité, tant il y avait d’angoisse et de souffrance dans cette question, que c’était Fantômas le vaincu.