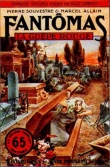Текст книги "Le mariage de Fantômas (Свадьба Фантомаса)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
– Quand vous aurez envisagé toutes les hypothèses, vous me préviendrez, Juve.
Juve s’arrêta, de sa voix calme, il déclara :
– J’ai terminé, en effet, pour le moment du moins, mais comme tu le dis fort bien, le problème est posé. Il ne reste plus qu’à le résoudre.
***
Tandis que Juve et Fandor envisageaient anxieusement les diverses hypothèses, à cette même heure, ce même soir, dans le coquet appartement du boulevard Malesherbes, occupé par le soi-disant baron Stolberg, deux êtres s’entretenaient tendrement, Fantômas et la Recuerda.
– Je suis effrayée de vos projets, Fantômas, disait l’Espagnole, et je me demande si jamais j’aurai le courage voulu ?
Mais le bandit l’interrompit, et serrant sa main délicate dans ses doigts vigoureux et énergiques :
– La Recuerda, déclara-t-il, avec emphase, vous êtes bien la femme qui convient à mon audace, à ma témérité. J’ai eu des maîtresses nombreuses, j’ai aimé dans mon existence, mais vous, vous êtes la femme qu’il me faut.
Puis, se penchant tendrement vers l’Espagnole, Fantômas effleura son front de ses lèvres. Puis il lui murmura à voix basse :
– Comprenez-vous bien le sens que je donne à mes paroles ? Je dis qu’il faut que vous soyez ma femme.
– Ne le suis-je pas déjà ? murmura la Recuerda en baissant les yeux.
– Vous êtes ma maîtresse, dit-il, nous ne sommes que des amants. Or si je dis que je veux faire de vous ma femme, c’est parce que, bientôt, nous serons unis l’un à l’autre par les liens indissolubles du mariage.
– Vous perdez la tête ?
– Je sais ce que je veux et ce que je veux, je le réalise. Vous serez ma femme légitime, la Recuerda, parce que je vous aime.
« Sa femme légitime ? la femme de Fantômas ? »
La Recuerda était si surprise, si étonnée, qu’elle ne savait que répondre. Certes, elle s’était sincèrement éprise de cet homme à la fois si tragique et si séduisant et son cœur ardent d’Espagnole éprouvait pour le bandit une attirance irrésistible.
Et la Recuerda se demandait quel pouvait bien être Fantômas ? Doucement, d’une voix presque imperceptible, elle murmura :
– Fantômas, qui est Fantômas ?
Le bandit, énigmatique plus encore qu’à son ordinaire, répliqua sur un ton solennel :
– Fantômas, c’est Fantômas, et cela suffit. Sachez cependant que Fantômas est le maître et qu’il fait toujours ce qu’il veut. Il n’est point d’obstacle qu’il n’écarte, de barrière qu’il ne franchisse. Lorsqu’il se produit quelque chose d’impossible, d’inexplicable, on est obligé de conclure que l’auteur de cette chose irréalisable n’est autre que Fantômas.
Le bandit, superbe dans sa déclaration, se rapprocha de l’Espagnole toute frémissante, il la serra sur sa large poitrine, et cependant que la Recuerda, émue au plus haut point, s’abandonnait à cette étreinte passionnée, Fantômas, déclarait très doucement :
– Vous serez ma femme, ma chérie. Lorsque nous serons unis légalement, nous atteindrons, grâce à l’Amour, la Fortune et la Richesse, au suprême Bonheur. Acceptez, la Recuerda ! Déclarez-moi franchement, les yeux dans les yeux et la main dans la main, que désormais nulle puissance humaine ne pourra vous faire rompre l’engagement que vous prenez vis-à-vis de moi ; de mon côté, je vous jure que votre existence sera la mienne, que nous serons désormais indissolublement liés.
Mais Fantômas s’interrompait. L’Espagnole, amoureusement, lui scellait les lèvres d’un long baiser d’amour.
29 – DEUX AMOUREUX
– Ce serait évidemment une excellente occasion pour passer en contrebande quelques paquets de cigarettes espagnoles, si, de l’avis unanime, les cigarettes espagnoles ne valaient pas, à beaucoup près, les cigarettes françaises. Dans ces conditions, le mieux est encore de ne pas faire tort à l’État d’un centime et de m’abstenir d’une opération qui ne me laisserait que des regrets. Où il n’y a pas de profit, il n’y a pas de plaisir.
Jérôme Fandor, gai, comme à son ordinaire, toujours plaisantant, se trouvait à la douane frontière d’Irun, dans la petite gare espagnole où s’arrête le Sud-Express, avant d’entrer en France et de filer à toute allure vers la capitale.
Pourquoi Jérôme Fandor s’était-il rendu à Irun ? Pourquoi lui, qui avait tant de raisons de garder un mauvais souvenir de l’Espagne, avait-il commis la redoutable imprudence de passer la frontière française et de gagner ainsi le territoire étranger ?
Il y avait beaucoup de raisons à cela, dont la principale était que Fandor, avec son insouciance habituelle, éprouvait un certain plaisir à narguer les gendarmes et la police et à se promener le plus ostensiblement dans un pays, où, pourtant, il possédait la redoutable qualité de condamné à mort.
– On verra bien s’ils me pincent, avait pensé Fandor en descendant du train qui l’avait amené de la capitale et puis ma foi, zut pour eux ! En ce moment Juve est libre, et j’imagine bien que si l’on me mettait la main au collet, mon respectable ami serait un peu là pour protester et me faire remettre en liberté dans les quarante-huit heures.
Ce n’était pas cependant le vain désir de narguer la police étrangère qui avait amené Jérôme Fandor au poste frontière.
– Mon petit, lui avait brusquement déclaré Juve, la veille même, faisant allusion aux terribles affaires dont ils poursuivaient tous deux l’éclaircissement depuis de longs jours, mon petit, il y a un fait de certain, c’est qu’en ce moment l’enquête patauge, s’éternise, n’aboutit à rien. Nous avons débrouillé quelques fils de l’écheveau que Fantômas a si bien emmêlé, mais nous ne tenons pas encore l’explication définitive. Tu es bien de cet avis, Fandor ?
– Tout à fait, avait répondu le journaliste.
– En ce cas, reprenait Juve, tu vas immédiatement te rendre à la gare et filer à la frontière espagnole. Je viens d’apprendre que l’infant don Eugenio doit accompagner le roi d’Espagne en Angleterre. Par conséquent, avec son souverain, don Eugenio traversera la France pour se rendre à Londres. J’imagine, Fandor, que tu devines comment nous allons tirer parti de cet événement. S’il y a quelqu’un au monde qui peut nous aider à deviner le rôle de Fantômas dans les aventures au milieu desquelles nous nous débattons en ce moment, c’est assurément don Eugenio. Malheureusement don Eugenio n’a point l’air décidé à nous faire des confidences. N’importe, il faut que toi ou moi nous l’abordions, que nous le fassions parler et par conséquent…
– Et par conséquent, vous m’expédiez dans le Midi pour aller tirer les vers du nez à ce respectable Espagnol qui est peut-être, après tout, la dernière des crapules. Bon, très bien, d’accord.
Là-dessus, après avoir encore quelque temps conféré avec Juve, Jérôme Fandor s’était rendu à la gare du quai d’Orsay, avait pris place dans le premier train en partance et s’était tranquillement rendu à Irun.
– Avec ça, monologuait Fandor, se promenant de long en large sur le quai de la gare frontière, avec ça que ça va être commode de rejoindre Eugenio !
Jérôme Fandor, toutefois, ne s’inquiétait pas outre mesure de la difficulté de la mission qui lui était confiée.
– En somme, se disait-il, avec une souriante philosophie, je sais que tout à l’heure, dans cette gare où je me trouve, un train de luxe va passer à bord duquel sera un personnage qu’il faut que j’interviewe. Pour réussir, il convient tout d’abord que je prenne place dans ce train. Quand le convoi filera, je me débrouillerai pour arriver jusqu’à don Eugenio.
Dans cet état d’esprit, Jérôme Fandor continuait à arpenter le quai de la gare d’Irun, furieux d’être arrivé en avance et d’avoir près de soixante minutes à faire comme il le disait pittoresquement « figure de parfait poireau ».
Or, il y avait au moins un quart d’heure que le journaliste s’ennuyait ainsi dans la petite gare, lorsqu’il se retourna en tressaillant :
– Tiens, une femme !
Quelques instants plus tard, il ajoutait :
– Oh, oh, et une jolie femme même !
Sur le quai désert, en effet, une gracieuse apparition venait de se montrer à quelque distance de Jérôme Fandor, une jeune femme vêtue de noir, habillée avec une sobre élégance qui n’excluait pas une certaine recherche, coiffée d’un chapeau dont les bords étaient recouverts par une épaisse voilette, allait et venait, ayant l’air, elle aussi, d’attendre le train spécial.
Jérôme Fandor, dans son ennui et baillant à toutes les minutes, contempla cette jeune femme distraitement, devinant qu’elle attendait elle aussi le convoi royal. Il pensa :
– Cette jeune femme est en avance comme moi.
Mais Jérôme Fandor éprouva comme un douloureux choc au cœur :
– Mon Dieu ! murmura-t-il.
Il était devenu blême, il tremblait de tous ses membres.
– Allons, je suis fou, se disait le journaliste, qu’est-ce que je vais imaginer ?
Pourtant, il avançait de quelques pas et au bruit qu’il faisait ainsi l’inconnue se retourna.
Une seconde peut-être Fandor pouvait alors apercevoir le visage de la jeune femme qui attendait le train où devaient se trouver Alphonse XIII et sa suite. Le regard de la jeune femme et celui de Fandor se croisèrent, et en cette minute, Jérôme Fandor croyait vivre mille vies. De son côté, la jeune femme semblait éperdue de surprise, elle avait porté, avec une hâte fébrile, ses deux mains à la poitrine comme pour comprimer les battements affolés de son cœur.
Fandor, comme un furieux, s’élança en avant vers la jeune femme. Elle demeura figée sur place.
Et, dans le silence de la petite gare, deux cris retentirent, deux cris d’amour :
– Hélène ! Fandor !
– Fandor !
– Hélène !
Hélène, pourtant, la première, en raison de son instinctive délicatesse de femme, se dérobait à l’étreinte du journaliste :
– Je vous en prie, dit-elle, on nous regarde.
Elle montrait des hommes d’équipe qui riaient, témoins de l’émotion des deux jeunes gens.
– Vous avez raison, répondait Fandor. Venez, Hélène, sortons de cette gare. Ah, mon Dieu ! Nous avons tant de choses à nous dire !
Il l’entraînait rapidement, comme s’il eût voulu la conduire très loin, puis, brusquement, s’arrêta.
Fandor, comme un enfant qui a peur, avec une parfaite naïveté, avait besoin d’être heureux, tout à fait heureux et il demandait, quoique ce fût bien inutile.
– Hélène, vous m’aimez toujours ?
La jeune femme le regarda de ses grands yeux, Jérôme Fandor lut la réponse qu’il désirait :
– Venez, venez, j’ai remarqué un petit bois tout à côté. Là, nous serons tranquilles.
***
Vingt minutes plus tard, Jérôme Fandor et la fille de Fantômas étaient installés dans une verte prairie et causaient à voix basse, tendrement pressés l’un contre l’autre.
Hélène, secouait la tête et calmait Jérôme Fandor :
– Vous êtes méchant, disait-elle, vous devriez savoir, mon pauvre ami, que si je vous ai fait de la peine, cela a été bien involontaire. Je n’y suis pour rien. Il n’y a nullement de ma faute dans ce qui est arrivé.
– Allons donc !
– Écoutez-moi Fandor, et vous jugerez.
Et la jeune fille, alors, fit à Jérôme Fandor l’hallucinant récit de ses dernières aventures.
À un moment donné, Fandor l’interrompit :
– Ma pauvre chère Hélène, quand je pense que cet infâme gredin de don Eugenio vous a réellement enlevée !
– Vous vous trompez Fandor, déclarait la fille de Fantômas. Don Eugenio n’est pas un infâme gredin, c’est au contraire un galant homme, un très galant homme.
– Pour Dieu, Hélène, répondez-moi, vous l’aimez donc ? Comment pourriez-vous le défendre si ce n’était pas ? Il vous a fait enlever. Ah, vous l’aimez !
– Vous êtes fou, je n’aime pas don Eugenio, je ne peux pas l’aimer, puisque je vous aime. Voyons, laissez-moi parler et vous comprendrez.
Encore tremblant de jalousie, Jérôme Fandor se jetait à genoux aux pieds de celle qu’il adorait :
– Parlez, alors, par pitié, parlez ! Hâtez-vous, vous me faites souffrir mille supplices !
– Ne vous tourmentez donc pas.
Et elle poursuivit son récit :
– Don Eugenio est un galant homme, Fandor, pour la bonne raison que, m’ayant fait enlever, ce qui était en effet une sorte de lâche attentat, il s’est immédiatement rendu compte, dès qu’il s’est trouvé en face de moi que je n’étais pas la femme qu’il croyait et qu’il se déshonorerait à user de violence à mon endroit. Don Eugenio s’est conduit en parfait gentilhomme, en s’excusant de toute son âme de m’avoir fait enlever et, dès lors, il a employé avec moi les procédés les plus délicats. Pourtant je l’aime si peu, Fandor, que si vous m’avez rencontrée à Irun, c’est que je guettais le convoi royal où il doit se trouver pour y monter et lui faire une violente scène de reproches.
Et comme Fandor la regardait, n’ayant plus l’air de comprendre du tout ces paroles, Hélène, après un éclat de rire, poursuivit :
– Donc, Jérôme Fandor, tombée entre les mains de don Eugenio, j’obtins d’être respectée par lui. Ce gentilhomme m’aurait sans doute immédiatement remise en liberté si, à cet instant, il ne m’avait proposé un pacte étrange, s’il ne m’avait demandé de lui rendre le plus extraordinaire des services.
– Lequel ? mon Dieu.
– Don Eugenio, mon cher Fandor, se trouve être l’oncle d’une certaine jeune fille, nommée Mercédès, à laquelle il porte une vive affection et qui cependant lui cause de terribles tourments. Cette Mercédès, sa nièce, est la fille d’un de ses frères, mort récemment, et laissant après lui une fortune considérable. Naturellement, Mercédès avait hérité ou du moins, allait hériter et être mise en possession de cette fortune au moment où je connaissais l’infant. Or, Mercédès, sous le nom de la Recuerda, vivait une vie de débauche à Paris parmi les pires apaches.
– Je sais. Après ?
– Oh, c’est bien simple, ripostait Hélène. Don Eugenio me proposait ceci : il me suppliait d’accepter de passer aux yeux de tous pour sa nièce, pour cette Mercédès, puis, de me prêter à la comédie d’une mort fictive : « J’obtiendrais ainsi, disait-il, un acte de décès au nom de Mercédès de Gandia. Cet acte de décès dûment acquis, empêchera que la fortune de mon frère ne soit dilapidée par Mercédès, actuellement insensée. Je ne désespère pas de ramener ma nièce au bien, je voudrais pouvoir hériter à sa place, et par conséquent, pouvoir lui sauvegarder une fortune que je lui remettrai au moment de son repentir.
– Et vous avez accepté ?
– J’ai d’abord hésité. Je me suis renseignée, j’ai voulu savoir si don Eugenio était honnête homme. C’est seulement quand j’ai été convaincue que réellement il ne cherchait point à capter la fortune de sa nièce pour son intérêt propre que je me suis prêtée à la comédie qu’il désirait. C’est moi et non pas Mercédès qui ai fait la morte, à Paris, chez don Eugenio. C’est moi que l’on a mise en bière sous le nom de Mercédès. Mais bien entendu, en fait, c’est une bière pleine de sable que l’on a ensevelie au cimetière, à ma place.
***
Ils causaient encore l’un et l’autre, Hélène et Fandor, longuement, de l’aventure extraordinaire d’Hélène.
– Voyez-vous, disait la fille de Fantômas, je n’ai pas à regretter d’avoir rendu service à don Eugenio, car c’est grâce à lui que j’ai pu savoir votre captivité d’abord, votre condamnation ensuite. C’est moi qui ai téléphoné à Dupont de l’Aube qu’un Français était prisonnier à l’Escurial. C’est moi ensuite qui, grâce à don Eugenio, grâce à son argent, ai pu acheter le bourreau et obtenir qu’il ne vous exécute pas réellement. Je ne savais pas, bien entendu, que Juve s’occupait de son côté à vous sauver.
Et comme Fandor couvrait de baisers fous les mains de la jeune fille, Hélène continuait son récit :
– Par exemple, Fandor, depuis votre sauvetage, don Eugenio n’a pas été charmant à mon endroit. Le pauvre homme est sans doute terrifié par la crainte perpétuelle d’un scandale, car, le jour même où vous étiez arraché au garrot à Madrid, j’étais, moi, bel et bien appréhendée par des serviteurs de l’infant et conduite dans un couvent dont je n’ai pu m’échapper qu’il y a deux jours seulement.
Hélène allait encore ajouter un mot, donner d’autres explications, lorsque soudain, elle bondit sur ses pieds, poussait une exclamation de colère et de surprise à la fois :
– Ah mon Dieu, mon Dieu ! Regardez !
– Quoi ? qu’est-ce qu’il y a ?
Fandor s’était levé, aussi inquiet, prêt déjà à repousser une attaque.
Et soudain, il éclata de rire, cependant qu’à côté de lui, Hélène riait elle aussi.
– Ah, zut, tant pis, ma foi, dit Fandor.
Hélas, les deux jeunes gens, oublieux de l’heure, apercevaient, filant à toute allure, un train de luxe qui venait de quitter la gare d’Irun.
– Ma foi, tant pis. Oui, vraiment, tant pis. Juve se débrouillera à Paris… Et puis, je vous ai retrouvée, ma chère Hélène, que m’importe le reste ?
30 – L’INFANT D’ESPAGNE AU PIED DU MUR
Ce matin-là, Juve arriva avec son air le plus renfrogné au bureau de la Sûreté générale. Avant de se rendre au cabinet de M. Havard, il passa en divers services, et sans en avoir l’air, sous prétexte de serrer quelques mains amies, il fit causer les employés.
C’est ainsi qu’au service de la voirie et de la surveillance de la rue, Juve apprenait d’un sous-brigadier ce qu’il savait déjà d’ailleurs et dont il voulait la confirmation, que c’était ce même jour, à six heures cinquante du soir, qu’allait arriver à Paris le roi d’Espagne accompagné de plusieurs grands personnages de sa suite.
Le souverain et son entourage se rendaient en Angleterre sans s’arrêter à Paris, ils devraient simplement le traverser et se rendre de la gare d’Orsay à la gare du Nord pour y trouver la correspondance de Calais.
Juve, qui écoutait avec attention ces détails, apprenait encore du sous-brigadier de service qu’on avait réglé pour cette petite cérémonie un protocole discret et commandé quelques voitures automobiles qui devraient transporter, sans attirer particulièrement l’attention de la foule, le roi d’Espagne et sa suite de la gare d’Orsay à la gare du Nord.
Juve s’intéressait tout particulièrement à ce voyage du souverain espagnol, car il savait que le roi était accompagné d’un personnage qui n’était autre que l’infant don Eugenio, don Eugenio que Fandor, inspiré par Juve, avait dû rejoindre déjà à la frontière espagnole et qu’assurément il devait serrer d’aussi près que possible.
Juve, satisfait des renseignements qu’il venait d’obtenir, quitta le sous-brigadier et montant un étage, parvint au bureau somptueux occupé par M. Havard.
Le policier ne se dissimulait pas, en entrant chez le chef suprême de la Sûreté, qu’il aurait été fort satisfait d’être plus vieux de dix minutes. Juve, en effet, avait demandé à son chef une autorisation qui, d’abord avait fait bondir celui-ci. Mais cela ne troublait pas autrement Juve qui lui avait répété nettement qu’il tenait au plus haut point à obtenir l’autorisation sollicitée.
Or, Juve avait tout simplement demandé la permission de procéder à l’interrogatoire, et si besoin en était, à l’arrestation de l’infant d’Espagne.
Juve estimait, en effet, bien que l’enquête à laquelle il se livrait sur les mystérieuses affaires de Mercédès de Gandia et du pont Caulaincourt n’eût guère avancé depuis une quinzaine de jours, que don Eugenio devait avoir une importante part de responsabilité dans ces extraordinaires aventures.
Juve avait exposé nettement sa thèse depuis quelques jours déjà à M. Havard qui avait déclaré qu’il ne déciderait rien du tout sans en avoir référé au gouvernement.
Juve devait avoir la réponse le matin même.
– Eh bien ? interrogea-t-il, en entrant dans le bureau de M. Havard.
Celui-ci eut une mine ennuyée en voyant arriver l’inspecteur de la Sûreté :
– Eh bien Juve, répondit-il, c’est non ! Les membres du gouvernement ont discuté la question hier et sont tombés d’accord sur ce point qu’il fallait laisser l’infant d’Espagne traverser librement le territoire, et cela pour deux raisons : la première, c’est qu’il s’agit là d’un grand personnage, à la culpabilité duquel le gouvernement ne peut pas croire, et qu’en outre, un grand personnage comme don Eugenio ne peut vraiment être appréhendé sans que cette façon d’agir provoque de graves complications diplomatiques. Enfin, il y a un second point, que tout galant homme comprendra : le roi d’Espagne et sa suite traversent le territoire français sous la protection des autorités, ce serait enfreindre les lois de l’hospitalité que de procéder à une arrestation, même officieuse et momentanée, dans de pareilles conditions.
Juve fronça les sourcils, mais n’insista pas. M. Havard poursuivit :
– Il est bien évident que si l’infant d’Espagne se trouvait actuellement à son domicile de Paris, on pourrait agir. Le convoquer à la Sûreté, l’interroger avec tact et discrétion, même au besoin lui faire un peu peur pour le décider à parler. Ce n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui, mais ce n’est peut-être que partie remise.
– En somme, déclarait Juve, ce qui vous fait hésiter d’une façon toute particulière, c’est surtout ce fait que l’infant d’Espagne va traverser aujourd’hui Paris sous le couvert d’une sorte d’immunité diplomatique. Si au contraire il était, pour une période même courte, l’étranger vivant à Paris que nous avons connu et que nous connaîtrons encore, dans son domicile d’Auteuil, rue Erlanger, vous n’hésiteriez pas à m’accorder ce que je vous demande.
– Hum, c’est à peu près cela, mais je ne dis pas que nous n’hésiterions pas. Nous hésiterions moins. Voilà tout.
Juve, à son tour, sourit énigmatiquement, puis il se retira, laissant M. Havard à ses nombreuses occupations. Juve, quittant la Préfecture de Police, suivit les quais, la tête basse, l’air songeur. Visiblement, le policier méditait quelque plan.
L’arrivée du Sud-Express à Paris détermine chaque soir un mouvement important, à la gare d’Orsay. Les voitures et les équipages de luxe attendent, nombreux, cette arrivée dans la cour, cependant que tout le personnel des employés et des manœuvres fait la haie sur le quai de débarquement. Car on sait que les riches clients du train de luxe n’aiment guère porter leurs paquets eux-mêmes à la manière des voyageurs de troisième et qu’ils récompensent par de généreux pourboires les employés qui leur rendent ce service.
Dans le hall de la gare, quelque temps avant l’arrivée de ce train, on voit souvent des groupes élégants, de jolies femmes, des messieurs distingués, qui viennent attendre un ami, un parent, ou même simplement saluer au passage quelque personnalité notoire, car le Sud-Express est le grand trait d’union qui réunit le sud de l’Europe au nord, et par lequel arrive même de l’ancien continent une grosse partie de la grosse clientèle espagnole, portugaise ou sud-américaine.
Trois superbes limousines automobiles étaient rangées un peu à l’écart sous la marquise vitrée de la gare. Elles avaient été retenues pour le roi d’Espagne et sa suite et, au milieu de la foule de curieux qui attendaient pour savoir quels allaient être les personnages que l’on verrait monter dans ses somptueuses limousines, allaient et venaient quelques hommes aux allures de militaires en civil, aux fortes moustaches, aux mains rouges.
– Ils sont vraiment méconnaissables, dit ironiquement quelqu’un.
Ce quelqu’un, d’ailleurs, avait quelque raison pour reconnaître les policiers, car c’était Juve. Il s’approchait d’un gros homme, qui allait et venait, très affairé :
– Bonjour, Morel, dit-il.
L’homme s’arrêta. C’était un commissaire de police que Juve connaissait depuis fort longtemps.
Tous deux se congratulèrent, puis, cependant que le commissaire s’éclipsait, informant d’un air important qu’il avait des ordres à donner, Juve se rapprocha des mécaniciens qui causaient, sans toutefois s’être écartés de leur voiture.
Il avisa le pilote de la limousine verte et lui fit un clignement d’œil. Le chauffeur, à son tour, reconnaissait Juve et lui répondait par une respectueuse inclinaison de tête.
C’était un agent de la Sûreté qui avait son brevet de mécanicien et qui allait, non point piloter la voiture, mais se tenir sur le siège à côté du mécanicien.
– Alors, lui dit paternellement Juve, on pilote les têtes couronnées aujourd’hui ?
– Ma foi oui, monsieur l’Inspecteur, fit le jeune homme en souriant, c’est nous qui emmenons le roi d’Espagne.
– Ils seront combien dans sa voiture ?
– Trois : le roi, son aide de camp et le secrétaire.
– Et alors, poursuivit Juve, qui donc prendra la limousine bleue ?
L’agent de police esquissa un geste vague, cependant, il déclara :
– Un parent du roi, un infant d’Espagne avec deux autres personnes qui l’accompagnent.
Juve s’écarta. Il était évident qu’il avait recueilli des renseignements qui pouvaient lui être utiles. Puis, après avoir disparu dans la foule, il revenait près des voitures, attendant leur clientèle. Toutefois, il ne s’adressait plus à son premier interlocuteur, il venait conférer mystérieusement avec le pilote de la seconde voiture, et quiconque aurait considéré cet homme, aurait pu reconnaître que sous la livrée élégante et discrète dont il était revêtu, se dissimulait Michel, le collègue de Juve.
Les deux hommes échangèrent quelques mots en hâte et leur rapide entretien s’acheva par cette affirmation de Michel :
– C’est entendu, c’est compris, patron. Vous pouvez compter sur moi.
***
Le Sud-Express avait du retard et ce fut seulement quarante minutes après l’heure régulière que la grosse machine remorquant le convoi entra dans la gare, silencieuse, comme figée dans une respectueuse immobilité.
D’un premier wagon-lit, le roi d’Espagne sautait lestement à terre et, de son air perpétuellement aimable, saluait d’un geste large la foule qui s’écartait sur son passage.
Le jeune souverain était élégamment vêtu d’un pardessus mastic, il était coiffé d’un chapeau mou noir et à la boutonnière de son vêtement, il portait, par déférence pour le pays dont il était l’hôte, une large rosette de la Légion d’honneur.
Quelques jeunes hommes, fort élégants eux aussi, aux yeux noirs, aux visages bruns, sautaient du wagon sur le quai, suivaient le souverain.
Et Juve, dissimulé dans la foule, avait un tressaillement de satisfaction en apercevant don Eugenio au nombre de ces derniers.
Cependant, le policier fouillait de son œil perspicace la foule des voyageurs qui descendaient des autres wagons. Il attendit quelques instants que le train se fût vidé, puis son front se plissa.
– C’est extraordinaire, se disait Juve, Fandor n’est pas là. Qu’a-t-il pu devenir ? Il est impossible qu’il ait manqué ce train et cependant…
Mais Juve ne perdait pas de temps à réfléchir. Les hauts fonctionnaires de la Compagnie conduisaient le souverain et sa suite à leurs automobiles respectives, et Juve, pour ne pas perdre leur filature, ne s’attardait pas sur le quai.
Au surplus, on était fort en retard et comme le roi d’Espagne, qui se rendait en Angleterre, n’avait pas de train spécial, mais simplement un wagon retenu dans l’express de Calais, il lui restait à peine vingt minutes pour gagner à la gare du Nord le train qui certainement ne l’attendrait pas.
Les deux somptueuses automobiles démarraient, celle du roi en tête, puis l’autre. Quant à Juve, il sautait dans la troisième voiture, élégante aussi, bien que plus modeste, puis il recommandait à son mécanicien :
– Courons derrière, quoi qu’il arrive !
Les deux premières automobiles marchaient à vive allure et, suivant les quais, gagnaient la place du Châtelet. Puis elles s’engageaient dans le boulevard Sébastopol, et dès lors, force était pour elles de ralentir, vu l’encombrement.
Juve, penché par la portière, suivait avec une certaine anxiété les évolutions de la limousine verte emmenant le roi d’Espagne et plus particulièrement surtout celle de la limousine bleue dans laquelle se trouvait don Eugenio.
À un moment donné, alors que l’on approchait du carrefour de la rue Turbigo, la limousine bleue obliqua brusquement sur la gauche et vint donner avec violence dans un camion qui stationnait le long du trottoir.
En l’espace d’une seconde, une foule énorme s’attroupait autour du véhicule.
– Encore un accident ! criait-on.
Le mécanicien, qui n’était autre que Michel, semblait fort ennuyé de ce qui venait de lui arriver. Il était descendu de son siège et se couchait à moitié sous sa voiture, puis réapparaissait, saturé d’huile et de graisse :
– Je n’y comprends rien, grommelait-il, c’est la direction qui m’a lâché, j’ai fait une embardée bien malgré moi. Ah sapristi que c’est ennuyeux !
Les sergents de ville s’étaient approchés, ils tiraient leurs calepins pour constater les dégâts, prendre note du nom des propriétaires. À l’intérieur de la limousine, cependant, les voyageurs étaient fort perplexes. Il y avait là don Eugenio qu’accompagnait un secrétaire du roi.
L’infant d’Espagne avait eu très peur au moment où s’était produit l’accident. Une des glaces de la voiture s’était brisée, il avait failli être atteint par un éclat de verre.
Mais ce qui le préoccupait surtout, c’était le retard que cet incident occasionnait. L’heure du départ du train était proche.
– Nous allons manquer la correspondance, déclara-t-il, l’air inquiet.
Et don Eugenio, tout en interrogeant le mécanicien pour obtenir de lui quelques renseignements sur la gravité de la panne, jetait des yeux autour de lui, cherchant à apercevoir un taxi, une voiture quelconque qu’il pourrait prendre afin de gagner la gare du Nord.
Or, au moment où il se penchait à la portière, un homme s’en approchait : il faisait nuit. L’infant d’Espagne ne pouvait le distinguer, d’autant que cet homme évitait de se montrer de face à don Eugenio. Il s’inclina toutefois respectueusement devant lui et proféra à voix basse :
– Monsieur, j’appartiens au service de la Préfecture, j’ai une voiture à votre disposition. Voulez-vous quitter celle-ci et monter dans la mienne ?
– Ah monsieur, répliqua l’infant d’Espagne, j’accepte volontiers, vous me rendez grand service !
Cet homme n’était autre que Juve.
Quelques instants plus tard, le policier s’installait sur le siège de sa voiture, laissant l’intérieur de la limousine à la libre disposition de l’infant et du secrétaire du roi, puis, sur l’ordre de Juve, la voiture démarrait.
– Attention, maintenant, recommanda le policier au chauffeur, tâche de multiplier les incidents pour que nous perdions encore dix minutes.
La voiture avait à peine parcouru quelques mètres qu’une détonation éclatait. Le mécanicien serra ses freins, sauta à bas du véhicule :