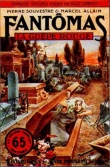Текст книги "Le mariage de Fantômas (Свадьба Фантомаса)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
PIERRE SOUVESTRE
ET MARCEL ALLAIN
LE MARIAGE
DE FANTÔMAS
17
Arthème Fayard
1912
Cercle du Bibliophile
1970-1972
1 – LES DEUX VIES DE DELPHINE
– Bonsoir, mademoiselle.
– Bonsoir, m’sieu, vous m’offrez quelque chose ?
– Ma foi, je ne dis pas non. On verra tout à l’heure.
Cette réponse était faite par un homme d’une cinquantaine d’années environ, élégant, à la carrure imposante, dont le visage s’ornait d’une barbe grise majestueuse. Une petite femme, celle avec qui avait eu lieu ce rapide colloque, pivota sur ses patins et s’en alla de nouveau décrire des courbes sur la piste.
Il y avait foule ce soir-là au skating de l’avenue Malakoff, une foule cosmopolite, élégante, de rastaquouères, de gens du monde, de femmes faciles et de désœuvrés.
La petite femme, après un « huit », revint interroger son interlocuteur :
– Alors, disait-elle, vous venez comme ça faire la fête, monsieur ?
– Ma foi, on ne peut pas toujours être un homme sérieux.
– Et vous devez l’être, interrompit la petite femme en considérant son compagnon avec une admiration naïve et se rendant compte qu’il avait toutes les apparences d’un personnage cossu : barbe poivre et sel, calvitie distinguée, belle chaîne de montre, canne à pommeau d’or.
Elle remarqua qu’il était en habit :
– Vous venez de dîner en famille ou alors au restaurant ?
– Au restaurant ? oui, je sors d’un banquet.
– C’est chic, ça, peut-être que vous êtes ministre ? ou employé dans l’administration ?
Cependant le personnage s’enhardissait, prenait la main de la petite femme, la serrait dans la sienne :
– Vous êtes gentille, commença-t-il, comment vous appelez-vous ?
– Delphine ou Delphina, comme vous voudrez.
– Vous venez souvent ici ?
– Oh, mais non, monsieur, c’est la première fois. Je m’ennuyais chez moi toute seule ce soir et alors je me suis dit : « Tiens, je m’en vais faire un tour au skating. » Je venais d’arriver lorsque je vous ai rencontré.
Au moment où la gentille patineuse venait de déclarer qu’elle « venait pour la première fois » dans cet établissement, quelqu’un l’interpella par son nom, quelqu’un lâcha un tonitruant :
– Bonsoir, mademoiselle Delphine, je compte encore sur vous ce soir, pour m’acheter des fleurs.
– Imbécile de Bouzille ! grommela la petite femme, tu ne vois donc pas que je suis en société ?
Bouzille avait déjà disparu.
– Vraiment, poursuivit la patineuse, c’est ennuyeux d’être interpellée par tous ces gens-là.
– Cela n’a aucune importance.
Puis, se rendant compte à qui il s’adressait et certain désormais de ne point avoir affaire à une vertu farouche, il proposa :
– On rentre chez vous ?
Mais Delphine ou Delphina, protesta :
– Comme vous y allez ! Faut pas vous figurer que je suis la première venue, prendre un bock ensemble, ça n’engage à rien. Zut !
– Qu’est-ce qu’il y a ?
– Rien. Ou plutôt si, c’est ma jarretelle qui vient de craquer.
– Si je puis vous être utile en la circonstance.
– Rien à faire, monsieur, rien à faire ce soir, tout au moins. Cependant si vous voulez m’être agréable, eh bien, vous n’avez qu’à me payer une autre paire de jarretelles. Ce sera une occasion de nous revoir. Si vous y tenez…
– Mais certainement que j’y tiens, poursuivit le galant compagnon de la petite femme qui, peu à peu prenait feu. Où pourrais-je vous retrouver ? Voulez-vous demain ? Dans l’après-midi, puisque vous n’êtes pas libre ce soir ?
La patineuse salua ironiquement. Elle se pencha à l’oreille du personnage et lui déclara :
– Puisque vous y tenez, faites-moi donc apporter votre cadeau 125, rue de la Croix-Nivert, demain dans l’après-midi. Vous demanderez Mlle Delphine, et alors, nous verrons…
Elle s’éclipsa, disparut, tournoyante, au milieu des couples qui se succédaient sur la patinoire avec des rapidités de personnages du cinématographe.
Le monsieur, resté seul à sa place, considéra quelques instants d’un œil pensif la silhouette de la petite femme. Il songeait à part soi :
– Dommage d’avoir dépassé la cinquantaine. Enfin…
Il haussa les épaules et quitta l’établissement.
Ce personnage avait été si absorbé pendant qu’il s’entretenait avec cette jeune personne qu’il n’avait pas remarqué quelqu’un qui, depuis un bon quart d’heure, l’observait avec une attention minutieuse.
– Parbleu ! monologuait le curieux qui, prudemment, se dissimulait pour n’être point vu du vieux monsieur, je ne me trompe pas, c’est notre excellent Dupont de l’Aube qui se dispose à faire des fredaines. Il est incorrigible cet homme-là. À son âge !
Celui qui songeait ainsi était un homme d’une trentaine d’années, à la physionomie ouverte, intelligente, c’était Jérôme Fandor, l’ami du policier Juve, l’adversaire de l’insaisissable Fantômas.
Fandor avait été quelque peu surpris de voir en conversation galante M. Dupont de l’Aube, sénateur, directeur du grand journal quotidien La Capitale, futur ministre et pour le moment ambassadeur extraordinaire du gouvernement français en Espagne. Fandor appartenait lui-même, en qualité de reporter, au journal dirigé par Dupont de l’Aube.
Il avait entendu la petite femme brune se nommer. Il avait retenu son nom, Delphine. Mais soudain, au moment où elle quittait le sénateur, le journaliste avait étouffé un cri de surprise et s’était vivement penché à terre : la patineuse avait laissé tomber un objet que Fandor avait ramassé. C’était un élégant petit carnet recouvert de cuir et portant un chiffre en argent : D. F.
Son premier mouvement avait été de le rapporter à la patineuse, mais c’est en vain qu’il la chercha des yeux dans la foule qui évoluait sur le plancher. Le journaliste, perplexe, ouvrit le calepin afin de savoir si par hasard il ne contenait pas le nom de sa propriétaire, son adresse peut-être. Et, sans souci de l’indiscrétion qu’il commettait, il en feuilleta les pages. Il n’y avait point de nom sur le calepin, mais seulement des notes tracées au crayon d’une écriture fine et régulière, et Fandor, en parcourant les feuillets, y retrouvait des inscriptions de ce genre :
Capiton satin blanc, fillette cent francs, le même riche cent cinquante francs.
Sous plomb brocard 350, ferrures comprises grand luxe, taille moyenne, 575 francs, goût américain 6 écussons : l’écusson, pièce 30 francs en argent, commission Dr Palter, 13 francs.
Enfin sur une dernière page : Fandor lut :
Suivre l’affaire Block, 94 ans, avenue de Messine.
De plus en plus perplexe, le journaliste tourna et retourna ce petit carnet.
– Ce n’est pas ordinaire, se dit-il, que signifient ces notes ? Que peuvent-elles bien vouloir dire ? Il faudrait absolument que je puisse retrouver cette femme.
Les initiales aussi le préoccupaient.
– D. F., se répéta-t-il, D. F., je sais que D veut dire Delphine, puisque je l’ai entendue se nommer, mais F ? Ne s’agirait-il pas de Delphine Fargeaux ?
Ce nom rappelait à Fandor un tas de choses dont le souvenir amenait un pli soucieux sur son front. Delphine Fargeaux, n’était-ce pas en effet une personne bizarre, dont il avait longuement entendu parler au cours de ses dernières aventures et dont l’existence avait été traversée par des drames terribles auxquels Fantômas n’était pas étranger. Était-ce bien elle ?
Fandor, à deux ou trois reprises, fit le tour du skating, cherchant à retrouver la propriétaire de ce carnet. Mais ce fut en vain, et ennuyé, il allait le porter à l’administration, lorsque soudain il avisa sur une feuille un numéro de téléphone :
– Parbleu, se dit-il, c’est là une indication. Demain matin je téléphonerai là et je demanderai : « Delphine Fargeaux », je verrai bien la réponse que j’obtiendrai, il faut que j’en aie le cœur net.
***
– Allô, allô, le 886-820.
Fandor, depuis dix minutes, dans une cabine téléphonique, s’efforçait d’avoir une communication difficile à obtenir.
– Pas libre, répondait la demoiselle du téléphone.
Et Fandor s’entêtait.
Enfin, il obtint la communication. À l’autre bout du fil, quelqu’un, une voix mâle lui répondit :
– En effet, c’est bien ici le 886-820. Parfaitement, monsieur, à votre service. Il s’agit évidemment d’une cérémonie. Voulez-vous nous dire le quartier, nous vous mettrons en rapport avec notre agence. Dans de semblables circonstances, on aime toujours avoir quelqu’un qui s’occupe de tout.
– Qu’est-ce que me chante ce bavard ? se demandait Fandor qui, l’interrompant, finit par placer une parole :
– Je voudrais simplement parler à Mme Delphine Fargeaux, elle est bien chez vous, n’est-ce pas ?
– Est-ce personnel ?
– C’est personnel.
– Une seconde, monsieur, nous allons l’appeler à l’appareil.
– Qui me demande ?
Le journaliste tressaillit. Il reconnaissait la voix et le léger accent méridional.
– Vous ne me connaissez pas, madame ? Mais peu importe, j’ai trouvé hier un objet qui vous appartient, je serais désireux de vous le rendre, c’est un petit carnet. Où puis-je vous l’apporter ?
Une exclamation l’interrompit :
– Ah mon Dieu ! monsieur, que je suis contente !
– Voulez-vous me donner votre adresse et je viendrai dans une demi-heure.
Mais on l’interrompit :
– Non, non, monsieur, non, ce n’est pas possible. Ou plutôt… cependant…
L’interlocutrice s’embarrassait ; après une légère hésitation, elle reprit pourtant :
– Vous me connaissez de vue, monsieur ?
– Certainement, répondit Fandor, vous êtes une très jolie personne brune…
– Eh bien, monsieur, puisque vous me connaissez, voulez-vous avoir l’obligeance de venir ce soir à six heures au square d’Anvers me rapporter mon carnet ? Je serais bien heureuse de vous en remercier. J’espère que ce rendez-vous ne vous dérange pas ?
– Entendu, déclara Fandor qui voulait encore poser une autre question, mais son interlocutrice avait raccroché.
***
Cependant, ce même matin, M. Dupont de l’Aube, pommadé, rasé de frais, descendait d’un taxi-automobile à l’entrée de la rue de la Croix-Nivert.
– Drôle de quartier à habiter pour une demi-mondaine, pensait-il, cependant qu’il s’avançait à pied dans la rue de Grenelle.
Le sénateur, tout guilleret, portait précautionneusement un carton plat, qui lui avait été remis une demi-heure auparavant dans un grand magasin où il s’était rendu. Ce carton plat contenait une délicieuse paire de jarretelles roses que le vieux sénateur, qui n’avait point oublié sa rencontre de la veille, désirait offrir à sa nouvelle connaissance.
Le sénateur suivait un long mur et il avait remarqué en lisant les numéros des maisons voisines qu’il devait approcher de l’adresse que lui avait donnée la « demoiselle » du skating.
Il arriva devant une grande porte à laquelle il sonnait et comme on tardait à ouvrir il considéra machinalement l’immeuble devant lequel il se trouvait.
Le sénateur parut stupéfait :
– Ah, nom d’un chien ! fit-il, ça n’est pas possible, cette petite femme m’a conté une blague.
À ce moment, la porte s’ouvrit, un personnage revêtu d’une sorte de livrée noire à boutons blancs, s’inclina devant lui :
– Si monsieur veut se donner la peine d’entrer.
Dupont de l’Aube jeta un coup d’œil sous la voûte qu’il découvrait à l’intérieur de la porte entrebâillée. Il recula :
– Monsieur désire quelqu’un ?
Dupont de l’Aube, machinalement, lui tendit le paquet qu’il avait à la main :
– Ceci, fit-il, est destiné à mademoiselle Delphine Fargeaux.
– C’est bien, monsieur, on le lui remettra. C’est de la part de qui ?
L’employé s’arrêta, demeura stupéfait lui aussi, conservant le paquet, car son interlocuteur avait brusquement tourné les talons. Dupont de l’Aube partit, courut presque dans la rue de la Croix-Nivert, sans se retourner.
– Non, grommela-t-il, non, voilà qui n’est pas ordinaire, du diable si j’aurais pu me douter !
Et le sénateur s’enfuit comme s’il avait eu le diable à ses trousses.
***
– Un paquet pour vous, madame Delphine Fargeaux.
– C’est bien, donnez.
L’employé à la livrée noire et aux boutons blancs, qui venait, quelques instants auparavant, de recevoir Dupont de l’Aube, se retira, grave et digne, cependant que Delphine Fargeaux, posait à côté d’elle le petit carton glacé et s’apprêtait à l’ouvrir.
La jeune femme était dans une pièce étrange et dont l’ameublement aurait assurément fait frissonner quiconque y aurait soudain pénétré.
Delphine Fargeaux, car c’était bien elle, en effet, qui la veille au soir patinait pleine de gaieté et d’entrain au skating de l’avenue Malakoff, se trouvait dans un immense hall au plafond vitré. Là, s’amoncelaient quantités de boîtes de dimensions différentes, mais toutes de forme semblable.
Delphine Fargeaux allait et venait, très simplement vêtue de noir, au milieu de cet assortiment extraordinaire ; la jeune femme errait dans la grande salle remplie de cercueils.
Delphine Fargeaux était employée à la maison Ange de Villars, l’une des plus célèbres entreprises de Pompes Funèbres de Paris.
C’était effroyable, terrifiant, de voir dans cette salle où le soleil pénétrait rarement, cet amoncellement de bières de toutes tailles, ces cercueils de toutes les qualités, depuis les modestes planches de sapin mal rabotées jusqu’au grand cercueil de chêne, verni, à poignées d’argent.
Delphine Fargeaux, au moment où l’employé à la livrée noire était venu lui apporter ce paquet, s’entretenait avec un individu à la face joviale et aux allures communes :
– M. Coquard, lui disait-elle, vous feriez beaucoup mieux d’aller à votre travail plutôt que de rester ici bavarder avec moi, vous allez me mettre en retard et vous-même vous vous faites du tort.
– Bah, répondit Coquard, j’ai gagné ma journée et je peux bien me reposer auprès de vous. J’ai fait ce matin une superbe affaire. Une troisième classe, ma chère, tout ce qu’il y a de luxe, à l’église d’Auteuil. À ce propos même, il faudra que je vous donne les indications nécessaires, la cérémonie a lieu après-demain. Du capiton blanc, c’est pour une jeune fille, et quelque chose de bien, je vous prie de croire.
Delphine Fargeaux s’approcha d’un petit bureau, plongea sa plume dans l’encre :
– Allez-y, monsieur Coquard, fit-elle, donnez vos indications.
Le personnage, évidemment un courtier de la maison chargé de procurer des « affaires » à l’entreprise, énonça rapidement les renseignements :
– Les tentures, rue d’Erlanger, la cérémonie à midi à l’église d’Auteuil. Pour l’administration, la personne décédée, c’est une jeune fille, mademoiselle Mercédès de Gandia, la nièce de l’infant d’Espagne, don Eugenio.
Delphine Fargeaux, lâcha sa plume, bondit :
– Qu’est-ce que vous dites ? La nièce de l’infant d’Espagne, il en a donc une ?
– Pourquoi pas ? reprit le courtier, c’est une chose qui arrive à des gens très bien.
– Ah, ne plaisantez pas ! fit Delphine toute tremblante. L’avez-vous vue, cette jeune fille ? Savez-vous de quel âge ?
M. Coquard haussa les épaules :
– Dans les vingt-deux, vingt-trois ans, je crois. Mais qu’est-ce que cela peut bien vous faire ?
Évidemment, Delphine Fargeaux ne voulait pas s’expliquer sur ce point :
– Rien, en effet, cela ne me fait absolument rien.
– Vous voyez, mademoiselle Delphine, que ma journée est faite. Le patron sera content que j’aie enlevé cette affaire. Nous étions trois dessus. Mais je suis arrivé premier et, dans notre métier, vous savez, c’est toujours le premier qui réussit. Cet après-midi, je me repose et, si vous le permettez, je vous invite à déjeuner.
– Non, merci, fit sèchement Delphine Fargeaux.
– Voyons, faites-moi ce plaisir. Vous savez bien que depuis longtemps je ne cherche qu’à vous être agréable et qu’il vous suffirait d’être un peu gentille avec moi pour me rendre le plus heureux des hommes.
Coquard se rapprocha de Delphine, lui passa le bras autour de la taille, se pencha sur sa nuque, effleura celle-ci d’un baiser.
Mais violemment la jeune femme le repoussa.
– Finissez, dit-elle, vous m’assommez.
– Oh, ça va bien, fit Coquard, tout à l’heure vous étiez plus aimable.
– C’est possible, grommela Delphine, et ça me regarde.
Cependant que le courtier demeurait interloqué par ce brusque changement d’humeur, que rien ne motivait à ses yeux, Delphine, avec une curiosité bien féminine, était allée ouvrir le paquet qu’on venait de lui apporter. Elle poussa un cri de surprise et de joie.
– Ah, par exemple, ça, c’est gentil ! dit-elle.
Et elle contempla, les yeux brillants de bonheur, les superbes jarretelles roses, auxquelles était épinglée une carte de visite.
Delphine lut : Dupont de l’Aube, sénateur, directeur de « La Capitale ».
– Mâtin ! proféra Coquard qui, indiscrètement, lisait par-dessus son épaule, ça n’est pas, comme on dit dans le métier, « de la petite bière ».
Puis il ajouta, goguenard :
– En voilà un que je guigne aussi, un personnage ce Dupont de l’Aube, à qui on fera un bel enterrement.
Delphine haussa les épaules.
– Vous êtes complètement idiot, mon cher Coquard, fit-elle, et vos plaisanteries sont d’un goût détestable.
– Pardon, murmura le courtier qui, d’un air humble, ajouta :
« Je n’ai pas beaucoup d’esprit, mais je suis un brave homme, et si j’imagine toutes sortes de bêtises, c’est histoire de vous faire rire. Dame, évidemment, ça n’est pas drôle, mon métier, ni le vôtre non plus, ne parler que de cercueils, de cadavres.
– Elles sont jolies, n’est-ce pas ? répondit Delphine en regardant les jarretelles.
Et Coquard, un instant assombri, retrouvait sa gaieté pour déclarer :
– Savez-vous ce que vous feriez si vous étiez gentille ?
– Non, et je ne veux même pas le savoir.
– Je vais vous le dire tout de même. Eh bien, vous me permettriez de vous les essayer.
– Insolent, imbécile ! s’écria Delphine en se dégageant.
Puis, tous deux s’arrêtèrent net, embarrassés. Quelqu’un venait d’entrer dans le vaste hall, un jeune homme d’une extrême distinction, au visage pâle, au crâne poli comme une boule d’ivoire, à la moustache blonde et tombante, un jeune homme dont les mains maigres et longues étaient surchargées de bagues.
– Zut, v’là le patron ! souffla Coquard.
C’était, en effet, le marquis Ange de Villars, directeur de l’entreprise des Pompes Funèbres, qui venait d’entrer dans le hall des cercueils pour donner des instructions à son personnel.
***
À six heures du soir, les ateliers de la rue Croix-Nivert se vidaient et, dans la rue, se répandait une foule de trois cent cinquante ouvriers et ouvrières qui s’éparpillaient rapidement dans le quartier.
Delphine Fargeaux monta en hâte à l’appartement qu’elle occupait dans une rue voisine, changea son uniforme de deuil contre une toilette tapageuse, puis redescendit, sauta dans un fiacre auquel elle donna pour adresse :
– Place d’Anvers.
Lorsqu’elle arriva dans le quartier mouvementé de Montmartre, quiconque aurait vu cette pimpante et jolie personne ne se serait vraiment pas douté de la profession qu’elle remplissait dans la journée. Elle ne faisait point tache dans ce quartier de plaisirs et de fêtes.
Delphine Fargeaux régla sa voiture, puis, amusée à l’idée qu’elle allait au rendez-vous de quelqu’un qu’elle ne connaissait pas, elle s’avança lentement dans le square d’Anvers. Le soir tombait et déjà le crépuscule jetait une ombre grise sur le jardin que les mères et leurs enfants quittaient.
Delphine Fargeaux demeura seule quelques instants, lorsqu’elle eut un soubresaut. Quelqu’un l’interpella, d’une voix grasse, éraillée :
– Alors, ça va toujours, mam’zelle Delphine ?
– Ah, par exemple, fit-elle, c’est vous, Barnabé ?
Devant elle se trouvait un individu aux allures communes, à la face terreuse, aux habits malpropres. Il avait une haleine avinée et des yeux injectés. Delphine Fargeaux le connaissait bien : c’était Barnabé, l’un des fossoyeurs de l’administration avec lequel elle avait souvent à s’entendre pour des détails de métier.
– Ah non, par exemple, vous en avez un culot, vous ! Si vous croyez que c’est rigolo de vous rencontrer, surtout dans l’état où vous êtes !
– De quoi ? grogna le fossoyeur. Il n’y a pas de déshonneur et c’est bien malheureux que vous fassiez la fière, car vous êtes une jolie fille et ça ne vous coûterait pas cher.
– Voyou ! s’écria Delphine, laissez-moi tranquille.
Et cependant que Barnabé, titubant sur ses jambes, cherchait surtout à assurer son équilibre, Delphine Fargeaux, rebroussant chemin, s’écarta, redoutant d’être vue en conversation avec cet homme par l’inconnu qu’elle attendait.
Comme elle traversait le square, Delphine Fargeaux se heurta soudain à un jeune homme. Celui-ci sourit en la regardant, puis, la saluant poliment, il demanda :
– Mme Delphine Fargeaux ?
– Oui, c’est moi, fit la jeune femme qui rougit.
Le jeune homme avait tiré de sa poche le petit calepin noir :
– Ceci vous appartient n’est-ce pas, madame ?
– En effet, je vous remercie bien, monsieur.
Mais Fandor, car c’était lui, ne rendait point le carnet.
– Un instant, dit-il, je voudrais, au préalable, vous poser, madame, une petite question. N’y voyez pas une curiosité malsaine, mais simplement l’intérêt que je vous porte. Je suis Jérôme Fandor et mon nom vous dit peut-être quelque chose, s’il est exact que vous êtes Mme Delphine Fargeaux ?
La jeune femme répondit affirmativement : les deux interlocuteurs s’assirent sur un banc.
Ils y passèrent près d’une heure.
Fandor et son interlocutrice pouvaient avoir, en effet, bien des choses à se dire, et si Delphine Fargeaux avait voulu parler, elle aurait pu mettre Fandor au courant de quantité d’aventures et d’incidents qui auraient singulièrement intéressé le jeune homme qui, depuis qu’il s’était échappé miraculeusement des ruines du phare de l’Adour, ne savait en réalité que fort peu de choses sur les dramatiques aventures qui avaient rendu Delphine Fargeaux veuve, l’avaient forcée à quitter les Landes pour venir à Paris.
Peut-être, un jour, Delphine Fargeaux parlerait-elle, lorsqu’elle connaîtrait mieux Fandor ; cela était dans les choses possibles ; peut-être même Delphine aurait-elle dit tout ce qu’elle savait au journaliste si, le matin de ce même jour, le courtier Coquard n’était venu lui annoncer le décès de la nièce de l’infant d’Espagne, la mort d’une certaine Mercédès de Gandia, dont Delphine ne soupçonnait même pas l’existence.
Delphine savait encore autre chose. Elle savait, pour l’avoir entendu dire à Juve, quelques semaines auparavant, que Fandor était épris d’une jeune fille nommée Hélène, laquelle n’était autre que la fille de Fantômas. Or, Delphine avait vu, de ses yeux vu, les hommes de l’infant d’Espagne enlever Hélène pour la conduire de force à leur maître.
– Si jamais, pensait Delphine Fargeaux, Fandor se doutait de ce que je crains pour lui, s’il apprenait que peut-être, à l’heure actuelle, la soi-disant nièce de l’infant d’Espagne n’est autre que son Hélène ?… le malheureux !
La nuit était tombée tout à fait que Jérôme Fandor et Delphine Fargeaux s’entretenaient encore, et si Delphine n’avait pas communiqué ses appréhensions à Fandor, elle lui avait néanmoins raconté par le menu son existence depuis le jour où la mort de son mari l’avait rendue libre, mais ruinée aussi, ce qui l’obligeait à venir à Paris, à y gagner sa vie, à accepter le poste qu’on lui proposait aux pompes funèbres, et à mener cette existence qu’elle tâchait d’oublier chaque soir, en menant joyeuse vie à Montmartre.