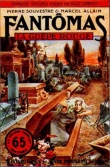Текст книги "Le mariage de Fantômas (Свадьба Фантомаса)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
M. Dupont de l’Aube, toutefois, paraissait fort gêné et, loin d’accepter l’invitation de la jeune personne il s’excusa :
– Je suis désolé, mademoiselle, de ne pouvoir vous être agréable, mais ce soir je suis pris, obligé de m’en aller. Excusez-moi.
Le sénateur tournait les talons, s’esquivait avec rapidité. Le visage de Delphine s’attrista ; lorsque le sénateur fut parti elle grommela, rageuse :
– C’est bien ça les hommes, ils ne savent jamais ce qu’ils veulent. L’autre soir au skating, c’était le plus acharné et voilà que maintenant il me dédaigne.
Delphine soupira :
– Oh je comprends bien. Ce n’est pas le premier. Tous les hommes que j’ai connus, lorsqu’ils ont appris ma profession et su que je n’étais pas une vulgaire grue, que je travaillais honnêtement, se sont débinés. Il faut dire, ajoutait-elle, que je ne fais pas un métier ordinaire. Probable que cela les dégoûte de savoir que je suis dans les Pompes funèbres.
Delphine Fargeaux, résignée, se leva, régla sa consommation, quitta l’établissement.
C’était un curieux caractère que celui de cette petite femme, amoureuse de l’amour et du plaisir avant tout, et qui venait traîner dans des établissements ordinairement fréquentés seulement par des filles vénales.
Assurément Delphine Fargeaux cherchait un amant et elle n’était pas une vertu assez farouche pour ne pas faire de consciencieuses expériences, mais elle répugnait à l’idée de faire la noce et elle aurait préféré de beaucoup une affection sincère et durable plutôt que ces caprices de passage, dont elle connaissait les satisfactions éphémères et aussi les rancœurs plus durables.
– Tout cela, était-elle en train de conclure, c’est la faute au métier que j’exerce. Si j’étais une simple grue, du soir au matin et du matin au soir, j’aurais plus de succès.
Delphine, sur cette réflexion amère, quitta le restaurant du Moulin-Rouge et, d’un pas nonchalant, se dirigea vers un autre établissement d’apparence moins élégante, mais assurément aussi fréquenté que celui qu’elle venait de quitter. C’était encore un restaurant de nuit, faisant l’angle du boulevard et de la rue Lepic, que les habitués de Montmartre désignaient familièrement sous le nom de La Boîte à Joseph.
La clientèle y était moins distinguée, la tenue moins sévère, les femmes décolletées, les habits noirs y étaient rares et l’établissement possédait au premier étage une clientèle d’habitués qui, paisiblement, jouaient au billard.
Il n’y avait pas, chez Joseph, de tziganes, mais un simple piano sur lequel tapait consciencieusement, jusqu’à trois heures du matin, une malheureuse femme au teint fané, à la poitrine étroite, aux yeux rougis par les veilles.
Delphine Fargeaux venait à peine d’entrer là, s’arrêtant machinalement sur le seuil, prise à la gorge par l’odeur de tabac, qu’elle s’entendit appeler.
Delphine fronça le sourcil en apercevant le consommateur qui lui offrait une place à sa table.
– Encore lui, grommela-t-elle.
Mais cependant Delphine, quelques instants après, s’asseyait auprès du personnage. C’était Coquard, le courtier de la maison Ange de Villars.
Coquard, avec ses allures communes et son énervante gaieté, était cependant un brave garçon et, bien que grand buveur de bocks, il était sentimental.
Le courtier était tout heureux d’avoir obtenu que Delphine acceptât son invitation :
– On va faire un gentil petit souper ? proposa-t-il, l’œil allumé.
Il éprouva un certain dépit lorsque Delphine lui répondit qu’elle ne voulait accepter qu’un bock, mais le courtier, néanmoins, qui avait son idée, lui prit tendrement la main, lui murmurant à l’oreille des paroles persuasives.
– Ah, si vous vouliez, Delphine, on pourrait s’arranger pour être heureux tous les deux ; vous savez combien je vous aime et, puisque nous sommes l’un et l’autre dans le même commerce, nous pourrions nous associer aussi bien de cœur que de fait. Je suis sûr qu’à nous deux nous réussirions très bien et si jamais le patron venait à se retirer, il y aurait une belle place à prendre, hein, Delphine, voyez-vous cela ? la première maison de Pompes funèbres de Paris : Ange de Villars, successeurs Coquard et Cie.
Évidemment Coquard s’illusionnait sur l’effet que produisaient ses propositions, car Delphine s’était levée, brusquement :
– Vous me dégoûtez, se contenta-t-elle de dire, je fais le métier que j’ai par nécessité et pour vivre ; si vous croyez que j’y trouve du charme, non vrai, vous faites erreur.
Interloqué, Coquard insista :
– Mais cependant, Delphine, il n’y a pas de sot métier, et ce que nous faisons n’a rien de déshonorant.
– Possible, conclut Delphine, mais ce n’est pas une raison pour que la profession me plaise ! Adieu !
Laissant Coquard tout interdit, Delphine, nerveuse, quitta l’établissement.
Non loin du Moulin-Rouge, à quelques pas de la Boîte à Joseph, se trouve encore le Diabolo, un établissement, celui-là, de dernière catégorie, une effroyable boîte où se donnent rendez-vous les miséreux du voisinage, les apaches du quartier et aussi toute la population interlope qui vit de la grande vie des restaurants chics et de onze heures du soir à six heures du matin, côtoie les noctambules.
Le plus souvent on se tient debout au Diabolo pour consommer devant le comptoir, tant l’affluence y est nombreuse et tant on passe vite sans s’attarder.
Ce soir-là, cependant, deux hommes ne quittaient pas l’établissement, ils y étaient depuis une bonne demi-heure, ils avaient absorbé au moins une demi-douzaine de consommations variées. Ils avaient des silhouettes caricaturales, et quiconque les voyait une fois ne pouvait les oublier.
C’était d’abord un fleuriste, à la barbe embroussaillée, célèbre dans le quartier par ses bons mots et ses saillies ; c’était Bouzille, l’inénarrable Bouzille, vieux Parisien de pure race, ayant exercé les métiers les plus extraordinaires et les plus différents.
Bouzille buvait en compagnie d’un homme dont les consommateurs se seraient volontiers écartés, s’ils avaient su sa profession. Cet homme, en effet, n’était autre que Barnabé, le fossoyeur du cimetière Montmartre.
Les deux amis, tout en choquant leurs verres avant de les vider, discutaient politique avec animation :
– Moi, proférait Barnabé, terriblement ivre, si j’étais le gouvernement, j’obligerais les bourgeois à payer les retraites ouvrières aux ouvriers à partir de quarante ans.
Bouzille approuva, en ajoutant :
– Seulement faudrait aussi que le gouvernement vende le tabac gratuit.
– Le tabac ? dit Barnabé, je m’en fous, je ne fume pas. Non, si j’étais le gouvernement, ce que je vendrais gratuit et obligatoire, ce serait le demi-setier. Tout honnête homme dans la société moderne doit avoir droit à son demi-setier chaque matin et chaque soir.
– Le fait est, reconnut l’autre, que ce n’est pas de trop.
– La révolution nous donnera cela, vois-tu, mon vieux Bouzille, il est temps d’en finir. Tiens, buvons à sa santé, nom de nom !
Le fossoyeur qui venait de proférer cette dernière exclamation, demeura interdit. Son compagnon, soudain, avait disparu :
– Ah, nom de Dieu ! répéta Barnabé, ça c’est plutôt rosse. Il profite de ce que j’ai du vent dans les voiles et du pèze dans mes profondes pour se débiner sans raquer. Mais je le retrouverai ce salaud de Bouzille et comment que je l’arrangerai si jamais il me tombe entre les pattes.
Bouzille, en effet, s’était éclipsé, et sans dire mot à personne, avait bondi hors du Diabolo. Ce n’était pas uniquement pour laisser à Barnabé la charge totale des consommations. Bouzille était un honnête homme ; or, une demi-heure auparavant, il avait reçu une gratification d’un client pour faire une commission et Bouzille voulait gagner son argent.
Cette commission consistait à dire à Delphine Fargeaux, si comme c’était probable, Bouzille la rencontrait, qu’un homme, un certain M. John, désirait ardemment lui parler et qu’il l’attendrait jusqu’à deux heures du matin à la troisième table à droite, au Moulin-Rouge.
Or, Bouzille, qui, de l’intérieur du Diabolo surveillait la place Blanche, avait soudain vu passer la jeune femme et s’était précipité.
– Écoute voir, Delphine, lui annonça-t-il, il y a un type chic qui veut faire ta connaissance, il m’a chargé de te prévenir, il t’attend, faut profiter de l’occasion.
Delphine, médiocrement satisfaite, toisa l’ancien chemineau :
– Est-ce que j’ai l’habitude d’accepter des combinaisons de ce genre et puis, je me méfie de tes types chics. Pour toi qu’est-ce que ça doit être ?
– Oh protesta Bouzille, je m’y connais, cet homme-là c’est un cocher de bonne maison, j’en suis sûr, il me l’a d’ailleurs dit, et pas cocher d’une maison à la manque, il a servi ces derniers temps chez l’infant d’Espagne, don Eugenio.
Cette dernière déclaration décida Delphine Fargeaux :
– Où dois-je le rencontrer ?
Bouzille précisa le rendez-vous, puis, suivit des yeux la jeune femme qu’il vit s’engouffrer sous la voûte lumineuse descendant au Moulin-Rouge.
Ainsi que l’avait indiqué Bouzille, seul à la troisième table, à droite du restaurant, un homme attendait. Il avait le visage hâlé des gens qui vivent au grand air, une chevelure rousse coupée ras, des favoris descendant jusqu’au lobe des oreilles, il était vêtu avec recherche et l’élégance spéciale qui dénotait sa profession.
Toutefois, quiconque l’aurait examiné aurait été incapable de reconnaître en lui, en ce cocher bien caractéristique, fait sur le modèle de tous les cochers anglais, le Roi du Crime, le Maître de l’Effroi, grimé avec cet art qui n’était qu’à lui.
Le bandit, qui affectait une tranquillité absolue, eut un léger tressaillement de satisfaction lorsque, au bout d’une heure et demie d’attente, il vit apparaître à l’entrée de la salle Delphine Fargeaux. Il se leva, lui fit un signe imperceptible que cependant la jeune femme remarqua, puis tous deux s’installaient, se regardaient, gênés, embarrassés, comme lorsque deux inconnus se trouvent ensemble et ne savent que se dire.
Le cocher John, puisque c’est sous ce nom que Fantômes se présenta, venait de faire apporter une bouteille de champagne et Delphine qui le considérait attentivement s’emballait aussitôt sur lui, se disant qu’assurément si cet homme-là n’était pas un vulgaire cocher, il lui plairait par ses belles manières et son allure.
Cependant, Fantômas, avec une remarquable habileté, incitait Delphine Fargeaux à faire très insensiblement un retour en arrière sur son existence passée. À quelques allusions discrètes, Delphine comprit que le cocher était au courant de son existence antérieure, savait qu’elle avait été mariée, châtelaine de ce que l’on appelait dans les Landes le château de Garros, et dès lors, le cocher John flattait la jeune femme en affectant d’avoir pour elle une grande et respectueuse admiration.
Delphine Fargeaux avait une certaine vanité et tirait volontiers gloire de son passé. Elle ne s’étonnait pas que le cocher John en eût connaissance puisqu’il était cocher de l’infant. À un moment donné Delphine, avec une pointe d’amertume, déclara :
– Dire qu’au lieu d’être ce que je suis, j’aurais pu être infante d’Espagne.
– Vraiment ? fit le cocher, l’air interloqué.
Et dès lors, Delphine, rendue bavarde par l’effet du champagne, racontait à son interlocuteur les extraordinaires aventures auxquelles elle avait été mêlée.
Don Eugenio l’avait aperçue à la chasse, s’était épris de ses charmes, s’était juré d’en faire sa maîtresse ; Delphine Fargeaux ne demandait pas mieux, l’infant lui plaisait et puis, c’était un grand seigneur. Alors que tout devait s’arranger pour le mieux, une femme mystérieuse survenait soudain et, volontairement ou non, barrait la route à Delphine Fargeaux, s’interposait entre elle et l’infant, finalement, était enlevée en son lieu et place par les hommes du grand d’Espagne.
Fantômas, intéressé par cette aventure qui remontait à deux mois à peine, interrogeait :
– Cette femme qui était-elle ?
Delphine Fargeaux proféra son nom :
– Hélène, dit-elle, je la connaissais sous le nom d’Hélène.
Et, parlant plus bas, elle ajouta :
– J’ai appris qu’elle était la fille du plus terrible bandit qui soit au monde, la fille de Fantômas.
Pas un muscle du visage de l’interlocuteur de Delphine ne bougea et cependant Fantômas éprouvait une violente émotion. Il se contenta d’interroger d’une voix calme, qu’il voulait rendre indifférente :
– Enlevée, m’avez-vous dit ? cette Hélène a été enlevée par l’infant d’Espagne et conduite où ?
– Je ne sais pas, mais je suppose que don Eugenio a dû l’emmener là où il était convenu que j’irais moi-même, dans ses appartements privés, au palais de l’Escurial.
– Ah ! fit Fantômas qui allait poser une autre question, mais qui s’arrêta et pâlit.
Delphine Fargeaux venait de murmurer :
– Mais tout cela c’est de l’histoire ancienne et j’aime à croire que ça ne lui a pas porté bonheur à cette Hélène, car, à moins que je me trompe beaucoup, il y a pas huit jours qu’elle est morte et qu’elle a été enterrée.
– Que voulez-vous dire ?
Mais, au fur et à mesure que Delphine parlait, Fantômas reprenait son calme.
La jeune femme, en effet, émettait cette hypothèse :
– On a toujours ignoré l’existence d’une infante qui serait la nièce de don Eugenio ; or voici que ces jours derniers, on a annoncé la mort de Mlle Mercédès de Gandia, nièce de l’infant et que l’on procédait à ses obsèques.
Dans l’esprit de Delphine Fargeaux, la Mercédès défunte n’était autre qu’Hélène. Quant à savoir si cette Hélène était morte naturellement ou par le fait d’un crime, elle ne se prononçait pas.
Delphine Fargeaux parla longtemps, bavarde et indiscrète, comme le sont toutes les femmes dès qu’elles sont un peu grises.
Fantômas cependant, écoutait de moins en moins ; au cours de cette soirée, pendant son entretien avec Delphine Fargeaux, il n’avait retenu que ceci : c’était bien Hélène, sa fille qui avait été enlevée par l’infant, mais il ne pouvait croire à sa mort, pour cette double raison, d’abord que le cercueil où elle aurait dû se trouver était vide, et ensuite que la mort d’Hélène ne pouvait profiter d’aucune façon à don Eugenio.
Ce qu’ignorait Delphine Fargeaux, Fantômas le savait. Que Mercédès de Gandia existait fort bien, sa disparition certes, pouvait être profitable à don Eugenio qui en héritait, mais Mercédès de Gandia avait-elle disparu, était-elle morte ?
9 – LE FANTÔME DU PONT CAULAINCOURT
– C’est-y malheureux, c’est-y malheureux… sûrement qu’il n’y a pas de bon Dieu au ciel, sans cela il aurait fait le chemin moins long pour aller du bistrot à ma cambuse, en voilà des kilomètres ! Jamais je n’arriverai au bout, surtout qu’il fait plus noir que dans un tunnel.
Sur le boulevard de Clichy, vers une heure du matin, Barnabé le fossoyeur zigzaguait. Complètement ivre une fois de plus, il rentrait chez lui ou tout au moins essayait de le faire, en suivant les itinéraires les plus détournés. Tout en marchant, Barnabé poursuivait son monologue :
– Bonsoir, m’sieurs dames, est-ce qu’on siffle encore un verre ?
Il se heurta soudain contre une barrière qui manqua de le faire basculer :
– Hé, grommela-t-il d’une voix pâteuse, je parie que c’est encore le père Bistrot qui me fiche son comptoir dans les jambes. Ah saloperie !
D’une main hésitante, Barnabé palpa ce qu’il venait de rencontrer, mais soudain il comprit ce dont il s’agissait :
– Non, grommela-t-il, c’est pas dans le zinc que je suis tombé, je viens de me cogner dans la balustrade du métro. Fichue invention que de mettre ces trucs-là au milieu des trottoirs.
Il fit quelques pas encore, se heurta à un nouvel obstacle.
– Pardon, excuse, mademoiselle, dit-il, tirant son chapeau poliment, s’inclinant jusqu’à terre.
Mais Barnabé éclatait de rire :
– Ah nom de Dieu, fit-il, qu’est-ce que j’ai ? c’est pas une demoiselle, c’est un arbre avec une carcasse de fer en guise de crinoline.
Zigzaguant toujours, le fossoyeur poursuivit son chemin, et il arriva enfin à l’extrémité du boulevard, à hauteur de l’ancien hippodrome.
Là, d’un pas trébuchant, il descendit le trottoir, puis s’assit sur la bordure de pierre et demeura pensif, la tête entre les mains. Il allait peut-être s’endormir là, lorsqu’une douce fraîcheur au bas des jambes l’arracha à sa torpeur.
– Oh que c’est bon, que c’est bon, murmura-t-il, c’est épatant ce qu’il y a des choses agréables dans la vie.
Il regardait instinctivement pour discerner la cause de cette délicieuse sensation :
– Tiens, fit-il hébété, c’est mes pieds qui se sont plantés dans le ruisseau. Je comprends que je sentais du froid.
Barnabé, toutefois, au risque de la congestion, ne remuait pas et regardait l’eau trouble du ruisseau qui coulait par-dessus ses chaussures mutilées. Puis, relevant lentement la tête, son regard s’arrêta stupéfait, retenu semblait-il, par une masse sombre placée à proximité de lui.
Barnabé considérait avec stupéfaction une silhouette humaine, puis il observa, désignant du doigt un grillage qui l’entourait.
– Faut-y que ce type-là soit méchant pour qu’on l’ait enfermé dans une cage.
Et aussitôt, par une rapide association d’idées d’ivrogne, Barnabé s’effrayait d’être auprès d’un aussi redoutable personnage. Et de sa voix de plus en plus éraillée, il se mit à geindre.
– Au secours, au secours !
Deux agents qui l’observaient depuis quelques instants, s’approchèrent lentement ; l’un d’eux, d’un geste paternel, lui toucha l’épaule :
– Hé là, mon brave homme, faudrait voir à rentrer chez vous.
Barnabé était respectueux de l’autorité. Il ôta son chapeau, salua les agents :
– Salut, messieurs, fit-il, j’ai bien l’honneur de vous saluer, excusez-moi de vous avoir dérangés, seulement, c’est rapport à cet individu, vous qui êtes dans la police, vous seriez-t-y pas capables de me dire pourquoi c’est-y qu’on l’a enfermé dans cette cage de fer ?
Les agents suivaient du regard le doigt de Barnabé et malgré la solennité que leur imposait l’uniforme, ils ne purent s’empêcher de rire. L’un d’eux haussa les épaules et expliqua :
– Allons, mon ami, vous avez trop bu, et vous dites des bêtises. Ce que vous croyez être enfermé dans une cage, c’est tout simplement une statue. Allons, circulez, rentrez chez vous sans faire de scandale, faute de quoi nous serions obligés de vous emmener au poste.
Péniblement, Barnabé s’était relevé, il protesta :
– Ça jamais, jamais, foi de Barnabé, on ne m’a conduit au poste, ce n’est pas que je n’aime pas les agents, mais je ne veux point aller chez le commissaire de police. Non, je ne veux pas.
– Alors, rentrez chez vous.
– Mais c’est ce que je fais, messieurs les agents, c’est ce que je fais.
Non sans peine, Barnabé traversa la chaussée, puis guidé par son instinct, il aborda la rue Caulaincourt. Au bout d’un quart d’heure, il parvint au point surplombant le cimetière de Montmartre, puis fatigué d’un tel effort il s’accota à la balustrade par-dessus laquelle son regard trouble et vacillant plongeait dans l’obscurité noire du cimetière silencieux. Incorrigiblement bavard lorsqu’il avait bu, Barnabé monologuait, il esquissait des sourires, il avait des gestes de satisfaction :
– Parbleu, je m’y retrouve, grommela-t-il, ça c’est mon quartier, et là-dessous voilà mon chantier de travail. Tiens, je les connais tous là-dedans, c’est mes clients. Voilà le caveau des Morel.
Barnabé haussait les épaules :
– Oh, les Morel, des purées, trois francs par mois pour l’entretien, c’est pas avec ça que je pourrai me payer une automobile. Parlez-moi des Artinien. V’là du monde bien, et puis c’est des gens qui font travailler, on en a descendu cinq dans le caveau, en moins de deux ans. Ah, conclut-il, en étouffant un soupir, voilà comme il en faudrait toujours de la clientèle. Ce qu’il y a de bon, d’ailleurs, dans le métier, c’est qu’on ne chôme jamais. Y a pas de morte-saison.
Soudain, le fossoyeur tressaillit, tourna la tête :
– De quoi ? qu’est-ce que c’est ?
Et il regarda d’un air surpris. Quelqu’un venait de le tirer par le bras, c’était une femme. Barnabé esquissa un sourire, puis, se rapprochant de la nouvelle venue :
– Oh, oh, fit-il, voilà un chopin [9].
Mais comme il arrivait près de la femme, il s’en écartait aussitôt avec un geste de dépit :
– Ah non, fit-il, rien à faire, t’es trop moche.
Et il ajouta, fier de lui-même :
– On en a d’autres, et mieux que ça !
La femme ne se vexait pas de cette marque de mépris, mais elle revenait à la charge. C’était une femme âgée, aux allures misérables, elle prit le fossoyeur par le bras.
– Viens, dit-elle d’une voix étranglée par l’émotion, que je te montre quelque chose.
Barnabé se laissait entraîner, traversait le pont et, sous la conduite de cette femme, allait s’accoter à la balustrade opposée du côté donnant sur la partie ouest du cimetière, qui s’étend à perte de vue dans la direction de Clichy.
Ils demeurèrent quelques instants immobiles, attentifs, son étrange interlocutrice ne prononçait pas une parole :
– Eh bien, de quoi ? fit Barnabé, qui commençait à s’impatienter.
La femme ne bougeait point, et le fossoyeur allait l’interroger encore, lorsque sa compagne, étendant le bras dans la direction du cimetière, murmura d’un ton angoissé :
– Regarde, nom de Dieu, regarde.
Barnabé, de son œil vague, obéit. Tout d’abord il ne voyait rien, mais ses yeux, peu à peu, s’habituaient à l’obscurité, parvenaient à la fouiller. Soudain il s’écria :
– Ah bon Dieu de bon Dieu !
Puis il se sentit pâlir. La vieille femme cependant se serrait contre lui :
– J’ai peur, balbutiait-elle, qu’est-ce que c’est ?
À son tour, Barnabé prononça des paroles vagues, incompréhensibles, il se cramponna à la balustrade du pont, voulut détourner la tête, cesser de regarder ce qu’il voyait, mais ses muscles ne lui obéissaient pas et ses yeux dilatés par l’épouvante continuaient à contempler fixement le spectacle qui s’offrait à eux.
– Là, là, désignait la vieille femme. Le vois-tu encore ?
– Je le vois, répliqua Barnabé que la vision extraordinaire dégrisait peu à peu.
Le fossoyeur et sa compagne pouvaient être surpris, étonnés, abasourdis.
Dans le mystère du cimetière, soudain ils avaient vu surgir une forme vague, imprécise d’abord, qui, peu à peu, se silhouettait plus nettement. Une tête leur était apparue, une tête humaine, blafarde et glabre, dont la moitié était toute noire, alors que l’autre moitié apparaissait blanche. Puis, un corps s’était dessiné, un corps vêtu d’habits vraisemblablement ; sur la poitrine c’était encore une tache blanche, affectant la forme d’un plastron de chemise, cependant que des membres humains constituant le reste du corps semblaient également dissimulés sous des vêtements noirs. Aux extrémités des bras pendaient deux mains toutes blanches et immobiles. Cette apparition se déplaçait, sans paraître marcher, avec des mouvements doux, indéfinissables ; tantôt la vision éclairée par le reflet des becs de gaz, s’affirmait nettement, tantôt au contraire elle devenait invisible. On la croyait partie, elle réapparaissait quelques secondes après, surgissant derrière un caveau, se dressant au-dessus d’une tombe, glissant entre deux monuments, passant sous le feuillage épais d’un arbre.
– Cré nom de nom ! répétait Barnabé qui sentait une sueur froide couler le long de ses joues, c’est un revenant, un fantôme, cré nom, j’ai jamais eu le trac dans ma vie, et ce coup-ci, je commence à avoir les foies !
Il voulait fuir ce spectacle extraordinaire. Impossible. Sa compagne, en proie à l’émotion que l’on devine, poussait des hurlements, appelait au secours.
Quelques passants s’étaient approchés, cherchaient à comprendre ce qui motivait l’agitation de ces deux personnages, puis quelqu’un d’abord, deux ou trois personnes ensuite, comme Barnabé et la vieille femme aperçurent l’étrange apparition en train d’évoluer dans le cimetière.
Rapidement, la foule grossissait. Quelle émotion sur le pont Caulaincourt ! On s’attroupait. Les voitures avaient peine à passer. Des cochers tempêtaient, cependant que les conducteurs d’automobiles, impatients de poursuivre leur course folle à travers Paris, faisaient ronfler leurs moteurs et retentir leur corne d’appel.
La police – enfin intriguée – arriva sur les lieux, s’efforça de rétablir la circulation. En vain. Les agents ne comprenaient pas les explications qu’on leur fournissait dans l’assistance :
– Il y a des voleurs dans le cimetière, disaient certains, cependant que d’autres, plus troublés, plus émotionnables aussi sans doute, affirmaient :
– Non, ce sont des revenants, ce sont les morts qui reviennent.
Les agents indécis ne savaient que faire. Ils se contentaient de pousser, avec une patiente énergie, ceux qui s’obstinaient à stationner.
Mais on leur obéissait avec peine. Puis une femme tomba par terre, eut une crise de nerfs, on s’empressa autour d’elle, on faillit l’étouffer en voulant lui prodiguer des secours. Quelques personnes se dévouant la descendirent vers le boulevard pour la conduire dans une pharmacie. Elle avait certainement vu, celle-là, vu le fantôme. D’ailleurs plus nombreuse devenait la foule, plus on acquérait la certitude que les deux premiers témoins de ce spectacle inadmissible, n’avaient pas été l’objet d’une hallucination. À un moment donné, une clameur angoissée retentit et la foule, se bousculant, recula de la balustrade, courut au côté opposé. Tout le monde venait de voir le spectre se rapprocher, venir au pied du pont puis disparaître dessous. Quelques jeunes gens plus audacieux que les autres dégringolaient rapidement le petit escalier qui, du pont Caulaincourt, conduit à l’avenue Rachel. Suivis par d’autres, ils se rapprochaient de l’entrée du cimetière. La grosse porte de fer était close depuis longtemps, cependant on y carillonnait. Le tintement clair de la sonnette résonna dans un silence impressionnant.
– Il faut faire une perquisition tout de suite, avertir la police, avait suggéré quelqu’un.
En attendant on réveillait le gardien. Au bout de quelques instants une petite porte sur le côté s’entrebâillait, un homme à demi vêtu, les yeux encore bouffis de sommeil, apparaissait. Il recula épouvanté à la vue de la foule massée dans l’avenue Rachel.
– Qu’est-ce que c’est ? qu’est-ce qu’il y a ? interrogea-t-il.
En vain lui aussi s’efforçait-il de comprendre les explications qu’on lui donnait, il répéta, machinalement, les paroles en apparence incohérentes qui retentissaient à ses oreilles :
– Des voleurs ? des spectres ? des revenants ? qu’est-ce que vous me chantez là ?
L’homme poussa un cri, agita les bras, protesta :
– Non, non, on n’entre pas, c’est défendu.
Mais en vain, cherchait-il à s’interposer. La foule envahit le cimetière et par la porte ouverte les gens s’introduisirent en masse dans la nécropole.
Il y avait là des élégants, des fêtards en habit coiffés de hauts-de-forme et qui ricanaient, serrant de près des femmes aux toilettes tapageuses avec lesquelles ils venaient de boire dans les établissements de nuit de Montmartre.
Au milieu d’eux grouillait une troupe miséreuse de pauvres gens mal vêtus, de vieilles déguenillées, d’hommes à face patibulaire. Et tout ce monde-là fraternisait, se rapprochait, semblait d’accord pour atteindre un même but : on voulait à toute force visiter le cimetière, savoir, avoir la clé de l’énigme qui préoccupait tout le monde depuis déjà plus de trois quarts d’heure.
Les agents, impuissants à mater la foule, s’étaient résignés à la suivre et les deux sergents de ville qui avaient été attirés par l’attroupement du pont Caulaincourt, pénétrèrent, eux aussi, dans le cimetière. Barnabé, moins ivre qu’une heure auparavant, semblait diriger la marche des gens qui, désormais troublés par le silence impressionnant des tombes et quelque peu gênés par le voisinage des caveaux mortuaires, semblaient de moins en moins désireux d’aller plus avant au fur et à mesure qu’on avançait. Une petite femme, qui n’avait pas lâché le bras de son ami, après avoir été des plus acharnées à pénétrer dans le cimetière, se roidit contre l’émotion et supplia, tremblante :
– Allons-nous-en.
Son compagnon ne demandait pas mieux que de la satisfaire ; il regrettait aussi de s’être ainsi avancé, il fit volte-face avec sa compagne. Ce mouvement semblait être un signal, et bon nombre de ceux qui s’enfonçaient dans l’obscurité froide du champ de repos les imitaient, reculaient, s’en allaient, regagnaient avec satisfaction le monde des vivants.
Et, au bout de quelques minutes, ce que les agents avaient été impuissants à obtenir, la solennité tragique du voisinage de la mort le réalisait. Comme par enchantement, le cimetière se vidait et il ne restait plus que quelques personnes assez acharnées, assez audacieuses, pour continuer la marche en avant, pour poursuivre les recherches.
Il y avait là toujours Barnabé, les agents, le gardien du cimetière qui n’était pas encore revenu de sa stupéfaction et s’affolait à l’idée du scandale que constituait cette invasion nocturne. Il y avait aussi deux messieurs bien habillés, quelques pierreuses au visage tragique, un homme aux allures de domestique de bonne maison, le cocher John.
Celui-ci, toutefois, ne tardait pas à disparaître. Quant à la vieille femme que l’on avait vue à côté de Barnabé et qui, la première, avait signalé l’apparition du spectre, elle s’était depuis longtemps éclipsée.
Le cimetière semblait plongé dans la tranquillité la plus absolue. On n’entendait plus rien et les bruits de la ville, déjà lointains, n’y parvenaient que très atténués. Des bouffées d’air froid semblaient surgir du fond de la terre, s’échapper de mystérieuses ouvertures ménagées à l’entrée des caveaux.
Cependant, la petite troupe restée dans le cimetière s’enhardissait peu à peu. Depuis quelque temps déjà, on n’avait rien remarqué d’insolite, et la vision qui avait stupéfié tant de monde paraissait s’être évanouie définitivement. On venait de passer sous le pont Caulaincourt et, machinalement, les gens quittant l’avenue de l’Ouest, s’avançaient vers le fond du cimetière, lorsque soudain ceux qui marchaient les premiers, poussèrent une exclamation et s’arrêtèrent brusquement :
– Le voilà, murmurèrent-ils. Encore le fantôme.
Il y eut un mouvement de désordre, on hésitait. Allait-on fuir ou continuer à s’avancer ?