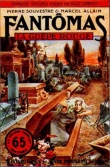Текст книги "Le mariage de Fantômas (Свадьба Фантомаса)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
16 – LA « MARQUE » DE LA DANSEUSE
Construit en forme de gril, le grand palais de l’Escurial est célèbre dans toute l’Espagne et dans le monde entier.
C’est une énorme construction, bâtie en pierre noire, glaciale, froide, élevée sur les plans d’un moine, qui semble tout inspirée de la dévotion cruelle et sanguinaire de la vieille Espagne, de cette dévotion barbare et fanatique de l’Inquisition.
L’Escurial doit son nom au petit village bâti à très peu de distance, au pied de la colline qui l’écrase de tout son poids. Dans la langue du pays, pour distinguer la ville du château, on appelle communément le palais : l’Escorial de Hijo, c’est-à-dire l’Escurial d’en haut, et le village : l’Escorial de Abajo, c’est-à-dire l’Escurial d’en bas. Aussi bien, le bourg est misérable, c’est un de ces humbles petits villages d’Espagne comme il en est tant, et sa population ne comporte guère que des gardes civils, des gendarmes, des soldats aussi, qui y tiennent garnison.
Dans les rues de l’Escorial de Abajo, on ne parle d’ailleurs qu’avec respect et crainte de l’Escorial de Hijo. Il semble qu’une terreur secrète frappe les habitants, lorsqu’on s’entretient du palais devant eux. Ils se signent alors, courent à l’un des multiples autels creusés dans les façades de leurs misérables maisons, allument des cierges, répandent de l’eau bénite, invoquent la Madone. Il semble vraiment que parler de l’Escorial de Hijo est sacrilège et que des maléfices peuvent atteindre tous ceux qui jettent les yeux sur le sinistre palais.
D’où vient la crainte qu’inspire le nom seul de l’Escurial ? Il n’est pas facile de le démêler. Le paysan espagnol est, en réalité, et malgré ses dehors de piété exubérante, des plus superstitieux. Peut-être s’effraye-t-il en songeant que l’énorme bloc de pierre qui domine son horizon n’est pas seulement la résidence superbe des rois espagnols, mais encore leur dernier sépulcre.
C’est en effet dans l’Escorial de Hijo que se trouvent les tombeaux de tous les souverains d’Espagne, les tombeaux des infants et des infantes. C’est là que leurs cendres reposent, protégées des outrages du temps par des granits inattaquables aux siècles.
***
Au village de l’Escorial de Abajo, comme dans tous les villages d’Espagne, les maisons de danses sont nombreuses. Ce sont à la fois des cabarets et des salles de bals. Elles ont un caractère particulier et pittoresque, qui n’est pas sans intéresser et intriguer tant soit peu l’étranger qui, toujours, se demande au juste ce que l’on peut faire à l’intérieur de ces masures sordides, mais qui continuellement retentissent du cliquetis des castagnettes, des accords des mandolines ou des guitares.
Le seuil passé, on se trouve dans une salle basse, obscure, car les volets sont perpétuellement clos pour arrêter les rayons du soleil torride. Le sol est fait de terre battue. Pas de meubles. À peine quelques bancs de bois, sur lesquels les consommateurs prennent place, serrés les uns contre les autres, tapant du pied, battant des mains, rythmant d’exclamations gutturales les perpétuelles danses de jolies filles qui ne sont point, ainsi qu’on pourrait le croire, considérées comme des femmes faciles, mais bien plutôt entourées d’un certain respect, à la façon dont on respecte, au Japon, les danseuses de caste noble.
On boit d’inévitables verres d’eau sucrée, parfois du coco, jamais d’alcool. L’Espagnol est sobre, extraordinairement sobre. Il fréquente la maison de danse pour le charme qu’il trouve à contempler les ballerines, pour satisfaire son goût de la musique. Non pour s’enivrer.
À l’Escorial de Abajo, il était de bon ton, parmi les gardes civils, de se réunir chaque soir à cinq heures, lorsque la force du soleil commençait à décroître un peu, dans l’une de ces maisons de danse : la Bonita, qui était plus vaste que ses concurrentes, où l’on arrosait davantage, où la fraîcheur apparaissait exquise, où l’atmosphère toujours mouillée et lourde avait d’éternels relents de parfums et de fleurs.
Ce soir-là, plus que jamais, il y avait foule. Dans un coin, des gardes civils en grand uniforme, le bicorne crânement posé en arrière, le long sabre entre les jambes, applaudissaient à tout rompre une superbe fille qui dansait devant eux, voluptueusement, lentement, la tête renversée en arrière, comme étourdie et grisée elle-même par le balancement de sa valse.
Plus loin, d’humbles Espagnols, n’appartenant point à l’armée se groupaient, eux aussi, applaudissaient, mais cependant n’osaient faire de bruit en présence de messieurs les gardes civils qui, à la Bonita, prétendaient être les maîtres, faire la loi et tout gouverner à leur guise.
– Bravo, bravo ! criait-on.
– La Pepita, tu es une étoile, recommence, recommence !
La ballerine, qui s’était brusquement interrompue, frappant de son haut talon le sol, secouant avec énergie ses castagnettes, tirant de son tambourin une résonance sourde, souriait avec la distinction innée des femmes de là-bas, remerciait d’un sourire ses admirateurs :
– Señores, disait-elle, il en sera fait selon vos désirs, voyez !
Les castagnettes à nouveau emplirent la salle de leur musique criarde, l’Espagnole dansa encore.
Mais, pendant qu’elle interprétait un pas nouveau avec une furia démesurée, alors que ses deux petites mains s’appuyaient à sa taille fine, cependant qu’elle bombait le torse, cambrait la jambe, attaquant en même temps une chanson tour à tour vive et lente, une exclamation dédaigneuse retentit soudain dans le silence de la salle où l’enthousiasme régnait :
– Des pas de mule dansés par une ânesse !
Et tout de suite ce fut le scandale. Les gardes civils s’étaient trouvés debout, fronçant les sourcils, faisant un grand bruit de sabre, prêts à défendre la Pepita, leur idole.
Non moins furieux, les paysans s’étaient levés, eux aussi. Pour la Pepita, elle s’était arrêtée net de danser, ses yeux noirs jetaient des éclairs, elle mordait ses lèvres de ses dents blanches, frissonnante, elle demanda :
– Qui donc a parlé ? qu’il s’avance le capitan qui ne m’applaudit pas !
Et, en vérité, elle était superbe de dépit. Aussi bien, la raillerie qu’on venait de lui adresser était une de ces railleries qu’une danseuse espagnole ne peut pardonner.
Et déjà, frémissante, elle cherchait à sa jarretière la navaja qu’elle y portait, prête à tirer vengeance immédiate de l’affront qu’on lui faisait subir.
– Qu’il avance, le capitan qui me dédaigne !
Dans l’atmosphère lourde du bouge où le tumulte s’éternisait, la voix claire et argentée de la Pepita avait des résonances étranges.
– Paix ! interrompit Alphonse, tenancier de la maison. Si quelqu’un n’est point content, qu’il sorte, c’est dehors que ces choses-là se règlent.
Et les gardes civils, d’un commun accord, demandèrent :
– Où est-il donc, l’insulteur de la Pepita ?
Mais, à ce moment, une stupeur arrêtait net ceux qui se dressaient dans le bouge pour défendre la Pepita. Sur le seuil de la porte, nonchalamment appuyée à la grille de bois, une apparition se tenait, apparition exquise, divine, celle d’une femme tout enveloppée d’un long manteau noir dont on ne voyait guère que le visage, un pur visage d’Espagnole de race, aux lignes fines et fermes encadré d’une merveilleuse chevelure noire dont les reflets soulignaient encore la blancheur du teint.
Et cette femme, cette femme apparue là, cette femme riait.
– Oh la señora, disait-elle enfin, calmez votre courroux, ce n’est point un homme qui vient de parler, c’est une femme, je n’insulte pas la Pepita, je constate simplement qu’elle ne sait pas danser.
Mais c’était en vérité trop d’audace.
L’inconnue n’avait pas achevé de parler que la Pepita, déjà avait bondi vers elle.
Dans sa main sa lame brillait. Ses yeux jetaient des éclairs :
– Par la Madone ! hurlait la danseuse. Fille du diable, je te rentrerai tes propos dans la gorge !
Et un drame se fût peut-être déroulé, car la Pepita était fille à faire comme elle disait et l’inconnue n’avait pas bougé, n’avait pas reculé, insoucieuse, semblait-il, si l’un des gardes civils qui, tout à l’heure s’était fait champion de la Pepita, n’avait arrêté la ballerine par le bras :
– Señorita, disait-il, on ne se bat point de femme à femme et vous ne voudriez point tuer une enfant qui a des yeux aussi beaux que les vôtres.
Tourné vers l’inconnue, le garde civil continuait :
– Señorita, ici, nous aimons la Pepita et nous trouvons qu’elle danse comme dansent les anges de Dieu, mais par la Madone, puisque vous n’êtes point de notre avis, soyez donc la bienvenue parmi nous et dansez à votre tour. Qui traite d’ânesses les oiseaux, qui parle de mules devant l’envolée des fleurs, doit, à coup sûr, mériter nos applaudissements. Señorita, à votre tour, dansez mieux qu’elle et la Pepita sera la première à vous applaudir.
C’était fort bien parlé et la Pepita n’y contredisait pas :
– Dansez, señorita, dit-elle subitement calmée, en jetant aux pieds de l’étrangère son tambourin et ses castagnettes, l’ânesse apprendra peut-être le fandango en vous regardant, qu’à vous entendre, elle ne sait point interpréter.
Or, la femme qui s’appuyait toujours à la barrière de bois de la maison de danse, souriait.
Elle comprenait sans doute ce qu’il y avait d’ironique dans la façon dont on l’invitait à succéder à la Pepita. Elle devinait qu’on s’apprêtait à la siffler pour venger l’insulte qu’elle venait de faire à la danseuse favorite, pourtant elle n’hésita pas.
– Soit, señores, je danserai.
D’un coup de pied elle ouvrit la barrière, entra dans la maison de danse.
– Señor, vous garderez mon manteau. Vous garderez mon manteau, reprenait la nouvelle venue et je vous paierai votre service en vous donnant cette fleur.
Au coin de ses lèvres, elle tenait en effet une superbe fleur rouge qui rehaussait encore la nacre de ses joues. À la volée, elle l’envoya au garde civil qui pâlit soudain.
Puis, l’inconnue s’avança dans le rond de lumière que dessinait la lampe suspendue à la poutre du plafond, brusquement elle apparut sortant de l’ombre, à tous les regards.
À peine était-elle entrée dans le flot de lumière qu’un frisson passait sur l’assistance. L’étrangère était admirablement belle. Elle portait le costume des danseuses professionnelles, la jupe tombant jusqu’aux chevilles, toute garnie de volants de dentelles, semées de clochettes argentines et de grelots. Dans son chignon brillaient deux grands peignes de corail, un collier d’ambre ruisselait sur sa poitrine. Elle était mutine, provocante, troublante :
– Señores, je danse, annonça-t-elle.
Et elle dansa. Sur un rythme populaire en Espagne, un rythme fiévreux et ardent qu’elle indiquait de ses castagnettes et que les joueurs de guitare soulignaient instinctivement d’une basse chantante, elle interprétait follement, rapide par moments, adorablement lascive en d’autres, une valse de fantaisie.
Au sein du bouge empuanti de l’odeur des pipes et des longues cigarettes d’âcre tabac, elle fut quelques instants comme un flocon tourbillonnant de neige, comme un pétale de fleur agité par la brise insensible.
Touchait-elle terre ? On en eût douté. Toute sa personne était grâces et mouvements, elle dansait et mimait à la fois, il y avait dans le jeu de ses bras, dans l’éclair de ses yeux, l’ardeur des déclarations d’amour, la foi des étreintes, l’abandon calme des causeries le soir au clair de lune.
Et puis, brusquement, elle accéléra son pas, secoua plus frénétiquement ses castagnettes palpitantes, à quatre temps sur trois pointes qu’eussent jalousées les plus célèbres danseuses, et elle s’arrêta net.
Et alors, cependant qu’au fond de la salle la Pepita, de rage, déchirait de ses dents aiguisées comme des couteaux un fin mouchoir de dentelle, les bravos éclatèrent, furieux, prodigieux, enthousiastes.
– Bravo, bravo !
On jetait des fleurs, on jetait des éventails, on agitait les chapeaux, jamais de mémoire d’homme on n’avait assisté à pareille danse à l’Escurial de Abajo.
Le garde civil, qui portait le manteau de la ballerine, s’empressait, heureux et fier.
– Qué bonita señorita ! s’écria-t-il.
Mais la danseuse, d’un coup d’œil le remerciait de sa galante exclamation :
– Qué bonito caballero, répondit-elle.
Et il n’était pas moins flatteur pour elle d’être traitée de jolie femme, qu’il n’était agréable pour le garde civil d’être qualifié de superbe cavalier.
Pourtant, de toutes parts, on redemandait une danse.
– Encore, encore, señorita ! Par pitié, dansez toujours !
L’étrangère secouait la tête :
– Merci señores, fit-elle, mais je ne danse plus.
Elle avait repris sa mante, tranquillement elle s’en enveloppait, elle allait partir.
Or, comme l’inconnue se dirigeait vers la porte de la maison de danse, cependant que, galamment tous les assistants, en dignes Espagnols qu’ils étaient, se levaient pour la saluer, n’osant insister pour la faire danser encore, car on ne voudrait pas en Espagne importuner une femme, elle se tourna vers le garde civil à qui elle avait confié quelques instants avant ses vêtements et posa sur son épaule une fine menotte.
– Señor, j’ai deux mots à vous dire, vous plaît-il de m’accompagner ?
Rayonnant, le visage épanoui, le garde civil, naturellement, s’empressait :
– Je suis señorita, votre humble serviteur.
Dehors, car elle sortit immédiatement de la maison de danse, ils rencontrèrent peu de passants, il était près de huit heures du soir, on flânait devant les portes, respirant l’air frais du soir, mais paresseusement, chacun restait chez soi.
– Venez, avait dit l’inconnue.
Et elle avait entraîné le garde civil vers la campagne, dans la direction de l’Escorial de Hijo, ils faisaient quelques pas en silence, puis la ballerine interrogeait :
– Vous vous appelez, señor ?
– Pedro Marcia, je suis votre serviteur.
– Señor, j’ai besoin de vous.
– Señorita, je vous appartiens.
– Vous saurez mon nom, señor, je me nomme la Recuerda.
– Ce sera le nom de celle que j’aime.
Hélas, le garde civil ne se doutait certes pas de la troublante et intrigante personne qu’était la Recuerda, – car c’était bien la Recuerda – qui, pour se venger de Fantômas, se trouvait à l’Escorial de Abajo.
– Señor, reprenait cependant l’extraordinaire et merveilleuse Espagnole, je retiens votre mot. Qui aime, ne compte point avec le danger. Señor, n’êtes-vous pas chargé de garder les tombeaux des rois, n’appartenez-vous pas au service de garde de l’Escorial ?
– Cela est vrai, señorita, mais pourquoi me demandez-vous ces choses ?
– Je suis marquée, dit simplement la danseuse.
Et elle n’avait point besoin, en vérité, d’expliquer davantage au garde civil ce qu’elle entendait par « être marquée ». Il existe, en effet, en Espagne, une superstition commune parmi le peuple, qui veut que certains individus nés dans de certaines conditions, soient désignés par le Ciel pour remplir de hautes destinées à laquelle leur naissance, semble-t-il, ne les appelle pas. On dit que ces heureux privilégiés sont « marqués » et nul ne doute que s’ils accomplissent certains devoirs spéciaux, tout ne leur réussisse dans la vie.
– Vous êtes marquée ? ripostait le garde civil, señorita, rien ne m’étonne de vous, vous devez être et vous serez parmi les plus heureuses, étant déjà parmi les plus belles. Puis-je vous demander la rançon de votre marque ? Puis-je vous aider à accomplir votre devoir ?
– Il se peut… Señor, ma marque dit qu’un jour ou l’autre quelque vaillant soldat m’aimera qui deviendra riche seigneur, cependant que moi-même, heureuse et fière, je mettrai ma main dans sa main et mon cœur dans son cœur. Señor, ma marque doit se réaliser si avant trois jours, – le terme m’est fixé – je puis danser devant le cinquième tombeau du cinquième roi d’Espagne, sous les voûtes mêmes de l’Escorial. Telle est ma marque.
– Telle est votre marque, señorita ?
– Danserai-je devant le cinquième tombeau ? interrogea brusquement la Recuerda.
Le garde civil venait de pâlir.
– C’est votre marque, señorita, et votre marque est peut-être un peu la mienne, puisqu’elle dit qu’un vaillant soldat vous aimera, dit-il enfin, vous danserez, señorita.
Il réfléchit quelques instants, puis lentement :
– Ce soir, à onze heures, par la poterne qui se trouve à l’angle de la quatrième tour.
***
À onze heures précises, Pedro, le garde civil, grâce à la complicité de deux camarades gagnés à sa cause, introduisait la Recuerda dans le Palais de l’Escurial.
– Señorita, souffla-t-il tremblant, refermant sans faire de bruit la poterne qu’il avait entrebâillée pour laisser entrer la jeune femme, je vous en supplie, ne parlez point et prenez garde que nul ne vous entende. Il faut que nous traversions tout le Palais, suivez-moi, je vous guiderai. Par la Madone, j’ai peur, mais je vous conduirai jusqu’au tombeau et vous accomplirez votre destin.
Il guida en effet la Recuerda le long des cours désertes et froides de l’Escurial. Adroitement, il lui fit éviter les patrouilles qui veillaient de toutes parts dans le gigantesque palais :
– Señorita, répéta de temps à autre le garde civil, prenez garde, ici nous traversons les cours où donnent les appartements des infants, certains habitent encore le palais.
– Don Eugenio est-il là ? interrogea la Recuerda.
– Je ne sais, señorita, le connaissez-vous donc ?
– Qu’importe.
À ce moment, Pedro marchait devant la Recuerda. Il était dans l’encoignure sombre d’une étroite voûte de pierre. À la réponse surprenante de sa compagne, le garde civil voulut se retourner, mais il n’eut point le temps d’effectuer ce mouvement. En une minute, avec une force surprenante de la part d’une femme, avec une habileté qu’elle tenait sans doute de son long séjour parmi les apaches parisiens, la Recuerda se jetait sur son guide. Et, quelques secondes après, sans qu’il eût pu se défendre, sans qu’il eût osé appeler à l’aide, Pedro, le pauvre garde civil, était étroitement ligoté, bâillonné ; la Recuerda le considérait avec un sourire amusé.
– Mon beau Pedro, murmura l’extraordinaire aventurière à l’oreille du garde civil, vous songerez à ma marque si vous voulez vous distraire, vous songerez aussi, pour vous en repentir, au rapide abandon que vous avez fait de la malheureuse Pepita. D’ailleurs, je ne vous veux point de mal, j’ai seulement besoin d’agir seule.
La Recuerda traîna jusqu’à un soupirail le malheureux garde civil, plus mort que vif. Elle le jeta de force dans une cave, elle rit en entendant son corps rouler lourdement sur le sol.
– Bonne nuit, caballero ! cria la Recuerda. L’Escurial est visité tous les huit jours, si je ne me trompe, vous ne mourrez pas, on vous sauvera.
Et, ayant dit, la Recuerda, furtive, se glissa le long d’un corridor, avant de monter par le grand escalier.
17 – DRAME À L’ESCURIAL
– Quelle bâtisse, nom d’un chien, c’est pire qu’une caserne, dans le style d’une prison et gai comme le Mont-de-Piété.
Sans le moindre respect pour la majesté, indiscutable cependant, de l’Escurial, Fandor contemplait l’énorme château, une moue dédaigneuse aux lèvres, nullement conquis par l’aspect rébarbatif de la demeure royale.
Pourquoi Fandor se trouvait-il donc à l’Escurial ?
Lorsque le jeune homme avait appris par Delphine Fargeaux qu’Hélène devait être en Espagne, Fandor, en réalité, n’était pas du tout persuadé de la chose, ne tenait nullement pour démontré que la fille de Fantômas fût réellement aux mains de l’infant.
Toutefois, Fandor n’avait pas hésité lorsqu’il s’était rencontré à la Boîte à Joseph avec la Recuerda que lui déléguait Fantômas, à affirmer à cette dernière qu’Hélène se trouvait à l’Escurial.
Fandor, sachant que Juve était prisonnier de Fantômas – puisque le sinistre bandit avait eu la cruauté de faire dérouler cinématographiquement devant Fandor les phases de la captivité du policier – avait décidé que la meilleure façon de sauver Juve était encore de retrouver Hélène pour s’attirer si possible la bienveillance momentanée de Fantômas.
***
Vingt-quatre heures plus tard, Fandor était installé à l’Escurial de Abajo, dans une mansarde qu’il avait louée à un paysan et il commençait à rôder aux environs du palais.
Fandor était d’humeur détestable. Il avait pu se convaincre de l’état d’âme tout particulier des habitants du village. Les interroger sur l’Escurial, sur ceux qui y demeuraient, était chose inutile. Tous se taisaient, frappés de stupeur dès que l’on prononçait le nom du palais. Ils se signaient lorsque l’on voulait savoir au juste ceux des grands seigneurs de l’Espagne qui habituellement y demeuraient.
N’ayant rien pu tirer des Espagnols, Fandor s’était rabattu sur le personnel du superbe Palace, édifié par les soins d’une compagnie anglaise au village même, pour abriter les nombreux touristes.
Malheureusement, les gens de l’hôtel, des « civilisés, ceux-là », comme disait Fandor, ne connaissaient rien de l’Escurial. Tout ce qu’ils en savaient, c’est qu’à certaines dates, des visites étaient autorisées moyennant finance.
– Quels idiots ! grommelait Fandor, je n’ai rien à faire dans la partie du palais où l’on autorise les touristes à promener leurs guêtres jaunes.
« Ça va, songeait Fandor en renonçant à faire bavarder ceux qu’il interrogeait, il paraît que les habitants de l’Escurial sont des gens qu’on n’approche pas facilement et que le populaire ignore.
Têtu comme il l’était, Fandor ne pouvait pourtant pas se décider à renoncer à voir l’infant don Eugénie. Il était venu en Espagne pour cela.
Après cinq jours passés dans le pays, Fandor n’était cependant pas plus avancé qu’au moment de son arrivée.
Certes, il avait bien remarqué que l’Escurial était construit en forme de gril pour rappeler le supplice de certains martyrs chrétiens, couchés jadis dans la Rome païenne, sur des grils chauffés au rouge, mais cette particularité laissait le journaliste indifférent. Il avait cru deviner, d’après les dires d’un garde civil qu’il avait grisé un soir, que la partie nord du château était, en général, l’endroit où se trouvaient les appartements réservés aux infants.
– Si don Eugenio est à l’Escurial, se disait Fandor, contemplant mélancoliquement les petites fenêtres étroites percées dans la façade du château, il est quelque part par là. Mais comment diable arriver jusqu’à lui ?
En bonne tactique, Fandor avait naturellement essayé de télégraphier, d’écrire, de faire porter un message à don Eugenio, mais ce billet était demeuré sans réponse, ses messagers n’avaient pu dépasser le corps de garde.
– Puisqu’on ne veut pas me recevoir, songeait le journaliste, j’entrerai de force, et voilà tout.
Mais c’était là une entreprise téméraire en son principe, impossible peut-être, en fait. Il est impossible d’entrer à l’Escurial sans posséder, soit le mot de passe qui fait fléchir les consignes les plus sévères, soit une lettre d’audience dûment timbrée, signée, paraphée, par le colonel commandant le château. Or, Fandor, bien entendu, ne possédait ni l’un ni l’autre.
– Eh bien tant pis, murmurait-il, tout en faisant le tour de l’énorme palais, j’entrerai par une petite porte, par une gouttière, par n’importe quoi, mais j’entrerai. Je suis venu pour voir don Eugenio, je le verrai.
Or, au tournant d’une muraille, Fandor sursauta d’étonnement en apercevant un homme tranquillement assis sur l’herbe et serrant entre ses jambes une volumineuse bouteille d’alcool, à laquelle il semblait puiser avec complaisance.
– Ça, c’est pas ordinaire, pensa le journaliste, que diable fait-il ici, ce coco-là ?
Bâti, en effet, sur le sommet désert d’une haute colline, l’énorme Escurial est toujours désert. Nul ne s’approche de lui, nul n’ose longer ses murailles et Fandor déjà commettait une sorte de sacrilège en les suivant comme il le faisait.
Or, l’homme qu’il apercevait à l’improviste, un individu qui n’était point vêtu en Espagnol, qui paraissait plutôt quelque Allemand, quelque Italien, était vautré sur l’herbe et aussi tranquille, en apparence, que s’il s’était trouvé à des centaines de kilomètres du sinistre bâtiment.
– Ça, reprenait Fandor, en considérant toujours l’homme, occupé à boire, c’est un lascar original.
Et Fandor supposait immédiatement que ce passant devait être un employé de l’hôtel, ayant fini sa journée de travail et venu là pour respirer le bon air.
Or, Fandor, immédiatement, tentait d’entrer en conversation. Il s’approchait du buveur et, familièrement, en bon français, le questionnait :
– Et alors, camarade, ça va la boisson ? C’est sucré ? Vous n’avez pas l’air de vous embêter.
L’autre ne répondit point, mais rit d’un rire niais, large et satisfait. C’était un homme assez grand, semblait-il, qui avait le visage le plus étonnant du monde : des sourcils épais, fournis, dessinaient un rond presque régulier autour de ses yeux et se rejoignaient au milieu de son front. Une moustache mal taillée, coupée dru, embroussaillait ses lèvres, cependant qu’une barbiche épouvantablement sale cachait son menton.
– Dites donc, reprenait Fandor, qui êtes-vous ? et de quel pays ? Je suis français, moi.
– Je suis auvergnat, fouchtra !
L’homme avait répondu avec une tranquillité parfaite. Il s’interrompit pour puiser encore une copieuse rasade à sa bouteille.
Son calme, toutefois, semblait s’accompagner d’une certaine gaieté.
– Ah vous êtes auvergnat, mais pourquoi diable riez-vous ainsi ? Je suppose que ce n’est pas la vue de ce palais qui vous semble rigolote ? Vous y êtes employé, peut-être bien ?
– Non.
L’Auvergnat avait répondu d’un ton sec et décisif. Or, à la minute, Fandor bondissait en arrière.
– Mais qui êtes-vous ?
Et la voix de Fandor, en prononçant cette question, tremblait.
L’Auvergnat se releva.
Mais, au moment où il se redressait, Fandor s’apercevait qu’il tenait quelque chose de brillant à la main. Et, à l’instant, le jeune homme lui aussi, fouillait dans sa poche fébrilement :
– Bas les masques, cria Fandor, qui êtes-vous ?
– Pourquoi me le demandez-vous ? vous m’avez reconnu.
Fandor tira son revolver.
– Fantômas ! hurla-t-il.
Mais le bandit, car c’était bien lui, secouait lentement la tête :
– Fantômas ? disait-il, peut-être, Jérôme Fandor, mais c’est avant tout le père d’Hélène qui vous parle. Vous savez où est ma fille ?
– Non, je ne le sais pas.
Fantômas, pourtant, avait arraché sa perruque, arraché ses faux sourcils, arraché sa barbe. C’était son visage glabre, énergique, volontaire que Fandor contemplait. Le bandit paraissait au comble de la colère. Son regard se fixa sur celui de Fandor :
– Vous mentez, Jérôme Fandor ! Si vous êtes ici à l’Escurial, c’est que vous savez où est Hélène.
– Vous vous trompez, je cherche votre fille, mais je ne sais pas où elle est.
Un silence pesa entre les deux hommes. Jérôme Fandor tenait à la main son revolver, prêt à faire feu. Fantômas, lui aussi, était armé.
Fantômas reprit d’une voix plus douce :
– Jérôme Fandor, voulez-vous que nous cherchions ensemble Hélène ?
Fandor, à cet instant, oublia toute mesure, tant la colère et la haine l’aveuglaient. Il oublia même son meilleur ami. Il ne songea plus aux dangers que courait Juve. Il ne pensa pas, devant le tortionnaire, à prendre aucun ménagement, aucune précaution, il hurla :
– Fantômas, je vous somme de vous rendre ! Il y a dix ans que nous vous poursuivons, et aujourd’hui, je n’hésiterai pas !
Fandor avait levé le bras. Mais il ne pressait pas sur la détente. Même devant cet ennemi mortel, même devant Fantômas, Fandor ne pouvait se décider à faire le geste qui tue.
D’ailleurs, il n’était plus temps d’hésiter. Aussi vif que lui, Fantômas avait aussi braqué son arme.
– Allons, Jérôme Fandor, gouaillait le bandit, vous n’y songez pas : me rendre, moi ? Pourquoi ? Que je voie votre doigt bouger sur la détente et je fais feu. Vous me tuerez peut-être, mais je vous tuerai aussi.
Fantômas ne mentait point. Se menaçant tous les deux de leurs revolvers, lui et Fandor feraient feu ensemble. C’était ensemble sans doute, si ce duel tragique avait lieu, qu’ils se tueraient l’un et l’autre.
Entre eux, à quelques pas de Fantômas, comme à quelques pas de Fandor, quelque chose de brillant, qui reluisait aux derniers rayons de soleil, tomba sur le sol, probablement jeté de l’une des fenêtres du Palais.
Les deux hommes tressaillirent.
– Mon Dieu, qu’est-ce que c’est ? cria Fandor.
Mais, en même temps, Fantômas s’était précipité. il ne faisait plus attention, semblait-il à Fandor ému, tremblant. Il s’agenouilla. Il ramassa l’objet qui venait de tomber :
– Un bracelet, hurla Fantômas, c’est un bracelet, le bracelet d’Hélène !
Il allait continuer à parler, lorsque l’objet, le bracelet d’or qu’il venait de ramasser, lui échappa brusquement des mains. Fantômas n’avait pas vu qu’il était attaché à un fil.
Fandor et Fantômas n’étaient point encore revenus de leur stupéfaction : le mince anneau d’or montait lentement le long de la muraille sombre de l’Escurial, qu’ils devaient se séparer.
– Señores, vous êtes priés de vous en aller. Il n’est pas permis de stationner ici.
Ni l’un ni l’autre n’avait fait attention à une patrouille brusquement survenue. Des gardes civils les contraignirent à s’éloigner. Fantômas s’en alla, rayonnant. Fandor dégringola la colline, oubliant qu’il venait de rencontrer l’épouvantable bandit, murmurant seulement tout bas :
– C’était le bracelet d’Hélène, c’était un signal. Hélène est prisonnière à l’Escurial.
***
Après avoir ligoté le malheureux garde civil qu’elle avait si habilement dupé, et l’avoir jeté dans l’une des caves du Palais, la Recuerda s’était engagée dans l’un des escaliers qui conduisaient aux étages de l’Escurial.
La jeune femme paraissait s’orienter avec une extraordinaire facilité dans l’immense monument. Elle suivait de longs corridors, traversait des galeries, puis, appuyant sur une pierre, démasquait une porte secrète. Quelques instants plus tard, la Recuerda était dans les appartements de l’infant don Eugenio et pouvait se convaincre que celui-ci n’habitait pas l’Escurial pour le moment.
– Ce n’est pas de chance, murmura la Recuerda. Avoir risqué ce que j’ai risqué pour rencontrer don Eugenio et ne pas le trouver… Bah, il n’empêche. Les autres ne le savent pas, ils viendront.
De qui parlait la Recuerda ?
La jeune femme visita minutieusement les somptueux appartements réservés à l’infant. Elle tressaillit, émue, en découvrant une chambre meublée comme une chambre de jeune fille. Elle s’occupait à passer en revue les pièces de l’appartement où elle se trouvait, demeurant de longues minutes dans chacune d’elles, bouleversée. Dans la chambre de jeune fille, où elle pénétrait en dernier lieu, la Recuerda ouvrait un écrin qui traînait sur la cheminée. La pièce était en désordre, d’ailleurs, et paraissait avoir été quittée précipitamment peu de temps auparavant.