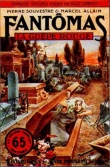Текст книги "Le mariage de Fantômas (Свадьба Фантомаса)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
23 – LES DEUX BOURREAUX
– Le señor ne veut pas une autre tasse de chocolat ?
– Non, mon ami. Le chocolat est une bonne chose, mais tout de même je ne tiens pas à en abuser.
– En ce cas, j’apporte au señor, à la minute, son verre d’eau sucrée.
– Mon verre d’eau sucrée ? Mais je ne vous ai rien commandé de pareil.
– Le señor n’avait pas besoin de me le commander, je sais bien que le señor…
– Vous ne savez rien du tout. Tenez, voilà ce que je vous dois, et au revoir.
Juve se leva, à l’ébahissement profond du garçon de café espagnol qui ne pouvait guère comprendre que l’on prît du chocolat sans faire suivre cette dégustation de celle d’un verre d’eau sucrée.
Juve était à Madrid, et paraissait de la meilleure humeur du monde. Il était dix heures du soir, il venait de descendre du Sud-Express, et guilleret, fredonnant une chanson, il s’en allait à grands pas le long des rues pittoresques où tout le peuple de Madrid grouillait, les femmes en mantille noire, la fleur rouge piquée dans les cheveux, les hommes en vestes courtes, le boléro posé crânement, un peu en arrière sur l’oreille.
– Tradéridéra, chantonnait Juve qui, à frôler les pimpantes Espagnoles, se sentait de vingt ans plus jeune. Ça va tout de même me faire plaisir de voir mon petit Fandor. Qu’est-ce qu’il va me chanter sur les prisons espagnoles ? Bah, ça lui apprendra. Les voyages forment la jeunesse.
Juve était donc à Madrid pour extrader Fandor. Il avait eu, deux jours auparavant, l’émotion d’apprendre de la bouche de Dupont de l’Aube le récit des aventures de Fandor, il avait su que le jeune homme était tombé aux mains des moines et qu’il était très régulièrement condamné au supplice du garrot.
– Tout de même, avait ajouté Dupont de l’Aube, ne vous inquiétez pas, mon cher Juve, rien n’est encore perdu, et même tout est sauvé, car je vais aujourd’hui voir le ministre des Affaires Étrangères, et le salut de Fandor ne fait pas de doute. En pareil cas, avec les moines, une grâce est toujours une question de prix.
Deux heures plus tard, Juve, en effet, avait reçu un coup de téléphone de Dupont de l’Aube lui apprenant que l’affaire était arrangée et lui donnant rendez-vous, si le cœur lui en disait, à Madrid même, où Fandor venait d’être transféré aux fins d’exécution, mais où il allait être remis en liberté sur la présentation du brevet.
C’était à ce rendez-vous sur la plus grande place de Madrid, à quelques pas de la prison, que Juve se rendait.
– Ma foi, monologuait le policier, je n’ai jamais eu une grande sympathie pour Dupont de l’Aube qui m’a toujours paru un peu vaniteux, un peu plein de lui-même, mais il faut convenir que, aujourd’hui, je dois le considérer comme un brave homme.
Or, tout en marchant, tout en s’orientant avec quelque peine dans Madrid, Juve continuait à dévisager les passants, à s’intéresser aux mouvements de la rue. Il longeait à cet instant une sorte de boulevard, un grand corso aux trottoirs bizarrement pavés de petites pierres rondes coupées de rigoles.
Juve remarquait au-dessus d’une porte le drapeau français.
– Tiens, l’Ambassade.
Il fut sur le point de passer, puis il se retourna, revint en arrière, entra dans l’édifice. En effet, les nécessités d’un climat parfois brûlant font qu’à Madrid toutes les administrations publiques restent ouvertes jusqu’à dix heures du soir. Juve pénétra dans les bureaux au moment où les employés s’apprêtaient à partir.
– Messieurs, demanda Juve, seriez-vous assez aimables pour me communiquer les feuilles de l’Havas, que vous avez dû recevoir ?
Il tendit sa carte, justifia de son identité, de sa qualité de policier, et très obligeamment, un attaché d’ambassade, quelques instants plus tard, lui passait les dépêches expédiées de Paris.
D’abord Juve n’y lisait que des renseignements peu intéressants. Une fabrique de sucre avait brûlé. La grève des taximètres s’éternisait [14]. On avait volé son réticule à une vieille femme alors qu’elle passait dans la rue de Rivoli. Mais soudain, Juve blêmit, haletait, pensa défaillir. En grosses lettres, le policier avait lu cette nouvelle :
On a retrouvé dans le fossé des fortifications, le cadavre de M. Dupont de i’Aube, sénateur, propriétaire du journal la Capitale, et chargé de mission officieuse en Espagne.
– Malédiction ! jura Juve, tout est perdu.
De ses lèvres qui tremblaient, un nom s’échappait :
– Fantômas.
***
Il était minuit à peu près. Dans le faubourg écarté où s’élevait la maison que tous connaissaient à Madrid, chacun dormait encore et les rues, à perte de vue, étaient solitaires. Un homme, pourtant, avançait à grands pas au milieu de l’une des calles, qui débouchaient près de la Maison-Verte. Il était vêtu à la française, il paraissait rompu de fatigue, et, de temps à autre, des mots sans suite s’échappaient de ses lèvres :
Cet homme, c’était Juve. Comment Juve était-il dans ce quartier désert de Madrid ? qu’y venait-il faire ? Pourquoi précipitait-il encore sa marche en apercevant la Maison-Verte ?
Lorsque Juve, à dix heures du soir, avait appris dans les bureaux de l’Ambassade, cette nouvelle épouvantable, la mort de Dupont de l’Aube, il avait pensé périr sur place. Dupont de l’Aube mort, Dupont de l’Aube assassiné, c’était immédiatement pour Juve, la certitude que Fandor allait être exécuté, que l’ordre d’extradition n’arriverait pas à temps. Qui donc d’ailleurs avait pu tuer Dupont de l’Aube ? Qui donc, si ce n’était Fantômas ?
Et Juve, en un instant, affolé, et pourtant raisonnant logiquement, avait deviné l’effroyable aventure : Fantômas faisant emprisonner Fandor en Espagne. Fantômas apprenant que Dupont de l’Aube allait sauver le jeune homme. Fantômas attirant Dupont de l’Aube, le tuant pour laisser périr Fandor.
– L’ambassadeur ? avait hurlé Juve, il faut que je parle à l’ambassadeur.
Mais le malheureux policier qui, si joyeux encore quelques minutes auparavant, se sentait désespéré maintenant, obtint une réponse épouvantable :
– Señor, l’ambassadeur n’est pas à Madrid, il est en voyage.
– Alors, menez-moi vers la personne qui le remplace.
– Señor, elle est à la cour.
– Il y a pourtant quelqu’un ici qui commande.
– Non, señor, il n’y a plus personne. Demain, à deux heures, peut-être.
– Demain, demain, il serait trop tard.
Et si Juve n’insistait pas, c’est qu’il se rendait compte que toute démarche serait inutile.
Juve connaissait trop bien la bureaucratie, la crainte des responsabilités pour pouvoir garder l’espoir d’émouvoir un fonctionnaire, de le faire intervenir.
– On ne me croira pas, on ne tentera rien, et pourtant !
Juve croyait vivre un cauchemar. Depuis que Dupont de l’Aube, homme précis et ponctuel, lui avait téléphoné, que la grâce de Fandor était un fait acquis, Juve ne s’était plus guère inquiété au sujet du journaliste. Et voilà que, brusquement, à quelques heures de l’exécution, Juve apprenait que l’extradition n’aurait point d’effet.
Et puis, brusquement, Juve s’était retrouvé maître de lui-même.
– Il ne faut pas que Fandor meure. Il faut que je le sauve.
Juve, encore qu’il parlât mal l’espagnol et qu’il le comprît difficilement, se livrait à la plus curieuse des enquêtes : il entra dans les bars, il pénétra dans les maisons de danse, il interviewa des gardes civils. En deux heures, Juve fut partout, vit des quantités de gens, trouva moyen de se faire comprendre, inventait des histoires invraisemblables, apparaissait, disparaissait, réapparaissait.
Et à minuit, Juve se trouvait devant la Maison-Verte.
Or, à peine le policier avait-il approché de la lourde porte qui fermait la demeure, peinte en vert, du seuil jusqu’au toit, qu’il heurta d’un vigoureux coup de marteau :
– Holà, geôlier !
D’abord, il n’obtint aucune réponse, mais il frappa si fort, qu’à la fin, une voix hurla de l’intérieur de la maison :
– Ce n’est pas l’heure.
– Eh non ! ce n’est pas l’heure, c’est un Français qui est là et un Français, don José, qui a besoin de vous voir.
Il y eut à l’intérieur de la Maison-Verte un grand brouhaha, des bruits de pas, des allées et venues stupéfaites.
À la fin, la porte s’entrebâilla et le visage effaré d’un homme d’une trentaine d’années apparut devant Juve :
– Vous demandez ? vous êtes Français ? Comment avez-vous su mon adresse ?
L’homme dormait encore et embrouillait les questions. Juve n’hésita pas, d’un coup d’épaule, il ouvrit la porte, il entra, il la referma sur lui.
– José, j’ai à te parler.
José l’Espagnol paraissait effrayé.
– Mais Señor, qui êtes-vous donc ?
– Peu importe.
Juve entraînait toujours l’homme ; assurément, si dans ses conversations de la soirée, si au cours de son enquête, Juve s’était fait donner l’adresse, il s’était fait aussi expliquer la façon dont la maison était construite. Il entraînait en effet José vers une sorte de petit jardin, un « patio » ombragé et là s’arrêta net.
– José, j’ai à te parler, répéta-t-il.
– À me parler ? répondait l’autre, le señor veut me parler ? le señor sait donc qui je suis ?
La figure de Juve pâlissait encore plus s’il était possible, cependant qu’une expression de rage contractait ses traits :
– Tu es le bourreau, faisait-il, et c’est toi qui, tout à l’heure, au petit jour, vas tuer sur la Plaza Mayor.
– C’est vrai señor, mais comment ?
– Tais-toi, interrompit Juve.
Le policier avait plongé la main dans la poche. Cependant que le bourreau stupéfait, car José était bien le bourreau, le considérait, Juve tirait une pleine poignée d’or, qui représentait évidemment tout l’argent monnayé qu’il avait emporté de France.
– José, demandait Juve, aimes-tu l’or ?
Les yeux du bourreau flamboyèrent : une lumière soudaine s’était faite dans son esprit. À la question de Juve, il recula de trois pas, les mains jointes et appuyées sur sa poitrine.
– Le señor est Français ? dit tout bas José, et c’est un Français que je garrotte tout à l’heure, le señor veut ? Oh, je comprends, mais c’est impossible.
– Tu ne comprends rien, dit Juve.
Et, en même temps le policier jeta des louis d’or sur le sol.
– Tiens, tu les prendras demain. Écoute José. Écoute bien : ce que je viens de te donner, ce n’est rien, si tu fais ce que je veux, tu recevras dix fois autant de pièces d’or.
– C’est impossible, señor.
– Mais tais-toi donc José. Tu ne me comprends pas.
– Señor, vous voulez sans doute que je sauve le condamné.
– Non, ce n’est pas cela que je veux.
Juve venait de parler avec une rage épouvantable. Il avait protesté si violemment qu’il ne voulait point sauver le condamné à mort que José le croyait. Le bourreau roulait des yeux étonnés, il ne comprenait plus du tout ce qu’allait lui demander l’étrange visiteur nocturne.
– Señor, que désirez-vous de moi ? interrogeait l’Espagnol.
Et Juve alors, se rapprocha de l’homme. Il se pencha sur lui, il lui souffla au visage plus qu’il ne les lui murmurait, ces mots extraordinaires :
– José, je ne connais point le condamné que l’on exécute demain, peu m’importe, qui il est. Peu m’importent ses crimes. Ce n’est pas cela, ce n’est pas sa grâce que je veux. Écoute ! Écoute, bourreau, tu as devant toi un insensé, un dément, un fou. Un malheureux aussi qui n’a qu’une passion : la passion de la mort.
– La Madone me protège !
Entendant Juve, le bourreau venait de se signer encore, et tremblait maintenant de tous ses membres. Et Juve poursuivait :
– J’ai la passion de la mort, comprends-tu ? Je ne suis heureux que lorsque j’entends des râles d’agonie, que lorsque je tue. Ah, bourreau, c’est horrible, mais je souffre de cette étrange folie. Et je suis honnête homme pourtant, je suis un honnête homme, mon Dieu. Et je ne puis pas tuer jamais, car il est interdit de tuer, car il est impossible de tuer.
– Señor, señor, vous me faites peur !
– Non, n’aie pas peur, José, je t’ai donné de l’or, je t’en donnerai d’autre, comprends moi bien, voilà tout ce que je veux de toi. Oh, c’est si simple, cela a si peu d’importance, et je te paierai si richement que tu ne peux pas refuser. Je veux que tu me prêtes tes habits. Je veux que tu me laisses prendre ta place demain auprès du garrot. Je veux que tu contentes ma passion. Je veux que ce soit moi qui exécute à ta place. Dis, tu acceptes ?
– La Madone me garde ! répétait le bourreau.
Mais Juve, admirable dans la comédie qu’il jouait, poursuivait toujours d’une voix insensée :
– Pour satisfaire ma passion, vois-tu, pour satisfaire le besoin de mort que j’ai, je me suis fait l’errant perpétuel du monde entier. Quand je sais qu’il y a une exécution quelque part, c’est moi qui veux la faire. Je m’arrange pour être partout, je connais tous les bourreaux du monde. Les bourreaux. Mais il n’y a pas d’autre bourreau que moi. C’est toujours moi qui tue en tous pays, partout te dis-je. Car partout les bourreaux me connaissent et partout ils consentent à ce que je les remplace. Tu seras riche, José, acceptes-tu ?
José, le bourreau de Madrid, ne se signa plus, il contemplait à la clarté de la lune, les louis d’or qui scintillaient sur le sol de son jardin.
***
Madrid était véritablement en fête. Des faubourgs comme des quartiers luxueux de la ville, un peuple en liesse, inlassablement, marchait, courait, se bousculait vers la Plaza Mayor.
Madrid, qui compte comme le plus glorieux des plaisirs les sanglantes fêtes des taureaux, allait voir, ce matin-là, le spectacle plus délicat encore d’une exécution capitale.
Certes, on aurait à peine la vue du sang, car le garrot n’amène jamais de blessure, ou de plaie, mais, en revanche, pendant le court instant où, l’exécution faite, le bourreau soulèverait le voile jeté sur le visage du condamné, on pourrait apercevoir l’horreur grimaçante de la figure du supplicié.
Et, pour que chacun pût jouir de la beauté du spectacle, des entrepreneurs s’étaient trouvés qui, impudemment, tout autour de la Plaza Mayor, avaient dressé des estrades d’où l’on pouvait merveilleusement apercevoir le sinistre garrot.
On avait assisté au travail compliqué des menuisiers qui, sur de longs tréteaux, avaient dressé l’estrade sur laquelle était installé, au centre de la Plaza Mayor, l’instrument du supplice. On examinait avec un intérêt plus vif encore le garrot lui-même.
C’était une sorte de piquet haut de deux mètres à peu près, profondément enfoncé en terre, dépassant le plancher de l’estrade et comportant un appareil bizarre. Devant le piquet, se trouvait une chaise, sur laquelle le condamné allait s’asseoir. À peine serait-il là qu’on lui passerait autour du cou, une sorte de boucle de fer qui lui serrerait la gorge. Cette boucle de fer traversait librement les planches du piquet, et venait aboutir par une vis à une sorte de tourniquet.
Au moment de l’exécution, le cou du condamné étant pris dans la boucle de fer, le bourreau n’aurait qu’à tourner le tourniquet, la vis tirerait la boucle de fer, le cou du supplicié serait lentement broyé entre la boucle et la planche.
– Hé, hé, criaient des hommes, on va voir s’il fera des grimaces, ce damné Français !
Mais les plaisanteries devenaient de plus en plus rares. Montés sur de petits chevaux arabes, des gardes civils avaient fait leur apparition. Ils entouraient le garrot, ils prenaient place autour de l’estrade fatale, à quelques mètres.
– Attention ! ça va commencer, cria-t-on.
Derrière les gardes civils, une procession s’était avancée. Bannières en tête, oriflammes claquant au vent, des religieux vêtus de rouge approchaient à petits pas. Ils portaient des statuettes sur de longs brancards qu’ils soutenaient de l’épaule, des enfants de chœur agitaient des encensoirs, d’autres haussaient des cierges, c’était la procession de la mort.
Derrière les prêtres, enfin, vêtu de rouge, coiffé d’un bonnet rouge, le visage recouvert d’une sorte de loup noir, ainsi que le veut la loi, suivi de vingt gardes civils, le bourreau s’avançait.
Les habitués des exécutions remarquaient, avec surprise, que ce ne devait point être José qui opérait ce matin-là.
– Ce n’est pas lui, criait-on, il est moins grand.
– Allons donc !
– Si, il est plus fort. C’est un nouveau bourreau.
Mais cela, évidemment, n’avait guère d’importance.
Un bourreau espagnol est toujours libre de choisir les aides qui lui conviennent, l’homme habillé de rouge qui montait sur le garrot n’était peut-être qu’un aide, le vrai bourreau allait sans doute arriver.
Et soudain, alors que le soleil, brusquement, illuminait la Plaza Mayor de ses rayons crus, un chant liturgique au loin s’élevait dans l’air.
Les portes de la prison s’étaient ouvertes. Des moines en robes blanches, la tête recouverte de la cagoule des pénitents, portant chacun deux cierges noirs allumés, s’avançaient à pas lents, psalmodiant sur un rythme funèbre, les hymnes de la messe des Morts. Alors, un grand frisson secoua tous les assistants, c’était une clameur formidable qui montait vers le ciel :
– Les voilà, les voilà !
***
Debout à côté du garrot, Juve attendait, contemplant avec des yeux fous l’effroyable procession qui précédait le supplicié : Fandor, qu’il allait avoir charge de garrotter, qu’il espérait bien, qu’il était certain naturellement de sauver.
D’abord les moines, aux costumes flamboyants, puis des capucins, vêtus de sombre, puis des enfants de chœur aux soutanelles empanachées de broderies qui flottaient au vent. Derrière eux, des chantres soufflaient de lentes mélodies. D’autres religieux venaient enfin, et, dans la poussière que soulevait le convoi, des armures scintillaient, un triple rang de soldats, l’épée nue, précédaient le condamné. Et c’était enfin, marchant seul, les poignets attachés derrière le dos, les jambes entravées par une corde, le condamné : Jérôme Fandor.
Juve n’avait plus d’yeux que pour Fandor. C’était lui et lui seulement que le policier voyait au sein de la multitude grouillante. Fandor marchait à grands pas, les yeux fixés à terre, un sourire sarcastique au coin des lèvres, superbement courageux, mais très pâle.
– Je le sauverai, je le sauverai, se disait Juve. Et il se rappelait ce qu’il avait décidé.
– En mettant la boucle autour de son cou, je le préviendrai que la boucle a été déclavetée par moi et j’aurai beau tourner le tourniquet, il ne sera pas étranglé. Sur le voile que je dois jeter sur son visage pendant l’exécution et soulever une seconde, pour montrer ses traits au peuple, j’ai écrasé de la couleur bleue, je ferai en sorte de lui appliquer ce voile sur le visage, sa face aura ainsi la coloration sinistre des faces de suppliciés. Après, mon Dieu, aux termes du règlement, c’est moi, le bourreau, moi qui dois l’emporter dans une voiture, moi qui dois l’enterrer. Je le sauverai.
Pourtant, le De Profundis devenait de plus en plus distinct. Avec une exaltation croissante, les religieux qui accompagnaient Fandor hurlaient vers le ciel bleu leur prière funèbre.
Le cortège, d’ailleurs, se disloquait, les moines se groupaient autour de l’échafaud. Seul le confesseur de Fandor demeurait auprès du supplicié :
– Repentez-vous, mon frère, clamait-il, d’une voix qui glaçait Juve jusqu’aux moelles, repentez-vous, car d’ici trois minutes, vous serez devant Dieu le Père.
Parvenu au pied des marches qui devaient le conduire au garrot, Fandor, à cet instant, leva la tête. Il aperçut le bourreau.
Juve vit le jeune homme tressaillir. Était-il reconnu ? Fandor comprenait-il qu’il allait être sauvé ?
Juve s’avança. Il fit trois pas au-devant du condamné. Il voulait faire trois pas. Hélas, au moment précis, en effet, où Juve s’approchait de Fandor, il se sentit brusquement empoigné, bousculé, emporté loin du garrot. À côté de lui, l’homme rouge, un autre homme rouge, s’était dressé, et ce bourreau survenu, ce nouveau bourreau, c’était le vrai bourreau, c’était José,
– Empoignez cet homme, avait crié l’exécuteur des hautes œuvres, c’est moi qui dois exécuter et non pas lui.
Et Juve eut beau se débattre, écumant, fou de rage et de terreur, il eut beau entreprendre une lutte insensée, cependant que des clameurs folles s’échappaient des rangs du peuple, Juve était emporté, entraîné au loin, par les gardes civils accourus.
C’était José, le vrai bourreau, qui prenait possession de Fandor, c’était lui qui l’asseyait de force sur la chaise, c’était lui qui empoignait le tourniquet, qui allait exécuter Fandor.