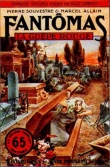Текст книги "Le mariage de Fantômas (Свадьба Фантомаса)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
– Au poste, au poste ! ordonnaient les agents, vous vous expliquerez devant le commissaire. Allons, venez, vous aussi, monsieur, vous êtes le témoin.
Ils encadrèrent les deux femmes, les jeunes gens qui s’étaient empressés de les séparer, ils poussèrent tout le monde, le baron Stolberg compris, vers le poste de police installé dans l’Opéra même, qui donne rue Halévy.
– Allons au poste, en effet, disait Stolberg. Le commissaire comprendra tout de suite que cet incident est seulement ridicule et il nous fera tous relâcher.
– Le commissaire de police n’est pas là, dit le brigadier, il ne passe au poste qu’à une heure du matin. Tout ça, ça n’est pas clair. En l’attendant, je vais tous vous mettre au violon. Ma foi, ça vous apprendra, les uns et les autres, tout gens chics que vous êtes, à vous conduire comme des voyous.
Et, superbe de dédain, merveilleux d’audace, sans s’inquiéter des protestations que son procédé inqualifiable soulevait de la part des personnages arrêtés, le brigadier, à peine arrivé au poste, fit en effet entrer les personnes qu’il venait d’appréhender dans le cachot où se trouvaient déjà une dizaine d’individus arrêtés pour tapage sur la voie publique dans la journée.
– Déplorable, dit le baron Stolberg, devenu très digne, ayant retrouvé tout son sang-froid. Messieurs, ajouta-t-il, en se tournant vers les quatre jeunes gens qui avaient été arrêtés en même temps que lui, alors qu’ils n’étaient pour rien dans les aventures de la soirée, messieurs, je vous fais toutes mes excuses pour la sotte affaire où vous voici compromis. Voulez-vous me permettre de vous demander vos noms ? Voici ma carte. J’irai demain, si l’on me relâche toutefois, vous présenter mes excuses.
Les autres jeunes gens riaient déjà, amusés par le pittoresque de leur arrestation et l’incompréhension des agents, et un échange de cartes eut lieu.
À l’intérieur du violon, cependant, Delphine Fargeaux et la Recuerda, soudain muettes l’une et l’autre, se contemplaient en silence, étonnées de l’attitude presque gouailleuse, infiniment calme en tout cas que venait d’adopter le baron Stolberg.
– Ma parole, pensait Delphine Fargeaux, je m’attends presque à ce qu’il dise qu’il ne nous connaît ni l’une ni l’autre.
À peine l’échange de cartes était-il terminé que Nicolas Stolberg, après avoir jeté un regard à la Recuerda, s’approchait de Delphine Fargeaux. Et c’est bas, qu’il murmurait à l’oreille de la coquette, cette phrase qui, soudain, la fit radieuse :
– Madame, excusez-moi de ne point pouvoir vous défendre comme je le voudrais, mon attitude doit vous paraître révoltante, croyez que je suis obligé d’agir comme je le fais. Dans quelques instants, d’ailleurs, nous allons être libres. Je vous en prie, veuillez me permettre de vous accompagner chez vous. J’ai à vous parler.
À peine avait-il dit ces mots qu’il s’inclinait, et, sans attendre de réponse, quittait Delphine Fargeaux pour s’approcher de la Recuerda :
– Ma chère, déclarait-il à l’Espagnole, qui le regardait avec surprise, cette petite Fargeaux est complètement folle. Il faut à tout prix qu’elle cesse de nous gêner. Tâchez d’être raisonnable. Tout à l’heure je partirai avec elle. Demain je vous verrai. J’ai à causer avec vous.
Il sourit en disant ces mots, puis salua. Et, deux minutes plus tard, Stolberg s’arrêtait, respirait profondément :
– Mais, sapristi, dit-il, cela sent terriblement le gaz, ici.
– Et comment qu’ça sent l’gaz ! Ça l’pue à plein nez !
C’était un marchand de quatre-saisons mis au violon pour refus de circuler qui donnait la réplique au baron Stolberg.
Mais, bientôt, chacun faisait chorus :
– Cela infecte le gaz, déclarait l’un des jeunes gens arrêté sur les marches de l’Opéra, c’est à croire qu’une tuyauterie quelconque est crevée et qu’il y a une fuite.
– Écoutez donc.
Un autre jeune homme, qui avait tendu à Stolberg une carte portant le nom : vicomte de Paluce, demandait le silence. On entendit alors une sorte de sifflement.
– Mais, reprit le baron, c’est parfaitement exact ; il y a un tuyau rompu, nous allons être asphyxiés.
À l’endroit même où il s’était appuyé à la muraille, quelques instants auparavant, et de façon si naturelle que personne ne s’était inquiété de ses gestes, une tuyauterie apparente tranchée d’un coup de canif, lâchait du gaz.
– Nous allons être asphyxiés.
Rapidement, Stolberg traversant le violon, frappa la porte.
– Y a-t-il des agents ici ? criait-il, au secours !
La voix brutale du brigadier s’informa :
– Voulez-vous rester tranquilles, là-dedans, qu’est-ce qu’il y a encore ?
– Ouvrez, criait le baron. Il y a une fuite de gaz. Nous allons périr asphyxiés dans votre violon.
La chose était grave, évidemment. Le brigadier, quelle que fût sa brutalité et son intransigeance, n’osait pas refuser de vérifier une pareille affirmation : il entrouvrit la porte, renifla, se convainquit qu’on ne lui avait pas menti.
– Ah, saloperie de saloperie, bougonna le brave gardien, c’est tout de même vrai que ça pue le gaz, bon Dieu de nom d’un chien ! Je ne peux pourtant pas vous laisser crever là-dedans et, d’autre part, j’aurais beau fermer le compteur, il ne commande pas cette conduite.
Le brigadier discuta quelques instants avec ses hommes qui, tous, étaient unanimes à déplorer l’arrestation des gens du monde :
– Eh bien, décida-t-il subitement radouci, il n’y a qu’un moyen de s’en sortir, puisqu’on ne peut plus vous garder au poste sous peine de vous asphyxier et que je n’ai pas d’autres endroits pour vous mettre, je m’en vais vous relâcher. Allons, foutez le camp, mais ne recommencez pas ! Allez, caltez tous. Caltez, nom d’un chien ! Vous aussi, les marchands de quatre-saisons, faut pourtant pas vous faire crever comme des lapins dans un terrier. Ah, par exemple, qu’est-ce qu’il va me chanter, le commissaire, quand il saura !
Et, pendant que les prisonniers, surpris, se hâtaient de quitter le poste, le brigadier appelait ses hommes :
– Eh bien, qu’est-ce que vous foutez là, à bâiller comme des carpes, bon sang ? Ce n’est pas malin, allez vite réquisitionner un plombier, qu’il vienne aplatir le tuyau, boucher la fuite, faire ce qu’il faut, enfin.
Dehors, sur le trottoir, avec des poignées de mains cordiales, les jeunes gens arrêtés à l’Opéra se séparaient en plaisantant sur leur courte captivité. La Recuerda avait appelé un fiacre, s’était éloignée. Très à l’aise, le baron Stolberg faisait monter Delphine Fargeaux dans une auto, saluait encore courtoisement ceux qu’il avait bien involontairement fait arrêter, revenait vers la voiture, jetait une adresse au cocher :
– Vous êtes jolie, commença Stolberg, entrant dans la voiture où Delphine Fargeaux, ahurie, l’attendait.
26 – VICTIME DU COCHER
– Vous êtes jolie, madame. Vous êtes exquise, et je ne saurais trop bénir les incidents de la soirée puisqu’ils me permettent de me trouver à côté de vous à cette minute et qu’ils sont cause du bonheur que j’ai à vous entretenir ainsi.
D’une voix charmeuse, avec des accents savamment étudiés, le baron Stolberg parlait à Delphine Fargeaux. Et c’était pour la jeune femme, en vérité, un grand honneur d’entendre le Baron parler ainsi. Depuis la veille au soir, elle rêvait de cet entretien. Il survenait enfin, elle ne pouvait croire à sa chance et elle oubliait presque la façon plutôt extraordinaire dont elle avait fait la connaissance du baron Stolberg. Delphine Fargeaux, qui n’était pas d’une intelligence suprême, qui incarnait à merveille le type de la petite provinciale grisée par la vie parisienne, se laissait prendre à toutes les fadeurs, à tous les compliments, pourvu qu’ils fussent dits avec une jolie voix et un accent convaincant, ferma les yeux, parut se recueillir, répondit lentement à voix basse :
– Si vous êtes heureux d’être avec moi, croyez, cher monsieur, que je n’éprouve pas moins de plaisir à me trouver à vos côtés. J’avais peur pour vous d’ailleurs. Cette femme, cette épouvantable femme qui s’est jetée sur moi tout à l’heure…
– Oh je vous en prie, madame, ne gâtons pas l’heure présente en évoquant de vilains souvenirs. Oublions.
Cela ne faisait pas l’affaire de Delphine Fargeaux. Malgré la prière que l’on venait de lui adresser, elle demanda donc :
– C’est votre maîtresse, cette femme ?
– Ne pensez pas à elle, et si je ne vous déplais point, laissez-moi en paix vous regarder, vous admirer, sans me troubler du souvenir d’une importune.
Il n’y avait, cette fois, rien à répondre. Delphine Fargeaux sourit, donna trois chiquenaudes à sa coiffure, chercha la pose la plus coquette, se serra un peu contre Nicolas Stolberg :
– Où me menez-vous ? interrogea-t-elle curieuse. Savez-vous que tout à l’heure, vous m’aviez proposé de me reconduire chez moi. Or la voiture file et vous ne m’avez même pas demandé mon adresse.
– Vous m’en voulez beaucoup ? Vous ne me pardonnerez jamais ?
– Mais vous ne répondez pas ! s’écriait Delphine Fargeaux.
– C’est probablement que je n’ose pas, madame.
– Je parie que vous avez donné votre adresse au cocher.
– Je ne vous conduis pas chez moi, disait-il, j’aurais horreur, lors d’une première entrevue, de vous amener dans un appartement où d’autres femmes que je n’aimais pas sont venues. Je vous conduis dans un endroit pauvre, situé au fond du plus détestable des quartiers, à Grenelle. Dans un endroit pauvre, où, jolie mignonne, je vais quelquefois rêver lorsque le spleen m’envahit, lorsque je me sens le cœur las et brisé. Là, j’imagine, plus qu’ailleurs, nous serons tranquilles.
– Je n’aurai pas peur tant que vous serez là.
Delphine Fargeaux séduite, conquise, par les galantes paroles de son beau compagnon, parlait en toute sincérité. Quelques instants plus tard, le fiacre s’arrêtait à la porte d’une pauvre demeure, d’une maison d’ouvriers située à quelque distance du boulevard Garibaldi, au cœur même de Grenelle.
– C’est ici ?
– C’est ici, madame, que je vous conduis.
Stolberg, en frac, le claque sur la tête, l’œillet à la boutonnière, paya d’un geste élégant son cocher, refusant de prendre la monnaie du louis d’or qu’il lui avait tendu, il sonna, il se tourna souriant vers Delphine Fargeaux :
– N’ayez aucune appréhension, répéta-t-il, si fou que je sois, j’ai cependant le sentiment des convenances et je vous mène là seulement où je puis vous mener sans crainte de vous compromettre.
La porte cochère de la maison s’ouvrit, il fit passer Delphine Fargeaux, craqua une allumette-bougie, et à la lueur tremblotante de la brindille de cire, guida la jeune femme au long d’un escalier tortueux, misérable :
– Il faut être bien original, n’est-ce pas, pour avoir un pied-à-terre dans une maison si peu luxueuse. Mais j’ai toujours été l’homme des contrastes. Ici, nul ne me connaît parmi des importuns qui peuvent se vanter de serrer la main du baron Stolberg, et par conséquent je suis sûr d’être toujours tranquille, de toujours posséder la paix profonde des inconnus. Entrez, madame.
Delphine Fargeaux qui s’attendait à pénétrer dans une élégante garçonnière, installée par originalité, en effet, dans une demeure populaire, entra dans une pauvre pièce, une sorte de salle à manger minable et que divisait en son milieu un grand rideau, une sorte de tenture usée, rapiécée, suspendue par des anneaux à moitié décousus à une tringle de fer :
– Voici mon palais. Asseyez-vous sur ce divan, je viens à vos côtés dans quelques secondes.
Il désignait du doigt une sorte de grand canapé à l’étoffe décousue et déchirée, et, tandis que Delphine Fargeaux, de plus en plus stupéfaite, presque inquiète maintenant, y prenait place, il passait lui-même de l’autre côté de la tenture, disparaissait aux yeux de la jeune femme.
– Mon Dieu, se demandait quelques instants plus tard Delphine Fargeaux, à la lueur vacillante d’une lampe à pétrole posée sur le coin d’une table, qu’est-ce que tout cela veut dire ?
Elle attendit longtemps, très longtemps, puis, à l’improviste, n’entendant plus bouger le baron, elle se sentit envahie d’une peur secrète contre laquelle elle essayait en vain de réagir.
– L’endroit est pauvre, se disait Delphine Fargeaux, écarté, dans un sinistre quartier. Pourquoi m’a-t-on conduite là ? Que va-t-il m’arriver ?
La pensée va vite chez qui a peur. Delphine Fargeaux, en une seconde, imagina, tout en s’en raillant, d’étranges aventures. En somme, elle ne connaissait pas le baron Stolberg. Plus même, elle l’avait rencontré en compagnie d’une femme qui était un assassin. Et puis, c’était un Russe, et les Russes sont toujours un peu énigmatiques, un peu étranges, un peu effrayants.
Delphine Fargeaux se leva. D’une voix blanche, elle appela :
– Monsieur Stolberg, vous êtes là ?
Mais, à peine eut-elle crié, que la tenture violemment repoussée, s’ouvrait. Un homme apparaissait, les deux mains dans les poches, ricaneur, ironique, qui dit d’une voix brève et nette :
– M. Stolberg, le riche baron n’est plus là. Inutile de l’appeler. Inutile de crier, vous êtes dans mes mains, en mon pouvoir, vous êtes chez John, le cocher John !
Et c’était, en effet, un homme vulgaire, un palefrenier, à en juger à son pantalon de cheval, à sa chemise à carreaux, à ses boutons de manchettes vulgaires en forme de fer à cheval, qui s’avançait vers Delphine Fargeaux. La malheureuse, à cet instant, pensa défaillir :
– Le cocher John ? s’écria-t-elle, le cocher John ?
Et elle contemplait les traits de son nouvel interlocuteur, se croyant victime d’un rêve, d’une hallucination épouvantable.
Delphine Fargeaux frissonna, se sentit perdue. L’homme qui lui parlait, l’homme qui lui annonçait être le cocher John, qui lui affirmait que Stolberg était parti, c’était le même homme, c’était Stolberg.
Sans doute, sa coiffure était changée, ses yeux eux-mêmes semblaient avoir une autre expression, mais elle ne pouvait pas se tromper à la forme particulière des sourcils, à la ligne du nez, aux traits de la bouche.
– Vous, vous êtes… ?
D’un geste de la main, l’homme la fit taire :
– Vous allez dire des bêtises, déclara-t-il, et j’aime autant vous empêcher de les prononcer. Je suis John le cocher. Voilà !
– Ça n’est pas vrai !
– Alors, tant pis pour vous. Puisque vous ne voulez pas admettre que je suis John, voici mon autre nom.
L’homme se croisa les bras, recula de trois pas, ses yeux se firent flamboyants, sa haute stature se redressa, il déclara lentement :
– Delphine Fargeaux, on m’appelle aussi Fantômas.
Mais, cette fois, la malheureuse n’eut pas le temps d’articuler un mot. Affolée, éperdue, elle ne pouvait même point hurler sa terreur, à peine avait-il parlé que Fantômas – car le baron Stolberg et le cocher John, en effet, cachaient la seule et même personnalité : celle de l’effroyable tortionnaire – se précipitait sur elle, la renversait violemment sur le canapé, sautait à genoux sur le meuble, et la maintenant immobile, l’écrasait de tout son poids, la bâillonnait de force avec un long bandeau, d’où dépassait un tampon d’ouate énorme.
Alors un râle, un râle lent, sinistre, interminable, commença d’emplir la petite pièce qui servait de logement au cocher John. Delphine Fargeaux immobile, le visage congestionné, les yeux sortant de la tête, hurlait sous son bâillon.
Mais Fantômas vraiment ne paraissait en avoir nul souci. Il prit dans une petite armoire voisine, un mince flacon de verre jaune. Il le déboucha soigneusement, puis, le renversa tout entier sur le bâillon de la malheureuse. Une odeur écœurante et fade de chloroforme satura l’atmosphère.
Quelques instants les rauques grondements de la bâillonnée continuèrent, puis, ils furent moins distincts, plus faibles, puis ils se turent.
Endormie par le soporifique, privée de sentiment, Delphine Fargeaux demeurait immobile, renversée, presque morte. Fantômas, debout devant elle, avait contemplé l’évanouissement progressif de la malheureuse jeune femme avec un froid sourire, Lorsque enfin, le râle s’arrêta, il haussa les épaules, et simplement, d’un ton indéfinissable, murmura :
– Et voilà.
***
John, le cocher, était à genoux sur le sol de son taudis et s’occupait à ficeler avec une corde solide le coffre en bois d’une haute horloge normande qu’il avait renversée et bourrée de linge probablement.
À ce moment des coups de pieds et des coups de poing ébranlaient la porte :
– Ouvre donc, bon Dieu de salaud ! Ohé patron, voilà l’équipe !
Le cocher John se releva, répondant d’une voix faubourienne :
– Ça va, ça va, démolissez pas la cambuse, bon Dieu.
Il ouvrit la porte, cinq hommes se bousculaient pour entrer à la fois :
– Bonjour ma vieille !
– Bonjour les potes. Ça va. Mort-Subite ? Ça va Bec-de-Gaz ? Mon vieil Œil-de-Bœuf, on dirait que t’as déjà reniflé dans tous les verres du quartier.
– T’occupe pas. T’occupe pas ! répondit Œil-de-Bœuf la voix pâteuse et le regard peu net. Quand je déménage, moi je fais comme les déménageurs. Un déménageur, ça déménage, et quand ça déménage, c’est-à-dire que ça fait un déménagement.
D’une bourrade, le cocher John envoya Œil-de-Bœuf rouler dans un coin de la pièce :
– Tais-toi barrique, lança-t-il, tu n’en sortiras pas.
– Mort-Subite, vous avez amené une charrette ?
– Elle est en bas.
– Alors, y a qu’à se mettre au turbin.
– On enlève tout ?
– Comme de juste. Tu ne t’imagines pas mon vieux que je vais faire des cadeaux au proprio ?
– Et où est-ce qu’il est ton logement ? demandait Mort-Subite, est-ce que tu vas nous faire tirer la bricole pendant des kilomètres ? Ta concierge, elle va gueuler, ma vieille, quand on transportera ton mobilier à travers ses escaliers.
– T’occupe pas.
D’une voix un peu énervée, d’une voix de commandement presque, John, le cocher, hâtait les opérations. Il aidait Bec-de-Gaz à se charger d’une table, il confiait à Œil-de-Bœuf, tremblant sur ses jambes, le soin de descendre un paquet de hardes. Le cocher John fit un signe à Mort-Subite :
– Reste. Tous les deux nous allons nous charger de l’horloge.
– Eh bien mon colon, déclarait Mort-Subite, en s’essuyant le front, du revers de sa manche, elle est rien lourde ta toquante. Celui qui t’a vendu ça pour peser une demi-livre, il ne t’a pas volé ton argent. Ferais mieux d’acheter un bracelet.
– Allez, dépêchons-nous ! On ira boire un verre quand tout sera descendu.
Quelques instants plus tard, le déménagement en effet était complet. Tout ce qui avait orné le taudis du palefrenier, était entassé, empilé, sur la charrette à bras et John, en compagnie de ses copains, alla prendre un verre sur le comptoir, chez un mastroquet voisin.
– Alors quoi, déclarait le tenancier, vous quittez le quartier ? c’est dommage. Vous étiez une bonne pratique. Faudra revenir nous voir de temps en temps.
– Sûr et certain, affirma John, je viendrai encore par ici, rapport aux chevaux que je garde aux écuries.
Dehors, il était maintenant près de dix heures. Mort-Subite s’attela aux brancards de la charrette à bras, John et Bec-de-Gaz poussaient par derrière.
– Quand on déménage, bégayait cependant Œil-de-Bœuf, qui venait de boire deux mominettes [17] de suite, et ne semblait pas dans ce breuvage, retrouver une plus grande lucidité d’esprit, quand on déménage, là, vrai, c’est rigolo, c’est toujours qu’on emménage. On déménage, on emménage.
Œil-de-Bœuf était attendrissant. Deux grosses larmes coulaient sur son visage, il parlait en faisant de grands gestes, il avait grand besoin de suivre les murs de tout près pour y trouver un appui lorsqu’il tendait à perdre son équilibre.
Et sans répondre à Œil-de-Bœuf, John guidait les copains :
– Droit devant vous, marchez toujours, allez, allez, je paierai une bonne tournée quand tout sera fini.
Chose curieuse, d’ailleurs, ceux qui tiraient la charrette à bras semblaient à la fois obéir à John et avoir des velléités de lui résister. Savaient-ils exactement que John était Fantômas ? L’ignoraient-ils ? Mort-Subite et Bec-de-Gaz avaient sans doute des soupçons relativement à la personnalité du bandit, à maintes reprises, certes, ils s’étaient demandé quel était ce John équivoque ? Mais ils n’avaient aucune certitude et cela faisait que, par moments, songeant que John était le patron, ils s’inclinaient docilement, alors que, au contraire, quelquefois, ils étaient tentés de mal recevoir ce camarade qui se permettait de leur donner des ordres.
La charrette à bras longtemps, longtemps, avança dans Paris. Après avoir traversé la Seine, au pont Alexandre, elle avait franchi les Champs-Élysées, rejoint la gare Saint-Lazare et maintenant grimpait la rue de Clichy.
– Ah çà, finit par demander Mort-Subite, cependant que pour la dixième fois, on sortait de chez un mastroquet où l’on avait pris de copieuses libations, ah çà, John, où c’est donc que tu t’en vas loger maintenant ? Vas-tu encore nous faire trimballer tes puces sur des kilomètres ?
John eut un sourire froid :
– Encore un quart d’heure de courage, dit-il, et nous serons rendus.
– Où, bon Dieu ? répéta Mort-Subite.
– Au cimetière, riposta le palefrenier dans un éclat de rire.
C’est, en effet, le long du mur du cimetière Montmartre que la charrette de déménagement s’immobilisait quelques instants plus tard. Œil-de-Bœuf, depuis longtemps avait été perdu par la bande, il était resté étalé de tout son long dans un ruisseau, aux environs de la gare Saint-Lazare ; il n’y avait plus que Mort-Subite, Bec-de-Gaz et John autour du petit équipage, quand il s’immobilisa :
– Silence, commanda John.
Il s’approcha du mur d’enceinte du champ de repos, John appela doucement :
– Barnabé, père Teulard.
Deux voix répondirent :
– Présent.
– Vous allez faire bien attention, dit John, d’abord, vous allez passer la grande horloge en bois par-dessus le mur. Ensuite, vous pousserez la charrette à cent mètres d’ici, n’importe où, et vous l’abandonnerez. Enfin, vous revenez ici et vous faites le guet. Si quelqu’un se présente, trois coups de sifflet. Compris ?
Mais ni Œil-de-Bœuf, ni Bec-de-Gaz ne répliquaient tout d’abord. Ils continuaient à se jeter des coups d’yeux inquiets, ils paraissaient hésiter à agir.
– Eh bien, c’est plutôt rigolo, commença de sa voix traînante Bec-de-Gaz, on s’imagine qu’on va aider un copain à déménager et ça finit par la balade d’une horloge dans un cimetière, l’abandon de frusques au hasard, sur la voie publique et le guet dans la rue. Moi, je demande à comprendre. John, qui qu’t’es ?
Bec-de-Gaz n’avait pas le temps de répliquer. Il allait encore discourir lorsque le cocher le fit taire :
– Assez, ordonna le soi-disant copain, je n’ai pas d’explications à fournir, si vous n’êtes pas des imbéciles, vous devez comprendre. Et si vous êtes des imbéciles tant pis pour vous. Passez l’horloge par-dessus le mur.
Mort-Subite et Bec-de-Gaz s’exécutèrent. Aidés de celui qu’ils continuaient à appeler John, mais dont ils devinaient la véritable identité, ils tirèrent de la charrette le pesant coffre de bois, le hissèrent sur le mur. John à cheval sur la crête, surveillait l’opération.
– Cela va bien, allons, poussez encore un petit peu et laissez basculer. Barnabé, Teulard, vous êtes prêts ?
– On est prêt.
– Alors, laisse aller Bec-de-Gaz.
Cette fois, l’horloge bascula, glissa par-dessus le mur, abandonnée par Bec-de-Gaz et Mort-Subite, saisie par les deux fossoyeurs.
– La tombe est prête, hein ? interrogea John qui venait de sauter dans le cimetière.
– Le trou est fait, répondit Barnabé. Mais qu’est-ce que c’est donc que t’as là-dedans ? C’est ça que tu prétends faire enterrer ?
– C’est cela même, mes enfants.
– Mais tu nous avais dit que c’étaient des sous. Un trésor ?
– Eh bien, c’est un trésor.
Barnabé et le père Teulard portant le coffre de l’horloge, et ployant sous le faix, avançaient avec peine dans la boue grasse.
Bientôt, cependant, ils laissèrent tomber leur fardeau à terre, ils désignaient au cocher John, un trou, un grand trou, une tombe creusée par eux quelques heures auparavant.
– Voilà l’endroit, disait Barnabé. Ça va-t-il ?
– Ça va très bien, répondit le cocher.
Il donna un coup de pied dans le coffre de bois, et il ordonna :
– Allons, pressons-nous. Mettez ça là-dedans et rejetez la terre par-dessus.
Les pelletées tombèrent d’abord régulièrement sur le coffre de bois, éveillant de sourds échos. L’opération semblait devoir s’achever sans encombre, lorsque soudain, Barnabé se jeta sur le père Teulard, lui empoigna le bras, l’empêcha de continuer sa besogne :
– Ah nom de Dieu, jurait Barnabé, écoute voir, écoute un peu.
Un instant, les deux fossoyeurs prêtèrent l’oreille, puis Barnabé se tourna vers John :
– Mais sacré bon sang, cria-t-il, c’est un crime que tu nous fais commettre là ? Réponds, nom de Dieu. Y a quelqu’un dans c’te boîte ? Quelqu’un qui vit ? Tu nous fais enterrer quelqu’un de vivant ?
Mais la voix du fossoyeur s’étrangla. En se retournant, ce n’était plus John qu’il avait aperçu, c’était la silhouette tragique d’un homme vêtu de noir, le visage dissimulé sous une cagoule noire, c’était la silhouette légendaire du terrifiant Fantômas.
Et Barnabé comme dans un cauchemar, se rejetant de côté, bousculant son ami le père Teulard, épouvanté par le râle sourd qui montait du fond de la fosse, entendit une voix sarcastique sortir de dessous la cagoule, une voix qui disait :
– Il n’y a plus de John ici. Regarde, camarade. C’est Fantômas qui te parle. Et puisque tu es si curieux, Fantômas va te renseigner. Tu prétends qu’il y a quelqu’un dans cette horloge que tu enterres. Mon Dieu tu ne te trompes pas. Il y a là une femme, elle s’appelle Delphine Fargeaux. Tu vois que je te donne tous les renseignements qui peuvent t’être agréables. Elle est endormie, elle est endormie grâce à du chloroforme et sans doute, elle commence à se réveiller. Oh cela n’a aucune importance, continue ta besogne, mon ami, fais ton office de fossoyeur, tant pis pour elle, si elle s’est réveillée. Elle n’avait qu’à continuer à dormir, elle n’aurait pas compris qu’on l’enterrait vivante.
Comme terrifiés, hagards, Barnabé et le père Teulard demeuraient encore immobiles, Fantômas soudain avança d’un pas.
Dans sa main, un revolver brillait, qu’il braquait vers les fossoyeurs :
– Allons, commanda-t-il, faites votre besogne, j’attends.
Et les pelletées tombèrent, régulières, sur la grande horloge normande.