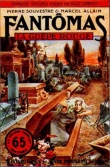Текст книги "Le mariage de Fantômas (Свадьба Фантомаса)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
– À mon tour de l’enfourcher.
Fandor n’était point, à vrai dire, excellent cavalier. Cependant, il sauta sur le cheval, fouilla de longues minutes le quartier de Grenelle, cherchant aussi bien à retrouver la fugitive qu’à découvrir le malheureux palefrenier qui devait assurément se lamenter sur la perte de sa bête.
Vaines recherches.
De guerre lasse, au bout d’une heure d’efforts, Fandor s’en alla au premier poste de police qu’il aperçut :
– Monsieur le brigadier, expliqua le journaliste à l’agent qu’il trouvait fort occupé à jouer aux cartes, voici un cheval que je vous amène, qui vient d’être volé et que j’ai pu heureusement rattraper.
– Et alors, quoi ? lui demanda le brigadier, qu’est-ce que vous voulez que j’en fasse de votre cheval ? Vous ne vous imaginez pourtant pas que je m’en vais le garder au poste ? À la fourrière !
Et Fandor eut beau parlementer, s’insurger, supplier, courir même à deux autres postes de police, il ne pouvait arriver à se débarrasser du cheval.
De guerre lasse, il finit en effet par mener la bête à la fourrière.
– Décidément, dit-il à l’employé qui lui délivrait un récépissé, si jamais je retrouve un cheval égaré sur la voie publique, comment donc que je m’empresserai de ne pas le recueillir. Ah zut alors ! c’est trop amusant de traîner jusqu’à quatre heures du matin pour arriver à s’en défaire !
Or, tandis que Fandor effectuait ainsi d’abord ses recherches, puis enfin sa promenade mélancolique à travers Paris jusqu’à la fourrière, la bande des apaches se reformait dans un bouge de Grenelle.
L’enthousiasme était à son comble. On applaudissait la Recuerda, on la portait presque en triomphe :
– Bravo la môme, à ta santé !
– Très bien la Recuerda, à ton honneur !
– Fameux, fameux, ah, ce qu’il a dû rigoler le palefrenier !
Et les petits verres succédaient aux petits verres, on buvait joyeusement la sacoche, dans le bouge empesté, aux âcres relents de fumée, à la clientèle inquiétante. D’ailleurs, nul ne se cachait parmi Bec-de-Gaz, Mort-Subite, Œil-de-Bœuf, Bébé, la Recuerda, et tous les autres, d’avoir fait un coup.
Seul, un homme, le visage intelligent et dur, la mine grave, n’avait rien dit, continuait à boire.
Et cet homme-là, qui regardait la Recuerda, murmurait :
– Cette veine bleue qu’elle a au travers du front, ah ça, c’est bizarre. Mais on dirait un véritable signe de famille.
Et cet homme grave, cet homme qui demeurait dans l’ombre et auquel nul n’avait encore prêté attention, portait un nom de terreur et de sang, un nom qui faisait trembler les apaches.
Cet homme, c’était Fantômas !
4 – LE MARCHÉ TERRIBLE
Ce matin-là, comme neuf heures venaient de sonner, Jean, le fidèle domestique de Juve, avait éprouvé une vive surprise, en ouvrant la porte de l’appartement que le policier occupait désormais, au n° 1 ter de la rue Tardieu, appartement qu’il avait en quelque sorte conquis sur Fantômas, le jour où, avec son sang-froid extraordinaire, traversant le miroir, il avait arraché Fandor à une mort qui semblait inévitable.
Jean s’était trouvé tout bonnement face à face avec son maître, avec Juve en personne, un Juve calme, flegmatique et pourtant pressé comme à son ordinaire.
– Seigneur Dieu, s’écriait alors le brave homme en levant le bras au ciel, est-ce bien possible que ce soit monsieur qui revienne ? Je commençais à être inquiet.
Juve avait haussé les épaules, tendu une lourde valise à Jean.
– Porte cela dans mon cabinet. Allez, dépêche, apporte-moi tout le courrier, et je n’y suis pour personne, sauf naturellement pour Fandor.
D’où venait Juve ?
Certes, Jean, qui était habitué depuis de longues années aux manières incompréhensibles de son maître eût été curieux de le savoir, mais il connaissait trop l’horreur qu’éprouvait le policier à l’égard des bavardages inutiles pour se permettre la moindre question.
Jean était fort peu renseigné. Il en eût appris davantage s’il avait pu écouter le monologue furieux auquel se livrait Juve en s’épongeant vigoureusement dans la salle de bains et en se rhabillant en toute hâte :
– Nom d’un chien de nom d’un chien ! grommelait Juve, j’ai fait arrêter quatre fois mon fiacre et quatre fois de suite je suis entré dans des cabarets et dans des brasseries pour téléphoner à Fandor, où diable peut-il être ? J’aurais pourtant eu joliment besoin de le voir et de m’entendre avec lui. Peut-être sait-il quelque chose. Ah, l’animal qu’a-t-il donc pu devenir ?
Juve s’épongeait toujours, sans souci de l’eau qui ruisselait sur le sol, heureusement dallé, de la salle.
En fait, que s’était-il passé depuis la nuit tragique où Juve s’était trouvé à bord du bateau commandé par Fantômas, puis jeté à la mer, et enfin, par miracle, sauvé du naufrage, mais sauvé d’une façon extraordinaire : sauvé en compagnie de trois personnages qu’il ne s’attendait guère à rencontrer en si fâcheuse posture : Jérôme Fandor, lady Beltham et Fantômas ?
Il s’était alors déroulé sur ce rocher que battait la mer en furie un drame rapide, d’intense horreur. Les doigts crispés, roidis par le froid, déchirés aux anfractuosités des roches, lady Beltham avait lâché prise la première sous l’assaut d’une vague monstrueuse. La superbe amoureuse de Fantômas avait roulé à l’abîme sans que Fandor ou Juve, qui voisinaient avec elle, eussent eu le temps de la retenir, de l’arracher au gouffre.
En une seconde, d’ailleurs, une autre chute à l’abîme avait succédé à celle de la grande dame. Fantômas n’avait pas vu disparaître celle qu’il aimait d’amour malgré tout, qu’un rire hideux et sarcastique s’était échappé de sa gorge et que, montrant le poing à Juve et à Fandor, il s’était, lui aussi, laissé rouler au bas des roches, emporté dans le tourbillon, avec l’espoir insensé peut-être de sauver lady Beltham.
Qu’était alors devenu Fantômas ?
Juve et Fandor, meurtris, blessés, battus par les lames qui envahissaient le récif, qui menaçaient de les engloutir, n’avaient plus revu le bandit. Le flot qui l’avait arraché de la roche l’avait sans doute fracassé contre les rochers.
Flottant au gré des flots, des morceaux de cordages, des planches, une mâture enfin, frôlèrent le rocher où s’agrippaient Fandor et Juve. Le fracas de la tempête était ni fort à cet instant que les deux hommes ne pouvaient guère causer, mais un regard leur suffisait pour se comprendre. Juve et Fandor lâchaient l’écueil, s’agrippaient à l’épave, se laissaient emporter, eux aussi. Ils pensaient, les deux amis, se sauver ensemble ou périr ensemble, mais le sort en décidait autrement. Plus haute que les autres, plus brutale et plus monstrueuse, une vague accourait du large vers leur radeau improvisé. Fandor se cramponnait à l’un des bouts du mât, Juve à l’autre, la masse d’eau passa, ils furent submergés. Quand elle fut loin, Fandor et Juve devaient se rendre compte, angoissés, que les planches qui les soutenaient s’étaient disjointes et que le courant les avait séparés, qu’ils flottaient, séparés l’un de l’autre, pris par des courants opposés.
Fandor avait été, après toute une nuit d’angoisse, jeté à la côte. Juve, plus heureux, avait été recueilli par un navire qui, faisant route à la voile vers Gibraltar, l’avait déposé dix jours plus tard à la pointe de l’Espagne.
Juve, naturellement, s’était immédiatement enquis de Fandor, avait su que le journaliste miraculeusement sauvé – car c’était miracle que le courant l’eût porté à la côte –, était rentré à Paris. Juve aussitôt, envoyait une lettre à Fandor pour le rassurer, et entreprenait de poursuivre une enquête discrète et rapide.
Bien entendu, il n’avait pu apprendre ce qu’étaient devenus Fantômas et lady Beltham. Morts ou vivants, ils avaient disparu à nouveau, mais ce n’était pas d’eux que le policier s’était enquis. Juve, profitant de ce qu’il était en Espagne, s’était tout naturellement occupé de retrouver Hélène, la fille de Fantômas, enlevée, il le craignait sans en être certain, par un grand personnage espagnol. Juve, de longs jours, avait fouillé les environs de Madrid, enquêté, interrogé, cherchant à comprendre, à savoir. Ses recherches n’avaient donné aucun résultat. De guerre lasse, la rage au cœur, furieux contre les grands d’Espagne qui, finissait-il par juger, jouissaient véritablement d’une impunité trop grande pour leurs caprices amoureux et criminels, Juve s’était décidé à rentrer à Paris pour s’y concerter avec Fandor, examiner avec lui la situation, chercher d’un commun accord comment on pouvait espérer rencontrer à nouveau Hélène, l’arracher à son ravisseur si besoin en était, et attendre aussi des nouvelles de Fantômas, si Fantômas, comme on pouvait le craindre, avait pu s’échapper et éviter la mort.
Juve dépouilla sans hâte son volumineux courrier. Il trouva des cartes de Fandor, un petit mot dans lequel le journaliste lui apprenait qu’il allait reprendre momentanément son poste au journal La Capitale et qu’il espérait bien que Juve lui ferait signe dès son retour.
– L’animal, grogna le policier, je ne fais que cela, lui faire signe, mais comme il n’est pas chez lui, c’est exactement comme si je crachais en l’air en chantant Femme Sensible [5].
– Un monsieur qui veut vous parler, dit Jean, qu’on n’entendait jamais marcher.
– Je n’y suis pour personne ! hurla Juve. Tonnerre de nom d’un chien, est-ce que vous ne comprenez plus le français, Jean ? Je vous ai déjà prévenu…
– Assurément, vous n’y êtes pour personne, mais vous devez l’être pour ce monsieur, il m’a dit de vous dire qu’il était ambassadeur.
« Eh, eh, songea Juve, est-ce que, par hasard, la Cour d’Espagne aurait appris quelque chose de mes enquêtes ? »
– Faites entrer, ordonna le policier.
Quelques instants plus tard, Juve voyait se soulever la portière de son cabinet de travail et sursautait, devenu blême, en reconnaissant l’ambassadeur qui pénétrait auprès de lui :
– Vous, vous, vous, Backefelder ! Ah çà, d’où diable sortez-vous ?
Backefelder, car c’était bien l’extraordinaire Américain, le flegmatique « amateur » qui se passionnait pour la lutte que, depuis tant d’années, Juve soutenait contre Fantômas, qui venait d’entrer dans le cabinet de travail du policier, ferma posément la porte, sourit à Juve, puis lui tendit la main :
– Vous allez bien, mon cher maître ?
Mais Juve ne serra pas cette main tendue. Juve plaqua un vigoureux coup de poing sur son bureau, bondit au-devant de l’arrivant :
– Ah çà, hurla-t-il, pourquoi venez-vous me voir ? Qu’est-ce que vous allez encore m’annoncer ? Comment savez-vous que je suis rentré ? Avez-vous des nouvelles de Fandor ?
Backefelder brossait son chapeau, souriait toujours.
– Vous permettez, demanda-t-il, que je prenne un siège ?
Et comme Juve ne répondait pas, il en prit un quand même, s’assit, déclara avec une tranquillité déconcertante :
– C’est un vilain temps, aujourd’hui. Ah, êtes-vous prêt à m’écouter, monsieur Juve ? Je viens en ambassadeur.
– Vous venez en ambassadeur, en ambassadeur de qui ?
Comme s’il eût dit une chose toute naturelle, comme s’il eût fait une commission fort simple et nullement digne de surprendre, Backefelder riposta :
– Je viens, mon cher Juve, en ambassadeur, de la part de Fantômas.
– Mais il est donc encore vivant ?
– Parfaitement, répondit-il, et je vous remercie de l’intérêt que vous lui manifestez. Fantômas se porte bien.
Juve, pourtant, avait empoigné l’Américain par les épaules et le secouait fortement :
– Fantômas se porte bien ? ah çà, vous êtes fou ? Et que venez-vous m’apprendre ? Mais, parlez donc, nom d’un chien, parlez, parlez donc ! Vous me faites mourir !
Backefelder, cependant, éclatait de rire. Il se dégagea de l’étreinte de Juve, le repoussa doucement :
– Je vous répondrai, faisait-il, quand vous cesserez de me secouer comme un arbre et quand vous serez tranquillement assis derrière votre bureau, prêt à m’entendre comme un gentleman que vous êtes.
– Parlez, je suis tout oreilles.
Or, Backefelder venait de tirer son portefeuille et tendait à Juve une feuille de papier blanc, puis un stylographe :
– Cher monsieur, faisait-il, j’ignorais que j’aurais la bonne fortune de vous rencontrer chez vous et je m’étais muni de ces accessoires indispensables à l’accomplissement de ma mission si je vous avais rencontré dehors. Veuillez donc avoir l’obligeance, poursuivait Backefelder, de prendre ce stylographe et d’écrire, de votre plus belle écriture, l’adresse de la fille de Fantômas. Vous mettrez cette lettre sous enveloppe, vous cachetterez si vous n’avez point confiance en ma discrétion, et je porterai le tout au Roi du Crime.
Mais, assurément, Backefelder eût parlé chinois qu’il eût été mieux compris de Juve. Le policier, en effet, à la demande plus que surprenante qui lui était formulée, pensait que la raison l’abandonnait et qu’il était victime d’une invraisemblable hallucination.
– Bon sang ! hurla Juve, que venez-vous me demander là ? Où est la fille de Fantômas ? Pourquoi ? C’est Fantômas qui vous envoie ? S’imagine-t-il que je vais ainsi le renseigner ?
Backefelder, cependant, conservait son calme imperturbable :
– Il se l’imagine, répondait-il, et il n’a point tort, monsieur Juve, car voici la commission dont je suis chargé.
– Mais, où est-il, Fantômas ? interrompit Juve, sacré nom d’un chien, dites-moi où il est ! Il faut en finir !
Juve n’acheva pas. Très maître de lui, Backefelder avait eu un petit signe de la main qui marquait combien il lui semblait absolument impossible de donner satisfaction à la curiosité du détective.
– Juve, vous oubliez nos conventions.
– Quelles conventions, Backefelder ?
– Les conditions dans lesquelles je me trouve, si vous le préférez… Je vous ai déjà dit que j’entendais ne faire œuvre ni de policier ni de bandit. Je ne trahirai pas plus Fantômas vis-à-vis de vous que je ne vous trahirai vis-à-vis de Fantômas. Je vais de l’un à l’autre, voilà tout, en amateur. C’est par exception que j’ai accepté de me charger d’une ambassade auprès de vous.
C’étaient là des propos qui achevèrent de désespérer Juve. Le célèbre policier se leva brusquement, renversant dans son impétuosité son fauteuil, et se promena de long en large.
Backefelder disait la vérité. Jamais, il le savait, l’Américain ne consentirait à lui dévoiler quelle était la retraite de Fantômas. Il était trop honnête, l’extraordinaire Yankee, pour trahir qui que ce fût. Il ne renseignerait pas plus Fantômas sur Juve qu’il ne renseignerait Juve sur Fantômas.
– Achevez, finit par déclarer Juve d’une voix sifflante, dites-moi tout ce que vous avez à me dire, Backefelder, et bon Dieu dépêchez-vous de sortir ensuite, car la pensée que vous venez de la part de Fantômas me bouleverse au point que je ne sais pas si je pourrais être longtemps maître de moi et ne pas…
– J’achève, coupa tranquillement Backefelder.
Et le bizarre amateur poursuivait en effet, d’un ton assuré, comme s’il n’eût point tenu les plus effroyables propos :
– Juve, affirma-t-il, je viens de la part de Fantômas, vous demander l’adresse de sa fille. Fantômas a échappé à la mort lors du naufrage, comme vous devez bien vous en douter. Fantômas ne sait pas où est sa fille et comme vous le savez, vous, il m’a chargé de venir vous demander ce renseignement et j’ajoute…
– Mais bon Dieu, je ne le sais pas, moi où est sa fille, depuis je ne sais combien de temps je la cherche.
Or, au moment où Juve déclarait – ce qui était la vérité – qu’il ignorait où était Hélène, Backefelder s’était levé et un peu de son calme semblait l’avoir abandonné subitement :
– Vous ignorez, demandait-il d’une voix tremblante où se trouve Hélène ?
– Mais oui.
– Alors, c’est horrible.
– C’est horrible ? répéta Juve. Pourquoi ? ah çà, avez-vous tellement pitié des sentiments paternels de Fantômas ? Croyez-vous, que même si je savais où est Hélène, j’aurais l’amabilité de le lui dire ?
Mais Backefelder était devenu nerveux :
– Taisez-vous Juve, faisait-il à son tour, je ne vous ai point encore tout dit.
Et, parlant lentement, d’une voix sourde, baissant les yeux, Backefelder continuait :
– Juve, Fantômas m’a tenu ce matin ce langage : Va trouver Juve, dis-lui qu’il te donne aujourd’hui même l’adresse de ma fille, dis-lui qu’il te donne les moyens de la retrouver ou que sans cela, avant la fin de cette semaine il recevra, lui, Juve, l’oreille droite de Fandor, que je couperai d’un coup de rasoir. Dis-lui qu’à chaque jour de retard, je mutilerai Fandor. Je lui arracherai l’oreille gauche après l’oreille droite, je lui trancherai les doigts, je le torturerai sans pitié et sans merci pour lui faire payer la torture que j’éprouve à ne pas savoir ce qu’est devenue mon enfant. Juve, si vous savez où est Hélène, dites-le-moi. Parlez. Fantômas n’hésitera pas. C’est la vie de Fandor qu’il faut lui racheter.
Mais Juve ayant entendu l’horrible menace que Backefelder, ambassadeur de l’épouvantable Fantômas, venait lui transmettre, en apprenant le danger que courait Fandor, ne répondit pas. Fandor qu’il n’avait point trouvé chez lui, Fandor qui n’avait pas répondu à ses coups de téléphone devait se trouver aux mains de Fantômas. Juve, atteint en plein cœur, pour une fois, vaincu par le destin, s’était écroulé sur un canapé et la tête dans ses mains, avec des yeux hagards, des yeux où s’amassaient des larmes lourdes et brûlantes, il considéra Backefelder avec un stupide affolement :
– Parlez, répéta l’Américain, où est Hélène ?
– Je ne sais pas, disait Juve, je ne sais pas. Où est Fandor ? Je ne sais pas. Je ne sais pas où est Hélène, je ne peux pas racheter Fandor. Je ne sais pas où est Hélène, répéta Juve, sur mon âme, je ne le sais pas !
Mais il devinait bien que Fantômas ne croirait pas à son ignorance et qu’il n’avait pas le droit, aux yeux du bandit, d’ignorer la retraite d’Hélène.
Juve, de longues minutes, réfléchit. Soudain il redressa la tête, se retourna brusquement pour faire face à Backefelder qui venait de passer derrière lui :
Et Juve alors d’un mouvement rapide, sauta à l’autre bout de son cabinet : il venait de voir que Backefelder enroulait tranquillement une corde.
– Que faites-vous ? demanda-t-il.
Backefelder haussa les épaules.
– Rien, dit l’Américain, je plie cela.
Et comme Juve le regardait toujours, Backefelder expliqua :
– J’étais chargé par Fantômas, mon cher Juve, de vous ligoter au moment où vous n’y penseriez point, ceci afin d’éviter que vous ne preniez ma piste lorsque je vous laisserai. D’ailleurs, je ne sais pas où retrouver Fantômas, j’ai été chargé de vous faire la commission que je viens de vous faire, et voilà tout. Je n’ai pas rendez-vous avec Fantômas, c’est lui qui doit m’aborder où et quand bon lui semblera. Le mieux est donc que vous ne me suiviez pas, il vous apercevrait, sa colère ne pourrait que nuire à votre malheureux Fandor.
Juve savait bien que Backefelder avait raison. Réellement, à cette minute, il se sentait vaincu par Fantômas. Il ne fallait pas risquer d’exciter encore le ressentiment du bandit quand il apprendrait que Juve n’avait point donné l’adresse d’Hélène.
– Partez Backefelder, répondit Juve, d’une voix brisée, allez dire à Fantômas que je ne sais point où est Hélène, allez lui dire que je n’ai jamais voulu de mal à sa fille et qu’il faut qu’il épargne Fandor.
Mais Backefelder, debout sur le seuil du cabinet de travail, répéta, de sa voix sourde et ferme :
– Hélas, Juve, les paroles de Fantômas sont, je le crains, définitives. Ses arrêts, vous le savez, sont sans appel. « Que Juve me dise où est ma fille », m’a-t-il répété, ou je mutile Fandor. Juve, j’ai peur.
Et Juve, frissonnant, lui aussi, dit comme Backefelder :
– J’ai peur, j’ai peur pour Fandor.
5 – UN MAUVAIS QUART D’HEURE
Délivré enfin du cheval laissé à la fourrière, Fandor, harassé, s’était jeté sur son lit, après avoir, par acquit de conscience, décroché le téléphone.
– Si l’on me demande, avait murmuré le journaliste, on ne me trouvera pas et voilà tout. Zut ! j’en ai assez de travailler, je baptise dimanche le jour qui vient et je fais la grasse matinée.
Fandor devait avoir, à coup sûr, grand besoin de repos pour agir ainsi. Couché au petit jour, il dormit tranquillement, sans prendre conscience des heures, longtemps, très longtemps.
– Cinq heures ! s’exclama Fandor, réveillé. Ça n’est pas possible, ma montre est arrêtée ! Tant pis, déclara froidement Fandor, je ne passerai pas à la Bourse, aujourd’hui. Mais avoir trouvé un cheval dans les rues de Paris, songeait-il, c’est déjà intéressant. J’ignore si on me le rendra dans un an et un jour, à la façon d’un vulgaire trousseau de clés n’ayant pas été réclamé. Mais, c’est insuffisant. Ma soirée d’hier m’a appris autre chose, m’a fait faire d’autres découvertes. N’empêche. Qui diable est la femme qui a enfourché ce cheval pour s’enfuir ? Il faut que je le sache et, ventre du diable ! je le saurai.
Fandor n’était pas breton, mais eût assurément mérité d’être né dans la péninsule armoricaine, vu la dureté de son crâne, inséparable, dit-on, de l’entêtement.
– Je saurai qui est cette femme.
Il prononça cette phrase à plus de dix reprises cependant qu’il s’habillait en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.
Les recherches que le journaliste méditait d’entreprendre étaient difficiles à mener à bien. Les apaches sont si nombreux à Paris, la population louche du boulevard de Grenelle est si vagabonde aussi qu’il paraissait à peu près illusoire de vouloir retrouver la femme qui l’intriguait si fort. Mais Fandor était entêté.
Fandor, d’ailleurs, dans l’espoir de rencontrer celle qu’il cherchait, n’avait pas ourdi un plan bien compliqué. Il possédait ce flair spécial qui est celui des agents de la Sûreté, des policiers, des chasseurs aussi, il devinait, eût-on cru, où pouvait gîter le gibier sur les traces duquel il s’acharnait.
– La bande a fait de l’argent, hier soir, s’était dit Fandor, car la sacoche était bien garnie. Ils ont été la boire, assurément, ils boiront encore ce soir, et c’est à table ou devant un comptoir que je rencontrerai mon monde.
Fandor, avec une belle tranquillité, se rendit alors au commissariat de police du boulevard de Grenelle. Il y trouva un brigadier un peu plus éveillé que celui qu’il avait entretenu la veille et se fit indiquer par lui les bouges mal famés qui restaient ouverts le plus tard dans la nuit.
Puis, nanti de ce renseignement précieux, l’âme assurée, la démarche fort calme, Fandor se rendit dans la rue du Théâtre et, méthodiquement, commença à visiter les bars interlopes.
Il entra dans dix cabarets différents, but, et fit semblant de boire mais sans résultat. À minuit, Fandor désespérait presque de réussir à retrouver un membre quelconque de la bande, mais, en revanche, il était devenu l’ami d’un brave chiffonnier qu’il avait invité à l’accompagner, auquel il avait payé de nombreuses tournées, et qui, les ayant bues consciencieusement, se trouvait plus qu’aux trois quarts dans les vignes du Seigneur.
– Mon poteau, déclarait l’homme en serrant tendrement le bras de Fandor qui le remorquait le long des arcades du métropolitain, je ne sais pas ce que tu fais dans le civil, mais, dans le militaire, sûr que t’aurais été un rude chasseur d’Afrique. Allons boire un verre !
– Allons boire un verre, répondit Fandor. Et, en même temps, le journaliste songeait :
– Ah çà, nom d’un chien, il est inépuisable ce bonhomme-là, c’est le Bottin des marchands de vin. Nous sommes entrés dans plus de cinquante mastroquets, et il en connaît toujours.
Ils avaient en effet visité des bouges à soldats, comme il n’en manque pas autour du quartier Dupleix, puis ils avaient gagné d’infects zincs le long du boulevard et, maintenant, le chiffonnier guidait Fandor dans des caveaux empuantis, élevés au fond de cours infectes, où la police ne devait jamais se risquer.
Fandor, avec un petit frisson, car, véritablement, l’endroit était sinistre, entra derrière le chiffonnier dans la dernière cave que celui-ci lui indiquait. Ce n’était plus même un bistrot, c’était tout ce que l’on voulait : hangar, caverne, cave, souterrain, n’importe quoi. Il y avait là, sur des planches entaillées, de grands tonneaux appuyés l’un sur l’autre. On prenait un verre et on le remplissait au robinet, on se soûlait librement, pour un prix fixe, payé à l’entrée.
– C’est des crus de Bourgogne, annonça le chiffonnier d’un ton confidentiel.
Ainsi le journaliste avait à peine franchi le seuil de ce bouge ignoble qu’il avait éprouvé un véritable saisissement en apercevant, parmi la foule d’hommes et de femmes qui se trouvaient déjà réunis là, qui ? L’apache Bébé.
Fandor, bien entendu, avant de sortir de chez lui, s’était délicatement fait une tête qui ne rappelait son propre visage que de fort loin.
Deux sourcils postiches, une moustache collée, un coup de crayon gras sous les yeux l’avaient suffisamment changé. N’empêche, il avait tressailli en reconnaissant Bébé.
Bébé, mais c’était l’un des lieutenants de Fantômas, l’un des plus cruels, des plus férocement sanguinaires parmi ceux qui avaient jadis travaillé avec le bandit, qui étaient toujours prêts, sans doute, à se grouper encore à ses côtés, si d’aventure il réapparaissait pour enrôler les soldats de l’armée du crime.
– Bébé, murmura Fandor, oh, oh, est-ce que par hasard ?
À la lueur fumeuse d’une petite lampe, le journaliste venait d’apercevoir, derrière une futaille, toute une série d’individus dont la seule vue le frappait de stupeur. Ils étaient tous là, les bandits redoutables, les compagnons de Fantômas. Et Fandor, reconnaissait : Bec-de-Gaz, Œil-de-Bœuf, Adèle, Marie Legall, la petite bonne du bureau de placement Thorin, tous, toutes.
– Jour de ma vie, murmura Fandor, est-ce que je ne vais pas voir Fantômas ?
Mais ce n’était pas lui qu’il aperçut soudain et qui le fit blêmir. Non. De l’ombre, une femme venait de sortir, joyeuse, esquissant un pas de danse.
Cette femme, Fandor ne la connaissait pas, il ne l’avait jamais vue, mais elle avait dit une parole qui ne lui permettait pas de se tromper sur son identité :
– Ah, mince alors, s’était-elle écriée, j’en rigole encore comme une bossue, quand je pense à la gueule du receveur, au moment où je raclais le flouse.
C’était donc elle, la femme qui s’était enfuie la veille au soir avec une si grande habileté, une si stupéfiante audace ?
– Bougre ! se dit Fandor, soudain furieux, je m’étais bien fichu le doigt dans l’œil.
Et, en même temps, une mélancolie soudaine lui serrait le cœur. Certes, il était content que ce ne fût pas Hélène, qui, la veille au soir, avait volé le malheureux receveur. Il préférait de beaucoup que ce fût une inconnue, mais cependant, en recherchant cette femme, cette femme qui avait audacieusement enfourché un cheval apeuré, Fandor avait eu continuellement devant les yeux l’image de la fille de Fantômas. C’était à elle qu’il avait pensé, c’était elle qu’il avait voulu retrouver, elle qu’il aimait, elle qui était loin de ses yeux et toujours si près de son cœur.
Dans le bouge, un joueur d’accordéon venait de faire une apparition, des danseurs sautaient, des cavaliers seuls, des filles gambadaient ivres et repoussantes.
– Dites donc vous, dit soudain le patron du bouge, un colosse qui se promenait au milieu de sa clientèle armé d’une trique, qu’est-ce que vous foutez ici, mon garçon. V'là cinq minutes que je vous zyeute, et vous ne buvez seulement pas.
Immédiatement, Fandor comprit que les choses allaient se gâter pour lui. Il est mauvais en effet, périlleux au plus haut point, lorsque l’on se trouve en pareille compagnie, de ne point adopter l’attitude générale.
Or, Fandor ne buvait pas, ne dansait pas. Lui qui avait cependant l’habitude des enquêtes policières, se faisait remarquer. Vite, il sauta sur un verre, et répondit à Coup-de-Bâton :
– Et puis quoi alors, on a pas le droit de regarder les mômes ici ?
Mais il avait beau vouloir faire diversion, il était trop tard. On se groupait autour de lui, on l’examinait curieusement.
– Encore un roussin nom de Dieu ! commença Bébé.
Et derrière lui, Bec-de-Gaz, qui par peur des coups, ne se mettait jamais au premier rang, susurrait :
– J’ parie qu’il est de la Tour-Pointue [6], faut le faire.
Fandor, instinctivement, serrait dans sa poche la crosse de son browning, prêt à vendre chèrement sa vie.
– Vos gueules vous ! hurla-t-il, si y en a encore un qui dit que je suis de l’arnac [7], je lui fais passer le goût du pain. Et presto encore. Si c’est pas malheureux tout de même. J’ suis pourtant assez connu à la Villette.
Et, se tournant vers le chiffonnier, qui buvait toujours, assis devant son tonneau, et ne prêtait nulle attention à la dispute commençante, Fandor quêta son approbation.
– Pas vrai, père Machin-Chose ?
Malheureusement, Fandor jouait de malheur. Le chiffonnier dont il sollicitait le témoignage, était connu de tous les habitués du bouge. On savait communément son nom : Détritus. On savait aussi que depuis plus de vingt ans il n’avait pas quitté le quartier. C’était un isolé qui faisait au petit matin les boîtes devant les restaurants et le chifftire juste assez pour trouver de quoi manger. Il ne pouvait pas connaître un gars de la Villette, on l’aurait su.
Bébé fut alors péremptoire :
– Eh bien, c’est moi, commença-t-il, qui vais le répéter que t’es de l’arnac. Et si ça ne te plaît pas, tu n’as qu’à le dire. Sors voir ton lingue.
Que répondre ? Il lui était impossible de « sortir » son « lingue », comme le lui offrait Bébé, pour la bonne raison qu’il ne possédait aucun couteau. Si d’autre part, il tirait son browning de sa poche, il fallait s’attendre à voir une rixe générale éclater. On n’aime pas les « rigolos » dans le monde des apaches. Ce sont des instruments qui font trop de bruit, qui attirent toujours les flics et puis, l’arme à feu y est considérée comme une arme de lâche.
– Ferme ça ! commença Fandor, j’en suis pas après tes poux. Laisse les miens tranquilles.
Au moment même où Bébé, avec un déhanchement caractéristique, s’avançait vers lui, l’arme à la main, la porte du caveau s’ouvrit avec une folle violence. Une voix apeurée se fit entendre :
– La paix, nom de Dieu ! Soufflez la camoufle [8], chahutez pas, ah bonsoir, j’ai plus de vingt mecs sur mes chausses. J’vas être fait.
L’arrivant avait recommandé le silence, une clameur lui répondit :