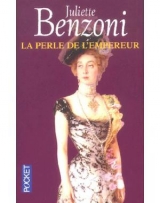
Текст книги "La Perle de l'Empereur"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
Sur l’estrade, Maître Lair-Dubreuil s’était figé, le marteau d’ivoire toujours en main, ne songeant même pas à préserver la perle. Vivement, Aldo s’avança pour la protéger. Ce faisant, il vit une femme accourir d’un des côtés de la salle. Elle se précipitait vers la « Régente », les mains tendues mais le prince fut plus rapide et se saisit d’elle quand elle allait atteindre sa proie. Il eut, devant lui, un visage crispé, des yeux flamboyants qu’il reconnut d’autant plus aisément que la femme portait les mêmes vêtements que chez Piotr Vassilievich : c’était Marie Raspoutine.
Elle se débattit comme une diablesse mais il tenait bon et elle gémit sous sa poigne :
– Lâchez-moi !… Laissez-moi !… Je ne vous ai rien fait !…
– À moi, non, mais ce pauvre Piotr ne pourrait en dire autant !
– À lui non plus je n’ai rien fait… Je voulais… seulement reprendre mon bien !
– Votre bien ? Vous avez une étrange façon de voir les choses. La « Régente » ne vous a jamais appartenu…
– Ce démon de Youssoupoff l’avait promise à mon père ! Lâchez-moi, vous dis-je !
– Pas question ! Nous allons d’abord voir la police…
– Non… Non vous ne pouvez pas faire ça !… J’ai assez souffert ! Par pitié, si votre mère vous a aimé, ne me livrez pas à la police ! Mes petites en mourraient peut-être…
Il y avait tant de douleur dans cette voix, tant de larmes dans les yeux noirs qu’Aldo sentit le doute s’insinuer en lui.
– Laissez-la aller. C’est une pauvre fille ! murmura-t-on derrière lui. Tournant la tête, Aldo vit Martin Walker qui lui souriait d’un air encourageant. Le journaliste répéta :
– Laissez-la !… Je vous dirai où la retrouver et vous pourrez causer avec elle… Voilà qui est mieux ! ajouta-t-il en constatant que Morosini laissait retomber ses mains. Filez vite, vous ! On ira vous voir et vous pourrez raconter votre histoire…
– Merci… Merci beaucoup !
Vivement la femme se pencha, prit la main de Walker, la baisa et se perdit dans la foule qui, après s’être agglutinée autour du groupe tragique, cherchait maintenant à vider les lieux. Le commissaire Langlois venait en effet de donner l’ordre de fermer les portes afin de pouvoir interroger tout le monde sans se soucier des protestations des gens connus, se contentant de lâcher, après qu’ils avaient donné leur nom, ceux qui ne pouvaient être mêlés à l’assassinat de l’Américain : la princesse Murat et les deux Rothschild, Gulbenkian, des comédiennes célèbres et quelques autres. Mais il fut bientôt évident qu’aucun de ceux qui composaient le public de cette vente ne pouvait avoir tiré sur Van Kippert. La balle l’avait atteint de face et en plein front, ce qui signifiait que le tireur devait se trouver derrière l’estrade du commissaire-priseur. Mais, naturellement, personne n’avait rien vu.
Aldo et Adalbert cependant se rapprochaient de Maître Lair-Dubreuil, qui venait de chercher dans son fauteuil un appui plus solide que des jambes ayant tendance à se dérober sous le coup de l’émotion. Il tenait à la main un papier et semblait sur le point de s’évanouir. La « Régente » avait disparu et ce fut d’elle que Morosini s’inquiéta en premier :
– Où est la perle ?
Le commissaire-priseur leva sur lui un regard éteint :
– Dans ma poche, rassurez-vous !… Tenez ! lisez cela !
Il tendit la feuille de papier sur laquelle on avait écrit en lettres majuscules : « Inutile de poursuivre la vente ou d’en organiser une autre. Quiconque osera acheter la perle de Napoléon aura le même sort, parce que la Grande Perle ne peut appartenir qu’à moi. Ainsi le veut le Seigneur et je saurai m’en emparer en temps utile… » La signature était assez effarante et Morosini la lut à haute voix :
– Napoléon VI ? D’où sort-il, celui-là ?
– Comment voulez-vous que je le sache ? s’exclama le commissaire-priseur. Un demi-fou ou un fou complet ?
– Ou simplement un type pourvu d’une aïeule qui a eu des bontés pour l’Empereur ? avança aimablement Adalbert. Comme pour Louis XV, on ne connaît pas exactement l’étendue de sa descendance. C’est facile d’en rajouter. Vous savez bien qu’on ne prête qu’aux riches…
– Quel qu’il soit, cela n’apporte pas la solution à mon problème. Voulez-vous me dire à présent ce que je vais faire de cette foutue perle ?
Il fallait que Maître Lair-Dubreuil soit vraiment perturbé pour employer un terme aussi grossier, lui qui personnifiait si bien le grand style. Il ajouta avec un nouveau soupir :
– Le mieux serait que je vous la rende, mon cher prince.
Aldo n’eut pas le temps de répondre. Soudain, Georges Langlois fut à ses côtés :
– C’est donc bien vous… « mon cher prince »… qui l’avez mise en vente ? C’est ce que je pensais. Et de là à imaginer qu’elle n’est autre que le trésor disparu de Vassilievich, il n’y a qu’un pas, fit-il narquois.
– Et vous l’avez naturellement franchi ? Inutile de finasser davantage, concéda Aldo. C’est bien moi qui l’ai confiée à Maître Lair-Dubreuil.
– Et elle vient de la cheminée de la rue Ravignan ?
– Elle en vient.
– Voulez-vous me dire de quel droit vous vous l’êtes appropriée ? Cela a un nom, « mon cher prince », outre qu’il s’agit aussi d’une dissimulation de pièce à conviction.
Le ton devenait menaçant mais Aldo n’en avait cure. Maîtrisant de son mieux la colère qui montait, il se fit glacial :
– Personne n’a jamais osé encore m’appliquer le qualificatif que vous avez dans l’esprit, « mon cher commissaire ». Et je ne me suis pas approprié la Régente. Je suis allé la porter à son légitime propriétaire le prince Félix Youssoupoff qui n’en a pas voulu, m’a demandé de la garder et de la mettre en vente…
– Et bien entendu le prince n’est pas là pour confirmer vos dires ?
– Il est en Corse. Ce n’est tout de même pas le bout du monde ? Demandez-le-lui !
– Je n’y manquerai pas mais ça ne me dit pas pourquoi vous avez décidé une démarche contraire à la loi : la perle devait m’être remise !
– Et qu’en auriez-vous fait ? Vous l’auriez enfermée dans un coffre d’où elle ne serait sortie qu’aux calendes grecques. Or le désir de Youssoupoff est que le produit de la vente serve à améliorer le sort des malheureux…
– Elle vient de servir à tuer un homme. Vous trouvez que c’est mieux ?
Ce fut Lair-Dubreuil qui se chargea de la réponse en tendant le message :
– Et si j’en crois ceci, elle en tuera d’autres. Alors j’en reviens à ma première question : qu’est-ce que j’en fais ? ajouta-t-il en tirant le joyau de sa poche pour l’offrir sur sa paume étendue.
Le policier prit le papier, lui jeta un coup d’œil puis l’empocha avant de cueillir la « Régente » qu’il mira un instant sous la lumière crue de la salle :
– Il manquait à cette histoire un mégalomane ! Et je n’arriverai jamais à comprendre pourquoi, depuis des siècles, on s’est entre-tué pour des objets comme celui-là…
– Admettez au moins que c’est une merveille ! protesta Maître Lair-Dubreuil atteint dans ses amours secrètes.
– Oh, je vous le concède !…
Il prolongea sa contemplation pendant un instant :
– Les coffres de cette maison sont solides, j’imagine ?
– Nous possédons ce qui se fait de mieux. Même la Banque de France n’est pas mieux équipée…
– Alors enfermez-la, cette belle meurtrière, et cela jusqu’à ce que nous réussissions à mettre la main au collet du candidat empereur ! Ensuite nous verrons ce qu’il convient d’en faire car, naturellement, la vente à M. Van Kippert est caduque.
– L’adjudication a eu lieu. Son héritière peut décider de verser la somme convenue et la prendre.
– Elle doit avoir d’autres chats à fouetter mais si le fait se produisait, montrez-lui donc le message de Sa Majesté et dites que, quoi qu’il en soit, la France a droit de préemption puisque la perle fait partie des Joyaux de la Couronne.
– Parfait ! conclut Morosini. Et que faites-vous de moi ? Vous m’arrêtez ou je peux rentrer chez moi ?
– Ni l’un ni l’autre, « mon cher prince », fit Langlois avec l’ombre d’un sourire. Vous êtes un témoin d’importance et j’ai encore besoin de vous. Alors prenez votre mal en patience et profitez un peu du printemps parisien !
– Mais j’ai une maison de commerce, une épouse… sans parler de deux enfants !
– Je suis désolé… mais pourquoi donc la princesse ne vous rejoindrait-elle pas ? Les collections d’été sont paraît-il très réussies. À présent, si vous voulez bien m’excuser, l’enquête commence et je dois voir la famille.
En le regardant s’éloigner vers le groupe, dans lequel se distinguait Martin Walker, qui entourait le cadavre caché sous une couverture, Aldo espéra, pour le bien de la jeune Muriel, que la famille se compose d’autres membres que du « fiancé ». En se penchant sur la jeune fille qui sanglotait assise un peu plus loin, il se donnait déjà des airs de propriétaire fort déplaisants…
– Si on rentrait ? proposa Adalbert. Je ne sais pas ce qui m’arrive mais j’ai faim.
– On peut toujours aller grignoter quelque chose mais, si tu es d’accord, je t’emmène souper ce soir au Schéhérazade.
– Caviar, vodka, blinis, chachliks et tout ce qui s’ensuit ? Te sentirais-tu saisi par la débauche comme ce pauvre Vauxbrun ?
– Non. Je voudrais bavarder un peu avec Masha. Elle et ses frères sont partis dans les premiers.
– Alors va pour les délices de la vieille Russie ! Mais que penses-tu de la suggestion du commissaire ?
– Faire venir Lisa ? Est-ce que tu imagines que cela signifie aussi les jumeaux et leur nounou suisse ? Si tu as le goût du martyre, Théobald ne l’a sûrement pas !
– Mme de Sommières ?
– Tante Amélie ? Aux dernières nouvelles, elle n’est pas encore rentrée. Et puis je n’ai pas envie de mêler Lisa à cette aventure sulfureuse.
– Dommage ! soupira Adalbert qui cultivait un faible pour la jeune femme.
– Je le pense aussi. Tu n’imagines pas comme elle me manque… Et je ne peux même pas lui téléphoner pour éviter de mettre en fuite l’ombre du divin Mozart !
Mais si les Colloredo étaient hostiles à la bruyante sonnerie, Lisa savait depuis longtemps apprécier ses commodités car, le soir même, elle appelait son époux.
– Comment as-tu deviné que j’avais tellement envie de t’entendre, mon cœur ? s’écria celui-ci.
– Peut-être parce que moi aussi j’en avais envie Dis-moi, quand penses-tu rentrer à la maison ?
– Pas maintenant, hélas, soupira Aldo. Cette désagréable affaire dont je t’ai parlé a eu aujourd’hui un prolongement : un milliardaire américain a été abattu en pleine salle des ventes au moment où il achetait la « Régente ». La police veut que je reste encore…
Au lieu d’une amère protestation, Aldo eut la désagréable surprise d’entendre ce qu’il crut bien être un soupir de soulagement :
– Ce n’est pas grave en ce qui me concerne mon chéri. Cela va nous permettre de prolonger notre séjour ici. C’est ce que je voulais te dire…
– Vous restez à Salzbourg ? Vous n’en avez pas encore assez des concerts et autres oratorios ?
– Non, nous ne sommes plus chez les Colloredo Je t’appelle de Rudolfskrone, où nous nous sommes installés hier. Nous avons rencontré à Salzbourg des amis anglais charmants, dont l’un est explorateur et aussi chasseur bien entendu. Grand-mère qui les aime beaucoup veut leur faire les honneurs de son château. On organise une chasse et un grand bal.
– En cette saison ? grogna Morosini qui n’aimait pas le ton allègre de sa femme… Ne devrait-elle pas mourir d’ennui sans lui ?
– Pourquoi pas ? Le printemps est ravissant à Ischl et la saison des eaux commence à Pâques. En outre le temps est superbe !
– Et les jumeaux là-dedans ?
– Eux ? Ils sont ravis. Tu penses : ils ont une grande maison pour eux seuls, sans compter nos gens qui sont déjà à leurs pieds. Mais, au fait, si on te libère bientôt tu pourrais venir nous rejoindre ?
– Par pitié n’emploie pas ce terme de libéré ! Je suis pas en prison ! Pas encore !
– Ne dis pas de sottises, mon chéri. Tu n’es quand même pas un repris de justice ?
– Quand même pas, non ! Et ils s’appellent comment ces Anglais charmants ?
– Sir William Salter et sa femme Sarah… qui est cousine de Mary Winfield, la marraine d’Amelia…
– Je sais qui est Mary Winfield, fit Aldo de plus en plus rogue. Et l’homme de l’aventure, c’est ce Salter ?
– Non, c’est son demi-frère, Francis Trevelyan. Mais tu as déjà dû voir sa photo dans les journaux : il est remonté aux sources de l’Amazone… Un personnage extraordinaire !
– Peut-être… oui. C’est possible…
En fait il se souvenait parfaitement de l’explorateur : un grand type tout en os avec une belle gueule en ciment armé et des dents que les clichés de presse n’avaient pas réussi à noircir. Juste le genre de type que l’on n’aime pas voir tournailler autour d’une jeune femme un rien romanesque ! Et moins encore quand la note lyrique vibre dans la voix qui en parle ! Aldo n’eut pas le temps de développer son opinion car juste à cet instant la communication fut coupée tandis que, inquiète de son soudain silence Lisa au bout du fil multipliait les « Allô ! Allô !... Ne coupez pas, mademoiselle ! ». Il raccrocha le combiné.
– Eh bien ? commenta Adalbert. Tu en fais une tête !
– Tu ferais la même si ta femme se mettait à délirer à propos d’un chasseur de têtes retour d’Amazonie…
Les yeux d’Adalbert s’arrondirent :
– Lisa ? Délirer pour un coureur des bois ? Je ne croirai jamais ça !
– J’aurais dû te passer l’écouteur !
Et il restitua l’essentiel de ce qu’avait dit Lisa mais s’il s’attendait à rencontrer de la compassion il se trompait : Adalbert se mit à rire. Ce qui acheva d’exaspérer Aldo :
– En plus tu trouves ça drôle ?
– Plutôt, oui ! Voyons, mon garçon, réfléchis un peu ! Voilà des jours et des jours que tu vis à Paris sous le prétexte que la police a besoin de toi…
– Le prétexte ?
– Lisa peut très bien imaginer que c’en est seulement un. Alors, elle te paie de la même monnaie.
– Mais c’est ridicule ! Elle a confiance en moi comme j’ai confiance en elle.
– On ne le dirait pas ! Écoute, si tu risques d’être coincé trop longtemps, je te propose d’aller faire un tour à Ischl pour remettre les pendules à l’heure. Moi, j’ai le droit de bouger…
Aldo se jeta dans un fauteuil en étendant devant lui ses longues jambes et alluma une cigarette.
– Elle aurait tôt fait de percer à jour ta démarche, mon bon ! Mais c’est gentil de le proposer. À présent va te préparer et allons faire la fête, ajouta-t-il d’un ton lugubre.
Chose extraordinaire, Gilles Vauxbrun n’était pas au Schéhérazade quand les deux amis y firent une apparition. Il était encore tôt d’ailleurs et la salle n’était pas pleine. Sous la conduite d’un maître d’hôtel qui aurait fait un succès dans Le Prince Igor, ils choisirent une table pas trop près de la piste d’où ils pouvaient découvrir la totalité de l’élégant cabaret. Les violons tziganes faisaient rage mais ni Masha ni la belle Varvara n’étaient encore visibles. Morosini pensa que le moment était peut-être favorable pour aller bavarder avec la chanteuse et, après avoir conseillé à Adalbert de commander pour eux deux, il se levait pour mettre son projet à exécution quand la tenture de velours se souleva pour livrer passage au commissaire Langlois. Impeccable dans un smoking coupé par un maître tailleur, il s’arrêta au seuil pour allumer un havane de belle importance. Morosini se rassit. Les yeux sur la carte, Adalbert demanda :
– Tu as changé d’avis ?
– Non mais l’instant me paraît mal choisi. Regarde !
Adalbert émit un petit sifflement admiratif :
– Peste ! Si on les habille comme ça cette année dans la police, je pose ma candidature tout de suite !
– Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée étant donné tes… activités annexes ? Tu aurais là une bonne couverture…
Le policier cependant les avait repérés et vint vers eux. Aldo se leva pour l’accueillir :
– J’espère que vous n’êtes pas en service et que vous accepterez de souper avec nous ?
Georges Langlois ne souriait pas souvent, ce qui donnait à son sourire le charme de la rareté :
– Je suis toujours en service et je ne fais que passer… mais je vous remercie.
– Voulez-vous dire que vous partez déjà ? Sans avoir entendu Masha Vassilievich ?
– Je l’ai déjà entendue… autrement ! Et je ne peux pas me permettre de me laisser enchanter par une si belle voix. Ulysse au moins s’était fait attacher au mât de son navire. Mais… je reviendrai volontiers l’entendre quand tout cela sera fini.
– J’espère que ce sera bientôt. Votre Napoléon VI ne m’amuse pas.
– Moi non plus. Bonne nuit, messieurs !
Une brève inclination de la tête et de son pas nonchalant il s’éloigna vers le vestiaire :
– Qu’est-ce qui t’a pris de l’inviter ? bougonna Adalbert. J’admets qu’il a de la classe mais est-ce suffisant pour partager le pain et le sel ?
– Et pourquoi pas ? C’est un excellent limier, tu sais ? Tu aurais pu lui demander des nouvelles de ton bon ami La Tronchère ?… Oh non ! C’est une gageure !
Quelqu’un en effet venait de franchir à son tour la somptueuse tenture brodée d’or mais ce quelqu’un n’avait que de lointains rapports, sur le plan vestimentaire, avec le dandy du quai des Orfèvres : Martin Walker, lui, dédaignait les atours et restait fidèle à son tweed fatigué et à ses knickerbockers bouffant mollement au-dessus de chaussettes écossaises et de grosses chaussures à semelles de crêpe. Imitant Langlois il s’arrêta pour tirer sa pipe de sa poche mais l’imposant maître d’hôtel qui le considérait avec un dégoût quasi palpable se jeta sur lui à temps pour éviter à ses clients des miasmes aussi nauséabonds.
– Que vient-il faire ici ? fit Aldo. Il a dû repérer les Vassilievich à la vente…
Aussitôt il fut debout et fit un geste pour attirer l’attention du journaliste. Adalbert protesta :
– Ne me dis pas que tu vas l’inviter aussi à souper, celui-là ?
– Pourquoi pas ? Il m’a promis un renseignement capital… Je ne pensais pas vous revoir si vite, ajouta-t-il à l’intention de Walker qui accourait avec empressement. J’avais l’intention de me rendre à votre journal demain matin pour vous rencontrer. Mais asseyez-vous, je vous prie.
Walker ne se le fit pas dire deux fois et ne protesta pas quand Morosini réclama un autre couvert. Au contraire, son visage à la grande bouche moqueuse sous un nez un peu de travers, pas sans charme d’ailleurs, et que les yeux bleus au regard direct rendaient sympathique, s’épanouit en un sourire de gamin gourmand quand les premières bulles de champagne pétillèrent dans sa coupe. De même l’apparition du caviar l’enchanta :
– Si vous traitez toute la presse comme ça, pas étonnant qu’elle vous adore…
– Je vous traite en ami parce que j’espère que vous me rendrez la pareille. Vous m’avez fait une promesse cet après-midi…
– Je n’ai pas oublié et je vous remercie d’avoir laissé Marie s’en aller. Je vous l’ai dit, c’est une pauvre fille.
– Elle est cependant mêlée de près à l’assassinat de Piotr Vassilievich, car d’évidence elle a partie liée avec les meurtriers. N’oubliez pas que je l’ai vue chez la victime peu après l’enlèvement et que je l’ai suivie jusqu’au lieu du crime… d’où elle a disparu comme par enchantement avec eux…
– Je sais. Elle me l’a dit.
– Vous la connaissez si bien ?
– Pas mal ! C’est même moi qui lui ai trouvé un engagement aux Folies-Rochechouart pour l’empêcher de mourir de faim.
– Elle fait du théâtre ?
– Un bien beau mot pour ce qui n’est guère qu’un music-hall et pas des plus relevés. Elle est danseuse. J’admets qu’elle n’est pas bien belle mais elle est bien fichue et elle a des jambes magnifiques…
Puis se tournant vers Adalbert qui le fixait comme s’il s’attendait à le voir filer avec les couverts d’argent :
– Votre nom me dit quelque chose vous êtes archéologue, je crois ?
– Égyptologue, précisa celui-ci dont le front émergea un peu des nuages qui le couvraient. Je ne pensais pas être connu de ces messieurs de la presse.
– Pas de tous, bien sûr, mais moi je suis un cas à part. J’ai toujours eu une vraie passion pour les vieux trucs que l’on déterre et qui ont souvent une belle histoire à raconter. Alors je sais qui vous êtes…
Et pour laisser à Vidal-Pellicorne le temps d’assumer sa confusion, Walker se refit une tartine de caviar. Aldo reprit :
– Je voudrais lui parler. Et le plus tôt sera le mieux…
– Qu’espérez-vous entendre d’elle ?
– Des renseignements sur ses dangereux compagnons. Je veux bien admettre quelle n’ait pas participé au meurtre de Piotr mais elle en est complice. En outre, je suis persuadé de leur implication dans le crime de Drouot.
– Vous avez sans doute raison mais, même si elle était sur place, Marie n’y est pour rien. Quant à vous renseigner sur ce que vous appelez ses dangereux compagnons, soyez certain qu’elle ne pourra rien vous apprendre…
– Qu’en savez-vous ? susurra Adalbert.
Walker lui dédia un grand sourire un rien narquois.
– Vous devez bien penser que je l’ai déjà passée à la question sur le sujet ? Je suis intéressé, moi aussi, et au premier chef encore ! Imaginez le papier que je pourrais écrire sur ma rencontre avec Napoléon le Sixième.
– Vous savez ça ? fit Aldo sèchement. Comment est-ce possible ?
– Parce que Marie m’en a parlé… bien qu’elle ne l’ait jamais vu.
– Expliquez !
– Oh, c’est simple ! soupira Walker en tendant sa coupe vide pour qu’on la lui remplisse. Je ne vais pas vous raconter sa vie parce que ce serait du temps perdu et que, si vous la voyez, elle vous la narrera avec tant de détails que ça ferait double emploi. Sachez seulement qu’après des années confortables vécues à l’ombre de son cher papa, elle a épousé, en 17 je crois, un certain Boris Solovieff qui était un des pontes du syndicat des poissonniers et elle a fini par fuir Saint-Pétersbourg pour rejoindre son mari qui, selon elle – et il appuya sur les deux mots –, voulait monter une opération pour faire évader le tsar et sa famille. Une de ces histoires que l’on raconte quand il n’y a plus personne pour vous démentir ! Toujours est-il que les Solovieff ont au moins réussi à fuir jusqu’à Vladivostok après moult aventures – les Bolcheviks les auraient accusés d’avoir emporté et caché les bijoux de la tsarine ! – où ils ont été finalement rattrapés par la Révolution Départ à prix d’or sur un cargo à destination de Trieste, débarquement, séjour à Prague, puis à Vienne dans des conditions de plus en plus lamentables, pour atterrir finalement à Paris où Marie espérait l’aide d’un banquier nommé Rubinstein qui d’ailleurs s’est déguisé en courant d’air. Là, le mari est mort usé par les épreuves et les petits boulots acceptés pour faire vivre sa famille – le couple a deux gamines ! – et Marie, après avoir vendu ce qui pouvait lui rester d’objets précieux, s’est trouvée affrontée à la misère. D’autant plus cruelle, ajouta le journaliste d’une voix plus sombre, qu’elle savait n’avoir rien à attendre des autres réfugiés russes : la fille de Raspoutine n’était-elle pas marquée pour eux du sceau de la malédiction ? C’est alors qu’elle a répondu à une petite annonce demandant de jolies filles sachant danser. Elle s’est présenté mais l’homme qui l’auditionnait a sauté en l’air à la lecture de son nom et lui a dit que sa place n’était pas chez lui, qu’elle devrait partir en Amérique et faire du cinéma. Découragée, elle est allée s’échouer dans un bistrot du faubourg Montmartre où elle a bu quelques verres de cognac pour tenter d’oublier ses déboires. C’est à cet endroit que je l’ai rencontrée. Elle était pitoyable, la pauvre, et j’ai fait de mon mieux pour l’aider. D’où l’engagement aux Folies-Rochechouart pour parer au plus pressé. Là, son nom et aussi son talent – car elle n’est pas maladroite ! – lui ont valu quelques admirateurs parmi lesquels un certain Aaron Simanovitch qui avait été un temps secrétaire de Raspoutine. C’est lui qui l’a engagée à attaquer en justice le prince Youssoupoff, qui a fait paraître un livre sur son histoire avec le staretz.
– Elle a une chance de le gagner ?
– Je n’en sais rien. La justice française ne me paraît guère compétente pour juger une affaire russe vieille de dix ans mais on ne sait jamais. Comme elle demande vingt-cinq millions cela va donner lieu à une belle joute oratoire entre ténors du barreau. Elle est défendue par Maître Maurice Garçon et Youssoupoff par Maître de Moro-Giafferi, et nous verrons bien. À peu près au même moment elle a reçu de mystérieux messages. On lui proposait de la protéger contre les ennemis sans scrupules qui, selon la tournure que prendrait le procès, pourraient y mettre fin en les faisant disparaître, elle et ses filles. Une tentative d’enlèvement – heureusement avortée ! – l’a convaincue de s’en remettre à ces amis discrets et efficaces. Un échange, ces gens lui demandaient de les aider à récupérer les trésors impériaux de l’ancienne Russie… et de l’empire français…
– Rien que ça ! Je leur souhaite bien du plaisir ! Ils sont disséminés un peu partout sur la planète à l’heure qu’il est, sans compter ceux que les Soviétiques ont eu le bon esprit de conserver !
– C’est leur affaire mais vous qui venez d’acheter une émeraude historique, vous devriez y songer !
– Soyez sûr que je n’y manquerai pas. Merci du conseil. Mais pourquoi l’empire français et pour quoi Napoléon VI? Ça n’a pas de sens !
Walker attendit que l’on eût déposé sur leurs assiettes le contenu des chachliks que l’on venait d’apporter tout flambants pour continuer :
– En apparence seulement. Si l’on cherche bien ce n’est pas complètement idiot. Avez-vous déjà entendu prononcer le nom de Berechkoffskaïa ? On l’appelait aussi la « Grand-Mère de la Révolution ».
– Jamais.
– Moi si, intervint Adalbert. Elle a passé la plus grande partie de sa vie en Sibérie, je crois, d’où on l’aurait menée en Crimée et installée dans l’une des anciennes résidences de Livadia. J’ai lu son nom quelque part dans un article… allemand, il me semble.
– Bravo ! L’article disait-il qu’elle était la fille de Napoléon et d’une jolie marchande de Moscou ?
– Alors là ça me paraît difficile, fit Morosini en riant. En admettant qu’il se soit trouvé une femme assez hardie pour braver Rostopchine et ses incendiaires afin de venir offrir à l’Empereur ses charmes consolateurs, elle serait née en 1813, votre bonne femme, et quand elle a découvert les rives ensoleillées de la Crimée, elle aurait eu cent quatre ans ?
– Très juste ! approuva Vidal-Pellicorne. C’est même pour ça qu’elle a eu droit à cet article allemand mais ça ne parlait pas de Napoléon. Alors, le rapport avec ce « prétendant » inattendu ?
– Il serait son petit-fils tout simplement ! émit joyeusement le journaliste. Celui de ses « fidèles » qui est entré en relations avec Marie le lui a expliqué soigneusement. Du fond de la Sibérie où l’on avait fini par envoyer sa mère, la Berechkoffskaïa a eu un fils d’un des décembristes expédiés là-bas par Nicolas Ier et ce fils en a eu un lui-même vers la fin du siècle dernier. Moi je trouve cette histoire passionnante. Pas vous ?
– Intéressante en tout cas ! soupira Aldo. Mais pourquoi ce chiffre six ?
– Dans cette famille on a l’air de tenir ses comptes à jour. Si l’on part du principe que le prince impérial, fils de Napoléon III, avait droit au IV, le marmot du décembriste devenait Napoléon V et son fils a continué en bonne logique. C’est aussi simple que ça…
– Et Marie Raspoutine ne l’a jamais vu ?
– Non, et c’est compréhensible. Quand on a de si hautes prétentions il faut bien se protéger. Elle n’a affaire qu’à des comparses.
– Soit, je l’admets volontiers, fit Aldo en allumant une cigarette, mais ce que je ne comprends plus, c’est pourquoi cette femme revendique la « Régente » ? Elle n’a jamais appartenu à son père et je pense que votre Napoléon VI n’a aucune intention de la lui donner : elle doit représenter un symbole pour lui ?
– Exact, mais souvenez-vous qu’elle a vingt-six ans, qu’elle est veuve et qu’elle ne verrait aucun inconvénient à devenir Madame Napoléon. Comme les grands aventuriers, cet homme est sûrement célibataire !
– Et elle avale cette couleuvre ? Vous dites qu’elle ne le connaît pas ?
– Mais elle a entendu sa voix et elle ne désespère pas de leur rencontre, qui serait sa première récompense. Ensuite, il se pourrait qu’il en fasse une maîtresse.
– Où allez-vous chercher tout ça ? fit Adalbert moqueur. Vous ne savez rien des intentions de cet homme…
– Eh non, mais quand on est journaliste il vaut mieux avoir de l’imagination. Cela permet de boucher les trous. En outre, je sais assez bien ce qui se passe dans la cervelle de Marie…
– Et elle ne vous a rien dit concernant les meurtriers de ce malheureux Piotr ? fit Aldo un peu agacé par ce qu’il jugeait être une trop forte dose de naïveté chez ce garçon. Il me semble que vous devriez être intéressé par la capture de ces misérables. Cela vous ferait un bon papier, comme vous dites.
– Pas si bon que si j’arrive à atteindre le cerveau en pénétrant l’association. Amener Napoléon VI devant nos objectifs, voilà qui vaut la peine de se donner du mal. Mais il y faut de la patience.
– En ce qui me concerne je n’en ai plus guère, parce que je voudrais bien rentrer chez moi et que ce nouveau meurtre n’arrange rien…
Il se tut soudain sous l’impact des applaudissements qui saluaient l’entrée de Masha, dont la voix s’élevait réduisant au silence les soupeurs aussitôt sous le charme. Un charme auquel Aldo n’essaya pas d’échapper, bien au contraire. Il ne comprenait pas les paroles mais il y avait dans cette voix aux sonorités de violoncelle une sorte de magie qui lui faisait du bien. Pourquoi fallut-il que le journaliste chuchotât à son oreille :
– Vous connaissez cette chanson ? Elle s’appelle « La fin de la route » et elle est chargée de douleur. Je suppose que Masha la dédie à son frère ? Voulez-vous que je traduise ?
– Vous parlez russe ?
– Je parle cinq langues. C’est utile dans mon métier. Écoutez, elle dit :
Mes rêves se sont tus car tu es parti maintenant,
Nous ne faisons plus route commune,
Une simple intention mal interprétée
Et le regard s’est glacé de haine…
– Par pitié, taisez-vous ! intima tout bas Morosini, désagréablement impressionné parce qu’a cet instant il pensait à Lisa et au plaisir qu’ils auraient goûté si elle était auprès de lui en ce moment. Je préfère ne rien comprendre : cette voix est un poème à elle seule…
– Oh ! Je suis désolé ! Toujours cette manie de faire étalage de mes petits talents…
– Ne faites pas attention ! Mon humeur tend à la morosité ces temps-ci…


