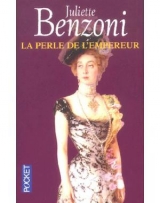
Текст книги "La Perle de l'Empereur"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Il ne perdit pas de temps à se demander ce qu’elle faisait dans ce lieu et, envahi d’un espoir tout neuf, il se mit à tambouriner doucement, puis un peu plus fort, contre la vitre. Il la vit tressaillir, lever la tête puis se précipiter vers la fenêtre qui, d’ailleurs, était dépourvue d’ouverture, y coller son visage puis réprimer un cri de joie. Presque aussitôt suivi d’un geste d’impuissance affolée. Pour la calmer il appliqua sa main sur la vitre, paume à plat, puis fouilla dans ses poches où se trouvait un assortiment d’outils de petite taille fort utiles à qui souhaite s’introduire chez quelqu’un sans sa permission. Parmi eux, il y avait un diamant de vitrier à l’aide duquel il entreprit de découper le carreau sur son pourtour afin de se frayer un passage. Comprenant son idée, Marie-Angéline partit chercher un oreiller et l’appliqua sur la vitre pour diminuer le bruit. Ce fut un travail long et plutôt fatigant étant donné la position instable d’Adalbert mais, finalement, le carreau fut enlevé, déposé sur le tapis, et la fausse Mina put aider son ami à franchir l’ouverture. À l’intérieur de la maison rien n’avait bougé.
– Éteignez ! chuchota Adalbert. Ils croiront que vous dormez et on peut aussi bien causer dans l’obscurité. À présent, dites-moi ce que vous faites là ? ajouta-t-il en se laissant tomber sur le pied du lit pour éponger la sueur qui lui coulait du front et d’un peu partout.
– Je remplace Lisa. Elle devait apporter toute la collection de joyaux d’Aldo.
Elle apprit alors à Adalbert le chantage auquel Lisa avait été soumise et les ordres qui lui avaient été donnés par les ravisseurs, précis et féroces. Elle devait venir sous un nom d’emprunt et ne prévenir aucun des amis d’Aldo ni des siens propres sous peine de mort pour son époux. Elle était donc partie, emportant la collection et sous son ancienne apparence de Mina Van Zelden, la fidèle et peu attrayante secrétaire d’autrefois.
– Mais, continua la vieille fille, une fois qu’elle été embarquée sur le Simplon-Express, M. Buteau resté à Venise, n’a pas supporté l’idée de la savoir seule aux prises avec des gens aussi dangereux. Il fallait qu’il fasse quelque chose : alors, afin d’être certain que sa communication ne soit pas surprise, il est allé chez le pharmacien Franco Guardini l’ami d’enfance d’Aldo, et il a appelé chez nous. Ce qu’il voulait, c’est que la marquise prévienne son ami l’ancien commissaire Langevin, mais nous avons eu une autre idée. Connaissant le plan que devait suivre Lisa, je suis allée la rejoindre au Continental et j’ai réussi, non sans mal, à la convaincre de prendre sa place. Ce rôle-là je pouvais le jouer sans difficultés…
– Ce qui m’étonne, c’est que vous ayez réussi ! Telle que je la connais… Elle ne vous a pas flanquée à la porte ?
– Oh, elle a essayé, mais je suis plus forte qu’elle. En outre je crois qu’elle a éprouvé un soulagement à voir enfin devant elle un visage ami. Elle a relâché la tension en pleurant d’abord, puis en ne se faisant pas trop prier pour me dire ce qu’elle allait devoir faire. Seulement quand j’ai dit que je voulais y aller à sa place, elle est devenue intraitable c’était elle qui devait y aller et nulle autre. Alors j’ai employé les grands moyens…
– Et c’est quoi, les grands moyens ?
Marie-Angéline rougit furieusement – un spectacle qui se perdit dans l’obscurité ! – baissa la tête et soupira :
– Je lui ai envoyé un uppercut au menton.
– Un quoi ?
– Un coup de poing ! Il faut vous dire que je fais beaucoup de gymnastique et que j’ai un peu étudié la boxe… Avec un adversaire non prévenu je me débrouille assez bien.
– Je me demande s’il y a quelque chose au monde que vous n’ayez pas essayé ! exhala Adalbert sidéré. Et après ?
– Je l’ai déshabillée, ligotée avec les ceintures des peignoirs de bain, bâillonnée avec un mouchoir et enfermée dans la salle de bains. Rassurez-vous, elle ne manque pas d’air. Là-dessus j’ai pris ses vêtements… et sa place au rendez-vous. Seulement nous ne sommes pas au bout de nos peines : le démon que j’ai vu à l’étage en dessous veut Lisa sinon il ne relâchera pas Aldo.
– Pas difficile de comprendre pourquoi : tenant Lisa il espère faire chanter son père pour obtenir une nouvelle rançon.
– Vous croyez ? C’est un gros morceau que Moritz Kledermann.
– Oui et assurément il ne se laissera pas manipuler aisément, mais en attendant tous ces délais risquent de coûter la vie à Aldo.
– J’en suis persuadée. Que fait-on maintenant ?
– On essaie de sortir d’ici pour pouvoir ouvrir ceux à qui sont en bas. Rallumez et criez aussi fort que vous pouvez… et aussi longtemps qu’il faudra pour que quelqu’un vienne.
Tout en parlant, Adalbert s’emparait du tisonnier placé près de la cheminée et se plaçait derrière la porte. Marie-Angéline, pour sa part, prit une longue respiration et se lança dans une série de cris perçants tout à fait convaincants : ceux d’une femme à qui on fait subir les pires sévices. Le résultat ne se fit pas attendre. Après un cliquetis frénétique de clefs la porte fut violemment rejetée et un homme au physique nettement ibérique parut :
– Qu’est-ce qui se passe ici ? Mais…
Il se figea devant une Marie-Angéline qui debout au milieu de la pièce, le regardait surgir avec un doux sourire. Il n’eut cependant pas de temps pour d’autres points d’interrogation : manié de toute la force d’Adalbert, le tisonnier s’abattit sur son crâne et il s’écroula sans un soupir.
– Allons-y ! fit Adalbert. Il fit sortir sa compagne, ferma la porte à clef, mit la clef dans sa poche et, saisissant d’une main son revolver et de l’autre le bras de « Mina », il l’entraîna dans un couloir poussiéreux et entièrement dépourvu de meubles qui débouchait sur le dernier palier d’un large escalier de bois. Là, ils s’arrêtèrent pour écouter les bruits de la maison. Elle leur parut silencieuse ; pourtant elle n’était pas endormie car il devait y avoir, au rez-de-chaussée, une pièce allumée dont la lumière se reflétait dans la cage d’escalier.
L’un derrière l’autre, en rasant les murs pour éviter le plus possible de faire crier les marches, ils descendirent prudemment, s’arrêtant cependant au premier étage où ils virent un rai lumineux sous une porte.
– On va voir ? souffla Marie-Angéline.
– Non. D’abord ouvrir en bas. Il nous faut de l’aide…
Ils continuèrent à glisser le long des degrés jusqu’à atteindre le sol dallé d’un grand vestibule, vide à l’exception d’une antique chaise à porteurs. Adalbert se dirigea vers l’endroit éclairé, vit qu’il n’agissait d’un salon mal meublé avec des rideaux de peluche rouge mais où il n’y avait personne. D’un geste il entraîna alors son amie vers la porte de derrière qui donnait sous l’escalier, et chuchota quelques mots à son oreille. Elle fit signe qu’elle avait compris, ouvrit la porte et interpella l’homme qui faisait les cent pas devant :
– Dites-moi, mon brave ! fit-elle sur un ton terriblement snob. Pouvez-vous me dire… ?
L’effet de surprise joua pleinement. L’étonnement paralysa l’homme un court instant. Très court mais suffisant : jaillissant de nulle part, Martin Walker lui tombait dessus, l’assommait d’un maître coup de poing et, quand il s’écroula, Martin exerça sur son cou une prise qui le laissa inerte et sans connaissance.
– Que lui avez-vous fait ? demanda Adalbert surpris.
– J’ai appuyé sur ses carotides. Il en a pour un moment : j’ai appris ça au Japon. Mais faudrait peut-être essayer de le cacher ?
– On a ce qu’il faut !
Un instant plus tard, le garde, bras et jambes ligotés au moyen des bas de Marie-Angéline, bâillonné avec deux mouchoirs, était déposé dans la chaise à porteurs.
– Il y a celui de devant, chuchota Adalbert. On ferait peut-être bien de s’en occuper ?
– Hé là ! Je n’ai plus de bas, moi ! gémit la vieille fille qui, assise par terre, était occupée à se rechausser.
– Vous avez peut-être une combinaison ? proposa obligeamment Martin. En la déchirant en bandes…
– Vous n’êtes pas un peu malade ? Pour peu qu’il y en ait encore deux ou trois à mettre hors de combat, je n’aurai plus rien sur le dos ?
– Bah ! C’est pour une bonne cause, fit le journaliste avec un sourire si charmant qu’elle se mit à rougir :
– S’il n’y a pas moyen de faire autrement…
– On n’a pas le temps pour le badinage ! grogna Adalbert. Mettons déjà celui-là hors de service, on verra après.
Le même scénario se reproduisit mais cette fois les deux hommes tombèrent sur le garde avec un bel ensemble : le poing d’Adalbert l’envoya au tapis pour le compte, après quoi les doigts de Martin opérèrent comme sur son complice.
– Il y a là un placard ! proposa Marie-Angéline qui explorait fébrilement les boiseries du vestibule. Et il a l’air solide : mettons-le là !
– C’est beau, la pudeur ! ironisa Adalbert. Ça rend ingénieux.
Le placard refermé sur le garde tassé dedans, on tint un rapide conseil pour essayer d’évaluer le nombre des occupants de la maison.
– On n’est pas au bout, expliqua Marie-Angéline. Il y a encore l’homme qui m’a embarquée rue de Rivoli, le chauffeur et le Mongol… ou quelque chose qui y ressemble.
– La Mongole ! rectifia Adalbert.
– Pas du tout. J’ai bien dit « un homme ». Une sorte de tank jaune fort comme un ours. Pourquoi avez-vous dit « la » ?
– Parce qu’il y a ici la servante de la comtesse Abrasimoff et que c’est même ça qui m’a fait comprendre qu’il fallait s’intéresser à cette maison…
– N’oubliez pas non plus le patron : Napoléon VI ; il est mauvais comme un serpent à sonnette !
– Oh je ne l’oublie pas ! C’est même par lui qu’on va commencer. Il doit être au premier étage.
– Allez-y ! dit Martin. Moi je fais venir Théobald et on va explorer le sous-sol. La cuisine doit y être et les domestiques aussi. Si vous entendez tirer, ne vous affolez pas ! Je n’ai pas l’intention de faire de quartier ! ajouta-t-il en fourrant dans sa ceinture le pistolet récupéré sur le second garde, Marie-Angéline ayant déjà fait main basse sur celui du premier. Quant aux fusils, trop encombrants en combat rapproché, on les avait glissés sous les premières marches de l’escalier.
Aussi prudemment qu’à la descente, Adalbert et Marie-Angéline remontèrent et s’approchèrent de la porte sous laquelle filtrait la lumière. L’archéologue se pencha pour regarder par le trou de la serrure mais la clef était dedans et il ne vit rien : le bandit avait dû s’enfermer… En effet, quand avec d’infinies précautions il appuya sur la poignée de la porte, celle-ci résista. Adalbert se rapprocha de son associée :
– Ça vous fait peur de rester là à surveiller cette porte ?
– Avec ça, non ! fit-elle en élevant son pistolet. D’autant que je tire bien. Que voulez-vous faire ?
– Passer par la fenêtre. Le balcon qui y correspond est facile à atteindre puisqu’il est au-dessus du perron et qu’il n’y a plus de garde. Mais si vous êtes amenée à tirer, faites attention : il me le faut vivant afin qu’il me dise où est Morosini…
Elle fit signe qu’elle avait compris. Adalbert redescendit, sortit de la maison et examina le porche qui soutenait le balcon, très Roméo et Juliette d’ailleurs avec ses groupes de colonnettes sculptées de motifs différents comme aux portails de certaines églises. Mais là – don du Ciel lui-même sans doute ! –, un lierre grimpait gracieusement jusqu’à la balustrade gothique. Adalbert se sentit des ailes et, en moins de cinq minutes, il avait atteint son but et s’approchait de la porte-fenêtre ogivale flanquée de deux étranges ouvertures à meneaux. Sûr de lui, l’occupant de la chambre n’avait même pas jugé bon de tirer les rideaux ou de porter son foulard blanc. L’archéologue eut tout loisir de reconnaître le marquis d’Agalar. Assis sur une chaise en bois sculpté placée près d’une table sur laquelle était posée une grosse serviette de cuir ouverte, il contemplait un bijou qu’il tenait sur la paume de sa main. Un bijou qui n’était autre que la « Régente »… Le temps, cette nuit, était doux et Adalbert considéra que sa chance tenait bon en constatant que la porte-fenêtre était simplement poussée. Divine imprudence des gens qui se croient invulnérables ! En dépit de sa fatigue, Adalbert s’offrit un sourire, assura son revolver et poussa doucement du pied le battant de verre.
– Désolé de troubler les délectables méditations de Votre Majesté, fit-il goguenard, mais je crains que son trésor de guerre ne lui échappe dans un bref délai. Les mains en l’air !
Pas autrement effrayé, l’air agacé plutôt, l’autre obéit :
– Qui êtes-vous et que voulez-vous ?
– Un ami du prince Morosini. Je viens le chercher et récupérer du même coup tout ce que vous lui avez volé. À commencer par ça ! ajouta-t-il en s’emparant de la perle qu’il glissa dans sa poche de poitrine. On ne vous a pas dit que ce n’était pas correct de toucher une rançon et de ne pas rendre son prisonnier ?
– Je n’ai pas reçu la totalité de ce que j’attendais. Je n’ai donc aucune raison de libérer votre ami. J’avais dit la princesse Morosini en personne !
– Pas difficile de deviner pourquoi : on l’enfermait, on faisait chanter son papa, on ramassait la collection Kledermann… et pour finir on tuait tout le monde afin d’être sûr de n’être reconnu par personne. C’était bien imaginé mais c’est raté ! Alors maintenant, vous allez me montrer le chemin ajouta-t-il avec rudesse. Debout et passez devant !
– Où voulez-vous aller ?
– Chercher Morosini ! Un peu vite, s’il vous plaît !
– C’est inutile : il est mort !
Le cœur d’Adalbert manqua un battement et il dut serrer les dents, mais sa détermination n’en fut que plus ferme :
– Alors conduisez-moi à sa tombe ! Et je vous préviens qu’il faudra creuser ! Je suis quelqu’un dans le genre de saint Thomas moi, je ne crois que ce que je vois !
– Il n’y a pas de tombe. Nous l’avons jeté à la Seine !
– Tiens donc ! Il aurait déjà refait surface.
– Pas avec une gueuse de fonte aux pieds…
Le sang d’Adalbert se glaçait de plus en plus. Ce misérable semblait affreusement sûr de son fait.
– Si vous avez fait ça, vous n’êtes qu’un fou, parce que moi, à présent, je n’ai plus aucune raison de vous ménager…
Au bout de son bras tendu, l’arme vint presque toucher le visage d’Agalar. Celui-ci lut sa mort dans les yeux soudain opaques de cet homme. Il allait tirer. D’une main qui tremblait, le marquis écarta le revolver :
– Je vous ai menti. Il vit ! Et… et je vais vous conduire à lui.
– J’espère qu’il est en bon état. Sinon, il ne restera pas grand-chose de vous à livrer à la guillotine ! Marchez ! Je vous suis… Et pas un geste de trop sinon vous êtes mort !
– Je ne suis pas stupide…
La porte franchie, Adalbert fronça le sourcil : il s’attendait à se trouver en face du pistolet de Marie-Angéline mais elle n’était pas là. Ce qui le surprit un peu, mais pas trop : il connaissait assez le caractère fantasque de la dernière des Plan-Crépin. Quelque chose avait dû attirer son attention et elle était allée voir.
L’un derrière l’autre, on descendit l’escalier à pas comptés.
En atteignant le vestibule, Adalbert pensa que l’atmosphère était bizarre : tout était désert, silencieux. Or, si Martin et Théobald avaient surpris les gens de la cuisine, un certain vacarme aurait dû s’ensuivre, et l’on n’entendait rien. On ne voyait personne. La porte du salon éclairé était toujours ouverte comme celles donnant sur le jardin.
Adalbert pensait que l’on allait se diriger vers celui-ci mais Agalar marcha vers le salon :
– Pas par là ! gronda Adalbert. Je suis sûr qu’il n’est pas dans la maison.
– Sans doute, mais je dois prendre des clefs et elles sont dans cette pièce…
– Dans ce cas…
Toujours l’un derrière l’autre on pénétra dans la zone éclairée. À cet instant quelque chose siffla dans l’air et une douleur brûlante envahit le poignet d’Adalbert. La lanière d’un long fouet venait de s’y enrouler. Et ce fouet était manipulé par un poussah mongol. L’arme s’échappa de sa main dont il eut l’impression qu’on la lui arrachait, et il se retrouva sur le tapis usé.
– Bravo, Timour ! fit Agalar avec satisfaction. Je me demandais où tu étais passé.
– Femme embusquée là-haut. L’ai assommée et jetée dans un coin.
Adalbert demanda mentalement pardon à « Plan-Crépin », coupable seulement de s’être laissé surprendre, et sentit un pincement à la pensée que cette brute l’avait peut-être tuée…
– Où sont les gardes ? demanda le marquis.
Timour fit signe qu’il n’en savait rien.
– On finira bien par les retrouver. Où sont les autres ?
– Ici, don José ! fit une voix à l’accent espagnol. Nous avons été attaqués à la cuisine et Pablo a été tué, mais j’ai assommé celui-là en lui lançant un fer à repasser à la tête, ajouta-t-il en jetant à terre un homme ficelé troussé comme un poulet dans lequel Adalbert, en qui montait le désespoir, reconnut Martin. Le journaliste était blême, inconscient, et du sang coulait de sa tempe.
– Il était seul ? grinça Agalar en allongeant au corps inerte un coup de pied chaussé d’un soulier pointu.
– Non. Il y en a un autre qui a réussi à s’échapper mais il n’ira pas loin. Tamar était allée… là-bas avec les chiens. En revenant elle a vu l’homme qui s’enfuyait et elle les a lâchés. Il ne doit pas être beau à voir à l’heure qu’il est.
Cette fois Adalbert ne put retenir un gémissement douloureux. Théobald ! Son fidèle, son irremplaçable ! Son ami !… Cette fois tout était fini, et par sa faute ! Quelle stupidité de ne pas avoir prévenu la police dès l’instant où il avait reconnu Tamar. Tout ça parce qu’il craignait qu’une arrivée massive ne précipite la fin d’Aldo… et aussi parce que, attaché à leur pacte d’autrefois, il se croyait assez fort pour le sortir de ce piège trop bien monté !
Cependant son léger signe de douleur ramenait l’attention d’Agalar sur lui, débarrassé de la lanière de cuir mais toujours à plat ventre sous le pied du Mongol qui lui maintenait la nuque à terre.
– Ça fait mal, hein, de perdre de bons compagnons, éructa-t-il. Seulement moi aussi j’en ai perdu et j’ai bien l’intention de vous faire payer le prix fort…
– Si c’est la mort que vous appelez le prix, vous faites erreur. Dès l’instant où mes amis sont morts, je n’ai plus guère envie de vivre. Alors allez-y ! Tuez-moi !
– Soyez sûr que je n’y manquerai pas, mais si vous pensez vous en tirer avec une balle dans la tête, vous faites erreur. La nuit est loin d’être achevée et nous avons tout notre temps ! En outre cette maison est suffisamment isolée pour que personne ne vous entende crier… Déshabillez-le attachez-le au pilier de l’escalier, vous autres. Quant à vous, mon cher, vous allez pouvoir apprécier avec quel art Timour peut découper un homme en lanières avec celle d’un fouet…
Un instant plus tard, l’archéologue était attaché solidement, le torse nu, à l’épais pilier de chêne dont ses bras faisaient à peine le tour…
CHAPITRE XI
OÙ LE MONDE SE MET À TOURNER À L’ENVERS
Tandis qu’on l’attachait à ce poteau de torture d’un nouveau genre d’où il ne devait pas sortir vivant, les idées d’Adalbert tournaient éperdument dans sa tête. Un léger, un très faible espoir venait d’y poindre du fait que le marquis croyait vides les maisons voisines, ce qui faisait grand honneur à la discrétion de La Tronchère. Pourtant il y était, lui, et aussi Karloff, dont le courage et l’esprit de décision ne faisaient aucun doute. Il fallait essayer de les alerter et, pour cela, sa seule chance – si l’on pouvait l’appeler ainsi dans une telle situation – était de hurler aussi fort que possible sous la torture qu’il allait subir.
Le premier coup de fouet lui fit comprendre qu’il n’aurait pas à se forcer. La dure lanière en cuir d’hippopotame, l’enveloppant d’une intolérable brûlure, lui arracha un cri, et le deuxième fut un véritable hurlement : le malheureux avait l’impression qu’on lui arrachait la peau du dos. Le ricanement d’Agalar le révolta :
– Comment osez-vous vous prétendre du sang de Napoléon alors que vous n’êtes qu’un fou criminel et sadique…
– N’oublie pas mon sang asiatique, pauvre imbécile ! Continue, Timour !
– Un jour… Un jour vous paierez vos…
Un troisième coup lui coupa la parole et la souffrance fut si rude qu’il faillit perdre connaissance et l’espéra… Que vienne la bienheureuse inconscience avant que le quatrième n’entame davantage sa chair ! Mais il était solide et il en fallait hélas plus pour qu’il s’évanouisse. Deux autres coups l’atteignirent sans obtenir ce résultat. Il ferma les yeux, attendant une recrudescence de souffrance, ouvrit la bouche… Un cri jaillit, mais ce n’était pas lui qui l’avait poussé, et le fouet ne s’abattit pas.
Tournant péniblement la tête il vit le Mongol tomber, un couteau dans la gorge. Un couteau qu’une main sûre venait de lancer de la porte arrière. En même temps des hommes vêtus de couleurs vives envahirent son champ de vision. L’un d’eux vint à lui pour trancher ses liens. Il se laissa glisser à terre et le spectacle qu’il eut sous les yeux lui parut relever du rêve, d’autant qu’un admirable contralto féminin se faisait entendre. Malheureusement il ne comprit pas les paroles car Masha Vassilievich s’adressait à Agalar en russe. Dressée en face de lui dans ses oripeaux rutilants, la grosse femme apostrophait le marquis avec une violence qui n’avait pas besoin d’interprète, tant elle exprimait la haine et le mépris. Médusé, celui ci l’écoutait sans faire le moindre geste pour l’écarter mais ce fut quand, à son tour, il cria qu’Adalbert comprit : elle venait de lui enfoncer dans la poitrine le poignard quelle tenait devant elle. Agalar tomba à ses pieds et elle leva le bras pour frapper encore.
– Non ! gémit Adalbert. Il faut qu’il parle ! Il faut qu’il dise où est Morosini…
Il essaya de se relever, ne réussit qu’à se mettre à genoux.
– Aidez-le donc, vous autres ! ordonna la tzigane. Vous voyez bien qu’il est plein de sang ! Soignez-le !… Mais toi, petit frère, tu as raison : il faut qu’il parle.
D’une seule main, elle empoigna Agalar par son vêtement pour le hisser jusqu’à ses genoux :
– Tu as entendu, assassin ? Où est le prince ?
– Je ne le dirai pas… Je sais que je vais… mourir mais il mourra aussi… plus lentement… voilà… tout !
Le poignard que Masha avait retiré de la blessure s’approcha de son œil droit :
– Tu parles ou je te fais sauter cet œil… puis l’autre ! Tu as tué mon frère, tu n’as aucune pitié à attendre de moi. Allons, parle, au moins pour sauver ton âme si c’est encore possible !
– Fais… ce que tu… veux ! Tu… tu n’auras pas le temps…
Il eut un spasme qui le rejeta en arrière. C’était la fin. Le comprenant, la tzigane le laissa retomber.
– Il faut pourtant que quelqu’un nous dise où il est !
Elle regarda autour d’elle, vit que l’Espagnol qui gardait Martin toujours inconscient était mort. Mort aussi Timour.
– Il y a les hommes que nous avons enfermé se souvint Adalbert. L’un dans une chaise à porteurs… L’autre là, dans le placard.
On les en tira mais Martin avait fait du trop beau travail : ils n’étaient plus que des corps sans vie…
– La femme ! s’exclama alors Adalbert. La Mongole ! Elle doit savoir…
– La femme aux chiens ? dit l’un des frères. Aliosha a tué les deux bêtes qui attaquaient un homme. Elle s’est enfuie.
– Et l’homme ? Comment est-il ?
– Amoché ! fit le tzigane qui n’ignorait apparemment rien des finesses de la langue française. Mais il s’en tirera !
– Je veux le voir !
À ce moment, Agalar, que l’on croyait bien mort cependant, ouvrit des yeux terrifiés. Une larme en coula et on l’entendit murmurer avec une horrible tristesse :
– Sur le salut… de mon âme ! Je… je n’ai pas tué le tzigane… ni l’Américain ! Ce n’est pas moi... Napoléon ! Pas moi !… Dieu… Dieu me pardonne !
Les yeux se fixèrent dans leur épouvante et le corps se raidit une dernière fois pour ne plus bouger. Cette fois c’était bien fini. Masha ferma les paupières d’une main qui tremblait un peu et se signa avant de murmurer avec un chagrin poignant :
– Devant la mort on ne ment plus !… Tout est à recommencer !
Elle se signa et se mit à prier.
– Pendant qu’il y était, sa contrition aurait pu lui inspirer de libérer Aldo ! s’écria Adalbert furieux. Il faut fouiller cette maison de la cave aux toits ! Il faut aussi retrouver Marie-Angéline ! ajouta-t-il, se souvenant de sa compagne de tout à l’heure.
– Vous allez surtout rester tranquille ! ordonna Masha. Je dois laver vos blessures…
– On les lavera plus tard ! fit Adalbert en réendossant sa chemise et sa veste. Occupez-vous des autres blessés ! lui dit-il en lui désignant Martin qui revenait lentement à la conscience et Théobald qu’Aliosha ramenait avec un bras enveloppé dans un torchon de cuisine.
Il devait souffrir beaucoup si l’on en jugeait par son visage pâle et crispé, mais il réussit à grimacer un sourire :
– Que Monsieur ne se tourmente pas !… Ça ira ! Mais il faudra que Monsieur cire ses souliers pendant un moment ! J’en demande bien pardon à Monsieur !
Adalbert se dirigea vers lui, le prit dans ses bras pour une chaude accolade :
– Ne dis pas de sottise ! C’est moi qui vais cirer les tiens.
Et il partit avec les quatre frères Vassilievich pour visiter chaque pièce de la maison qui n’en manquait pas. On allumait au fur et à mesure et bientôt la bâtisse brilla comme si une fête y était donnée, sans révéler la moindre trace de Morosini.
En revanche, Mlle du Plan-Crépin fut retrouvée presque par miracle dans l’un des clochetons du toit. On l’y avait bourrée comme un ballot de linge sale et elle pouvait à peine respirer mais, entendant du bruit, elle réussit à pousser des gémissements qui attirèrent l’attention d’Adalbert :
– Comment se fait-il qu’on ne vous ait ligotée ni bâillonnée ? s’étonna-t-il en l’aidant à regagner le grenier.
– Parce que vous trouvez que je n’en ai pas subi assez ?
Tandis qu’ils redescendaient vers le vestibule, elle lui raconta les derniers événements, mais elle eut un haut-le-corps en découvrant tant de cadavres sur le sol. Martin Walker, enfin ranimé, considérait lui aussi le carnage d’un œil désabusé, tout en fourrageant dans ses cheveux blonds. Sa tempe s’ornait à présent d’un hématome bleu gros comme un œuf de poule. Mais ses préoccupations étaient d’un ordre différent :
– Dire que j’ai manqué tout ça, moi ! Il va falloir m’expliquer… Toujours pas de Morosini ?
– Toujours pas ! On a retourné la maison entière sans relever la moindre trace.
– Qui est-ce ? demanda-t-il en désignant Marie-Angéline. Elle fait partie de la bande ?
– Non. C’est Mlle du Plan-Crépin, une cousine de Morosini. Elle a pris la place de Lisa au moment où celle-ci allait livrer la rançon et se livrer elle-même. Mais on vous le racontera plus tard ! Il faut…
– Prévenir le commissaire Langlois et un peu vite ! Au moins pour compter les cadavres et nous aider à fouiller le jardin.
– Vous pensez… qu’on l’y a enterré ? lâcha Adalbert la gorge serrée.
– Ce n’est pas à ça que je pense, fit Walker avec impatience. Réveillez-vous, mon vieux ! Avez-vous oublié ce que vous avez vu depuis la maison d’à côté ? La Tamar qui partait herboriser avec un pain et un seau, et qui revenait avec le seau vide.
– Comme je n’ai pas vu ce qu’il y avait dedans, j’ai pensé qu’elle allait jeter des ordures…
– … ou porter de la nourriture à quelqu’un ! Il doit bien y avoir des dépendances à cette foutue bicoque ?
– Vous avez raison ! Allons voir ! Mais quel malheur que cette damnée bonne femme ait réussi à s’enfuir ! Je vous jure qu’elle parlerait…
La voix paisible du colonel Karloff retentit soudain :
– Vous avez perdu quelque chose ?… Ça ne serait pas ça, par hasard ?
Ça, c’était Tamar qu’il menait en laisse comme un chien hargneux à l’aide d’une corde passée à son cou. Un autre bout lui liait les poignets dans le dos. Elle ne soufflait pas un mot et son visage plat suait la haine mais, quand elle vit son congénère étendu raide mort sur le sol, elle poussa un cri qui ressemblait à celui d’une louve, éclata en un déluge d’imprécations et de sanglots, voulut se jeter sur le corps mais Karloff la retint à l’écart :
– Si j’en crois ce qu’elle dit, c’était son homme, traduisit-il. Autrement dit, elle appartenait beaucoup plus à Agalar qu’à la pauvre Tania. Elle était chargée de la surveiller, tout simplement : la malheureuse aurait pu déménager autant qu’elle l’aurait voulu, dès l’instant qu’elle traînait ce boulet après elle…
– On la laissera pleurer tant qu’elle voudra quand elle nous aura dit où est Morosini ! coupa Adalbert. Demandez-lui où elle allait avec son seau et son pain l’autre jour ! Et avec un peu d’énergie, s’il vous plaît ! Sinon je m’en charge…
– Il vous faut un interprète : elle ne connaît que quelques phrases en français. Juste ce qu’il faut pour le service minimum d’une domestique.
Mais, sous le feu roulant des questions, la Mongole resta muette, ses lèvres serrées ne formant plus qu’une ligne mince dans son visage cireux. Pendant ce temps, les frères Vassilievich étaient allés explorer le parc à l’aide des lampes électriques dont pratiquement chacun s’était muni. Au bout d’un moment, Aliosha revint seul tandis que ses frères continuaient à battre le terrain :
– On n’a rien trouvé parce qu’il n’y a rien. Le jardin est composé d’une étendue d’herbe mal tenue, d’un petit bois et, derrière, d’une terrasse envahie par des broussailles qui domine d’assez haut une petite route… Mes frères cherchent encore, plus par acquit de conscience que pour autre chose. Le prisonnier n’est pas ici… et dans ce cas où chercher ?
Une véritable fureur s’empara d’Adalbert qui voulut se jeter sur Tamar en criant :
– Je vous jure qu’elle va parler ! Cette femme sait où il est. J’en suis sûr ! Et il faut qu’elle parle ! Il le faut ! sanglota-t-il, à bout de nerfs.
On la lui arracha, ce qui ne parut pas émouvoir Tamar plus que son attaque. Agenouillée près du corps de son époux et les mains toujours liées, elle avait entonné une sorte de mélopée murmurée, plus obsédante que les cris. Masha intervint alors : – Laissez-moi faire ! dit-elle calmement. Je crois savoir ce qu’il faut dire…
Elle s’agenouilla auprès de Tamar… et se mit à chanter.
Un frisson parcourut alors ceux qui l’écoutaient. Jamais sa voix n’avait été si chaude, si prenante. Pourtant le fil mélodique ne ressemblait en rien à ce qu’elle tissait d’habitude. Il y avait dedans quelque chose de plus sauvage, de plus héroïque et de plus désespéré à la fois…


