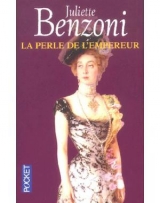
Текст книги "La Perle de l'Empereur"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Adalbert était en train de caresser la fière tête du dieu-faucon Horus quand il entendit bâiller. Presque aussitôt l’escalier grinça sous le pas pesant d’un homme qui vient de se réveiller, puis ce fut la porte de la cuisine qui grinça à son tour. Contrairement à ce qu’il pensait, La Tronchère était là mais il avait dû faire une longue grasse matinée. Il est vrai qu’il s’était couché fort tard.
Un sourire qui ressemblait à une grimace détendit le visage fatigué d’Adalbert qui mit la main à sa poche et tira son revolver : le petit déjeuner du voleur aurait du mal à passer… Pourtant, avant d’entrer dans la cuisine, il eut une autre idée : il alla à la fenêtre et arracha les cordons de tirage des doubles rideaux, les passa à son cou pour avoir les mains libres et reprit son chemin, s’arrêtant un instant pour écouter. Le bruit du moulin à café le renseigna sur ce que faisait La Tronchère. Alors il fit son entrée :
– J’espère que vous avez prévu large, mon cher confrère, fit-il aimablement. J’en prendrais bien une tasse !
La gueule noire de l’arme braquée démentait la bénignité des paroles et Fructueux La Tronchère accusa le coup : il émit une sorte de hoquet, leva des bras tremblants, écarta les genoux dans un réflexe machinal et laissa tomber le moulin dont le contenu se répandit sur le carrelage.
– Quel maladroit ! soupira Adalbert qui ajouta après un coup d’œil au paquet de café ouvert. Mais je crois qu’il n’y a pas à regretter : cette marque de café ne vaut pas grand-chose ! Et maintenant, cher ami, veuillez vous lever en gardant les bras en l’air et allez vous mettre face à ce grand placard.
L’autre obéit sans protester : visiblement il mourait de peur mais il trouva cependant la force de bafouiller
– Qu’est-ce… qu’est-ce que vous… me voulez ?
– Te mettre hors d’état de nuire, après quoi réglerons nos comptes…
Il palpa d’une main rapide le corps rondelet mais musclé de La Tronchère, qui était un faux gros trapu, explora les poches d’une attendrissante robe de chambre verte imprimée d’oiseaux roses, posa son revolver et, en quelques gestes prompts, saucissonna solidement sa capture qu’il ramena ensuite s’asseoir sur sa chaise. Puis, parodiant le baron Scarpia au second acte de la Tosca :
– Et maintenant causons d’amitié pure ! Je croyais vous avoir accordé une semaine pour me rapporter ce que vous m’avez volé. Or je m’aperçois que vous n’en preniez pas le chemin : mes biens décorent encore votre salon. Pas tous, d’ailleurs ! Il en manque…
– Il y en a là-haut, dans ma chambre, fit La Tronchère de mauvaise grâce. Et puis j’ai vendu deux ou trois pièces.
– Quoi ! Non seulement tu m’as pillé, s’écria Adalbert, renonçant définitivement à toute formule le politesse, mais en plus tu as osé vendre une partie de ton larcin ? Moi qui croyais que tu avais agi par pur amour de l’art ! C’est impardonnable !
– Oh, ce n’était pas de gaieté de cœur, mais je ne suis pas riche, moi ! Il faut que je vive et avec vous à mes trousses personne ne m’aurait employé !
Il oubliait peu à peu sa peur sous l’influence d’une colère qui finit par exploser :
– Et puis, après tout, je n’ai fait que prendre ce que vous aviez déjà volé ! Alors qu’allez-vous faire de moi ? Me livrer à la police ? Vous aurez du mal à expliquer votre position. Me tuer ?…
– Je ne suis pas un assassin… mais en ton honneur je pourrais peut-être me forcer, puis creuser un trou dans ton jardin. Je manie la pelle et la pioche comme un dieu !
– Vous n’allez pas faire ça ? Je n’ai tué personne…
– C’est vrai, concéda Adalbert. Mais avant de décider ce que je vais faire de toi, il faut que j’effectue un tour là-haut. Voir ce qui s’y trouve.
Remettant le revolver dans sa poche, il grimpa l’escalier en quelques enjambées, explora deux chambres qui n’avaient à lui offrir qu’un mobilier sans intérêt, puis une troisième qui était celle du maître si l’on en jugeait par le lit en désordre. Il n’y avait à cet endroit que deux objets, mais admirables : deux têtes de femme en bois polychrome de la XIIe dynastie où paraissaient encore des traces de peinture et qu’Adalbert aimait particulièrement. Posées sur des sellettes, elles faisaient face au lit, encadrant de leur splendeur une fenêtre qui n’en avait certainement jamais espéré autant. Adalbert eut une explosion de joie :
– Mes belles ! Quel idiot j’ai été de vous laisser dans ce trou perdu ! Mais je tenais tellement à vous garder pour moi seul !
Tout en débitant cette sorte de déclaration d’amour, il s’était approché de l’une d’elles et caressait sa noire chevelure quand, soudain quelque chose au-dehors attira son regard.
La fenêtre de cette chambre donnait sur le côté de la maison dominant le mur qui la séparait de la grande propriété voisine : une énorme bâtisse démodée qui avait dû voir le jour à la fin du siècle précédent. Elle était flanquée de tours, de clochetons biscornus et de balcons disposés de façon irrégulière. En fait, un vrai cauchemar mais un cauchemar mal entretenu : l’un des clochetons menaçait ruine, il y avait deux ou trois fenêtres brisées et l’herbe envahissait les allées de ce qui avait dû être un parc.
Ce n’était pourtant pas l’aspect bizarre de la grande « villa » qui avait attiré l’attention d’Adalbert, mais bien une grosse femme vêtue de noir, coiffée d’un fichu noir attaché sous le menton, qui sortait d’une porte de service et qui, tournant le coin de la maison, se dirigeait vers les profondeurs du jardin pour se dissoudre dans l’épaisseur des arbres. Or, cette femme, c’était Tamar, la Mongole, et elle était étrangement équipée d’un seau dans lequel il y avait quelque chose sous un chiffon.
Oubliant ses belles Égyptiennes, Adalbert dégringola l’escalier comme la foudre, sortit dans le jardin et se rua sur le mur de clôture qu’il escalada sur sa lancée, mais où il s’arrêta, un peu calmé, à l’abri de la grosse vague de clématites qui en couvrait une partie. Et où il s’aplatit. D’où il se trouvait il pouvait voir un homme vêtu de cuir, une sorte de colosse jaune qui faisait les cents pas derrière la maison. Un fusil à l’épaule, deux pistolets et un poignard à la ceinture, un autre dans ses bottes et pourquoi pas des grenades dans ses poches, cet homme devait avoir la puissance de feu d’un croiseur et Adalbert se demanda, tout juste un instant d’ailleurs, ce qu’il pouvait bien garder. La réponse lui sauta à l’esprit aussitôt : si c’était Aldo ? Il allait falloir voir ça de plus près mais à une heure moins claire.
Il se tapit plus étroitement dans ses clématites : la Mongole revenait et adressait quelques mots au garde dans une langue inconnue. Mais celui qui l’observait put remarquer que ses mains étaient dans les poches de son tablier et qu’elles étaient débarrassées du seau. Où avait-elle pu le laisser ?
Adalbert attendit qu’elle fût rentrée, descendit de son mur et partit rejoindre son prisonnier. Toujours ligoté sur sa chaise de cuisine, celui-ci n’avait pas bougé d’un pouce. Il semblait résigné à son sort mais n’en leva pas moins sur son vainqueur un regard plein de rancune :
– Qu’est-ce que vous allez faire de moi ? Je ne vais pas rester ficelé là toute ma vie ?
– On en parlera plus tard. Pour l’instant j’ai d’autres chats à fouetter…
– Mais c’est que j’ai faim !…
– Réponds d’abord à quelques questions. Les gens d’à côté, tu connais ?
– Quel côté ? fit l’autre avec une évidente mauvaise volonté.
– Pas à droite bien sûr, puisque c’est moi, ou plutôt c’était moi. À gauche, et si tu a aussi faim que ça, je te conseille de ne pas faire l’imbécile !
– Ce que vous pouvez être devenu grossier tout d’un coup, mon « cher confrère » ! Est-ce que je vous tutoie, moi ?
– Je ne fais que prendre un peu d’avance sur la police. Elle est très égalitaire dans ses relations…
– Parce que vous voulez appeler la police ? suffoqua La Tronchère. Vous n’avez pas peur de ce que je dirai ?
– T’occupe pas et réponds-moi ! Qui sont les gens d’à côté ? Cette fois ne fais pas le Jacques, il s’agit de meurtres… au pluriel !
– Dans ce cas… Eh bien, à vrai dire, je n’en sais pas grand-chose parce qu’il n’y a pas longtemps qu’ils sont là. Cette maison est restée vide pendant des années et, comme vous avez pu vous en apercevoir, elle commence à avoir besoin de réparations. Elle appartenait paraît-il à un grand-duc ou quelque chose d’approchant. On n’y voyait jamais âme qui vive mais, depuis quelques semaines, elle a repris un peu d’activité. Des gens s’y seraient installés. Pas trop difficiles sans doute, parce que la baraque ne doit pas manquer de courants d’air. Ça a excité ma curiosité et j’ai un petit peu observé. Une fois j’ai même aperçu celui qui doit être le propriétaire : un bel homme très brun avec de l’allure mais l’air mauvais. Il est arrivé dans une grande voiture noire…
– Une Renault ?
– Non. Une vraie belle voiture. Une Delage, je crois. Et avec un chauffeur. Il n’est resté que quelques heures puis il est reparti, mais il a laissé du monde là-dedans…
– Des domestiques chargés de remettre de l’ordre, peut-être ?
– Drôles de domestiques ! Je ne les ai jamais vus avec un balai ou un plumeau. Quand il ne pleuvait pas ils jouaient aux boules derrière la maison et, le reste du temps, quand une fenêtre s’ouvrait c’était pour faire partir les fumées de tabac.
– Il y a une femme avec eux ?
– Non. Tout au moins je ne l’ai jamais vue. Il est vrai, ajouta-t-il, que je viens d’être absent…
– C’est vrai. Vous êtes rentré cette nuit, fit Adalbert, revenant à un vouvoiement plus diplomatique.
– Ah ! Vous savez ça ?
– Je sais beaucoup de choses. En arrivant, vous vous êtes fait des œufs au plat. D’où veniez-vous ?
– De Londres. J’étais… j’étais allé vendre… une babiole.
– Quel genre de babiole ?
– Le… le petit scribe aux yeux d’émail de la XVIIIe dynastie, émit doucement La Tronchère, qui s’attendait à une réaction violente ; mais Adalbert ne broncha pas, ou si peu…
– On réglera ça plus tard ! Pour le moment je cherche un de mes amis qui a disparu depuis… des jours ! Je ne sais même plus combien et je commence à me demander si on ne l’a pas amené ici. Vous avez le téléphone ?
– Pour quoi faire ? Vous ne l’avez pas non plus vous, à côté ? Parce que vous n’aviez pas plus que moi envie de vous retrouver dans le Bottin. Pour téléphoner il faut aller à la poste…
– Bon. Alors j’y vais…
– Vous n’allez pas me laisser comme ça ? En robe de chambre et mourant de faim ? Je vous jure que je vous attendrai ! Et… et même que je vous aiderai parce que… chaparder de-ci de-là, passe encore… Mais un meurtre ! Ça non !…
Indécis, Adalbert considéra son prisonnier, sa figure poupine de bon vivant, son crâne chauve et son corps replet boudiné dans la robe de chambre verte et rose. Presque attendrissant !
– Qu’avez-vous à craindre ? reprit celui-ci. Que je me volatilise avec… avec ce qu’il y a ici ? Vous en avez pour une demi-heure à tout casser, et il m’a fallu deux nuits pour vous déménager ! En outre, je ne vois pas très bien où je pourrais aller. À part à Montauban, chez mon père, et ce n’est pas la porte à côté. Faites-moi un peu confiance ! Dans cette histoire je ne demande qu’à vous aider. Et même, tenez ! Pendant que vous allez téléphoner, je vais nous préparer à manger, parce que je suppose que vous n’allez pas rester là qu’un moment. Et j’ai à la cave quelques bocaux de confit d’oie que j’ai rapporté de chez moi… C’est… c’est à la police que vous voulez téléphoner ? conclut-il d’une toute petite voix.
– Non. À mon domicile ! Je dois faire venir de l’aide…
– Alors, déliez-moi, je vous en prie ! En m’habillant, je surveillerai un peu la maison d’à côté et je me mettrai en cuisine…
Il débordait d’une si évidente bonne volonté qu’Adalbert n’hésita plus. Prenant un couteau, il coupa les cordons de tirage, ce qui lui valut un grand sourire reconnaissant :
– C’était un peu serré, vous savez ? Et je n’ai pas une très bonne circulation… Vous êtes venu comment ? À pied ?
– Non. J’ai laissé ma voiture un peu plus loin.
– Si c’est la petite chose rouge qui fait tant de bruit, vous feriez mieux de la rentrer dans le jardin. Elle est un peu voyante. Je vais vous ouvrir la grille.
– D’accord, je la rentrerai en revenant…
Et Adalbert partit téléphoner tandis que La Tronchère, qui avait tout à coup l’air heureux comme un collégien, se précipitait vers sa cave avec un panier pour en rapporter les fameux pots auxquels, généreux, il ajouta une boîte de foie et deux bouteilles de vin. Il déposa le tout sur la table de la cuisine puis galopa au premier pour revêtir une tenue plus conforme à une nuit qu’il espérait passionnante. C’est très joli de veiller jour et nuit sur un trésor mal acquis – avec de loin en loin une escapade pour se procurer de l’argent –, mais à la longue on se lasse. Et Fructueux, fondamentalement sociable, commençait à entrevoir un agréable changement d’existence…
La nuit tombait.
En s’habillant, il jeta un coup d’œil à la maison voisine, vit qu’il y avait de la lumière dans les pièces de derrière mais aucun autre signe d’activité. Pensant qu’il avait mieux à faire, il redescendit à la cuisine, s’enveloppa d’un vaste tablier blanc et se mit à préparer le repas en chantonnant…
Dans la limousine noire qui l’avait cueillie au coin de la rue Rouget-de-l’Isle, « Mina » ne pensait à rien sinon à jouer de la meilleure façon son personnage. Elle ne voyait rien non plus, excepté l’homme qui lui tenait compagnie, car on avait tiré les rideaux sur les vitres, y compris celle de séparation avec le chauffeur. Celui-là devait être de bien belle humeur : elle l’entendait siffloter. Quant à son compagnon, il ne représentait guère qu’un amoncellement de vêtements : pardessus sombre à col relevé, chapeau mou à bords baissés et, entre les deux, une écharpe de couleur indécise remontant jusqu’aux yeux. Il n’avait pas dit un mot non plus, se contentant de récupérer sans douceur excessive la grosse serviette de cuir qu’il tenait à présent contre son cœur avec une sorte de tendresse. Il respirait lourdement avec, de temps en temps, un petit rire qui donnait la juste mesure de sa satisfaction. Celui-là devait entrevoir un avenir aussi brillant que les bijoux enfermés dans le sac. Sa prisonnière espéra sincèrement que cela lui donnerait l’envie de se laver plus souvent : il répandait une odeur de vieux tabac et de sueur que le balancement de la voiture n’arrangeait pas : c’était à vomir !
Incommodée, elle chercha dans les poches de son tailleur – on lui avait aussi pris son sac ! –, trouva un petit mouchoir qui avait été imprégné de parfum et le mit sous son nez pour en respirer l’odeur fraîche et boisée.
Le voyage dura environ trois quarts d’heure.
Vers la fin, le puant écarta légèrement le rideau de son côté puis, sortant un bandeau noir, ôta les lunettes de sa voisine, les glissa dans la poche de poitrine du tailleur – non sans vérifier au passage la fermeté d’un sein, ce qui lui valut une gifle qu’il évita – et noua solidement le bandeau à leur place.
La voiture quitta les pavés, tourna à droite roula sur des graviers qui semblaient présenter quelques aspérités et enfin s’immobilisa. La prisonnière – elle ne s’illusionnait guère sur son statut – en fut extraite par une main vigoureuse guidée jusqu’à un perron dont on lui fit gravir les marches puis, à travers un vestibule dallé, introduite enfin dans une pièce qui sentait très fort la poussière, un peu le moisi et dont le parquet dépourvu de tapis grinça sous ses pas. Là on lui enleva le bandeau et on lui remit ses lunettes. Elle vit alors qu’elle se trouvait dans une sorte de salon pourvu de rideaux de peluche rouge tirés devant les fenêtres, de quelques fauteuils disparates, d’un canapé, de deux guéridons et d’une table à usage de bureau. La lumière pauvre et triste tombait d’un lustre en bronze doré où seulement trois ampoules électriques sur six brûlaient. Derrière le bureau il y avait un homme mince, très brun et entièrement vêtu de noir dont le visage était caché sous un foulard blanc qui ne laissait voir que des yeux très sombres. Elle poussa un soupir et attendit.
L’homme au foulard blanc sortit de derrière la table, vint jusqu’à elle et, de deux gestes synchrones, ôta les lunettes et arracha la cloche de feutre gris. Aussitôt ses yeux noirs flambèrent de colère :
– Vous n’êtes pas la princesse Morosini ! gronda-t-il.
– Je n’ai jamais prétendu l’être, répondit-elle tranquillement. Je suis Mina Van Zelden, la secrétaire du prince…
– J’avais exigé que la princesse vienne elle-même !
– Elle serait venue bien volontiers mais, avec une jambe dans le plâtre et deux côtes cassées, ce n’est pas très commode. Il faudra vous contenter de moi… et de ce que je vous apporte ! fit-elle en désignant de sa main gantée la serviette que le puant avait l’air de bercer.
Sans mot dire, l’homme au foulard enleva la lourde sacoche de cuir, la posa sur la table et entreprit de l’inventorier. Les sacs de peau révélèrent l’un après l’autre leur contenu : une parure d’améthystes et de diamants ayant appartenu à la Grande Catherine, le ravissant bracelet de Mumtaz Mahal (13), deux colliers de diamants dont l’un avait orné – brièvement – le cou de Christine de Suède et l’autre celui de Mme de Pompadour, des pendants d’oreilles de toutes sortes et de différentes provenances, d’autres bracelets, des bijoux destinés à épingler un chapeau, des perles aussi quand elles étaient associées à des pierres précieuses, et puis des bijoux plus modernes mais somptueux, ceux qui appartenaient à Lisa Morosini. Bientôt s’amoncela sur la table un tas scintillant qui s’emplit de fulgurances quand l’homme alluma au-dessus une forte lampe de bureau.
Il les caressait avec une avidité que « Mina» jugea écœurante. Il en prenait un, le reposait, en prenait un autre, revenant au premier comme s’il s’agissait pour lui de choisir. Une femme chez un bijoutier devait se conduire de cette façon-là.
– Vous êtes satisfait ? reprit la voix brève de « Mina ». Alors maintenant rendez-moi mon patron !
L’homme s’arracha à sa contemplation et vint vers elle en faisant tourner autour de son index un bracelet d’opales et de diamants qui avait appartenu à l’impératrice Joséphine :
– Désolé, mais je n’ai que la moitié de ce que j’ai demandé. La collection est là et je vous remercie de me l’avoir apportée, mais je veux aussi la princesse…
– Mais je vous ai dit que…
– Qu’elle est clouée au lit pour quelque temps. Eh bien j’attendrai !… Lui aussi d’ailleurs, ajouta-t-il avec une intonation haineuse qui fit frissonner la fausse secrétaire. Évidemment, dans la position qui est la sienne, il vaudrait mieux que sa femme guérisse vite. Si solide qu’il soit, un organisme humain peut toujours flancher mais, étant donné la preuve de bonne volonté que l’on vient de me donner, je ne mettrai pas à exécution ma menace de diminuer la nourriture en proportion du temps écoulé.
– Je veux le voir !
– Cela ne me paraît pas indispensable. Je tiens à ménager votre sensibilité, ma chère. Je ne l’ai pas vu depuis un moment mais il ne doit pas être agréable à contempler… Alors, voilà ce que nous allons faire : le prochain train pour Venise part…
Il alla chercher un indicateur des Chemins de fer et le feuilleta jusqu’à ce qu’il ait trouvé ce qu’il cherchait :
– Voilà ! Il part demain soir de la gare de Lyon. Alors, en attendant, nous allons vous garder ici afin que vous puissiez prendre quelque repos et demain nous vous ramènerons à la gare et resterons avec vous… ou plutôt quelqu’un vous accompagnera jusqu’à Venise : une femme, soyez tranquille, et qui nous est toute dévouée. Elle pourra ainsi veiller aussi sur la princesse quand ses médecins lui permettront le voyage. Que pensez-vous de cet arrangement ?
– Que vous êtes un homme malhonnête et un monstre !
Il haussa les épaules avec un petit rire méchant :
– Mais non, je suis très humain ! Ainsi, félicitez-vous d’être aussi laide, sinon je vous aurais peut-être proposé une façon plus agréable de passer le temps… Timour ! appela-t-il en élevant la voix et en frappant dans ses mains.
Ce qui fit apparaître un personnage inattendu : un petit homme trapu aussi large que haut avec un cou de taureau et un faciès résolument mongol. Il n’était pas grand mais sa force devait être redoutable. L’homme au foulard lui désigna « Mina » en lui donnant un ordre dans une langue inconnue.
Le Timour en question approuva de la tête et coinça aussitôt un bras de la fausse secrétaire dans une poigne qui lui donna l’impression d’être prise dans un étau. Impossible de se dégager de cette pince-là !
– Dormez bien, ma chère ! dit l’homme au foulard. Nous nous reverrons demain, avant votre départ ! En attendant, soyez tranquille, on vous apportera de quoi ne pas mourir de faim… Vous m’avez apporté de trop belles choses pour que je lésine sur votre nourriture !
Resté seul, il retourna vers la table, ôta son foulard et plongea ses longues mains avides dans la masse scintillante… Son regard noir brûlait de tous les feux de l’enfer.
Il était plus de dix heures du soir quand le taxi du colonel Karloff pénétra tous feux éteints et avec une sage lenteur dans le petit jardin de La Tronchère. Adalbert, qui ne tenait plus en place, se précipita à la portière :
– Vous y avez mis le temps ! émit-il dans un souffle indigné. Qu’avez-vous bien pu fabriquer ?
– D’abord il a fallu qu’on me trouve, fit la voix de basse taille de l’ancien cosaque. Et ne rouspète pas ! On a fait aussi vite qu’on a pu !
– On a perdu beaucoup de temps en cherchant Romuald, renchérit Théobald. Et malheureusement on ne l’a pas trouvé !
– Il est parti où, celui-là ? En vacances ? Chez sa mère malade ? En reportage ?
– Ça, c’est moi que ça vise ! dit Martin Walker qui sortait du taxi par la portière opposée. Il est vrai que je vous dois un tas d’excuses.
– Ce n’est pas à moi que vous les devez ! gronda Adalbert. D’où sortez-vous ?
– De chez vous dans l’immédiat et avant de chez le commissaire Langlois. Mais est-ce que cette conférence ne pourrait pas se tenir à l’intérieur ? Il fait frisquet !
Adalbert approuva d’un signe de tête et l’on entra dans la maison au seuil de laquelle attendait La Tronchère. Chemin faisant, Théobald expliquait :
– M. Walker était chez nous quand Monsieur a téléphoné. Il a tenu absolument à m’accompagner et, comme je ne trouvais toujours pas mon frère, j’ai pensé qu’un homme jeune et sportif comme lui pouvait être utile.
– Tu as bien fait. Pouvez-vous me dire, vous, pourquoi vous avez disparu au moment où l’on avait réellement besoin de vous ? Grâce à vous Morosini est accusé d’un meurtre horrible et tous vos confrères l’ont traîné dans la boue.
– Mon excuse est que j’ignorais la mort de la comtesse. J’ai reçu tôt le matin une nouvelle qui pouvait nous donner une piste…
– En Pologne ? C’était peut-être un peu loin ?
– Pour découvrir un assassin on ne va jamais trop loin. On m’a prévenu que l’on venait de découvrir à Varsovie des manuscrits de Napoléon Ier et qu’ils allaient être vendus aux enchères. J’ai pensé que notre Napoléon à nous n’y résisterait pas et que j’avais une chance de le pincer là-bas. Alors je suis parti…
– Et qu’avez-vous trouvé ?
– Rien. À la réflexion, le gouvernement polonais a interdit la vente au dernier moment. Alors je suis rentré et, comme j’avais pu me procurer un ou deux journaux français, je me suis précipité au quai des Orfèvres pour raconter notre nuit.
– On vous a cru, j’espère ?
– Oh oui ! J’ai tout de même écopé d’une engueulade : Langlois était furieux que je ne me sois pas manifesté plus tôt. Comme vous ! Enfin demain, la Presse entière rendra justice à votre ami. Et moi, je vous offre mes excuses bien sincères. Comme je les lui offrirai quand on le retrouvera…
Le jeune homme était visiblement ému et bourrelé de remords. Adalbert lui tendit une main et de l’autre, lui assena une tape sur l’épaule.
– À condition qu’on le retrouve vivant ! Je suis presque persuadé qu’il est ici…
– Racontez !
Les cinq hommes étaient à présent réunis dans le salon si étrangement orné de merveilles pharaoniques dont la vue avait soulevé jusqu’au milieu du front les sourcils broussailleux du journaliste :
– Nous sommes chez un de vos confrères ?
– En quelque sorte. J’ajoute que de la fenêtre du premier étage nous avons vu arriver une voiture qui s’est arrêtée derrière la maison avant de se rendre au garage. Tout était éteint mais il nous a semblé qu’il y avait dedans une femme…
– Ils sont nombreux là-dedans ?
– Aucune idée ! Il y a au moins les deux hommes qui viennent d’arriver et dont j’ignore si l’un deux est notre Napoléon, il doit y en avoir deux autres puisque notre hôte ici présent en a vu quatre jouer aux boules. Sans compter notre amie Tamar qui est aussi costaude qu’un mâle, si ce n’est plus… Vous n’avez pas prévenu la police ?
– Bien sûr que non. D’abord nous ne sommes pas certains d’avoir trouvé l’endroit où est détenu le prince, ensuite, s’il y est, l’apparition d’uniformes pourrait signifier sa mort… On y va ?
– Venez d’abord au premier pour reconnaître le terrain.
Dans la chambre obscure ils observèrent un moment la maison voisine, et ce qu’ils virent n’était pas réjouissant. La voiture avait été rentrée au garage mais il y avait un homme armé en sentinelle aux deux entrées, celle du perron et celle de l’arrière, et pour les atteindre il fallait avancer en terrain découvert.
– Il faudrait pourtant entrer là-dedans, fit Walker.
– Il y a une solution, dit tranquillement Adalbert. Par le toit !
– Ce hérissement de clochetons, de créneaux et de pentes ardoisées ? Vous êtes fou !
– Clochetons ou pentes ardoisées ont des petites fenêtres ou des lucarnes, donnant sur des greniers en général. Jamais fait d’alpinisme ?
– Jamais, non. J’ai le vertige !
– Gênant ça ! Moi si ! J’ai commencé avec les Pyramides et la Vallée des Rois.
Il n’ajouta pas que, lorsqu’il travaillait pour le Deuxième Bureau, il lui était arrivé de grimper le long de bâtiments tout aussi rébarbatifs. Et même plus ! Dire qu’il y avait des gens pour dire du mal du style « troubadour » ! Escalader cette horreur tarabiscotée ne devait pas être au-dessus de ses moyens.
– On va se partager le travail ! Moi je grimpe là-haut et vous vous postez dans les fusains que vous voyez là-bas, de façon à surveiller la sentinelle de l’arrière. Quant à Théobald il va rester sur le mur pour garder l’échelle que je vais demander, la tenir à disposition et faire le guet.
– Et moi, grogna Karloff, je ne fais rien ?
– Vous tenez compagnie à notre hôte et vous gardez votre taxi prêt à démarrer au cas où il faudrait prendre le large. Et maintenant, Messieurs au travail ! La Tronchère, trouvez-moi une échelle !
L’échelle servit à franchir le mur mitoyen à peu près à égale distance des angles de la maison, de façon à être hors de vue des gardiens. Adalbert passa le premier, sauta à terre sans faire le moindre bruit. Martin le suivit courageusement étant donné sa tendance au vertige et, pour le combattre, se laissa tomber bravement les yeux fermés. Théobald ferma la marche plus calmement en prenant soin de tirer l’échelle côté La Tronchère. Après quoi chacun s’en alla, en prenant mille précautions et sur la pointe des pieds, vers l’objectif qui lui était assigné. Du haut du mur, Adalbert avait déjà examiné le versant de la maison qu’il voulait escalader, repéré au-dessus des grosses pierres en relief qui formaient la base, ici une corniche, là un balcon, qui lui simplifieraient la tâche, sans compter un superbe tuyau de descente des eaux. Mais, une fois à pied d’œuvre, il vit les choses autrement et se demanda si ce serait aussi facile qu’il l’avait imaginé. Pourtant un atout supplémentaire se présentait : au second étage – le premier était très élevé – une tourelle vitrée venait de s’allumer. Elle lui éclairait du même coup le chemin. Après avoir enfilé des gants de daim qui protégeraient ses doigts, il s’élança à l’assaut de la maison.
Le début fut encourageant : les parpaings de la base se montrèrent conciliants et le grimpeur atteignit sans difficultés majeures le premier balcon d’une large fenêtre obscure qui devait donner sur une pièce de réception quelconque, mais au-dessus le mur était lisse en dépit des tarabiscotages prétendument médiévaux qui ornaient ladite fenêtre. Heureusement, il découvrit une haute colonne proche du tuyau de descente, destinée sans doute à le rendre moins laid en l’aidant à se fondre dans l’ensemble. Alors il enjamba la colonne, s’arc-bouta entre les deux « ornements » et, conscient qu’un faux mouvement pouvait le précipiter à terre, il reprit son ascension. Elle se fit plus lente, plus pénible aussi parce que la peur s’y mêlait. Il devait choisir soigneusement les points d’appui de ses mains et de ses pieds. Il eut l’impression que cela allait durer l’éternité avant d’atteindre le second balcon orné de trèfles évidés comme sur les rambardes de Notre-Dame de Paris. Il voyait de mieux en mieux à mesure qu’il approchait de la tourelle éclairée mais cet avantage présentait l’inconvénient qu’il devenait, de ce fait, beaucoup plus visible. Enfin son calvaire prit fin. Il atteignit la corniche où reposait le petit balcon et s’y laissa tomber avec un soupir de soulagement. Le plus dur était fait. Atteindre le toit n’occasionnerait guère de difficultés grâce à la surabondance de galbes, de pignons, de sculptures dont certaines n’avaient d’ailleurs pas grand-chose à voir avec le Moyen Âge : tel l’angelot joufflu qui le regardait en rigolant et en agitant une trompette. Il se trouvait à présent à la hauteur de la tourelle – plutôt une échauguette en forme de lanterne – bâtie en surplomb et dont le séparait seulement quelque deux mètres de corniche.
Reposé, il allait reprendre son ascension quand il aperçut une silhouette de femme : celle qui était arrivée tout à l’heure sans doute et qui, maintenant, jetait un coup d’œil à l’extérieur, essayait d’ouvrir la fenêtre de façade puis, n’y parvenant pas, reculait dans la pièce avec un haussement d’épaules découragé.
D’où il était, Adalbert la distinguait mal, surtout à cause de la saleté qui couvrait les carreaux, mais dans cette silhouette entrevue, quelque chose accrocha son attention et il pensa que cette femme était peut-être prisonnière. Le mieux étant, selon lui, d’y aller voir, il enjamba le balcon et, le dos au vide, progressa sur la corniche. Il atteignit celui des trois panneaux vitrés qui était le plus proche de lui, nettoya un morceau de carreau avec son mouchoir et, en se tordant le cou, réussit à voir l’intérieur de la chambre. Ce qu’il vit alors le sidéra tellement qu’il faillit dégringoler en bas de la maison. C’était bien une femme qui était assise là, presque en face de lui, dans un fauteuil et une attitude découragée, mais cette femme c’était Marie-Angéline du Plan-Crépin.


