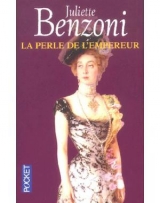
Текст книги "La Perle de l'Empereur"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
– Qu’est-ce que vous voulez ? grogna-t-il en laissant lentement retomber ses bras levés.
– Que tu laisses tes mains là où elles sont pour commencer ! fit Karloff qui, à la surprise de son compagnon, poursuivit en russe et reçut une réponse dans cette langue.
– Qu’est-ce qui vous prend de parler russe ? protesta Adalbert.
– Parce que c’en est un. Je peux même vous dire qu’il vient de l’Oural. J’ai reconnu l’accent… Mais ce n’est pas étonnant puisque ce Napoléon de pacotille est russe lui aussi. Celui-là s’appelle Boris Karaghian, travaille au champ de courses et ne comprend pas ce qu’on lui veut.
– C’est simple : pourtant rien que l’adresse de ton patron, mon gros ! Moyennant quoi on ne te fera aucun mal, poursuivit Adalbert en agitant son arme sous le nez de l’homme. Qui se mit à rire à gorge déployée avant de libérer un nouveau flot de paroles dans la langue de Pouchkine.
– Restez avec lui ! dit Adalbert. Moi je vais visiter la maison. Cela me donnera peut-être une idée de l’endroit où se trouve Morosini. Il ne doit pas y avoir beaucoup de cachettes dans une petite baraque comme ça.
– Allez-y ! Nous, on va continuer à causer…
Quand il s’agissait d’inventorier un lieu quelconque, Vidal-Pellicorne en aurait remontré à un policier. Il fouilla d’abord la chambre voisine où quelqu’un devait habiter, puis le cabinet de toilette, descendit au rez-de-chaussée où une assez grande pièce et une cuisine tenaient toute la surface, descendit à la cave, n’y trouva que des bouteilles de bière, vides ou pleines, ressortit, fit le tour de maison, puis remonta avec un soupir en espérant que le colonel aurait obtenu un meilleur résultat… Un coup de feu alors éclata, aussitôt suivi par la ruée dans l’escalier d’une sorte de rouleau compresseur qui envoya Adalbert au bas des marches à demi assommé. Puis il y eut le claquement de la porte et le bruit d’un moteur mais, à cet instant, un second boulet de canon passa dans l’escalier, suivi du même bruit de porte claquée et du démarrage d’un second moteur…
Encore étourdi, Adalbert s’assit sur la dernière marche pour essayer de retrouver ses esprits. Il n’eut d’ailleurs guère de peine à reconstituer ce qui venait de se passer : Boris avait dû échapper au colonel qui à présent s’était lancé à sa poursuite sans plus s’occuper de lui. Il ne lui en fit aucun reproche : lui-même en aurait fait autant, mais maintenant il allait falloir rentrer à Paris par ses propres moyens. Heureusement la gare n’était pas loin…
Adalbert se releva, frictionna ses reins endoloris et se rendit à la cuisine pour boire un verre d’eau et voir s’il n’y aurait pas moyen de se faire une tasse de café : le premier train ne passerait sûrement pas avant deux bonnes heures.
Il trouva ce qu’il cherchait et mit de l’eau à chauffer sur le réchaud à gaz tandis qu’il actionnait le moulin à café coincé entre ses genoux, tout en s’efforçant de vider son cerveau afin de pouvoir y réintroduire des idées claires. Puis, tandis que le café passait en répandant une bonne odeur – on peut être un truand et aimer les produits de qualité ! – il passa une nouvelle inspection de la maison sans en apprendre davantage. Il venait juste de s’installer devant un bol fumant quand une voiture s’arrêta. Adalbert n’eut besoin que de tendre le cou pour voir qu’il s’agissait de son taxi et l’instant suivant le colonel Karloff débouchait dans la cuisine et se figeait devant le spectacle qu’il découvrait :
– Ne me dites pas que vous vous installez dans cette turne ?
– Je ne m’installe pas : j’attends l’heure du train parce que je pensais ne plus vous revoir. Vous en voulez ? ajouta-t-il en allant chercher un autre bol sans attendre la réponse. Si vous me disiez ce qui c’est passé ?
– Il s’est passé qu’on aurait dû ligoter ce type, maugréa Karloff en s’asseyant en face de lui. Et encore, je ne suis pas certain que cela aurait suffi : c’est une force de la nature ! Il a commencé par répondre à mes questions. De mauvaise grâce, mais enfin il répondait, quand soudain il s’est jeté sur moi. J’ai alors tiré et je l’ai blessé, car j’ai entendu un gémissement, mais il n’a eu aucune peine à m’aplatir. Vous savez la suite. À l’exception du fait que je lui ai couru après et qu’il m’a semé avant Versailles.
– Qu’avez-vous appris ?
– Pas grand-chose. Il s’est obstiné à répéter qu’il travaille au champ de courses, qu’il ignore tout de Napoléon – même le premier du nom – et que le copain avec qui il vit est en ce moment à l’hôpital pour avoir pris un coup de pied de cheval. Et vous à part le café, vous avez trouvé quelque chose ?
– Encore moins que vous ! Sauf si Morosini est enterré dans ce bout de jardin, il n’y a ici aucun endroit pour le cacher. On aurait pu s’en douter d’ailleurs. S’il est prisonnier il doit être bien gardé… Seigneur ! C’est à devenir fou ! Il y a des moments où je commence à croire qu’on me l’a tué ! fit-il d’une voix soudain enrouée en écrasant ses yeux sous ses poings.
Karloff laissa passer l’instant d’émotion en se contentant de reverser un peu de café dans le bol vide de son compagnon ; il y ajouta une giclée de calvados sortie d’une fiasque d’argent qu’il gardait toujours sur lui et qui devait être une précieuse relique de son ancienne splendeur. Puis s’en adjugea une lampée avant d’émettre :
– Ça ne sert à rien ni à personne de se démoraliser ! Ce qu’il faut, c’est agir… Jusqu’au bout. Même si au bout il y a le pire ! Alors écoutez-moi !
Libérant ses yeux rougis, Adalbert avala le breuvage avec un plaisir qui ramena une petite étincelle dans ses prunelles.
– Allez-y ! J’écoute.
– Si vous voulez m’en croire, on a assez joué aux petits soldats tous les deux. Il faut dire ce qu’on sait à la police et cesser de protéger cette Marie Raspoutine parce que je crois sincèrement qu’elle se moque du monde : elle est bel et bien la complice d’un assassin sans scrupules et pas la pauvre victime qu’on voudrait nous faire croire… Ce qu’il faut, à présent, ce sont les moyens d’investigation de la police ! Et tant pis pour les pots cassés !
– Même si l’un de ces pots est Morosini ?
– Tâchez de savoir ce que vous voulez ! Il y a deux minutes vous pleuriez sa mort… De toute façon, si vous ne parlez pas, moi je parlerai. On y va ?
– On y va !
Une heure plus tard le taxi s’arrêtait devant les portes en fer du Quai des Orfèvres.
À l’évidence le commissaire Langlois ne s’était pas couché cette nuit-là. Une grisaille de barbe ombrait son visage toujours si bien rasé et son humeur était exécrable. Les deux compères en firent les frais.
– Et c’est maintenant que vous venez me dire ça ? tonna-t-il en s’adressant particulièrement à Adalbert. Vous espériez quoi en vous lançant dans vos investigations solitaires sans m’en parler ? Démontrer que vous êtes les plus forts ?
– Bien sûr que non, mais essayez de comprendre, commissaire ! Morosini et moi avons déjà couru ensemble tant d’aventures plus ou moins dangereuses que nous avons pris l’habitude de compter avant tout sur nous-mêmes. Dans certains cas, il peut être prématuré de mêler la police à des histoires…
– … beaucoup trop délicates pour sa cervelle obtuse ? Je sais que c’est en général l’opinion que l’on a de nous, mais avouez que, lorsque les principaux témoins restent aussi muets que des carpes, ou des coupables, il y a de quoi sortir de ses gonds ! Je me demande ce qui me retient de vous coffrer tous les deux pour dissimulation de faits majeurs.
– Peut-être la pensée que ça ne vous servirait pas à grand-chose de nous mettre sous les verrous. Surtout le colonel Karloff ! S’il se trouve mêle cette histoire, c’est parce que je loue ses services de son taxi.
– Hé là, doucement ! protesta celui-ci. C’est bien gentil à vous de me mettre hors de cause mais je revendique ma part ! Pour le tsar et pour l’honneur de la Russie ! ajouta-t-il d’une voix forte en faisant le geste de brandir un sabre comme s’il chargeait à la tête de son régiment.
– Qu’est-ce que le tsar vient faire là-dedans grogna Langlois.
– Où qu’il soit, il est toujours notre père et nous, ses enfants, devons être dignes de lui, fit le vieil homme avec une immense dignité. J’entends démontrer à ce pays qui nous donne asile que nous ne sommes pas tous des terroristes ou des mendiants ! Et moi j’ai le droit d’avoir d’autres aspirations que celles d’un simple chauffeur de taxi !
Le commissaire ne répondit pas. Quant à Adalbert, il eût volontiers applaudi mais la porte s’ouvrit sous la main d’un jeune inspecteur aux joues rouges et à la moustache tombante qui apportait avec lui l’air vif du matin et une mauvaise nouvelle : la descente de police effectuée boulevard Rochechouart pour appréhender Mme Solovieff et l’homme qui la protégeait venait d’échouer lamentablement : en dépit de son pied foulé, la danseuse l’avait levé en compagnie de sa petite famille. La veille au soir, une grosse Renault noire était venue la prendre et tout le monde était parti sans oublier d’emporter les valises. D’après la concierge elle partait pour une tournée…
– Tournée ? Mon œil ! vociféra Langlois. Depuis quand va-t-on danser à cloche-pied ? On l’a mise à l’abri quelque part, oui !
– Et peut-être pas très loin ? avança Adalbert. Ce départ explique que la voiture soit rentrée plus tard que de coutume à Saint-Cloud. Sa Majesté a déménagé sa favorite. Reste à savoir où il l’a mise.
– Soyez sûr que nous nous y employons ! On va surveiller la maison de Rochechouart et celle de Saint-Cloud, rendre une petite visite à l’homme au coup de pied de cheval et tâcher de retrouver la voiture… si vous voulez bien nous confier son numéro. Car vous avez bien pensé à le relever, n’est-ce pas, messieurs ? fit le commissaire avec une douceur aussi suspecte qu’inattendue.
– Vous nous prenez vraiment pour des apprentis, ronchonna Karloff. Vous l’avez déjà puisque c’est la même voiture qu’on a suivie dans la nuit de Saint-Ouen, le prince Morosini et moi.
– J’aime qu’on me répète les choses ! Évidemment, si par hasard vous l’aviez oublié…
– Pas du tout !
Et Karloff donna le numéro de la Renault noire du ton dont il eût déclaré la guerre. Mais Adalbert avait encore quelque chose à dire :
– À propos de cette Marie Raspoutine, il paraît qu’elle a intenté un procès au prince Youssoupoff. Comme c’est important, il va lui falloir donner quelques nouvelles à son avocat. C’est…
– Maître Maurice Garçon ! aboya Langlois. J’y ai déjà pensé, figurez-vous, et soyez sûr que je prendrai contact avec lui. Seulement il n’est pas Paris actuellement : il plaide à Aix-en-Provence.
– C’est fou ce que les gens dont on pourrait avoir besoin éprouvent, eux, le besoin de changer d’air en ce moment ! soupira Adalbert découragé. Toujours pas de nouvelles de Martin Walker, bien entendu ?
– Si ! Son rédacteur en chef en a reçu. Il est à Varsovie.
– Pas plus loin ? Quelle chance ! Et qu’est-ce qu’il fait là-bas ?
– Secret professionnel ! Mais il ne devrait plus tarder à rentrer.
– Merveilleux ! Quand on retrouvera le cadavre de Morosini, il sera peut-être reconnu innocent. En attendant…
Brusquement, Georges Langlois abandonna son humeur noire et sa raideur officielle pour venir s’asseoir à côté d’Adalbert.
– Allons, ne désespérez pas ! Si cela peut vous aider, je suis à peu près persuadé qu’il n’a pas commis ce crime. C’est pourquoi je vous en veux de m’avoir caché des faits si importants. Pour bien faire mon travail j’ai besoin d’en savoir le plus possible. Vous comprenez ?
Adalbert fit signe que oui, mais ajouta :
– C’est bien soudain, cette idée d’innocence. D’où la sortez-vous ? De chez le maharadjah d’Alwar ?
– Je n’ai pas ajouté foi une seule seconde à sa déposition. Il a de la sympathie pour votre ami et il a voulu l’aider, un point c’est tout ! Non, si j’ai changé d’avis c’est parce que la Mongole a disparu.
– Vous voulez dire la servante de Mme Abrasimoff ?
– Et accusatrice de Morosini. Elle a quitté la rue Greuze sans que personne s’en aperçoive. Pour quelle raison ? Mystère ! Aucune trace d’enlèvement ou d’une quelconque violence. Elle a dû partir sur ses pieds, par l’escalier de service et la petite porte. La concierge – que je soupçonne d’ailleurs de forcer un peu sur la bouteille les soirs de cafard… et peut-être les autres aussi ! – n’a rien vu, notre factionnaire pas davantage.
– Et le marquis d’Agalar ? Pas de traces non plus ?
– Aucune. Il est… en voyage, d’après son serviteur, mais ce type a été incapable de nous dire où.
– Il fallait le boucler, le cuisiner ! lança Adalbert hargneux. Cela l’aurait rendu plus loquace…
– Je ne dispose ni des brodequins ni du chevalet ! fit sèchement Langlois. En outre, jusqu’à présent aucune charge n’a été relevée contre cet homme ou contre son maître.
– C’est beau la légalité ! soupira Vidal-Pellicorne en se levant avec l’arrière-pensée d’aller rendre visite à cet intéressant personnage. Peut-être en compagnie de Théobald et de son jumeau ! Ce dernier surtout s’entendait comme personne à opérer des cures miraculeuses sur les muets les plus confirmés.
– Encore un instant ! dit le commissaire. Avant que vous ne partiez je voudrais vous poser une dernière question. Avez-vous des nouvelles de la princesse Morosini ?
– Non, et c’est de beaucoup ce que je préfère. Elle n’a pas appelé une seule fois son mari depuis sa disparition.
– Un peu de brouille ?
– Peut-être. Elle doit lui en vouloir de prolonger son séjour à Paris et s’attarde au fin fond de l’Autriche dans l’espoir qu’il se décidera à venir la chercher. Pour le moment c’est très bien ainsi. Je prie seulement pour que les journaux français ne soient pas allés jusqu’à elle. En revanche, ajouta-t-il après une légère hésitation, j’ai eu des nouvelles de Venise.
– Qu’y a-t-il à Venise ?
– Guy Buteau, le fondé de pouvoir de Morosini qui a été aussi son précepteur. Lui est au courant depuis plusieurs jours, et complètement affolé, mais j’ai obtenu qu’il garde son calme et continue veiller aux intérêts de la maison comme si de rien n’était. Et surtout sans parler de quoi que ce soit à Lisa…
– Lisa ?
– La princesse Morosini. L’amour qu’elle voue à son époux pourrait la porter à des gestes… irréfléchis !
– Lisa !… Joli nom, fit Langlois soudain rêveur.
– Et plus jolie femme encore ! J’entends la garder à l’écart de cette horreur le plus longtemps possible ! s’écria Adalbert. Puis, empoignant Karloff par le bras, il l’entraîna hors du bureau du commissaire en oubliant de dire au revoir…
À sept heures trente-cinq du matin – à peu près au moment où Adalbert et le colonel quittaient le quai des Orfèvres –, le Simplon-Express entrait en gare de Lyon et arrêtait son chapelet de wagons-lits au quai n° 7. Il était parti de Venise vingt-deux heures plus tôt mais la longueur du trajet ne semblait pas avoir fatigué les voyageurs : le train était luxueux et son confort sans défaut. Les bagagistes s’empressaient au service de ces gens élégants et fortunés, ou les deux, mais personne ne prêta vraiment attention à une mince jeune femme sans autre signe distinctif qu’une paire de lunettes à verres épais. Elle portait, sous un cache-poussière de couleur neutre, un tailleur sévère dont la jupe descendait au-dessous du mollet et dont la jaquette évoquait vaguement la forme d’un cornet de frites. Une cloche en feutre gris emprisonnait ses cheveux dont pas un n’était visible. Des gants de cuir noir et des richelieus bien cirés complétaient son costume, et elle tenait dans ses mains une valise de taille moyenne et une grosse serviette de cuir.
Elle traversa la foule sans prêter attention à quiconque, sortit sous la verrière, héla un taxi et lui ordonna de la conduire à l’hôtel Continental, rue de Castiglione.
Arrivée à destination, elle ne parut pas s’apercevoir du regard vaguement dédaigneux du voiturier qui lui ouvrit la portière et lui commanda, sèchement, de prendre ses bagages.
À la réception, elle demanda une chambre pour une durée indéterminée sans se soucier de l’œil inquisiteur du préposé, mais sur un ton qui n’admettait pas de réplique. Après quoi, elle ôta ses gants et tira de son sac de cuir noir un stylo pour rédiger calmement sa fiche d’hôtel, puis se détourna et suivit le groom que le réceptionniste venait d’appeler d’un signe de la main. Ce fut seulement quand la voyageuse eut disparu dans l’ascenseur que celui-ci donna libre cours à sa curiosité. La petite fiche de papier ivoire annonçait : Mina Van Zelden. Secrétaire. Venant de Venise…
CHAPITRE X
DANS LA GUEULE DU LOUP
Parvenue dans sa chambre dont les fenêtres donnaient sur le jardin des Tuileries, la voyageuse en ouvrit une pour respirer un moment l’air joyeusement ensoleillé du matin puis défit sa valise, rangea ses vêtements, gardant seulement une rechange de linge, sonna pour demander qu’on lui serve un petit déjeuner, fit couler un bain et alla s’enfermer dans la salle de bains.
Quand elle revint enveloppée dans un peignoir en tissu éponge, son reflet dans le miroir ancien placé au-dessus d’une console la saisit et elle resta là un instant à se regarder, ce à quoi elle s’était refusée en faisant sa toilette. Elle eut peine à se reconnaître. Elle était si pâle que ses yeux ressemblaient à des trous d’ombre. Plus pâle peut-être à cause de ses cheveux bruns qu’elle venait de libérer du bonnet de caoutchouc. Et puis ce pli amer au coin de la bouche… Mais était-ce vraiment le temps de s’apitoyer sur elle-même ?
Brusquement elle tourna le dos à la déplaisante image et s’installa devant la table qu’on lui avait servie pendant son bain. Elle n’avait pas vraiment faim mais elle savait qu’elle allait avoir besoin de forces. Et puis le café était bon et sa chaleur lui fit du bien.
Restaurée, elle se rhabilla, se recoiffa en bandeaux avec un chignon tordu sur la nuque, remit son chapeau, son manteau, ses grandes lunettes qui la rassuraient comme si elle portail un masque, prit son sac, l’épaisse serviette de cuir, sortit de sa chambre et quitta l’hôtel…
Elle n’alla pas loin : simplement jusqu’au bureau de poste de la rue de Castiglione où elle demanda un numéro de téléphone. Ses instructions spécifiaient qu’elle ne devait en aucun cas appeler de l’hôtel. Le numéro dépendait du standard Marcadet, mais elle ignorait dans quelle demeure il aboutissait et devait se contenter de demander Luis. Elle l’obtint d’ailleurs presque aussitôt et le dialogue s’engagea :
– Vous venez d’arriver ? demanda une voix masculine à l’accent ibérique.
– Oui.
– Où êtes-vous descendue ?
– Hôtel Continental, rue de…
– Je sais où c’est. Sous quel nom ?
– Mina Van Zelden.
Elle entendit un ricanement désagréable :
– Vous n’auriez pas pu trouver plus simple ? Vous autres aristocrates, il vous faut toujours des noms à tiroirs…
– Je connais bien celui-là.
– Bon. Peu importe. Vous avez ce qu’on vous a demandé ?
– Oui.
– Tout y est ?
– Tout.
– Bien. Alors maintenant écoutez ! Vous allez rentrer à votre hôtel et y rester sans bouger jusqu’à ce soir. À neuf heures, vous sortirez sous les arcades de la rue de Rivoli en vous arrêtant au coin de la rue Rouget-de-l’Isle. Une voiture viendra vous prendre mais jusque-là vous ne communiquerez avec personne. Compris ?
– Si par personne vous entendez la police, soyez tranquille.
– Pas seulement ! Nous savons que vous connaissez du monde à Paris. Alors ne faites pas l’imbécile. Votre mari pourrait en pâtir : le moindre suspect à l’horizon et il ne revoit pas la lumière du jour.
– Comment va-t-il ?
– Comme on peut aller quand on est enchaîné au fond d’un trou avec un pain de quatre livres et un seau d’eau tous les deux jours. Il était temps que vous arriviez d’ailleurs, car on allait diminuer ses provisions de moitié. Vous allez le trouver changé !
De nouveau le ricanement pénible. Les doigts de la jeune femme se crispèrent sur l’appareil au point de blanchir aux jointures.
– C’est tout ce que vous avez à me dire ?
– Non. Comment êtes-vous habillée ? On a une belle photo de vous en robe du soir mais je suppose que vous ne vous baladez pas avec des kilomètres de satin blanc et une fortune en émeraudes ?
– Je porte un tailleur gris sous un cache-poussière, un chapeau de feutre gris… et des lunettes !
– Parfait. À ce soir… et tenez-vous tranquille hein ?
– Comme si j’avais le choix…
Elle raccrocha, paya sa communication et repris à pas lents le chemin de l’hôtel. Revenue dans sa chambre, elle s’adossa un instant à la porte refermée en laissant tomber la serviette et s’efforça de respirer à fond pour essayer de calmer les battements désordonnés de son cœur. Puis elle arracha son chapeau et se jeta sur le lit où elle éclata en sanglots désespérés. La tension subie depuis qu’elle avait reçu l’affreuse lettre était devenue intolérable, mais jusqu’à présent le bienfait des larmes lui avait été refusé. Or, si vaillante qu’elle fût, il y avait tout de même une limite à la résistance de Lisa Morosini…
Elle pleura longtemps mais, peu à peu, les sanglots, si douloureux au début, s’apaisèrent et l’épouse d’Aldo finit par sombrer dans un sommeil dont elle avait le plus grand besoin…
L’après-midi était avancé quand elle s’éveilla. Il y avait une éternité qu’elle n’avait aussi bien dormi et il lui fallut un moment pour réaliser où elle se trouvait, avant que la notion de ce qui s’était passé et de ce qui allait advenir ne lui revienne. Des jours de colère aboutissant à des jours d’angoisse pour en arriver à ce voyage dont elle ne savait trop comment il se terminerait…
La colère était venue quand, à Vienne, elle avait reçu ces lettres indignées de son cousin Gaspard Grindel qui dirigeait la succursale parisienne de la banque Kledermann. Il avait vu Aldo souper en tête à tête chez Maxim’s avec une ravissante créature, repartie d’ailleurs avant lui, mais qu’il avait suivie et chez qui, par la suite, il s’était rendu plusieurs fois. La première épître l’avait agacée bien qu’elle se fût refusé à lui attacher trop d’importance : elle savait que Gaspard, en bon Suisse, n’aimait guère celui qu’il appelait l’« Italien », mais c’était un homme honnête qui ne se serait pas amusé à affabuler. Du coup Lisa avait accepté cette invitation chez les Colloredo, puis le séjour inattendu à Rudolfskrone, afin d’exciter un peu la jalousie de son époux tout en l’incitant discrètement à la rejoindre. Mais il n’en avait rien fait, se cramponnant à cette histoire de meurtre dans lequel il était témoin… ce qui, selon Gaspard, ne justifiait nullement qu’il prolonge à ce point son séjour. Et puis il y avait eu cette abominable coupure de journal : la belle comtesse avait été assassinée, tenant dans sa main une lettre passionnée. Aldo était en fuite, accusé du meurtre pour lequel, malheureusement, il y avait un témoin…
À sa petite-fille, Mme von Adlerstein avait affirmé aussitôt que c’était impossible. Un coup monté, peut-être, une affreuse machination, mais Aldo était incapable d’une mauvaise action et d’un crime encore moins :
– Je connais les hommes, ma petite, et celui-là en particulier : je l’ai étudié attentivement. Jamais il n’aurait fait cela ! Jamais !
C’était bon à entendre même si Lisa savait, d’expérience personnelle, quelle influence une femme trop jolie pouvait avoir sur Aldo. Elle avait assez souffert de son premier mariage ! Cependant, elle non plus ne le croyait pas coupable du meurtre. Elle était alors rentrée sur-le-champ à Venise et cette autre lettre était arrivée, portée par un messager inconnu. Elle exigeait que la princesse Morosini apporte elle-même, en se soumettant des ordres bien précis, la collection de joyaux de son époux qui comportait aussi ses propres – et très beaux ! – bijoux.
Il avait fallu calmer la colère du vieux et charmant Guy Buteau, qui vouait au couple une affection paternelle :
– Je n’accepterai pas – et en cela je sais que je traduis la pensée d’Aldo – que vous vous engagiez dans une aventure aussi dangereuse ! Aldo ne manque pas d’amis dévoués à Paris. Je suis certain qu’ils font tous leurs efforts pour le retrouver…
– Moi aussi j’en suis certaine, Guy, mais vous avez lu : je dois venir moi-même…
– Pas difficile de deviner pourquoi : quand ils vous tiendront, ils ne vous lâcheront plus. N’oubliez pas de qui vous êtes la fille unique !
– Il y a peut-être un moyen. Nous allons laisser courir le bruit qu’il m’est arrivé un accident et je vais ressusciter Mina. C’est sous cette identité que j’irai à Paris. À moi de les convaincre que je suis vraiment ce que je prétends être. Et pour commencer je vais teindre mes cheveux…
– Lisa, Lisa ! Vous avez des enfants. Les oubliez-vous ?
– Les oublier ? Dieu me pardonne, Guy, mais vous déraisonnez ! Comme si vous ne saviez pas combien je les aime. Seulement ils ont autant besoin de leur père que de leur mère…
– Et s’ils n’ont plus ni l’un ni l’autre ?
– Il leur restera assez d’amour pour les entourer jusqu’à ce qu’ils soient un homme et une femme. Il y a ma grand-mère, mon père, vous.
– Alors je vais avec vous !
– Non, Guy. Je dois y aller seule et le plus vite possible : vous avez lu cette lettre ? Vous devez rester justement pour protéger les enfants. Ces gens sont capables de s’en prendre à eux…
Il avait bien fallu en passer par où le voulait Lisa et, nantie d’une fortune en joyaux tirés de leurs écrins et logés dans des sachets de peau de chamois, elle avait pris le train pour Paris…
Elle consulta sa montre. Il lui restait trois heures avant de gagner le lieu du rendez-vous. Que faire à présent au cœur de cette ville qu’elle aimait, où vivaient ceux qu’elle considérait non seulement comme ses meilleurs amis mais aussi comme sa famille : Adalbert le fidèle, Mme de Sommières et ce phénomène sympathique et déroutant qui avait nom Marie-Angéline, et puis, encore plus proche géographiquement parlant, Gilles Vauxbrun qui lui montrait toujours une respectueuse admiration. Ils étaient là, tout près, et cependant à des milliers de lieues. Il aurait été tellement réconfortant de pouvoir partager sa peur, son angoisse avec eux. Mais ne les partageaient-ils pas déjà et depuis plus longtemps qu’elle sans doute, eux qui vouaient à Aldo une amitié si vraie, une tendresse si pure ?
Haussant les épaules comme pour les débarrasser d’un fardeau, Lisa se dirigea à nouveau vers la salle de bains pour se rafraîchir et refaire le léger maquillage qui la différenciait davantage encore de sa propre image.
À ce moment-là, quelqu’un frappa…
La jeune femme se figea. Puis, comme on insistait, elle s’approcha de la porte :
– Qui est-ce ?
– Le service d’étage, Madame, fit une voix féminine. On a oublié de changer les serviettes…
Elle faillit dire que cela n’avait pas d’importance mais craignit de causer un tort quelconque à la femme de chambre.
Alors elle ouvrit…
Le premier mouvement d’Adalbert, en sortant de chez le commissaire Langlois, avait été de récupérer son Théobald et de filer vers cet autre quai de Paris où logeait fastueusement le marquis d’Agalar. Tous deux étaient décidés à employer les plus grands moyens, sinon les pires, pour extraire un renseignement quelconque du valet de chambre. Malheureusement là non plus il n’y avait personne.
– Il est parti hier soir pour la Bretagne où sa mère est malade, leur confia un concierge imposant comme un suisse d’église. Il a même laissé un petit mot pour Monsieur le Marquis au cas où il rentrerait pendant son absence…
– Et le marquis vous ne sauriez pas où il est ?
– Quand il part en voyage, il ne dit jamais où il va, maugréa l’homme. Même son valet Gontran ne sait pas toujours où il est. Et il voyage souvent…
– Il n’aurait pas une maison de campagne, un château, ou quelque chose d’approchant en province ?
– À part le château de famille en Espagne, je n’ai jamais entendu parler de ça. Et même en Espagne je ne sais pas où ça se trouve…
Il n’y avait vraiment pas de quoi pavoiser ! Quel résultat ! Étrange, d’ailleurs. Ces gens qui jugeaient utile de filer n’importe où dès que l’on avait le dos tourné !
– Je sens, émit Théobald, que Monsieur va être d’une humeur exécrable et j’aimerais mieux que Monsieur la passe sur quelqu’un d’autre que moi.
– Désolé, mon vieux, tu es tout ce que j’ai sous la main ! lâcha Adalbert en embrayant férocement pour rentrer chez lui. Ou alors trouve-toi un remplaçant…
– Pourquoi pas M. La Tronchère ? Monsieur m’a bien dit qu’il l’avait retrouvé cette nuit ?
– Ça, pour une idée, c’est une idée ! D’ailleurs, il ne serait peut-être pas mauvais d’aller voir ce qui se passe dans la maison près du chemin de fer ! Je te dépose chez nous et je file.
Tandis que la petite Amilcar rouge pétaradait sur la route de Saint-Cloud, Adalbert entendait dans sa tête des trompettes sonner la charge. Il avait besoin de se défouler et quiconque lui tomberait sous la main passerait un mauvais quart d’heure…
La vieille bâtisse de l’homme à la Renault noire se montra aussi décevante que le quai d’Orsay. Adalbert n’y vit rien qu’il n’eût déjà vu la nuit précédente. Personne n’y était revenu depuis que Karloff et lui l’avaient visitée… Aussi les roues de la petite voiture rouge le portèrent-elles tout naturellement vers le gîte de son ennemi. À des abords un peu distants, car le bruit et la couleur de l’Amilcar étaient trop aisément repérables. Adalbert choisit un bouquet d’arbres à l’entrée d’une propriété et s’en alla à pied vers la tanière du rat des musées privés.
Rien n’avait bougé là non plus. La rue était aussi déserte que la nuit précédente. On n’y entendait rien ; on ne voyait personne. En foi de quoi Adalbert escalada derechef la petite grille et fit le tour de la maison afin d’y pénétrer par la porte de la cuisine. Au cours d’une carrière déjà longue où il lui était arrivé d’entrer chez les autres sans y être invité, l’archéologue savait que les portes de service sont presque toujours moins bien défendues que les entrées principales. Il n’eut besoin que d’un seul petit outil pour venir à bout de celle-là et se retrouva bientôt dans la cuisine où il avait vu La Tronchère se faire des œufs au plat. Il n’y avait personne, mais tout était propre et bien rangé.
Ainsi renseigné sur les capacités ménagères de son ennemi, Adalbert entreprit la visite de la maison qui se composait, pour le rez-de-chaussée, d’un salon et d’une salle à manger de part et d’autre d’un couloir central d’où un escalier montait à l’étage. Mais, dès son entrée dans la première pièce, il eut l’agréable surprise de retrouver quelques-uns de ses chers trésors : de magnifiques vases canopes décoraient une salle à manger qui sans eux eût été banale. Quant au salon, il était orné de deux importants fragments de fresques, d’une statue d’Isis en basalte noir avec des ornements d’or, d’une admirable tête de la vache sacrée Hathor portant entre ses cornes le disque solaire, d’un très beau sarcophage thébain privé de sa momie mais encore en possession de son cercueil en bois de cèdre brillamment enluminé, d’une collection de statuettes en malachite, d’autres vases canopes et, dans la vitrine d’une autre collection de bustes, de fragments variés et de papyrus peints qui eussent fait le bonheur du Louvre ou du British Museum. C’était fort bien entretenu mais, dans ce décor d’une affligeante banalité, les plus belles pièces prenaient un air tristounet : elles avaient l’air en exil chez la concierge !…


