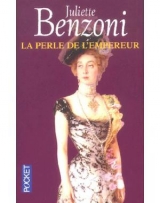
Текст книги "La Perle de l'Empereur"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
– Comme il aimait vraiment Anielka et, avant elle, Dianora Vendramin ! Mon pauvre ami, tout ce que nous pouvons faire, vous et moi, c’est de laisser passer le temps…
– Si Aldo nous le laisse, ce temps ! Je retourne à la clinique et je n’en bougerai plus jusqu’à ce que j’aie une certitude ! Quel qu’en soit le sens…
En fait, quarante-huit heures plus tard, le Pr Dieulafoy pouvait répondre de la vie de son patient mais décidait de le garder encore une quinzaine de jours pour assurer sa guérison et, surtout le mettre à l’abri des journalistes. Depuis la nuit de Saint-Cloud, la presse s’en donnait à cœur joie pour essayer de rattraper le retard pris sur Martin Walker, à qui sa situation de témoin oculaire assurait une place privilégiée. Les abords de la clinique étaient assiégés de jour comme de nuit en dépit du cordon de police que le commissaire Langlois avait établi pour préserver au mieux le malade.
En effet, outre Vidal-Pellicorne qui n’en bougea pas pendant trois jours, Gilles Vauxbrun, Mme de Sommières, Guy Buteau accouru de Venise, Marie-Angéline et quelques amis s’y rendirent, nombre de personnalités déposèrent leur carte, comme le maharadjah de Kapurthala qui allait repartir pour les Indes. Mais surtout il y avait le seigneur d’Alwar qui, depuis le premier jour, faisait prendre des nouvelles et que Langlois avait eu le plus grand mal à empêcher de faire garder la clinique par quelques uns de ses nombreux aides de camp…
Comme elle l’avait annoncé, Lisa repartit dès que la guérison fut assurée. Elle avait eu, auparavant, une longue conversation avec le vieux fondé de pouvoirs de son époux à qui elle vouait une sincère affection. Elle en traduisit la substance pour Adalbert quand il la conduisit au train pour Salzbourg où l’attendrait la voiture de sa grand-mère :
– Je n’ai nullement l’intention de divorcer ou de priver Aldo des petits mais je ne veux pas le voir avant un certain temps, parce que j’ai besoin de réfléchir. De toute façon, les jumeaux se trouveront mieux d’un séjour d’été en montagne plutôt que dans la touffeur humide de Venise. Dites-lui qu’il peut m’écrire mais en aucun cas venir me voir ! Cela n’arrangerait rien…
– Ça ne va pas être facile de lui faire avaler ça. Car enfin, Lisa, en admettant même – et moi je ne l’admets pas ! – qu’il ait eu un faible pour cette femme, elle est morte à présent.
– Justement ! Le souvenir d’une morte peut être difficile à effacer et je ne veux pas subir le temps des comparaisons.
Comme l’avait prévu Adalbert, la délivrance du message n’alla pas sans difficultés. Lorsqu’il était revenu à une conscience claire, les premières paroles d’Aldo avaient été pour réclamer sa femme. Adalbert s’en était tiré en disant qu’elle était malade mais vint le moment où Morosini eut retrouvé assez de forces pour entendre la vérité. Elle l’atterra :
– Lisa ne veut plus me voir ? Elle croit vraiment que j’étais l’amant de cette femme ?
– Elle croit que tu l’aimes : c’est pire !
– C’est surtout idiot ! Qui a pu lui faire croire va ?
– Le cousin Gaspard d’abord…
– Celui-là, je vais m’en occuper quand…
– Je ne te le conseille pas. Tu penses bien que je suis allé le voir. Il ne t’aime pas mais c’est un homme honnête et il n’a fait que dire ce qu’il a vu. Si tu t’attaques à lui, cela ne fera pas plaisir à Lisa. D’ailleurs le principal coupable, ce n’est pas lui mais toi…
– Moi ?
– Oui, toi. Quand elle est venue ici au lendemain de ton sauvetage, tu l’as appelée Tania. Je sais bien que tu délirais encore, mais le fait n’en est pas moins vrai : j’étais là.
Abasourdi, Morosini resta un moment sans mot dire puis, soudain, reprit :
– C’est insensé ! Je n’ai aucun souvenir de Lisa. En revanche je me souviens très bien d’avoir, à un moment donné, vu Tania dans une espèce de brouillard…
– Alors tu as vu un fantôme : tu sais bien qu’elle a été tuée !
– Je l’ai su ensuite, mais je te jure qu’à ce moment-là elle était pour moi bien vivante. Je la vois encore se penchant sur moi avec son visage pâle dans tout ce noir et ce bleu clair qui sont ses couleurs habituelles…
– Elle… elle portait toujours ces couleurs ?
– Toujours ! Elles convenaient si bien à ses grands yeux bleus.
– Tu as vu des yeux bleus ?
– Pas vraiment, peut-être… J’ai vu un ensemble un peu brumeux mais qui ne pouvait être qu’elle.
– Et qui pourtant n’était pas elle mais Lisa. Lisa qui a teint ses cheveux pour jouer le rôle qu’elle s’était attribué pour venir à ton secours et qui portait ce que lui avait conseillé la maison Lanvin : un ensemble de velours noir et satin bleu pâle avec un ravissant turban assorti qui lui emboîtait la tête. Je comprends tout maintenant : c’est un affreux malentendu…
– Mais bien sûr ! Alors écoute, mon vieux ! Tu vas courir à Ischl… ou plutôt non ! Tu vas lui téléphoner et lui raconter tout ça ! C’est trop bête en vérité !
Adalbert ne discuta pas et alla téléphoner mais la réponse qu’il rapporta le lendemain était conforme à ce qu’il attendait :
– Eh bien ? s’impatienta Aldo. Qu’a-t-elle dit ?
– Que c’est le ton qui fait la chanson… et que tu avais l’air un peu trop heureux. Elle ne change rien à sa décision de ne pas te voir avant l’automne…
Affreusement déçu, Aldo laissa la colère l’emporter :
– Quelle tête de mule !… Qui lui dit qu’à ce moment-là j’aurai encore envie de la voir, moi ? Les femmes sont inouïes : on les aime, on ne sait que faire pour elles, on endure les tourments de l’enfer à leur sujet quand…
– Je peux placer un mot ?
– Lequel ?
Adalbert ouvrit la bouche pour émettre l’idée qui venait de le traverser puis la referma, pensant que ce qu’il allait dire pouvait ressembler à une trahison envers Lisa. L’épisode de la clinique n’avait fait que renforcer la volonté de la jeune femme de ne revoir son époux qu’à l’automne, c’est-à-dire dans six mois. Autrement dit quand ses cheveux repoussés lui auraient rendu son vrai visage… Une raison bien féminine mais tellement compréhensible !
– Eh bien ? aboya Morosini. Il vient, ton mot ?
– Non. Non, tout compte fait, continue donc de vociférer ! Ça te fait le plus grand bien…
Quelques jours plus tard, le Pr Dieulafoy autorisait Morosini à quitter la clinique afin de poursuivre sa convalescence chez Mme de Sommières. Le printemps changeait le parc Monceau, sur lequel donnait la fenêtre de sa chambre, en un énorme bouquet de senteurs et de couleurs. Ce qui fut comme une délivrance : Aldo ne supportait plus les contraintes médicales, le rythme immuable du thermomètre, des soins, des repas, des – rares – visites, du sommeil imposé à huit heures du soir. Et surtout, il s’offrit le luxe délicieux de pouvoir enfin allumer une cigarette.
Ce n’était sans doute pas ce qu’il y avait de mieux pour qui relevait d’une broncho-pneumonie mais le plaisir en fut si vif qu’Aldo se sentit tout à coup beaucoup mieux. C’était pour lui un premier pas vers la vie normale à laquelle il aspirait.
Évidemment l’image que lui renvoyaient les miroirs lui rappelait fâcheusement son retour de la guerre. Les blessures de ses poignets étaient cicatrisées mais il flottait dans ses vêtements et la peau de son visage semblait adhérer à l’ossature, le moindre mouvement un peu vif le fatiguait. Au fond – et même si par instants il étouffait du désir de revoir sa femme – l’espèce de quarantaine imposée par Lisa n’était peut-être pas une mauvaise chose. Affronter son regard dubitatif et sans doute apitoyé avec cette mine de déterré lui serait insupportable. Il lui fallait reprendre des forces, replonger dans la vie avec l’appétit de naguère et retrouver ses passions. Toutes ses passions !
La collection Morosini était repartie pour Venise avec Guy Buteau, discrètement escorté par deux policiers en civil ; le commissaire Langlois vint en personne annoncer à Aldo que, si les bracelets de rubis avaient repris leur place dans les écrins de la princesse Brinda, l’émeraude d’Ivan le Terrible et, bien entendu, la « Régente » avaient été restituées à Adalbert. Ce fut pour Morosini une bonne occasion de se mettre en colère :
– Passe encore pour l’émeraude que j’ai achetée le plus légalement du monde en salle des ventes mais je ne veux pas garder plus longtemps cette maudite perle ! Je vais en faire cadeau au musée du Louvre et voilà tout ! Dans la galerie d’Apollon, elle n’embêtera plus personne ! Ce qui ne saurait manquer d’arriver puisque, malheureusement, Agalar n’était pas Napoléon VI et qu’il n’y a aucune raison pour que le vrai renonce à ses prétentions !
– Vous oubliez que vous n’êtes que le mandataire. En fait, le propriétaire c’est toujours le prince Youssoupoff, si j’ai bonne mémoire.
– Il n’en veut pas ! Il m’a chargé de la vendre…
– Mais pas d’en faire cadeau puisque l’argent doit être employé à des fins charitables. Alors achetez-la !
– Ça jamais ! Elle dégouline de sang versé et elle a failli me tuer. Quant à la vendre, la mort de Van Kippert découragerait n’importe qui. Drouot en tout cas n’en veut plus. Et je ne suis pas certain qu’en Angleterre ça marcherait mieux…
– Essayez l’Amérique ! Van Kippert savait parfaitement ce qu’il achetait.
– Mais certainement pas qu’il allait être tué sur le-champ. Si vous voulez le fond de ma pensée commissaire, la meilleure solution pour moi serait que vous arrêtiez Napoléon VI. Celui-là s’est juré de l’avoir pour rien. Et maintenant que nous savons que ce n’est pas Agalar, il faudrait peut-être reprendre la piste ?
– Et que croyez-vous que je fasse d’autre ? Seulement j’ai peu de chose à me mettre sous la dent.
– Avez-vous retrouvé Marie Raspoutine ?
– Pas encore. On la cherche, bien sûr, mais nous n’avons rien contre elle. En outre, si j’ai bien compris ce que l’on m’a raconté, elle ne connaît de lui qu’une ombre, une voix… Ce qui ne l’empêche pas d’en être tombée amoureuse… Une grande imaginative, en résumé !
– Mais j’ai dans l’idée que lui aussi y tient. Il faut la retrouver et avec une surveillance étroite…
– Merci, je connais mon métier. Mais, j’y pense, ajouta Langlois en louchant sur le grand carton somptueusement armorié et gravé qui reposait sur une petite table auprès de Morosini. N’aviez-vous pas dans l’idée de vendre cette sacrée perle au maharadjah de Kapurthala ? Je vois là une superbe invitation. Vous allez l’accepter ?
– Une occasion pareille ne se refuse pas quand on exerce mon métier mais, pour en revenir à la « Régente », je n’ai aucune chance de ce côté. Ah, si elle avait appartenu aux Louis XIV, XV ou XVI ce serait déjà fait, mais Napoléon ne l’intéresse pas. Et puis, toujours la même rengaine : il y a trop de sang frais sur elle…
– Qu’allez-vous en faire alors ?
– Je ne sais pas. Sans doute la confier au coffre de la Banque de France en attendant des jours meilleurs. Et je ne peux pas m’occuper d’elle en exclusivité : il est plus que temps que je rentre à Venise. Ma maison peut tourner sans moi mais jusqu’à un certain point seulement…
Il n’eut pas le temps de développer davantage ce point de vue : Marie-Angéline, rouge et essoufflée, fit à cet instant irruption dans la chambre :
– Les Mille et Une Nuits débarquent chez nous, Aldo ! Il y a là un… un maharadjah ! Un vrai !… Il brille comme une aurore et sa suite brille presque autant que lui. Ses gens envahissent la maison et moi il m’a écartée de son chemin d’un geste dégoûté… C’est merveilleux !
Mais le policier avait déjà mis un nom sur cette apparition fabuleuse :
– Alwar, à tous les coups !… Est-ce que je peux sortir d’ici sans le rencontrer ?
– Il vous fait peur ?
– Non, mais si je me trouve en face de lui, je devrai sans doute le coffrer pour déclarations mensongères dans une affaire de meurtre et je n’ai pas le droit de déclencher un incident diplomatique. Alors, je sors comment ?
– Par le balcon, fit Marie-Angéline en ouvrant plus largement la porte-fenêtre. Il communique avec la chambre de la marquise.
– Elle va me prendre pour un malotru ?
– Elle va être enchantée, voulez-vous dire ! Je vous conduis…
Ils disparurent juste à temps : déjà Cyprien rouge d’essoufflement et de colère, était propulsé chez Aldo par deux magnifiques jeunes gens aux yeux de gazelle dont les tuniques brodées d’or scintillèrent dans la flaque de soleil qui décolorait le tapis. Le vieil homme ouvrait la bouche pour annoncer l’auguste visiteur mais la fureur étrangla sa voix dans sa gorge et ce fut l’un des deux jeunes gens qui annonça Jay Singh. L’instant suivant celui-ci fit une entrée de prima donna sous sa couronne de rubis. Il était tellement cousu d’or, de rubis et d’énormes topazes qu’il ressemblait à une éruption volcanique.
Ôtant ses gants de satin – sous lesquels il en portait d’autres, en soie si fine qu’elle était presque transparente, afin d’éviter le contact impur de l’infidèle –, il s’avança vers Aldo les mains tendues :
– Mon cher… si cher ami ! ! Quelle joie de vous revoir après cette abominable épreuve ! Mais… dans quel état ! s’écria-t-il sur un ton dont l’enthousiasme semblait décroître à mesure qu’il découvrait Morosini. Êtes-vous contagieux ? ajouta-t-il, se contentant de serrer les mains d’Aldo au lieu de l’accolade primitivement prévue.
– Nullement, Votre Grandeur ! fit celui-ci en se levant pour saluer son visiteur. Je ne l’ai jamais été et, en outre, je suis convalescent…
– J’en suis tellement heureux ! Quelle affreuse histoire ! Tous vos amis ont eu très peur. Et moi plus que quiconque, je pense : je ressentais comme une blessure l’impression que l’on avait enlevé mon frère !
– Votre Grandeur est infiniment bonne et je sais quelle aide généreuse elle s’est efforcée de m’apporter. Je ne saurais dire à quel point je lui en suis reconnaissant…
– En ce cas, fit le maharadjah en fermant à demi les yeux, ce qui ne laissa filtrer qu’un mince éclat de son regard jaune, pourquoi ne pas revenir à nos conventions d’avant cette terrible épreuve : laissons de côté la grandeur et appelez-moi Jay Singh !
– Ce ne sera peut-être pas très facile mais je promets d’essayer…
Ses beaux serviteurs disparus, le prince tira démocratiquement un fauteuil pour s’installer près d’Aldo en prenant soin de récupérer quelques coussins supplémentaires. Ce faisant, son regard, comme précédemment celui de Langlois, effleura le carton armorié et il sourit :
– Ah ! Vous avez reçu, je vois, l’invitation de Kapurthala ?
– En effet. Accompagnée d’une aimable lettre du prince Karam.
– Vous y viendrez, j’espère ? Cela nous permettra de nous retrouver sous le ciel de mon magnifique pays… Mais, j’y pense, pourquoi n’irions nous pas ensemble ?
– Ensemble ?
– Mais oui. Partez un peu plus tôt, venez avec moi à Alwar ! Cela me permettra de faire admirer à l’expert que vous êtes les quelques joyaux rares que je possède. Et Alwar renferme des trésors architecturaux. Ensuite nous irons ensemble chez Jagad Jit Singh. Mon train privé est plus confortable que celui du Vice-Roi…
– Je n’en doute pas mais cette invitation s’adresse aussi à ma femme et elle est habituée à être accueillie avec autant d’égards que moi-même. Je ne saurais imposer cela à…
– Laissez, laissez ! Ce n’est pas un inconvénient ! J’ai moi aussi des épouses qui ne quittent guère le palais. Recevoir la princesse Morosini sera une vraie joie pour elles. Je voyage beaucoup et elles se sentent évidemment un peu seules : une telle visite leur apportera bonheur et lumière… Oh, ne me refusez pas ! Nous passerons quelques jours charmants… En outre, ajouta-t-il après un léger temps d’arrêt, j’avais dans l’idée en venant ici aujourd’hui de conclure avec vous une affaire.
Dès que le mot fut prononcé, Morosini se sentit plus détendu. Voilà un terrain solide sur lequel il aimait à s’aventurer et, à contempler cet homme dont le moindre mouvement faisait jaillir des étincelles, il pensa que ce pourrait être fort intéressant. De toute façon cela lui changerait les idées…
– Quel genre d’affaire ? demanda-t-il.
– Je souhaite acheter la perle dont les journaux ont parlé avec tant d’abondance. Celle qui appartenait au grand Napoléon ! Pouvez-vous me la montrer ?
– Elle n’est pas ici. Cette maison appartient à ma grand-tante la marquise de Sommières. C’est une dame âgée qui vit avec des serviteurs plus très jeunes non plus et la « Régente » s’est révélée un joyau… dangereux. Je me dois d’ailleurs de vous en informer, Altesse.
Alwar eut un geste de la main qui balayait la mise en garde :
– Pouvez-vous me la décrire en spécialiste que vous êtes ?
C’était pour Morosini l’enfance de l’art. Il se surprit même à se laisser aller sur les pentes d’un certain lyrisme pour évoquer l’orient admirable, la forme, le doux éclat de la grosse perle, sans oublier la pureté et la qualité extrêmes des diamants qui la coiffaient. Le maharadjah buvait ses paroles et, quand ce fut fini, il se montra enthousiaste :
– Magnifique ! Je vois déjà exactement le collier que je ferai exécuter et dont elle sera la pièce maîtresse. Le prix importe peu et je l’achète !
Aldo en aurait crié de joie. Il avait l’impression que le ciel s’ouvrait au-dessus de lui pour lui permettre d’entendre chanter les anges ! La damnée perle allait partir pour les Indes, tout à fait hors de portée de « Napoléon VI » ! Et cette châsse ambulante ne discuterait même pas le prix ! Un prix grâce auquel la vie du petit Le Bret serait assurée et quelques misères soulagées.
– Je pense, dit-il en s’efforçant de contenir sa joie, que vous ne regretterez pas cet achat, Monseigneur ! C’est à ma connaissance l’une des deux plus belles perles du monde et si vous voulez bien me faire l’honneur de revenir demain, elle vous attendra.
– C’est que demain je ne serai plus là ! Je rentre chez moi par le premier bateau…
– Mais alors…
Après un geste apaisant, Alwar frappa doucement dans ses mains sur un certain rythme : un homme en bleu apparut, une serviette sous le bras.
– L’un de mes secrétaires, présenta Alwar. Voilà ce que je vous propose : il va vous remettre un chèque de la moitié du prix dont nous allons convenir…
– Un instant, Altesse ! coupa Morosini. Je vous demande pardon mais je n’ai pas l’habitude de travailler ainsi. Je n’accepte d’argent qu’en remettant à l’acheteur le joyau choisi. Vous pouvez avoir la perle ce soir même… dans une heure au besoin. En ce cas vous la payez et nous n’en parlons plus.
– Tstt ! Tstt !… Je ne vois pas les choses ainsi. Je vous l’ai dit, je n’ai pas l’intention de l’emporter et si je vous fais remettre la moitié du prix c’est afin de concrétiser notre marché. L’autre moitié de la somme vous sera remise… dès votre arrivée à Alwar. Quand, avant d’aller à Kapurthala, vous me l’apporterez vous-même ! Ainsi le plaisir que j’en aurai en sera centuplé… et cela ne vous fera jamais qu’un petit détour.
Les anges, tout à coup, avaient cessé de chanter…
Troisième partie
LES TRÉSORS DE GOLCONDE
CHAPITRE XII
LA PORTE DES INDES
Ce fut avec un vif plaisir que Morosini et Vidal-Pellicorne reprirent, à Bombay, contact avec la terre ferme. En dépit de son confort attentif, L’Irraouadi, le paquebot des Messageries maritimes qui les amenait depuis Marseille, les avait secoués sans ménagement presque tout au long d’une de ces traversées qui comptent dans la vie d’un homme. Sauf pendant la lente remontée du canal de Suez et la navigation en mer Rouge – un intermède apprécié ! – le père Neptune leur avait fait grise mine, pour ne pas dire plus. L’aimable Méditerranée, dans la seconde quinzaine d’octobre, s’était montrée hargneuse et, en débouchant dans l’océan Indien, ils avaient rencontré la queue du cyclone qui venait de dévaster une partie des côtes indiennes. Fort heureusement, le port de Bombay n’en avait pas souffert. Le grand paquebot blanc put venir à son quai sans autre difficulté et y déverser une cargaison humaine soulagée mais déjà transpirante dans la chaleur humide qui règne en permanence sur ce grand port.
– Qu’est-ce que ce serait si nous n’étions pas à la saison fraîche ! soupira Adalbert, à peine assis dans la voiture qui allait les conduire à l’hôtel, en ôtant son casque colonial pour s’en éventer. J’ai l’impression de tremper dans un bain de vapeurs.
– Cette nuit tu auras presque froid, fit Aldo pour qui la chaleur n’avait jamais posé de problème, en regardant d’un œil distrait les flèches du soleil qui perçaient la brume pour se briser sur l’eau plate.
Tout ici était tellement différent ! Il avait conscience d’être au seuil de ce monde inconnu dont il rêvait lorsqu’il était enfant : les Indes ! Deux tout petits mots mais tellement évocateurs qu’ils se passaient d’adjectifs tant ils étaient chargés de couleurs, du parfum des épices, du ruissellement des joyaux et des turbans empanachés de diamants voguant dans les herbes hautes sur des éléphants caparaçonnés d’or. La réalité de l’instant présent était tout autre : la grisâtre brume dont s’enveloppait la ville éteignait les couleurs et même si Morosini savait que les splendeurs rêvées l’attendaient quelque part dans cet immense pays, les odeurs aussi manquaient au rendez-vous, remplacées par des relents de vase, de pourriture et d’huile chaude où se mêlait par instants une vague senteur d’encens.
Pourtant, quand ils arrivèrent devant l’hôtel – un énorme caravansérail coiffé de quatre minarets à bulbe de ce style indéfinissable qui caractérise l’ère victorienne, avec sur le pavillon central une énorme coupole semblable à une grosse fraise –, la brume se déchira soudain pour libérer un grand ciel bleu où planaient des oiseaux blancs. En face, au bout d’une place ovale terminant le boulevard Maritime et dominant le port, apparut une sorte d’arc de triomphe en basalte jaune, arrogant à souhait et construit en 1911 pour commémorer le voyage aux Indes du roi George V et de la reine Mary. Imposant, un peu écrasant même, il semblait peser de son poids de pierre sur la foule de mendiants, de charmeurs de serpents, de devins, de vendeurs d’amulettes, de saints hommes nus à la chevelure couverte de cendres, de vaches bossues et de petits marchands de fruits : une humanité couleur de craie, ou de terre, d’où se détachait, parfois, la silhouette gracieuse d’une femme enroulée dans un sari aux couleurs tendres. Cet arc de triomphe s’appelait la Porte des Indes et en vérité il portait bien son nom…
Debout près de la voiture d’où les boys de l’hôtel extrayaient les bagages, Aldo s’attardait à contempler ce décor qui avait l’air planté là pour qu’on y joue Le Tour du Monde en quatre-vingts jours quand une jeune femme armée d’un Kodak sortit de la masse des « figurants » et entreprit de traverser la place en courant à la manière des photographes : c’est-à-dire que, sans trop faire attention où elle allait, elle se retournait fréquemment pour chercher des angles de prises de vue.
Elle atterrit ainsi au milieu des bagages, faillit tomber, se raccrocha à la première aspérité venue qui se trouva être l’épaule d’Adalbert, perdit son casque blanc et éclata de rire :
– So sorry! commença-t-elle, I am...
L’archéologue l’avait déjà reconnue :
– Lady Mary ?… Mais quelle agréable rencontre.
– Et inattendue, fit Aldo. Que faites-vous à Bombay, Mary ?
Rendue muette par la surprise, elle les regarda tour à tour comme s’ils tombaient du ciel et finir par articuler :
– Mais c’est à vous qu’il faut demander cela. D’où sortez-vous ?
– Du bateau, voyons ! fit Aldo qui, ravi de cette rencontre tellement inopinée, se penchait déjà pour embrasser la marraine de sa fille.
Mais celle-ci s’écria :
– Mon Dieu ! J’allais oublier… On se verra plus tard !
Et sans rien ajouter elle s’engouffra dans l’hôtel saluée par les serviteurs qui en ouvrirent les portes devant sa fougue. Les deux hommes qu’elle venait de planter là regardèrent Mary Winfield, qui était l’une des deux meilleures amies de Lisa, disparaître dans les profondeurs du palace où ils ne tardèrent pas à la suivre.
– Qu’est-ce qui lui prend ? émit Adalbert, un peu vexé par un traitement aussi cavalier.
Car, depuis le baptême des jumeaux, il se sentait un petit faible pour la jeune Anglaise dont il appréciait aussi bien l’humour et la vitalité que le joli visage toujours souriant, les boucles blondes aussi difficiles à discipliner que les siennes propres et les pétillants yeux noisette qui lui donnaient l’air d’un lutin à la recherche d’un mauvais tour. Aussi peu conformiste que Lisa – elle avait été la seule à connaître, à approuver, l’équipée de la fille du banquier suisse délaissant les palais familiaux pour se couler dans les habits sans grâce de Mina van Zelden, secrétaire émérite –, Mary, fille d’un membre du Parlement affreusement riche, avait choisi de s’établir à Chelsea pour y exercer ses talents de peintre. Un talent réel, d’ailleurs, qui exaspérait sa famille mais commençait à lui valoir des commandes flatteuses.
Aldo haussa des épaules indulgentes et philosophes :
– Mary ne fait jamais rien comme les autres. Il est inutile de se poser des questions à son sujet. Tu l’as entendue : on se verra tout à l’heure. Allons déjà prendre une douche et nous changer !
Les dimensions du « Taj Mahal » étaient celles d’un de ces palais princiers qui accumulent les passages, les cours intérieures, les salons immenses, les galeries surmontées de verrières et, en découvrant ses murs tendus de velours rouge, les grands ventilateurs de plafond dont les pales brassaient l’air, ses énormes lustres de cristal de Bohême et son armée de serviteurs vêtus de blanc et rouge, les deux voyageurs eurent l’impression – voulue d’ailleurs par l’architecte – de franchir une sorte de sas entre l’Occident et l’Orient, avec un penchant certain pour le second. Il y avait tant de monde dans le hall que l’on se serait cru sur un marché, à cette différence près que ceux qui s’y agitaient appartenaient à de nombreuses nationalités, à des ethnies différentes, l’ensemble relié par des moyens financiers parfois imposants. Au milieu de tout cela les serviteurs passaient, silencieux comme des ombres…
En pénétrant dans sa chambre, vaste comme un hall de gare, dans laquelle un énorme lit drapé dans une moustiquaire blanche paraissait minuscule, Aldo se précipita sur une sorte de secrétaire où du papier et des enveloppes invitaient à la correspondance, griffonna quelques mots, glissa le tout dans une enveloppe sur laquelle il inscrivit le nom de Lady Winfield et sonna un boy qu’il chargea de porter la lettre à sa destinataire.
– Je viens d’envoyer un mot à Mary pour l’inviter à dîner avec nous, confia-t-il à Adalbert qui venait voir comment son ami était installé.
– Ça me paraît une bonne idée ! Mais tu ne crois pas qu’on aurait dû prendre une seule chambre pour nous deux ? J’ai l’impression d’habiter au milieu du désert…
– Personne ne t’empêche de peupler ton désert. Je suis sûr que, sur un simple appel, on doit pouvoir te fournir toute une troupe de bayadères, fit Morosini en riant.
– Par cette température ? Tu veux ma mort. Et ce machin qui tourne au ralenti, fit-il avec rancune en désignant le ventilateur nonchalant qui battait mollement de l’aile au plafond.
– Sonne ! On te le fera marcher plus vite. C’est aussi ce que je vais faire…
Un moment plus tard, en effet, les pales brillantes créaient un tourbillon à peine plus efficace dans l’air humide et lourd. Seule la douche dispensait un peu de soulagement mais, en endossant son smoking après avoir mis un temps fou à nouer sa cravate, Aldo se prit à regretter de ne pouvoir opter pour les tenues locales. Il est vrai qu’il se voyait mal coiffé d’un turban.
La nuit tomba subitement comme un rideau de théâtre, apportant une fraîcheur légère mais suffisante pour que l’on puisse cesser de se préoccuper de soi-même. Lady Winfield ayant répondu qu’elle serait ravie de dîner avec ses amis, ceux-ci descendirent sur le coup de sept heures pour la rejoindre.
Ils la trouvèrent dans la grande véranda fleurie qui jouxtait le hall et servait de bar. Bien qu’elle fût presque pleine, il y régnait un calme de bonne compagnie orchestré par un fond discret de musique anglaise déversé par un orchestre invisible. Mary était déjà là. Vêtue d’une robe du soir en mousseline à volants couleur miel, des topazes au cou et aux oreilles, elle buvait tranquillement ce qu’il est convenu d’appeler un whisky bien tassé, qu’elle remplaça par un autre quand un boy s’approcha pour prendre les commandes. Elle semblait d’excellente humeur et commença par s’excuser de les avoir abandonnés devant l’hôtel avec un peu trop de brusquerie :
– J’ai aperçu dans le hall le préposé au courrier et je me suis rappelé brusquement que je n’avais pas descendu la lettre que j’avais préparée… À présent dites-moi un peu ce que vous faites à Bombay, vous deux ?
– Nous ne faisons que passer, répondit Aldo. Nous sommes invités aux fêtes du jubilé du maharadjah de Kapurthala.
– Quelle chance vous avez ! Ça va être le grand événement mondain de l’année. Mais… n’allez vous pas arriver un peu tôt ? Si j’ai bonne mémoire, c’est seulement le 24 de ce mois ?
– Nous allons traîner en chemin. J’ai une affaire à régler avec un autre prince mais… (Il hésita un court instant devant la question qui lui brûlait les lèvres et n’y résista pas plus longtemps.) Avez-vous-eu des nouvelles de Lisa ces temps-ci ?
Il la regretta aussitôt, comprenant qu’il allait lui falloir donner des explications, tout raconter sans doute, mais Mary ne parut pas autrement surprise et Aldo respira :
– Pas depuis le mois d’août, dit-elle. Je suis allée passer quelques jours à Ischl avec elle et les enfants…
– Comment vont-ils ? murmura Aldo sans pouvoir empêcher sa voix de trembler et une larme de lui monter aux yeux.
Elle eut pour lui un chaud sourire et sa main, solide et forte pour une main féminine, vint se poser sur sa manche :
– Tout le monde va très bien et les jumeaux sont de vrais petits diables à qui la présence d’un père sera toujours nécessaire…
– Puisque vous me semblez au courant, Mary, vous devez savoir que cela ne dépend pas de moi… même si je suis responsable de cette désolante situation. Lorsque je me suis retrouvé à Venise après ma convalescence chez Tante Amélie, j’ai écrit une lettre à Lisa. Une longue lettre mais sans obtenir de réponse…
– Moi aussi j’ai écrit une lettre, fit Adalbert, et si à moi elle a répondu, son épître n’encourageait guère une correspondance suivie. Avec beaucoup de grâce et de gentillesse, elle me priait poliment de me mêler de ce qui me regardait. C’était à peu près le sens général.


