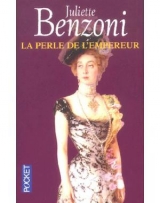
Текст книги "La Perle de l'Empereur"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
– Vrai…
Elle admettait en ne disant rien de plus. Assise à présent dans ses coussins elle jouait nerveusement avec l’un de ses bracelets. Aldo s’assit près d’elle mais sur le tapis et en tailleur. Il prit, dans son étui d’or, une cigarette qu’il alluma et plaça d’autorité entre les lèvres de la jeune femme avant de se servir.
– Si vous me disiez la vérité, Tania ? Il me semble que cela vous ferait du bien. Qui est ce type d’abord ?
Elle tira quelques bouffées avec une sorte d’avidité puis soupira :
– Mon amant jusqu’à ces temps derniers. Et aussi mon ami. Du moins je le croyais…
– Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ?
Elle raconta alors sa rencontre avec José d’Agalar à l’une des grandes soirées de Paris organisées au bénéfice du Comité de secours aux réfugiés russes. Un ami commun les avait présentés et, pendant des semaines, ils ne s’étaient plus quittés. Agalar se disait passionnément amoureux et il avait faite sienne la quête de son amie à la recherche des bijoux envolés.
– J’étais tellement heureuse ! exhala la jeune femme. Il m’en a retrouvé deux. Pas les plus importants, bien sûr, mais c’était déjà un début. Et il a réussi à les avoir pour un prix vraiment doux…
– Parce qu’il vous les a fait payer ?
– Quoi qu’on en dise, il n’a guère de fortune. C’est sa famille qui est très riche. Quant à moi, il était normal que je dédommage un peu les innocents possesseurs de ces bijoux volés. Et puis je l’aimais à un point que vous n’imaginez pas. Je songeais même à l’épouser quand il m’a fait comprendre qu’il n’y tenait pas, préférant rester célibataire pour ne pas offenser les siens qui lui tenaient en réserve une fiancée quasi princière…
– Première blessure ? fit Aldo.
– Bien entendu. Je suis, moi aussi, de noble maison et je ne voyais pas pourquoi le duc, son père, ne m’accepterait pas. Je l’ai dit et pendant un temps il s’est écarté de moi : il boudait. Mais je le répète, j’étais folle de lui. Et puis, un jour, il a levé pour moi un coin du voile quand il m’a demandé de l’aider, personnellement, dans le recouvrement de mes trésors… et de quelques autres. Il m’indiquerait les maisons intéressantes et je devrais m’y faire recevoir – ce qui évidemment m’est très facile ! –, y nouer des liens d’amitié, ce qui me permettrait de lui communiquer tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin sans que jamais il apparaisse lui-même…
– ... après quoi, une belle nuit, vos « amis » se verraient dépouillés de leurs plus belles pièces, conclut Aldo pour qui ce récit un peu embarrassé devenait limpide. Autrement dit, le beau marquis est un simple cambrioleur.
– C’est ce que j’ai pensé aussi et c’est pourquoi j’ai refusé. Il m’a expliqué alors qu’il fallait que je sache ce que je voulais : ceux qui refusaient toute tractation pour me rendre ce qui m’appartenait ne méritaient, selon lui, aucune considération morale. Je lui ai alors fait observer que la grosse émeraude dont Mme Pecci-Blunt déplorait la perte ne m’avait jamais appartenu. Il m’a répondu qu’il avait bien le droit de penser à lui et que l’émeraude en question venait de sa propre famille et qu’un ancêtre, compagnon de Cortez, l’avait prise jadis dans le trésor de Montezuma.
– Il a réponse à tout, le bougre !
– Plus encore que vous ne l’imaginez ! Il m’a dit encore que désormais nous étions associés et que bon gré mal gré il fallait que je continue à l’aider parce que, au cas où je l’abandonnerais, il s’arrangerait pour que tout retombe sur moi. Même chose si je prévenais la police. Et il m’a conseilla de réfléchir le temps du séjour qu’il allait effectua chez les siens, en Andalousie. D’évidence il vient de rentrer.
– Et sa première visite n’a pas été pour vous ?
– Donnez-moi une autre cigarette !
Cette fois il la laissa l’allumer elle-même et tirer, comme précédemment, deux ou trois bouffées avant de poursuivre :
– Cela eût été difficile ! Dès qu’il a eu le dos tourné, j’ai loué en hâte cet appartement et je suis venue m’y installer. Auparavant j’habitais quai d’Orsay et j’ai laissé là-bas beaucoup de beaux objets, mais je ne songeais qu’à une chose : lui échapper.
– Vous n’avez fait que traverser la Seine. Pourquoi n’êtes-vous pas partie plus loin ? En Angleterre, en Suisse, en Amérique ?
– Je n’aime que Paris. En outre l’idée de mettre une trop grande distance entre moi et les pierres que je cherche me crève le cœur.
– À propos de cœur, où en est votre grand amour pour don José ?
– Je ne sais pas vraiment, parce que je ne me suis pas posé la question. Mais je crois bien qu’il n’en reste pas grand-chose ! À présent, vous comprenez, j’ai peur de lui.
– Hum !… Admettons ! Mais en ce cas vous devriez vivre cachée, ensevelie sous des châles, des manteaux, des voiles. Que faisiez-vous chez le prince Youssoupoff et habillée à ravir ?
– Félix est un ami, un vrai et je suis chez lui en parfaite sécurité. En outre, José n’est pas admis dans le monde russe ou ce qu’il en reste. Il est arrogant, brutal et il a tué en duel le jeune Wronsky après la plus stupide des altercations.
– Que n’a-t-il vécu au temps d’Anna Karénine ! La pauvre femme n’aurait jamais fini sous un train et la terre aurait été privée d’un beau livre ! Dites-moi maintenant pourquoi vous avez voulu sortir avec moi ?
– Parce que je ne le savais pas rentré… et aussi parce qu’en vous rencontrant j’ai eu l’impression que le ciel répondait à mes questions angoissées concernant l’homme idéal…
C’était peut-être flatteur mais Morosini ne put s’empêcher de trouver cela inquiétant. Il se releva aussitôt pour reprendre place sur un fauteuil :
– Merci bien, mais comment l’entendez-vous ? En quoi suis-je idéal ?
– En ce que vous êtes celui qui connaît le mieux les pierres, qui dispose de grands moyens, qui est admis… et même recherché dans n’importe quelle société et que vous représentez la meilleure garantie possible si vous me prenez sous votre protection…
– Cela fait beaucoup tout ça et je crois qu’il est temps de mettre les choses au point. Je ne demande pas mieux que de vous aider… dans certaines limites toutefois…
– Quelles limites ?
– Celles de la légalité. Pas question avec moi de se procurer des bijoux en les volant ! En outre, il faut que vous admettiez que je ne suis pas parisien, que j’habite Venise et que cela met entre nous une grande distance kilométrique. Enfin, si devenir votre… protecteur officiel est infiniment flatteur pour la vanité d’un homme, il ne peut en être question quand cet homme est marié et qu’il aime sa femme !
Elle ferma à demi ses longues paupières en esquissant la plus jolie moue qui soit :
– Presque tous les hommes intéressants sont mariés et tous sans exception prétendent aimer leur femme… Cela ne tire pas à conséquence.
– Sans doute êtes-vous mieux placée que moi pour en juger mais ce n’est pas chez moi une parole en l’air, un terme convenu. Et si je dis que j’aime celle qui porte mon nom, c’est la vérité du bon Dieu ! Aucun de ceux qui la connaissent n’en douterait un seul instant. Mais changeons de sujet, voulez-vous ? Et montrez-moi plutôt les bijoux que votre José vous a « aidée » à retrouver !
D’un mouvement souple, elle se releva, quitta le salon et revint au bout d’un instant, portant un écrin de cuir fatigué griffé d’armoiries dédorées qu’elle ouvrit en le lui tendant : il contenait une croix d’émeraudes et de perles ainsi qu’une paire de pendants d’oreilles assortis. La facture en était ancienne, le style archaïque mais les pierres semblaient belles. Pour mieux les étudier, Aldo tira de sa poche la petite loupe de joaillier qui ne le quittait pas plus que son mouchoir, son étui à cigarettes ou son portefeuille, la coinça dans son orbite en s’approchant d’une lampe posée sur une table.
L’examen fut bref. Il ne l’avait entrepris que pour confirmer ce qu’il avait cru voir au premier coup d’œil : les montures d’or étaient anciennes mais émeraudes et perles étaient d’autant plus neuves qu’elles étaient fausses. Ainsi ce bandit d’Agalar avait osé revendre – à vil prix mais tout de même ! – à cette malheureuse des bijoux dont il avait remplacé le plus important et qui ne valaient plus que le poids de l’or qui les composait. Cependant il ne laissa rien paraître, garda pour lui ses réflexions, referma l’écrin et le rendit à sa propriétaire :
– Vous les portez quelquefois ?
– Jamais. José m’a bien recommandé de les garder secrets pendant quelque temps. Ils ne sont d’ailleurs plus très à la mode et il vaut mieux attendre que le temps passe pour les faire remonter…
« Ben voyons ! pensa Aldo. Le bonhomme n’est pas fou ! Mais cette pauvre petite est vraiment mal partie. Et moi, qu’est-ce que je viens faire au milieu de tout cela ? »
Il se sentait fatigué, un peu désorienté aussi parce qu’il devinait, derrière la belle comtesse, une affaire louche peut-être liée à une association de malfaiteurs qu’il préférait de beaucoup tenir à l’écart. Cependant Tania, après être allée ranger l’écrin, revenait vers lui avec dans ses beaux yeux une véritable imploration :
– Donnez-moi au moins un conseil ! Je suis si seule et j’ai si peur !
– Je suis prêt à vous en donner deux mais vous ne suivrez ni l’un ni l’autre, n’est-ce pas ?
– C’est selon. Dites toujours !
– Le premier est d’aller confier votre histoire à la police. Je peux, si vous le voulez, vous mettre en relations avec le commissaire principal Langlois et je serais fort étonné s’il ne vous débarrassait pas du marquis !
– La police ? Oh non ! À aucun prix ! Voyons le deuxième conseil !
– Je vous l’ai déjà donné partez ! Allez vous réfugier quelque temps en Angleterre – j’y ai un ami à Scotland Yard – ou encore en Suisse…
Un grand sourire éclaira soudain le beau visage :
– Pourquoi pas en Italie ? À Venise par exemple ? Ainsi vous pourriez veiller sur moi… discrètement ? Votre femme n’est certainement pas jalouse au point de vous interdire toute amitié féminine ?
Il eut un haut-le-corps et fronça le sourcil.
– Ma femme n’a jamais eu l’occasion d’être jalouse, fit-il sèchement en sachant parfaitement qu’il mentait et qu’au temps où elle jouait auprès de lui les secrétaires « hollandaises et fagotées », comme lors de son désastreux mariage polonais (7), Lisa avait eu plus que son compte d’occasions d’être jalouse. Aussi se refusait-il farouchement à lui en fournir d’autres. Il savait qu’elle avait confiance en lui et Lisa elle-même lui était trop précieuse pour risquer de l’écorner si peu que ce soit en installant à sa porte une aussi affriolante créature. Celle-ci d’ailleurs compléta sa pensée en constatant avec tristesse :
– … mais vous ne souhaitez pas la mettre à l’épreuve et je serais sans doute gênante.
– N’en croyez rien, dit-il gentiment, mais vous seriez déracinée chez nous, où nous subissons un gouvernement dictatorial, en dépit de la présence du roi. Les étrangers y sont tenus sous une surveillance peu agréable. Croyez-moi, l’Angleterre vaudrait mieux ! Sinon… le seul conseil que je puisse vous donner est de sortir le moins possible. À moins de chercher refuge auprès de votre ami Félix ? Et, à ce propos, pourquoi ne pas rejoindre à Londres la princesse Irina ?
– Elle ne m’aime pas et je ne suis pas sûre de l’aimer !
Aldo retint un soupir découragé :
– Alors restez chez vous ! N’en bougez pas et attendez de mes nouvelles. Je vais essayer de savoir ce que fait au juste votre bel ami…
Quelques minutes plus tard, Aldo retrouvait le colonel Karloff et son taxi avec une sensation de soulagement qu’il se reprocha comme indigne de lui. Lisa n’aimerait pas qu’il devînt égoïste et laisse dans la détresse une femme dont le seul tort était d’être trop belle !… Alors, bien sûr, il l’aiderait… mais à condition qu’elle s’aidât elle-même et consentît à écouter des conseils de sagesse !
En attendant et ainsi qu’il en avait émis l’idée, lui et Karloff s’attablèrent dans un petit café de la rue Saint-Dizier qui restait ouvert la nuit et qui, selon l’ancien colonel, faisait un très bon café. Naturellement, on parla de Tania Abrasimoff, Karloff représentant une assez bonne source d’informations. Par lui, Aldo eut une précision sur l’ancienne adresse de la jeune femme et sut du même coup que l’appartement était au nom d’Agalar et que, très certainement, il était revenu y habiter.
– Si ça vous intéresse, je peux le surveiller discrètement, moyennant une honnête rétribution bien entendu, car je n’ai plus, hélas, les moyens de faire de cadeaux…
– Cela va de soi mais j’aimerais mieux que vous me la surveilliez, elle. Cet homme la terrifie. Cependant je ne suis pas certain qu’elle se résignera à rester chez elle. Il faut avouer que l’appartement est sinistre…
– Oh, pour elle, vous devriez vous contenter d’acheter son concierge. Dans ces immeubles, même si les appartements sont lugubres, les pipelets ont en général le téléphone… Et dans ce couple, c’est lui le plus intéressant…
– D’accord. Je verrai demain. Un autre café ?
– Volontiers. Il est bon, n’est-ce pas ?
En réalité il n’était pas meilleur que les autres mais, en revanche, le calvados dont Karloff l’arrosait était excellent. En matière d’alcool on pouvait faire confiance à un Russe de bonne maison et Aldo se laissa facilement convertir à la religion du café-calva chère à presque tous les chauffeurs de taxi. C’était incontestablement revigorant. Aussi en rentrant rue Jouffroy se sentait-il plutôt optimiste et enclin à voir l’avenir sous les tendres couleurs de l’aurore. Après avoir rompu quelques lances afin de rendre la paix du cœur à la belle comtesse, il regagnerait les splendeurs de son palais vénitien où l’attendaient le sourire de sa femme… et les hurlements des jumeaux. L’instant présent l’attirait plus volontiers vers son lit pour y trouver les délices d’un sommeil réparateur. Force lui fut cependant de constater que ce ne serait pas pour tout de suite.
En dépit de l’heure tardive, Adalbert n’était pas couché. Vêtu d’une vieille veste d’intérieur en velours à brandebourgs, les pieds dans des charentaises, il arpentait son cabinet de travail en déclamant :
Corrige-toi devant tes propres yeux et
Prends garde de te faire corriger par un autre.
Si tu es un homme vertueux,
Fonde un foyer,
Épouse une femme forte,
Il te naîtra un fils.
Construis une maison pour ton fils…
– Merci, grogna Morosini, c’est déjà fait. Qu’est-ce qui te prend ? Tu fais ton testament ou tu prends à retardement les bonnes résolutions que l’on décide au début de l’année ?
Arrêté dans son élan lyrique, l’œil accusateur sous sa mèche en désordre, Adalbert proféra :
– Barbare ! Comment peux-tu traiter avec cette désinvolture un superbe texte qui vient du fond des âges et que je viens d’avoir le bonheur de traduire !
– Du fond des âges ?
– La IVe dynastie, ignorant ! Il s’agit d’une partie de l’enseignement d’Hergedel, le fils du grand Khéops ! Un sage s’il en fut et dont chaque homme devrait s’inspirer…
– Mais c’est qu’il a l’air d’y croire ! Adalbert, mon bon, redescends sur terre et considère avec magnanimité les pauvres mortels qui la peuplent ! Et si cet « enseignement » te paraît tellement sublime, que ne t’en inspires-tu ? Marie-toi à… une femme forte et…
– Je les préfère fines et délicates. Je déteste les viragos ! Mais, au fait, d’où sors-tu à pareille heure ? Il est près de trois heures…
– Aussi n’ai-je qu’une envie, c’est d’aller dormir… si toutefois tu consens à mettre la pédale douce à ton lyrisme !
– Je crois que je vais t’imiter, fit l’archéologue en rejetant sur son bureau le papyrus qu’il avait à la main.
Mais ce fut pour y prendre un grand bristol superbement armorié :
– Tiens, je viens de recevoir des invitations pour nous deux…
– Pour nous deux ? Il faudrait que l’on sache que je suis chez toi. De qui ces invitations ?
– Du prince Karam, le plus jeune fils du maharadjah de Kapurthala. Son père donne une fête le 15 avril prochain dans son château du bois de Boulogne. J’y suis invité et le prince ajoute que son père et lui-même seraient infiniment honorés si tu consentais à m’accompagner. Ils croient savoir en effet que tu séjournes chez moi en ce moment. Il y a d’ailleurs un carton pour toi…
– Comment savent-ils que je suis ici ?
– Cela, le prince Karam ne le dit pas. Une sorte de mystère… et tu adores les mystères.
– Sauf ceux me concernant directement. Et puis le 15 avril j’espère bien être rentré chez moi.
– On ne peut jurer de rien et il faut répondre. Si j’étais toi j’accepterais. Une fête chez le maharadjah est toujours un grand plaisir et pour un homme comme toi c’est intéressant. Enfin, si d’aventure Lisa s’attardait à Salzbourg…
– Ah, je t’en prie ! Pas de pensées négatives ! Tu sais quelle hâte j’ai de la retrouver…
– Et superstitieux avec ça ! Écoute, tu peux toujours accepter, quitte à te décommander avec force lamentations si tu es déjà parti. À moins que tu ne reviennes ? Crois-moi, cela vaut le voyage !
– On verra ça !
CHAPITRE V
UNE VENTE MOUVEMENTÉE
Comme toujours lorsque la vente était d’importance, la grande salle de l’hôtel Drouot faisait le plein. Il n’avait fallu que peu de jours à la presse pour s’emparer de la « Régente » et lui tisser, à grands fracas d’articles à sensation, une histoire – au plutôt des histoires – qui n’avaient pas grand-chose à voir avec la réalité. L’étude de Maître Lair-Dubreuil s’était contentée de signaler l’achat par Napoléon pour Marie-Louise, le passage chez l’Impératrice Eugénie et, lors de la vente des joyaux de la Couronne, l’achat par un joaillier qui l’avait revendue à un membre de la famille impériale russe sans autres précisions. Comme il le souhaitait le nom du prince Youssoupoff ne fut pas évoqué… jusqu’à la veille de la vacation cependant où, renseigné on ne sait comment, un journaliste du Matin, Martin Walker, avait titré sur quatre colonnes : « La Perle sanglante » avec, en sous-titre « Raspoutine venait la chercher chez Youssoupoff : il a trouvé la mort. » Suivait un article, pas mal fait d’ailleurs, où Morosini put lire avec une stupeur incrédule ce que lui avait raconté le prince Félix avec, naturellement, les « enjolivures » rituelles. Entre autres celle-ci : il était convenu entre Youssoupoff et Raspoutine que la princesse Irina – que le staretz brûlait d’approcher enfin ! – lui ferait elle-même l’hommage de la perle qu’elle porterait sur sa gorge, d’où il aurait le droit de la détacher…
– Seigneur ! s’écria-t-il en froissant le journal qu’il envoya rouler à terre, où diable ce type est-il allé chercher cela ?
– Comme tu dis : le diable seul le sait ! soupira Vidal-Pellicorne en ramassant le quotidien, mais ce genre de truc marche d’autant mieux que c’est mélangé à la vérité…
– En tout cas, si je peux mettre la main sur ce Martin Walker, il faudra bien qu’il me crache ses sources !
C’est donc animé des intentions les plus belliqueuses qu’Aldo se rendit à la salle des ventes, flanqué d’un Adalbert qui n’eût manqué le spectacle pour rien au monde.
Ils eurent quelque peine à atteindre le saint des saints et c’eût été impossible sans l’aide d’un des commissionnaires savoyards et musclés qui assuraient l’ordre et s’efforçaient de canaliser la ruée des amateurs de sensations fortes. Il y avait tellement de monde que ce n’était pas une mince affaire d’extraire de la foule les porteurs de cartes d’invitation, et la direction de l’hôtel Drouot dut faire appel à la police pour éviter l’émeute…
Elle était cependant déjà sur place et, en émergeant dans les premiers rangs des chaises disposées pour les acheteurs éventuels, Aldo se retrouva nez à nez avec le commissaire Langlois, toujours tiré à quatre épingles selon son habitude et qui feuilletait tranquillement le catalogue de la vente où l’on avait, en hâte, ajouté un feuillet pour la « Régente ». Les deux hommes se saluèrent avec, chez le policier, un rien d’ironie :
– Je constate avec plaisir que vous êtes toujours notre hôte, prince…
– Ce n’est pas une surprise, j’espère ? Ou bien n’ai-je pas reçu votre autorisation de rentrer chez moi ? À moins que vous ne m’ayez simplement oublié ?
– On ne vous oublie pas facilement mais il se pourrait que votre… quarantaine prenne fin aujourd’hui.
Puis sur un ton plus sec :
– C’est la curiosité qui vous amène ici ?
– Non, fit Aldo rendant sécheresse pour sécheresse. « Mon métier ».
– Vous venez acheter la fameuse perle ?
– Je n’aime pas beaucoup les perles et n’ai d’ailleurs aucun client pour celle-ci.
– Un joyau historique ? Vous le dédaignez ? C’est surprenant ! N’est-ce pas plutôt parce qu’il s’agit là de ce que les receleurs et les gens de la profession appellent un « bijou rouge » ?
– Oh, vous savez ! Presque toutes les pièces historiques en font partie. Serait-ce le cas de la « Régente » ?
– Comme si vous ne le saviez pas ! Allez-vous me faire regretter mes bonnes dispositions ?
– Vos bonnes dispositions ?
Le visage de Morosini était à cet instant un poème de candide indifférence. Langlois eut même droit à un beau sourire qu’il n’eut pas tellement l’air d’apprécier :
– Celles qui m’incitaient à vous laisser reprendre dès ce soir l’Orient-Express à destination de Venise. Voyez-vous, prince, je suis persuadé que c’est la « Régente » que le pauvre Piotr Vassilievich cachait dans sa cheminée et que vous le savez parfaitement, parce que c’est vous qui l’avez trouvée…
– D’où le prenez-vous ?
– Dans mes convictions et aussi dans certaines figures que j’aperçois parmi le public. Tenez ! Voyez-vous là-bas votre amie Masha Vassilievich accompagnée de deux de ses frères ? Cela m’étonnerait qu’elle vienne acheter. Alors pourquoi est-elle là ?
– Parce que l’on ne vend aujourd’hui que des bijoux russes. Une façon comme une autre de reprendre l’air du pays ! Du moins je suppose…
– Vous avez réponse à tout, n’est-ce pas ? fit le policier avec un petit rire. Mais, au fond, je ne comprends pas pourquoi vous me refusez si obstinément la vérité. Ce n’est pas vous l’assassin du tzigane. Vos raisons m’échappent, je l’avoue.
– Eh bien, je vais vous expliquer ma présence : il y a dans cette vente une émeraude dont on dit qu’elle a appartenu à Ivan le Terrible et je souhaite l’acquérir pour un collectionneur…
Un instant Langlois considéra l’homme élégant et désinvolte qui lui faisait face. Difficile de trouver la vérité sous ce beau masque à la fois aimable et impénétrable. Il haussa les épaules :
– Après tout, c’est peut-être vrai ?… Tiens, voilà le responsable de cette cohue !
L’œil inquisiteur, le cheveu blond en bataille, assez grand et solidement bâti sous le costume de tweed de bonne coupe quoiqu’un peu fatigué, un homme d’une trentaine d’années se frayait un chemin à travers la foule sans trop se soucier de ce qu’il bousculait. Mais sa méthode était énergique et il eut bientôt rejoint les deux hommes :
– Toujours à la recherche de votre assassin, commissaire ? Vous espérez le trouver ici ?
– Pourquoi pas ? Il doit aimer les bijoux et il y a ici de quoi flairer ! Je vous présente Martin Walker, prince, et j’espère que vous avez apprécié son article à sa juste valeur.
– « La Perle sanglante » ? Efficace, sans doute… mais pas très nouveau. Ce qui l’est davantage, c’est la belle imagination dont vous avez fait preuve…
Le journaliste fronça le sourcil :
– À qui ai-je l’honneur… oh non, inutile de me dire qui vous êtes ! Le prince Morosini, je présume ?
– Vous présumez bien. Je fréquente peu la presse cependant.
– Mais elle vous apprécie. Vous êtes de ces gens précieux grâce à qui nous pouvons parfois faire rêver des millions de lecteurs ! L’homme qui connaît le mieux au monde les bijoux historiques ! Vous venez acheter la perle ?
– Non. Rien qu’une émeraude.
– Tout aussi sanglante si, comme le prétend le catalogue, elle a appartenu à Ivan IV ?
Ce fut au tour des sourcils d’Aldo de remonter avec un rien d’insolence :
– Comment ? Vous qui aimez tant les titres à sensation, vous lui donnez platement son matricule !
Walker se mit à rire, ce qui lui enleva une quinzaine d’années.
– Me voilà pris en flagrant délit de culture historique ! Pardonnez-moi !… Ah, on dirait que les choses commencent à s’arranger et nous allons pouvoir démêler les personnalités du menu fretin.
Peu à peu, en effet, le désordre refluait et la salle, si elle restait bruyante, prenait son habituel visage policé. Naturellement et comme ses deux compagnons, Aldo s’intéressa à ceux qui la composaient et parmi lesquels il fallait distinguer les curieux qui n’achèteraient rien mais formeraient le fond du tableau, de jolies femmes actrices de théâtre ou de cinéma qui, elles, venaient se montrer et peut-être se laisser tenter, les représentants de deux ou trois grands joailliers, des membres de la colonie russe venus cultiver leur nostalgie. Parti pour son domaine de Corse le prince Youssoupoff n’y était pas mais Aldo reconnut une de ses proches, la princesse Murat (8) qu’il se promit d’aller saluer tout à l’heure, elle qui ne manquait jamais une vente proposant des souvenirs napoléoniens. Ce qui était le cas de la « Régente ». Des collectionneurs enfin : deux Rothschild, Nubar Gulbenkian et quelques autres de moindre importance mais l’attention de Morosini les oublia vite pour se fixer sur un groupe de trois personnes qu’il n’eut aucune peine à reconnaître : le milliardaire Van Kippert, sa fille et le marquis d’Agalar, sombrement beau à son habitude, qui courtisait de toute évidence la jeune Muriel et son imposante dot. Aldo n’aurait jamais cru que cet arrogant visage put produire autant de sourires. Il est vrai que cela lui permettait de montrer l’éclat neigeux de ses dents. La jeune Américaine semblait fascinée…
Adalbert, qui s’était attardé auprès d’un grave personnage barbu orné d’une énorme rosette de la Légion d’honneur, rejoignit à cet instant la place qu’Aldo lui gardait.
– Je me demandais si tu allais le quitter un jour, murmura celui-ci. C’est un parent ?
– Penses-tu ! C’est un académicien et c’est lui qui m’avait présenté La Tronchère. Je voulais apprendre de lui s’il savait où se trouve actuellement ce sacripant car, bien entendu, il n’y a plus personne rue du Mont-Thabor…
– Et il le sait ?
– Mon voleur serait à Bagdad.
– Patrie de tous les voleurs bien nés depuis le fameux film de Douglas Fairbanks ! fit Morosini en riant. Ton académicien va trop au cinéma.
– Ça pourrait être vrai, grogna Adalbert. Je te l’ai dit, ce truand serait « mésopotamologue », seulement quelque chose me dit aussi que Fructueux n’est pas parti si loin. Je le sens…
– On en reparlera plus tard. La vente commence.
Le commissaire-priseur entamait en effet un petit discours destiné à mettre en valeur les pièces qu’il s’apprêtait à vendre. Après quoi les enchères commencèrent sur une parure de très beaux camées enrichis de diamants ayant appartenu à une princesse et qui atteignit rapidement une somme rondelette, puis l’on passa à des sautoirs de perles dont Aldo se désintéressa. Son regard ne quittait le noble espagnol que pour fouiller le public tant il craignait de repérer le visage de Tania parmi les autres. Jusqu’à présent, elle se tenait tranquille mais Aldo, qui était allé la voir la veille, n’était pas certain que cette sagesse dure encore longtemps. Réduite à la seule compagnie de Tamar qui lui tirait les cartes quand elle ne se prosternait pas devant les icônes, la belle comtesse s’ennuyait et ne le cachait pas :
– Je ne vais pas rester enfermée toute ma vie ?
– Cela ne fera jamais que cinq jours. Soyez un peu patiente. Si Agalar mène ses projets à bien, il partira pour les États-Unis et vous pourrez faire des plans d’existence…
Le bruit courait en effet d’un prochain mariage entre miss Van Kippert et le beau marquis, et s’il en jugeait par ce qu’il voyait, la rumeur – rapportée par Gilles Vauxbrun – pourrait bien avoir raison.
Au bout d’un instant, il fallut revenir aux mouvements du marteau d’ivoire : un assistant de Maître Lair-Dubreuil apportait la grande émeraude carrée à laquelle Aldo était censé s’intéresser.
C’était, en vérité, une admirable pierre et l’amateur passionné de joyaux se réveilla. À sa manière nonchalante, il suivit d’abord le jeu des enchères puis le mena quand il ne resta plus en face de lui que le baron Edmond de Rothschild. Le duel passionna la salle et elle éclata en applaudissements quand le prince-antiquaire l’emporta : le baron se retira avec un sourire et un geste aimable de la main.
– Tu es fou ? souffla Vidal-Pellicorne. J’espère que tu as un client ?
– Pourquoi pas moi ? Je collectionne, tu sais ? Et celle qui ne quitte pas l’annulaire de Lisa est au moins aussi belle si elle est plus moderne.
– Tu vas la lui offrir ?
– Oh, que non ! Si elle a vraiment appartenu à Ivan, ce n’est pas un cadeau à faire à la femme qu’on aime. Il se trouve que j’ai un client. Inattendu d’ailleurs. Avant de partir j’ai reçu un courrier du palais de Venise (9) : le Duce, qui m’a tout l’air de se prendre pour Néron, désire que je lui trouve une émeraude ayant appartenu à un personnage illustre…
Adalbert émit un petit sifflement :
– Difficile de dire non. Et… tu es sûr que tu seras payé ?
– Je pense, oui. Nous avons encore un roi et Mussolini ne peut pas se permettre, tant qu’il est là, de jouer les bandits de grands chemins…
Vint enfin le moment que tous attendaient. La « Régente » fut apportée au commissaire-priseur qui d’abord la fit présenter, escortée de deux Savoyards, à ceux des acheteurs éventuels qui le souhaitaient. Un murmure, où Aldo décela du respect, parcourut ces gens sur qui semblait s’étendre l’ombre de l’Empereur. Les enchères s’égrenèrent dans un grand silence et opposèrent d’abord cinq prétendants. Elles montèrent vite, décourageant l’un après l’autre plusieurs acheteurs. Il en resta trois puis deux : cette fois il s’agissait de Gulbenkian et de Van Kippert qui ne cachait pas que la grande perle était l’unique but de sa présence. Ce fut lui qui l’emporta mais, dès que la « Régente » lui eut été adjugée, il se dressa debout, les bras levés dans un geste de victoire. Un coup de feu éclata. Il s’écroula tandis que la salle entière se levait en criant.
Un instant, le tumulte fut indescriptible. Tout le monde voulait voir et le commissaire Langlois dut jouer des poings pour s’ouvrir le passage jusqu’au corps étendu sur lequel Muriel s’était abattue secouée de sanglots.


