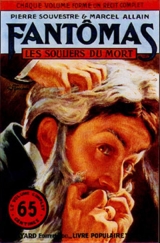
Текст книги "Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Le courtier en vins se promenait de long en large, se frottant les mains, embrassant sa femme de minute en minute.
– Tiens, déclara Fernand Ricard, c’est le plus beau jour de ma vie. Nous allons toucher cent mille francs, hein, tu entends ? Cent billets de mille francs. Ose encore soutenir que je ne suis pas un malin ? Que je n’ai pas tout combiné ? Que tu as des remords ?
– Écoute, ce ne sont pas des remords que j’ai maintenant, c’est…
– C’est quoi ?
– Ce sont des pressentiments.
– Bah, disait-il, des pressentiments de quoi ? Des pressentiments ? Pourquoi ? Ça ne rime à rien les pressentiments. Je te dis que le plus dur est fait et que tout marchera comme sur des roulettes.
– Oh, tu n’étais pas si fier tout à l’heure, en rentrant.
– Moi ? Allons donc.
– Si. Tu m’as dit en dînant, et je rappelle là tes propres paroles : « Cette histoire de malle verte est affolante. »
Alice Ricard regardait son mari bien en face ; le courtier en vins eut un geste ennuyé, se passa la main sur le front. Évidemment, toute sa bonne humeur de l’instant précédent disparaissait. Il toussa, marcha plus vite, puis s’arrêtant :
– On boit un verre de champagne ? proposa-t-il. Hein, ça vaut bien cela, il me semble.
Et se forçant à être gai, il ajouta :
– Car enfin, ce qu’il y a de plus clair en ce moment, dans toutes ces histoires, c’est que l’assurance paye et que si nous le voulons, nous toucherons immédiatement les cent mille balles.
Alice Ricard ne répondit pas. Déférant au désir de son mari, elle avait été chercher une bouteille de champagne et deux coupes.
Bientôt le vin mousseux pétillait dans le cristal. Fernand Ricard but d’un trait, puis recommença à se promener de long en large :
– Oui, c’est ennuyeux en effet, dit Fernand.
– C’est très ennuyeux, dit Alice.
Le courtier se laissa tomber sur une chaise, mit ses coudes sur ses genoux, se prit le front à deux mains.
– Très ennuyeux, car enfin cette malle verte, nous ne savons pas d’où elle vient, qui l’a envoyée, et à quoi elle rime ? Qu’en penses-tu ? C’est peut-être une coïncidence fortuite ? Après tout, il doit y avoir de par le monde bien des malles tachées de sang. On en trouve une, on croit qu’il s’agit de celle ayant servi à transporter le cadavre de l’oncle, et ma foi…
– Non, tu dis des bêtises.
Il se tut, se leva, alla boire encore un verre de champagne, puis brutalement, déclara :
– Les coïncidences, vois-tu, Alice, ça ne paraît acceptable qu’aux imbéciles. Les coïncidences, ça n’existe pas.
Et plus bas encore, buvant un troisième verre de champagne, ce qui lui mettait le sang aux joues, Fernand Ricard continuait :
– D’ailleurs, si la découverte d’une malle verte tachée de sang pouvait être une coïncidence, il y a quelque chose qui ne peut pas dépendre du hasard : c’est que cette malle verte ait été expédiée précisément à une nommée Brigitte, c’est-à-dire à une ancienne bonne de l’oncle.
Il se tut. Alice Ricard frissonna, puis demanda :
– Alors, ça te fait peur à toi aussi ?
– Oui, répondit Fernand Ricard, cela me fait peur.
Le silence qui pesait alors dans la petite pièce si tranquille, si calme, avait quelque chose de lugubre, de sinistre, de menaçant.
Il était si pénible même à supporter qu’Alice Ricard, la première, éprouva comme un secret besoin de le rompre, coûte que coûte.
– Tu as peur, hein ? Tu reconnais que tu as peur ? Oh, c’est affreux vois-tu de trembler comme nous allons trembler maintenant. Cette malle, je te dis que ça cache quelque chose. Cette malle verte, elle doit avoir une signification. Il faudrait…
La jeune femme paraissait désespérée, Fernand Ricard se releva :
– Alice, ma petite, commença le courtier, quand on a fait ce que nous avons fait tous les deux, on n’a pas le droit de geindre, et l’on est des imbéciles si l’on perd la tête. La découverte de cette malle verte qui vient nous ne savons d’où, qui est envoyée par nous ne savons qui, est inquiétante. Bon, cela je te l’accorde. Mais enfin, ce n’est pas un motif pour croire que tout est perdu. Jouons serré, voilà tout.
Alice Ricard ne répondit point. La jeune femme s’était emparée, machinalement, de la lettre de l’assurance qui traînait sur la table. Elle la relisait avec attention.
– Donne-moi cela, commanda Fernand Ricard, ce n’est pas la peine de laisser traîner ce papier, et puis, nous avons autre chose à faire.
– Quoi donc ? répondit Alice Ricard, levant les yeux vers son mari.
– Dame, il me semble que je ne devrais pas avoir besoin de te l’expliquer. Cela s’impose. On a trouvé une malle verte, on croit que c’est la malle du crime, reste à faire disparaître la malle jaune.
– Tu as raison, murmura la jeune femme. Mais enfin, ce n’est pas ici qu’on viendrait la chercher.
Et comme Fernand Ricard ne répondait pas, Alice insista :
– Tu n’as pas peur d’une perquisition hein ? On ne nous soupçonne pas ?
– Il faut tout prévoir.
Fernand Ricard sortit alors de la salle à manger où sa femme demeurait seule. Il descendit dans la cave de la maison :
– Le fourneau de la cuisine brûle encore ? demanda-t-il quelques instants plus tard, en réapparaissant, tenant à bout de bras une valise.
– Oui, répondit Alice. Pour quoi faire ?
– Tiens, tu vas voir.
Tenant la lampe, éclairant son mari, Alice Ricard précéda le courtier dans la cuisine de la villa.
Le fourneau était encore rouge, il y avait encore du charbon à l’intérieur de la grille.
– Aide-moi, commanda le courtier.
Il avait ouvert la valise, il en tirait les débris d’une malle, d’une malle jaune, de la malle jaune dont on avait tant parlé au cours de l’enquête.
– Tu vas tout brûler ?
– Ma foi, oui. Le feu ne laisse pas de traces.
Aidé de sa femme, le courtier, en effet, jeta un par un les morceaux de la malle sinistre dans le foyer. Cela flambait terriblement, cela ronflait. Il fallut bien peu de temps pour brûler la malle entièrement.
– Maintenant, déclara Alice Ricard lorsque le dernier morceau de bois eut été précipité dans le feu, nous n’avons plus rien de compromettant ici ?
– Non, rien, ripostait Fernand.
Mais, en disant cela, le courtier se penchait sur le fourneau de cuisine et tisonnait vigoureusement les cendres.
– Qu’est-ce que tu cherches ? questionna Alice.
– Je regarde s’il ne reste aucun débris.
Au moment où il disait ces mots, le courtier en vins se mordait les lèvres :
– Bon sang, dit-il, ah bien, j’ai joliment été inspiré de regarder ! Voilà quelque chose à quoi nous ne pensions pas.
Du bout de sa pincette, Fernand Ricard tirait des cendres un objet tordu, noirâtre, impossible à définir.
– Qu’est-ce que c’est ?
– La serrure, ma chère, la serrure de la malle. Il n’en faut pas plus pour faire prendre les gens. Et, ma foi je t’avoue que, cependant, je n’avais pas pensé à cela. Parbleu, c’est du fer, le feu n’allait pas le brûler.
– Alors, qu’est-ce que tu vas en faire ?
– Je vais le jeter dans le puits.
– Maintenant ?
– Oui, maintenant, pourquoi pas ?
– Tu vas me laisser seule pour aller au jardin ?
– Dame, évidemment ! Mais qu’est-ce que cela te fait ?
– J’ai peur.
Le courtier regarda sa femme dans les yeux :
– Pas d’enfantillage, hein, commanda-t-il.
Et sans plus se préoccuper de la jeune femme, il descendit au jardin.
Quelques minutes plus tard, Fernand Ricard rentrait dans la salle à manger où Alice l’attendait.
– Voilà, dit-il, c’est fait. La serrure est au fond du puits. On n’ira pas la chercher là.
Il semblait plus joyeux, plus tranquille. Comme sa femme ne lui répondait rien, Fernand Ricard reprit la parole :
– D’abord, vois-tu, dit-il, nous sommes des imbéciles de nous faire du mauvais sang. En somme, quelle est la situation ? Qu’est-ce qui se passe ? Mais rien que des choses favorables pour nous. Nous pouvions craindre qu’on recherche la malle jaune, crac, on trouve une malle verte ! Nous pouvions avoir peur d’être soupçonnés. Ah, je t’en fiche, le chef de la Sûreté lui-même fait arrêter le petit Théodore et la bonne Brigitte. Nous sommes vraiment bien bêtes de nous plaindre. Fatalement, on devait chercher des assassins. Or, la police tient des coupables. Ma foi, nous n’avons qu’à laisser aller et qu’à charger nous-mêmes ceux qui ont la malchance d’être déjà compromis.
Alice Ricard ne répondant toujours pas, son mari voulut la forcer à sortir de son silence :
– Tu n’es pas de mon avis ? demanda-t-il. Tu ne trouves pas que c’est excellent qu’on ait arrêté Théodore et Brigitte ? Eh bien, qu’est-ce que tu as ?
– Rien, j’écoute.
– Quoi ?
– Tu n’as pas entendu du bruit au jardin ?
– Au jardin ? Tu es folle.
Fernand Ricard s’était levé, il prêtait l’oreille, cependant que sa femme, anxieuse, joignait instinctivement les mains :
– Il n’y a pas de bruit. On n’entend rien.
– Si, on a marché.
– Tu rêves.
Il prit pourtant la lampe, s’approcha de la fenêtre. Fernand Ricard ouvrit les rideaux, regarda dans le jardin, blêmit en se penchant :
– Oh tu as raison, fit-il, voilà quelqu’un.
– Mon Dieu !
Brusquement, Fernand Ricard mit la main sur la bouche de sa femme.
– Tais-toi donc, c’est peut-être une visite.
Au même instant, la sonnette de la porte d’entrée retentissait :
– Je vais ouvrir, dit le courtier en vins.
Un instant plus tard, Alice Ricard, demeurée seule dans la salle à manger, entendit un cri d’épouvante. La porte de la maison s’était ouverte brusquement, avait-elle cru, et, tout de suite, un cri avait retenti. Oh, ce cri, il avait résonné jusqu’au plus profond de l’âme d’Alice Ricard.
– Fernand, appela la jeune femme, Fernand !
Malgré sa peur, elle voulut courir en avant. Mais, au même instant, la porte de la salle à manger s’ouvrait. Dans la demi-obscurité qui régnait dans la pièce, car un rayon de clair de lune filtrait à travers les rideaux, Alice Ricard vit entrer deux hommes :
L’un était son mari, blême, qui tenait à la main la lampe éteinte. Derrière lui venait un inconnu, grand, mince, vêtu de noir. Alice ne put distinguer son visage, car il se rencognait dans l’ombre. Au même instant, la voix de Fernand Ricard, une voix qui tremblait, qui était presque indistincte, s’éleva :
– Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ? Pourquoi avez-vous éteint ma lampe ? Si vous ne partez pas, j’appelle au secours.
Il parut à Alice Ricard que l’inconnu ricanait à ces mots.
– Taisez-vous, dit simplement l’homme noir.
« Mon Dieu, songeait la jeune femme, c’est assurément un homme de la police, on vient nous arrêter. » Au même instant, l’inconnu prit la parole :
– Fâché de vous déranger, dit-il d’une voix grave et étrangement railleuse, fâché de me présenter ainsi chez vous, monsieur Ricard, en éteignant votre lampe, en forçant votre porte, mais, ma foi, je n’avais pas le choix des moyens, et puis, pour ce que nous avons à nous dire, il n’est pas besoin d’y voir.
L’inconnu ricanait encore, et tranquillement, comme s’il eût été chez lui, conseillait :
– Mais prenez donc des sièges, et causons.
Il s’était assis lui-même, et c’est seulement quand Alice Ricard et Fernand, fous de peur, se furent laissé choir sur un divan, que l’étrange et mystérieux homme noir ajouta :
– Maintenant, comprenez bien qu’il va de votre intérêt de me répondre en toute franchise.
– Qui êtes-vous ? interrompit encore le courtier. Que me voulez-vous ? Sortez.
Mais les mots s’étranglaient dans sa gorge. L’inconnu, tranquillement, avait mis la main à sa poche et en tirait un revolver :
– Monsieur Ricard, dit-il, il ne faut pas être indiscret avec moi. Cela porte malheur. Je me réserve de vous interroger, mais je ne vous permets pas de me poser des questions. Est-ce compris ?
Fernand Ricard baissa la tête. La sueur coulait de son front. Quant à sa femme, elle était à demi morte.
– Donc, reprit l’inconnu, causons ! Votre oncle Baraban, n’est-il pas vrai, est à l’heure actuelle, mort, coupé en morceaux, expédié quelque part. C’est ce que vous croyez ? C’est ce que vous savez ?
Fernand Ricard à cette question, pâlissait plus encore.
Depuis l’arrivée de l’inconnu, il redoutait que cet homme noir ne vînt lui parler de l’affaire Baraban. En entendant prononcer le nom du vieillard, il éprouvait pourtant un choc douloureux, une émotion torturante. Que devait-il répondre ?
Fernand Ricard, talonné par la peur, pensant lui aussi à la police, domina cependant son émotion.
– Je ne sais pas qui vous êtes, déclarait-il. Mais cependant, je vous répondrai, car je n’ai rien à cacher. Oui, mon pauvre oncle doit être mort, nous en avons bien peur, ma femme et moi.
– Pauvres gens ! La mort de cet oncle chéri vous rapporte un gros héritage, n’est-il pas vrai ?
Mais à cette question précise, le courtier en vins bondit plus qu’il ne se leva.
– Non, dit-il, ça n’est pas vrai. Mon oncle n’avait pas de fortune, sa mort ne nous rapporte rien.
Il se hâtait trop peut-être de se défendre. L’inconnu se dressait lui aussi :
– Taisez-vous ! ordonna-t-il rudement. Vous dites des stupidités. Il est absolument inutile, monsieur Ricard et madame Ricard, de croire que je parle au hasard. Je ne dis rien que je ne sache, la mort de votre oncle vous fait riches.
– Non.
– Silence ! Elle vous fait riches, et c’est pour cette richesse enviée que vous n’avez pas hésité devant un crime.
– C’est faux ! hurla le courtier.
Fernand Ricard ne pouvait cependant articuler une phrase, il dut se taire car les mots s’étranglaient encore une fois dans sa gorge. L’inconnu continua tranquillement :
– Vous êtes donc, vous, Fernand Ricard et vous, madame, d’épouvantables crapules, de lâches assassins, vous méritez le bagne, pis je pense : la guillotine. Donc, reprenait le mystérieux visiteur, vous allez être riches par le fait du décès de M. Baraban. Très bien ! Le coup était merveilleusement combiné et je vous en félicite, mais…
– Mais ?
– Mais, continua le visiteur, il se trouve que je suis au courant de toute votre machination.
– Ce n’est pas vrai ! Nous sommes innocents !
L’inconnu parut ne pas tenir compte de cette dernière protestation :
– Je viens donc vous déclarer ceci, continua-t-il. De deux choses l’une : ou vous allez accepter de partager votre héritage, et dans ce cas, je ne dirai rien, ou vous allez refuser de vous entendre avec moi, et dans ce cas, je vous préviens que je m’arrangerai pour vous dépouiller entièrement. Acceptez-vous ? Je vous offre la moitié de la fortune si vous vous exécutez de bonne grâce, je prends tout au cas contraire.
L’inconnu, sur ces étranges paroles, se tut.
« C’est un piège », songeait Fernand Ricard, « cet individu doit appartenir à la police et il m’offre cela pour me faire avouer ».
Brusquement, Fernand Ricard répondit :
– Je ne comprends rien à vos paroles. Je nie de toutes mes forces être pour quoi que ce soit dans la mort de mon malheureux oncle. Jamais je n’accepterai un compromis semblable à celui que vous me proposez. Il me fait simplement croire que c’est vous, vous, qui êtes l’assassin.
Fernand Ricard allait parler encore. L’homme, sans insister, répliqua :
– Monsieur Ricard, écoutez ceci : je viens vous voir par honnêteté, parce que j’avais scrupule à vous dépouiller de votre butin. Vous me refusez ce que je vous demande. Tant pis pour vous. Comprenez-moi bien : d’aujourd’hui il y a guerre entre vous et moi et je n’ai jamais été vaincu. Je vous offrais la moitié de la fortune de l’oncle Baraban, la moitié du moins de ce que sa mort vous rapportera, vous me la refusez. Tant pis pour vous, j’aurai tout.
L’inconnu, sur ces mots, salua brusquement.
– Serviteur, dit-il.
Et, avant qu’Alice et Fernand Ricard eussent pu faire un mouvement, plus rapide que la pensée, il bondissait vers la fenêtre, écartait les rideaux, sautait dans le jardin, se perdait dans la nuit.
Une heure plus tard, Fernand Ricard et sa femme, étaient encore debout, immobiles, ils n’avaient osé ni un geste, ni une parole.
Alice la première, rompit ce silence tragique :
– Fernand, Fernand, j’ai peur !
Et Fernand Ricard répondit :
– J’ai peur, moi aussi !
12 – IL FRÉQUENTAIT LE « CROCODILE »
Fandor avait quitté Juve à trois heures du matin la nuit même où Alice et Fernand Ricard recevaient à Vernon la surprenante, l’inquiétante visite de l’inconnu qui osait proposer un pacte relatif à la succession de l’oncle Baraban.
Fandor était parti furieux de chez Juve, bougonnant, envoyant à tous les diables son ami le policier.
« Juve est assommant, pensait Fandor. Il s’entête, en dépit de toutes les apparences, à vouloir soutenir l’invraisemblable. Parbleu, je ne dis pas que ce Théodore et cette Brigitte soient certainement les coupables. Mais en revanche, nom d’un chien, je donnerais bien ma tête à couper que le malheureux Baraban est bel et bien mort, mort assassiné, et que de plus, son cadavre a séjourné dans la malle verte. »
Fandor, il est vrai, était assez ému par l’objection que lui avait faite Juve.
Mais Fandor ne se tenait pourtant pas pour battu :
« La malle est défoncée, disait-il, bon, c’est un fait. Mais après tout, il ne prouve pas grand-chose. Qu’est-ce qui prouve en effet que ce n’est pas précisément parce que le corps a été mis dans la malle que le fond s’est abîmé ? Qu’est-ce qui a été cassé ? Est-ce la malle sous le poids du cadavre ? Ou est-ce au contraire parce que la malle était cassée que le cadavre n’a pas été mis dedans ? »
Fandor, rentré chez lui à près de quatre heures du matin, n’était point si fatigué qu’il ne flânât encore de longues minutes.
« J’en aurai le cœur net, ronchonnait-il de moment en moment, j’en aurai le cœur net. Quand ce ne serait que pour prendre Juve une bonne fois en flagrant délit d’erreur. Que diable, il est assommant cet animal-là, à ne jamais vouloir se gourer ! »
Mais, en même temps qu’il souhaitait prendre Juve en flagrant délit d’erreur, Fandor faisait une vilaine figure :
« Ce qui est ennuyeux, pensait-il, c’est que si Baraban est mort assassiné, il y a bien des chances pour que cette malheureuse Brigitte et ce petit imbécile de Théodore Gauvin soient réellement les assassins, et Havard alors a raison, sa thèse est fondée. »
Et cela vexait d’autant plus Fandor qu’il n’avait pas, pour M. Havard, une admiration profonde et que cela l’ennuyait de le voir triompher, et triompher contre Juve, et enfin, la culpabilité de Brigitte aurait évidemment pour première conséquence de créer de graves ennuis à son ami Jacques Faramont.
Fandor finit par se coucher :
« Tâchons de faire notre Ponce Pilate, grommelait-il, moi, je m’en lave les mains, après tout. »
Il ferma les yeux et s’endormit d’un sommeil de plomb.
***
Fandor dormit cette nuit-là avec tant de conviction, il était si fatigué qu’il perdit complètement la notion de l’heure. En ouvrant les yeux, en regardant sa montre, le lendemain, il poussait un juron formidable.
– Deux heures de l’après-midi, bon sang, mais je suis fou !
Sauté à bas de son lit, il lui fallut tout juste une demi-heure pour faire sa toilette, s’habiller, être prêt à sortir.
Sur le seuil de sa porte, Jérôme Fandor hésita cependant.
– Et mon déjeuner, murmura-t-il.
Il eut un vague sourire, puis ferma sa serrure.
– Bah, je dînerai mieux, voilà tout.
***
Vingt minutes plus tard, il carillonnait chez le policier, et Jean le vieux domestique l’introduisait auprès de lui.
– Tiens, s’écriait alors Fandor, on dirait que vous n’avez pas été plus matinal que moi.
L’exclamation était justifiée, car Juve paraissait sortir du lit. Il était en caleçon, venait tout juste de mettre son faux col et s’occupait à lacer ses bottines.
Juve pourtant protesta :
– Fandor, tu parles à la légère, je me suis levé avec le jour.
– Mensonge, rétorqua le journaliste, c’est moi qui me suis couché avec…
Il éclata de rire, puis interrogea :
– Alors vrai, Juve, vous ne sortez pas de vos toiles ?
– J’étais dehors à dix heures, ripostait le policier.
– Fichtre, pour aller où ça ?
– Pour courir après Baraban.
Fandor mâchonnait une cigarette. Il tapa du pied en soufflant rageusement une bouffée de fumée.
– Dieu, que vous êtes assommant Juve ! Puisqu’on vous dit qu’il est mort !
– Puisque je te dis qu’il est avec une femme en train de faire la bombe.
– Et alors Juve, vous l’avez rencontré, Baraban ?
– Non, avoua le policier en passant son pantalon. Pas de nouveau, mais j’en aurai peut-être ce soir.
– Où allez-vous donc ?
– Au Palais de Justice. Je suis même en retard. On va confronter le jeune Théodore et Brigitte. Peut-être saura-t-on quelque chose.
– Oui, ce sera peut-être intéressant.
Puis, après avoir allumé une autre cigarette et tendu son étui à Juve, Fandor ajouta :
– Sérieusement, ce matin, vous n’avez rien appris ?
– Peu de chose. Un indicateur est venu dire à Havard que Baraban faisait souvent la noce à Montmartre.
Juve disait cela d’un petit ton tranquille, mais, en même temps ses yeux pétillaient.
Fandor, pour toute réponse, commença par faire la moue :
– Et alors ? interrogeait-il.
Juve d’abord, ne répondait pas. Il était occupé à fixer son bouton de faux col qui se refusait à entrer dans la boutonnière :
– Maudit bouton, grommela le policier. Ah ça, tu ne pourrais pas m’aider, Fandor ?
Fandor se leva, aida Juve, puis questionna :
– Naturellement, monsieur Juve estime que la fugue est d’autant plus probable que Baraban allait à Montmartre ?
– Naturellement.
Fandor alors portait les deux mains à son front :
– Bon Dieu, déclara-t-il, ce que vous êtes obstiné ! Vrai, votre tête, c’est encore pire que le crâne d’un Breton, on pourrait s’en servir pour casser les cailloux.
Juve cependant sifflotait en brossant son chapeau.
– Rira bien qui rira le dernier, dit-il simplement.
Et, s’interrompant pour jeter un coup d’œil à sa montre :
– Sapristi, je vais être en retard ! Aide-moi donc, au lieu de flâner.
Fandor connaissait assez les habitudes de Juve pour n’avoir pas besoin d’autres indications.
Quelques secondes plus tard, il avait aidé le policier à finir de s’apprêter, c’est-à-dire lui avait jeté à la volée un mouchoir propre, son porte-monnaie, ses gants, ses clés.
– Là, déclara-t-il, foutez le camp ! Juve, vous êtes beau comme un astre.
Juve se dépêchait, dégringolait l’escalier devant Fandor :
– Tu viens avec moi au Palais ?
– Non. Pas maintenant.
De surprise, Juve s’arrêta :
– Ah ça, tu as une idée derrière la tête alors ? Si tu ne viens pas, c’est que tu penses à une démarche.
– Non, riposta Fandor, c’est tout simplement que je me sens l’âme poétique et je vais aller aux Tuileries écouter la musique et donner du pain aux moineaux.
Les deux hommes étaient à ce moment au coin de la rue Tardieu. Ils échangèrent une poignée de main.
– Eh bien, tâche de tuer les moineaux. Bonne chasse ! cria Juve en appelant un fiacre.
– Et vous, bonne confrontation, dit Fandor.
Puis, le journaliste regardant Juve partir, haussa les épaules en éclatant de rire :
« Et voilà, pensait-il en lui-même, on est le plus grand policier du monde, le premier inspecteur de la Sûreté française et on se laisse barboter ses propres pièces d’identité par un ami.
Fandor, sur ces paroles énigmatiques, appela un fiacre :
– Rue Richer, 22.
À sept heures du soir exactement, Fandor sortait à nouveau de chez lui. Il était en habit, portait une fleur à sa boutonnière, s’était rasé de près, avait l’allure d’un homme chic.
– Seigneur Dieu Jésus ! s’écria sa concierge en le voyant passer. Vous allez-t’y donc voir une demoiselle pour vous marier ?
– Justement, madame, répondait Fandor, c’est exactement cela et pas autre chose. Je vais peut-être me marier cette nuit.
Quiconque se fût à coup sûr trompé au sens équivoque de ces paroles, si d’aventure on avait entendu l’adresse que Jérôme Fandor donnait quelques instants plus tard au taxi-auto qu’il arrêtait :
– Place Pigalle, au Monastère [8].
Mais pourquoi Fandor s’était-il mis en habit ? Pourquoi se rendait-il à Montmartre à une heure où Montmartre sommeille encore ?
Fandor se tenait tout simplement le raisonnement suivant : « Baraban allait à Montmartre. Bon, s’il allait à Montmartre, il doit y être connu. Bon. S’il est connu à Montmartre, j’aurai à Montmartre des renseignements intéressants sur lui. »
Fandor se rendait donc tranquillement à Montmartre, se préparant à y dîner et à y passer la nuit, à effectuer des recherches policières.
Dans sa voiture, Fandor tira son portefeuille, y logea deux petites cartes qu’il considérait en riant :
– Si Juve voyait cela entre mes mains, murmurait-il, il en attraperait deux jaunisses au moins.
Au Monastère, établissement ultra-chic, Fandor descendit. Il paya son taxi-auto puis entra dans une grande salle. Il était à peine huit heures, il y avait encore fort peu de dîneurs et les maîtres d’hôtel s’avançaient pour lui offrir une table :
– Deux couverts ? demanda l’un de ces graves personnages, peu habitués à ce qu’un gentleman vînt seul dîner à pareil endroit.
Fandor, à ce moment, eut une idée saugrenue :
– Payons d’audace, pensa-t-il.
Il jeta un regard dédaigneux autour de lui, semblant hésiter.
– Heu, dit-il, ça n’a pas l’air bien gai, chez vous. Il n’y a personne, ici.
– Il est encore de bonne heure, monsieur. Monsieur veut-il cette table ?
– Je ne sais pas, ma foi. J’ai envie de faire un tour. D’ailleurs j’attends un ami. Vous connaissez peut-être M. Baraban ?
– Je le connais sans doute de vue, mais le nom m’est inconnu.
– Au fait, j’ai la photographie de ce Baraban. Tenez, regardez-la, vous connaissez ce monsieur ?
Le maître d’hôtel prit la photographie que lui tendait Fandor, l’examina soigneusement :
– Si vous connaissez ce monsieur, poursuivit le journaliste, je vous chargerai d’une commission pour lui.
Or, visiblement, le maître d’hôtel ne reconnaissait pas le portrait de Baraban.
– Je ne suis pas très sûr, commença-t-il, mais il me semble que si monsieur veut aller faire un tour, monsieur peut me laisser cette photo, quand l’ami de monsieur arrivera…
– Inutile, coupa Fandor. On m’attendra je pense, et je vais tout juste aller prendre un apéritif au bar.
Sorti du Monastère, flegmatiquement Jérôme Fandor conclut :
– Et d’un, l’oncle Baraban est inconnu ici ! Ça, c’est une tape pour Juve.
Fandor, à ce moment, replia son portefeuille et y introduisit la photographie. Soudain, il remarqua, écrite au dos, une inscription de la main de Juve :
– Tiens, je n’avais pas vu cela ! murmurait-il.
À la lumière d’un bec de gaz, Jérôme Fandor put déchiffrer la note prise par le policier : « Fréquentait leCrocodile ».
Immédiatement le journaliste éclata de rire :
– Bon Dieu que je suis bête, se déclarait Fandor, je vais me balader au Monastèrequand Juve a eu la précaution de noter au dos de cette photographie l’adresse du restaurant intéressant. Ah, j’ai été rudement inspiré en volant cette photo dans son portefeuille ce matin.
Jérôme Fandor, en effet, avait tranquillement subtilisé dans le portefeuille de Juve, la photographie de Baraban.
Un quart d’heure plus tard cependant, le journaliste entrait au Crocodile. Il était tout près de huit heures et demie, et, dans les salons de l’établissement, la foule des dîneurs se pressait.
– C’est mieux ici, pensa Fandor, et puis, je connais la boîte. C’est même ennuyeux on pourrait m’y reconnaître.
Jérôme Fandor déposa son pardessus au vestiaire et du pas d’un dîneur tranquille, gagna une petite table. Là encore, un maître d’hôtel s’avança vers lui :
– Deux couverts pour monsieur ?
– Heu, je ne sais pas trop, je pensais retrouver un de mes amis, mais il n’est pas là. Vous connaissez M. Baraban ?
– De vue peut-être, monsieur, mais de nom…
– Tenez, mon ami, cela éclaircira vos souvenirs.
Il tendit la photographie, interrogeant :
– Vous rappelez-vous cette tête-là ?
– Non, monsieur. Mais il vient tant de monde ici.
– En effet.
Jérôme Fandor au même moment, décidait de ne point insister :
– Après tout, pensait-il, Baraban ne venait peut-être ici qu’aux heures avancées de la nuit. Montmartre n’est guère fréquenté à l’heure du dîner, je poursuivrai mon enquête auprès des bars mêmes qui prennent service aux environs de minuit.
Il commanda son menu, qu’il choisit d’une façon très recherchée.
Or, il y avait à peine quelques instants que Fandor dînait de bon appétit, lorsque le propre gérant du Crocodiles’approchait de sa table et discrètement, se penchait sur lui :
– Monsieur, demandait-il, veut-il m’autoriser à lui poser une question ?
– Assurément, répondit Fandor, laquelle ?
– Monsieur n’a-t-il pas demandé, continuait le gérant, après M. Baraban ?
Impassible, mais très joyeux à part lui, Fandor répondit :
– Oui, il vient ici quelquefois, n’est-ce pas ?
Il s’attendait presque à une réponse affirmative, il fut stupéfait de celle qu’il reçut :
– Monsieur serait fort aimable de descendre me parler au bureau, avait déclaré simplement le gérant.
Il n’avait pas besoin d’en dire plus. Fandor, à cet instant, était pris d’une formidable envie de rire :
– Bon, voilà que le gérant, qui a lu les journaux, connaît l’assassinat de Baraban et se demande comment je peux avoir rendez-vous avec lui ici. Je parie cent francs contre deux sous, que si je me laisse faire, on va dans trois minutes me prendre pour l’assassin. Heureusement, que j’ai prévu la chose et que j’ai été voir Juve tout à l’heure.
Le gérant, pourtant, attendait, respectueux mais décidé. Jérôme Fandor n’hésita pas :
– Hep, appela-t-il, regardez cela.
En même temps le jeune homme fouillait dans sa poche, prenait son portefeuille, l’ouvrait, tendait un carton à son interlocuteur ahuri :
– Vous comprenez ? demanda-t-il, inspecteur de police. Voici ma carte de la Sûreté.
Le gérant était rouge de confusion.
– Oh pardonnez-moi, monsieur. Je ne pouvais pas savoir, n’est-ce pas ? Et…
– Cela va bien, coupa Fandor, il n’y a pas de mal. Mais sachez cela pour votre gouverne : je me nomme Juve, je suis l’inspecteur Juve, d’ailleurs, pour enlever tous vos doutes, je vous en prie, examinez cette carte.
Fandor, à cet instant, faut-il le dire, faisait preuve d’une effroyable audace.
Non seulement, en effet, il tendait la carte de Juve, carte qu’il avait subtilisée le matin même chez le policier, mais encore, il offrait au gérant de l’examiner.
Si le gérant du Crocodileavait pris la carte en main, les choses eussent vraiment mal tourné pour le brave Fandor puisque ce n’était pas sa photographie qui ornait le carton.
Par bonheur, l’assurance du journaliste en imposa au personnage.
– Non, non, je n’ai pas besoin de vérifier vos titres, protesta-t-il. D’ailleurs, je connais bien les cartes de police.








