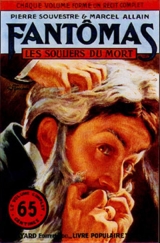
Текст книги "Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
– Vous leur direz, à ces gens de la police, que je suis venu et qu’on ne m’a pas même permis d’aller me recueillir dans l’appartement de mon pauvre oncle. Vous les préviendrez que ça leur coûtera cher. De quel droit, maintenant, empêche-t-on la famille de venir embrasser un parent décédé, surtout un parent aussi intime que notre pauvre oncle Baraban ?
– Mais, protesta la concierge stupéfaite, vous savez bien, monsieur Ricard, que feu Monsieur votre oncle n’est pas là, puisque son cadavre a disparu.
– Peu importe, il aurait pu y être !
– Oh, oh, pensa Fandor, qui souriait en entendant le personnage répondre sans se démonter les choses les plus inattendues, voilà un gaillard qui me plaît. Il faut que je fasse plus ample connaissance avec lui.
Fandor descendit encore quelques marches, s’approcha des deux interlocuteurs :
– Monsieur Ricard ? interrogea-t-il aimablement, affectant un air très respectueux.
– C’est moi-même, courtier en vins. Toujours en voyage par monts et par vaux et domicilié à Vernon (Eure), neveu par sa femme de la victime. Que désirez-vous ?
– Mon Dieu, je veux tout d’abord, monsieur, vous présenter mes plus sincères condoléances, et ensuite vous demander quelques renseignements.
– À quel titre, monsieur ?
– Voilà, poursuivit Fandor, que l’attitude désagréable de Fernand Ricard ne démontait pas. Je suis journaliste, Jérôme Fandor, pour vous servir, rédacteur à La Capitale, et je voudrais bien vous interviewer.
– Ah, ah ! J’ai souvent lu de vos articles et vos aventures me sont connues, monsieur Jérôme Fandor. Voulez-vous que nous descendions au café ? Nous prendrons quelque chose ?
– Au café ? Non, montons plutôt. J’habite au-dessus, nous serons plus à l’aise pour causer.
– Croyez-vous, comme ces gens de la police sont extraordinaires ! Voilà qu’on m’empêche d’entrer dans l’appartement de mon oncle.
– Ils n’en font jamais d’autres.
Cependant, il avait refermé la porte derrière son hôte et le faisait s’installer dans son petit salon.
– C’est gentil chez vous, observa Fernand Ricard. Vous vivez seul, là-dedans ?
– Mon Dieu, oui.
– Et vos repas ? Où prenez-vous vos repas ?
– Ma foi, ça dépend… au restaurant… chez des amis.
– Vous ne mangez jamais chez vous ?
– Jamais, c’est beaucoup dire, quelquefois… Mais pourquoi ces questions ?
– Parbleu, parce que, si vous aviez eu une maison montée, je vous aurais placé du vin. Une occasion excellente en ce moment. Cent douze francs la barrique. Rendu franco en cave. Quelque chose de merveilleux. Enfin, ce n’est pas de cela dont il s’agit pour le moment.
– En effet, dit Fandor, revenons-en à l’oncle Baraban.
– Ah le pauvre homme ! Croyez-vous, tout de même, que c’est malheureux. Un si brave type ! Se faire assassiner comme ça ! C’est épouvantable. J’étais à Londres, en train de traiter une grosse affaire de Bordeaux, lorsque j’ai appris ce malheur. Vous pensez si j’ai sauté !
– Je comprends.
– Sauté en l’air d’abord, car j’étais surpris, et sauté dans le train aussitôt ensuite, pour arriver le plus vite possible à Paris. J’ai passé par Douvres, Calais. Le temps de manger un morceau à la gare et je suis tombé ici. Ah, comment m’a-t-on reçu. Un chien dans un « bowling », mon cher monsieur. Il faut vous dire que j’avais d’abord été à la Sûreté pour avoir des renseignements. Personne. Pas de M. Havard. Pas même de Juve. J’arrive ici, personne encore. L’appartement bouclé. Enfin, heureusement que je vous trouve. Ça me permet de m’asseoir et de vider mon sac. D’ailleurs je ne resterai pas longtemps, il faut que j’aille retrouver ma femme d’urgence. Vous pensez dans quel état elle doit être, la malheureuse.
– Je m’en doute. Enfin, peut-être qu’elle va pouvoir fournir quelques renseignements qui permettront à la justice de faire la lumière sur ce singulier événement.
Ricard changea de couleur :
– Qu’est-ce que vous dites ? interrogea-t-il, ma femme va parler à la justice ?
Fandor souriait. Il tira sa montre :
– Trois heures, dit-il. Selon toute probabilité, M me Ricard est actuellement en tête à tête avec mon ami Juve, tout comme je suis en tête à tête avec vous, Monsieur Ricard.
– Ah, que c’est ennuyeux.
– Pourquoi donc ?
– Oh, c’est ennuyeux sans l’être. Alice n’a rien à se reprocher, ni moi non plus, d’ailleurs. Mais enfin, vous connaissez les dames, ça bavarde toujours maladroitement. Ça raconte un tas de choses inutiles, et j’aurais mieux aimé que ce soit moi à qui M. Juve vienne demander des renseignements.
– Juve peut-être sera à sept heures à Paris, ce soir même. Attendez-le donc.
– Je ne peux pas, j’ai promis de rentrer, il faut que je rentre. Songez donc, Alice doit se faire de la bile, à l’idée que je ne suis pas là. Moi, je prends le train de quatre heures, zut pour le reste !
Et il se dirigea vers la porte :
– Drôle de type, pensait Fandor, assez interloqué par l’attitude du courtier en vins. Voyons, dit-il, deux mots encore pour l’interview.
– Qu’est-ce que vous voulez savoir ?
– Dame, dit Fandor, des détails. Quelques renseignements sur votre oncle, M. Baraban. Quelle sorte d’homme était-ce ?
– Quelle sorte ? Je n’en sais rien moi, un homme comme les autres. Il avait cinquante-cinq ans environ. Soixante peut-être. Un brave type, pour ça oui, et n’engendrant pas la mélancolie. Il savait rigoler et levait le coude plus souvent qu’à son tour.
– Ah, ah, remarqua Fandor, vous faisiez la noce ensemble ?
– Jamais de la vie, monsieur ! Je suis un homme rangé, marié, moi, mais l’oncle Baraban était célibataire, et dame, vous savez, les célibataires s’en payent tant qu’ils peuvent. Le vieux Baraban n’avait certainement pas encore dételé. Ça, c’est écrit sur la figure des gens. Ça se voit à leur manière, à leurs vêtements. Baraban toujours élégant, toujours parfumé, tiré à quatre épingles, devait apprécier les jolies femmes. Assez aisé avec cela.
– Il était riche ? interrogea Fandor qui ajoutait clignant de l’œil : c’est une consolation. Vous allez hériter !
– Heu, je ne sais pas, ce n’est pas l’heure de s’occuper de ça. En tout cas, nous ne toucherons pas grand-chose, le vieux était égoïste, il a dû fourrer tous ses biens en viager. Trois heures et demie, s’écria-t-il, il faut que je parte. Au revoir, monsieur.
Cependant qu’il descendait l’escalier à pas précipités, Ricard cria à Fandor :
– Si vous tartinez quelque chose dans votre journal vous pourrez dire que je suis furieux contre la police. Franchement, ils auraient pu donner des ordres pour qu’on me laisse entrer dans l’appartement de mon oncle. Je sais bien que cela ne servait à rien, mais enfin c’est une satisfaction qu’on ne devrait pas refuser aux personnes de la famille.
– Comptez sur moi.
– Et puis, vous savez, quand toutes ces histoires-là seront finies, je reviendrai vous voir. On causera de cette affaire de vin. Occasion épatante en ce moment. Vous m’avez l’air d’un bon garçon, je vous en ferai profiter.
Déjà Fernand Ricard s’éloignait à grands pas, courait dans la direction de la gare Saint-Lazare.
Au moment où il sortait de la maison de la rue Richer, le courtier en vins se heurta à un grand jeune homme au visage bouleversé qui demandait à la concierge, d’une voix tremblante :
– Monsieur Fandor est-il chez lui ?
– Je ne l’ai pas vu sortir, répondit la brave femme qui ne voulait pas compromettre son locataire et n’affirmait rien.
Le grand jeune homme au visage bouleversé trouva la réponse suffisamment rassurante et s’engagea dans l’escalier, monta les quatre étages. Quelques instants plus tard, il était en face de Fandor qui s’écriait en le voyant :
– Jacques Faramont ! Ah, par exemple, quelle surprise ! Quel bon vent vous amène ?
– Quel bon vent ? dites plutôt quel cataclysme, quelle tempête ! Vous voyez devant vous, mon cher Fandor, un malheureux bouleversé, atterré…
– Je ne m’en doutais pas du tout, fit joyeusement le journaliste, cependant qu’il désignait un siège à son visiteur. (Décidément, pensait Fandor, j’ai bien fait de ne pas sortir de chez moi, je fais recette, ça ne désemplit pas).
– J’ai quelque chose de très grave à vous dire, Fandor.
– À quel sujet ?
– Au sujet de l’affaire Baraban.
– Eh bien, mon cher ami, je vous écoute.
Jacques Faramont fit au journaliste le récit détaillé de son existence et de celle de sa maîtresse, depuis l’époque où le jeune avocat s’était installé chez lui, rue Claude-Bernard, et s’était, pour ainsi dire, mis en ménage avec la jeune femme dont il avait fait la connaissance lorsqu’elle était domestique chez son oncle et sa tante, M. et M me de Keyrolles.
« Pourquoi diable me raconte-t-il tout cela, se demandait Fandor et quel rapport l’histoire de ses amours avec la bonne peut-elle avoir avec l’affaire Baraban ? »
– Brigitte a été femme de ménage, expliquait le jeune avocat, il y a de cela quatre ou cinq mois chez M. Baraban. Elle l’a quitté, emportant, par erreur, cette clé dont la disparition avait été signalée par la concierge au cours des premières enquêtes, et qui faisait suspecter la personne qui devait l’avoir conservée. La nuit du crime, Brigitte avait découché. Où ? Pour quoi faire ? Allez savoir.
– Elle prétend, continuait-il, avoir erré toute la nuit, puis sommeillé sous un pont. Vous pensez comme cela est suspect. Tout d’abord j’ai cru qu’elle m’avait trompé, mais j’ai peur désormais qu’il n’y ait quelque chose de plus grave.
– En effet, déclara Fandor, c’est bizarre.
Jacques Faramont devait troubler encore plus le journaliste lorsqu’il lui montra la lettre d’avis du chemin de fer adressée à Brigitte et signalant qu’un colis l’attendait à la gare d’Orléans, expédié par un individu portant le nom de Baraban.
À deux ou trois reprises, Jacques Faramont avait déjà voulu s’en aller. Fandor l’avait retenu.
Il avait téléphoné chez Juve, espérant que celui-ci aurait devancé l’heure de son retour. Le policier n’était pas là, mais on l’attendait d’un moment à l’autre.
Enfin, vers sept heures moins le quart, Fandor eut l’extrême satisfaction d’entendre la voix sympathique de l’inspecteur de la Sûreté qui répondait à l’autre bout du fil :
– J’ai du nouveau, lui déclara-t-il, je vous attends chez moi.
– Moi également. Et tu sais Fandor, l’hypothèse de la fugue se confirme de plus en plus dans mon esprit.
– Eh bien moi, j’aime à croire qu’avant ce soir, nous aurons retrouvé le cadavre de l’oncle Baraban, mort malheureusement et bien mort.
Fandor se rendait compte que Juve allait poser d’autres questions, mais il se fit un malin plaisir d’interrompre la conversation.
Jacques Faramont était devenu livide :
– Fandor, supplia-t-il, dites-moi ce que vous pensez. Expliquez-moi le sens des propos que vous venez de tenir à Juve ?
– Oh, c’est bien simple, fit le journaliste, et je vais vous dire nettement ce que je crois. Le colis de cent dix kilos, qui attend que M lle Brigitte vienne le chercher à la gare des marchandises du chemin de fer d’Orléans, doit être une malle, vraisemblablement une malle jaune, cette fameuse malle dont on a parlé et que M. Baraban avait fait apporter chez lui l’après-midi qui a précédé la nuit du crime. Que peut contenir cette malle ? Je n’en sais rien, mais je ne serais pas autrement étonné qu’on y retrouve un cadavre, un cadavre qui ne serait autre que celui de M. Baraban.
– Mon Dieu, Fandor, murmura l’avocat, vous m’épouvantez ! Qu’a-t-il pu se passer ? Quel rôle a joué Brigitte dans cette sinistre affaire ?
***
Cette même soirée, il était environ neuf heures et demie, trois hommes pataugeaient dans la boue grasse des interminables hangars qui longent la Seine sur le quai d’Austerlitz. C’étaient Juve, Fandor et Jacques Faramont.
Tous les trois s’étaient présentés à la gare des marchandises de la Compagnie d’Orléans et, porteurs de la lettre d’avis destinée à Brigitte, ils s’étaient trouvés renvoyés de bureau en bureau, avant de savoir où pouvait se trouver le colis. Un employé avait constaté, chose assez curieuse, que l’expédition avait été faite de Paris pour Paris. Vraisemblablement, ce colis avait dû être déposé à la consigne, expédié, puis réclamé ensuite par l’expéditeur. On allait évidemment le retrouver sur le quai du bâtiment B.
On erra longtemps sur ce quai et ce fut en vain. Au bout d’une demi-heure, on apprit que les colis destinés au bâtiment B se trouvaient sous les hangars du bâtiment F.
Les trois hommes ne se décourageaient pas pour autant.
Du bâtiment F on passa au bâtiment G, puis on revint au bâtiment A. Cette fois Juve et Fandor et même Jacques Faramont, que cette chasse infructueuse énervaient considérablement, poussèrent un soupir de satisfaction. Le chef de service ayant consulté des liasses de papiers, leur avait déclaré :
– J’ai en effet ce colis. Il ne doit pas être loin.
Il tenait à la main la lettre d’avis, puis interrogea avec une attention singulière et méfiante :
– Pardon, mais je ne vois pas de femme parmi vous ?
– Qu’est-ce que cela peut vous faire ? commença Fandor.
L’employé s’excusa :
– Le destinataire de ce colis est M lle Brigitte, je ne puis point vous le livrer sans une autorisation écrite d’elle. À moins cependant que vous ne me donniez l’ordre de faire suivre à son domicile.
Le policier suggéra :
– Nous sommes chargés par elle d’enlever ce colis. Puisque nous avons la lettre vous pouvez bien le donner.
– Rien à faire, répéta l’employé, on vole assez de colis sans que nous le sachions, pour que nous ne nous laissions pas faire quand nous avons des doutes ou des soupçons.
Fandor éclata de rire, tant l’idée qu’on les soupçonnait de vol lui paraissait amusante, mais Juve n’était pas d’humeur à prendre la chose en plaisanterie.
– Allons, allons, dit-il, ça va bien, finissons-en, conduisez-moi au sous-chef de gare.
Quelques instants après, le policier revenait avec le fonctionnaire auquel il avait fait connaître sa qualité. Le sous-chef de gare dit un mot à l’oreille de son subordonné qui, aussitôt, se confondit en excuses.
Puis les cinq hommes partirent sous les hangars.
– Voilà le colis.
Toutefois, Juve jeta un regard de triomphe sur Fandor, et Fandor lui répondit par un coup d’œil de désappointement. Le colis en question était bien une malle comme les deux hommes l’avaient présumé, mais cette malle était vieille. Elle était verte. On la soupesa, elle était lourde, mais ne semblait pas pourtant peser les cent dix kilos annoncés sur le bulletin.
– Monsieur l’inspecteur, demanda poliment le sous-chef de gare en s’adressant à Juve, que voulez-vous que nous fassions ?
– Nous pourrions peut-être, dit Juve, aller ouvrir cette malle dans ce petit local, là.
On appela deux hommes d’équipe qui transportèrent le colis, puis Juve, froidement, fit sauter les serrures avec un levier :
Il y avait dans cette malle, tassés par le couvercle, des vêtements, du linge rempli de sang. On voulut soulever le premier compartiment pour voir ce qu’il y avait en dessous. Le compartiment était extraordinairement lourd. Les deux hommes d’équipe y parvinrent cependant, et dès lors, au moment où on apercevait la partie inférieure de la malle, on constatait que le fond de la malle était vide. Les parois étaient souillées de sang, usées en certains endroits, comme par suite d’un frottement continu. Le sous-chef de gare, ses hommes et Jacques Faramont, s’étaient reculés, laissant Juve et Fandor agir seuls.
Les deux hommes ne disaient pas un mot, mais ils inventoriaient minutieusement le contenu du premier compartiment qui pesait si lourd. L’explication de ce poids était facile à trouver ; sous les vêtements se trouvaient des pavés de grès, pris dans une rue en réparation, sans doute.
Juve et Fandor se regardèrent :
– Eh bien ? demanda le journaliste, que pensez-vous de cela ?
– Mais rien du tout, fit Juve d’une voix fort naturelle. Toutefois, son clignement d’œil signifiait qu’il ne voulait point révéler ses pensées devant cet auditoire.
Fandor n’insista pas. Au surplus, Juve s’était approché du sous-chef de gare.
– Monsieur, lui déclara-t-il, de cet air impassible et froid qui paralysait tant de gens, je vous remercie d’avoir satisfait à ma requête. Il me reste à vous demander de bien vouloir fermer ce petit local à clé et de donner l’ordre que personne n’en approche, et à plus forte raison que personne n’y pénètre. Demain, nous reviendrons peut-être.
Le sous-chef de gare obtempéra au désir de Juve, et celui-ci, rassuré désormais sur le sort réservé à la malle, quitta avec Fandor et Jacques Faramont les immenses locaux de la gare des marchandises.
Le policier héla un fiacre, il y fit monter ses deux compagnons.
– Quel est le numéro ? demandait-il à Jacques Faramont.
– Soixante-quatorze, dit l’avocat. Vous allez chez moi ?
– Si vous le voulez bien ? J’aimerais causer avec M lle Brigitte.
Jacques Faramont, de plus en plus inquiet, suivi de Juve et de Fandor, monta l’escalier conduisant à son appartement.
– Brigitte, pensa-t-il, doit être couchée, elle sera affolée lorsqu’elle nous verra.
C’était peut-être, là aussi, l’espoir de Juve, qui, sans en avoir l’air, avait interrogé l’avocat sur les habitudes de sa maîtresse. Il avait appris que celle-ci se couchait de bonne heure et Juve, en vieux policier retors qu’il était, savait que les gens qui ont quelque chose à dissimuler le font avec d’autant plus de difficulté que les questions qu’on leur pose les surprennent à l’improviste.
Toutefois, si tel était l’espoir de Juve, il devait être déçu.
À peine avait-il entrouvert la porte que Jacques Faramont s’écriait :
– Il y a quelqu’un chez moi !
Les trois hommes, hâtivement, pénétraient dans le cabinet de travail de l’avocat stagiaire. Ils y surprenaient une conversation vive et animée, tragique également.
Une femme en pleurs, gisait, écroulée sur le parquet cependant qu’un homme, debout, les bras croisés devant elle, l’apostrophait. Un autre personnage se tenait à l’écart, silencieux, immobile.
La femme, c’était Brigitte ; Fandor reconnaissait, dans le troisième personnage immobile, l’inspecteur Michel ; quant à Juve, malgré son impassibilité proverbiale, il ne pouvait s’empêcher de proférer avec surprise, en apercevant l’homme debout devant Brigitte :
– Monsieur Havard ! Ah, par exemple !
C’était en effet le chef de la Sûreté qui était venu au domicile de l’avocat depuis deux heures, avec un de ses subordonnés.
Machinalement, M. Havard rendit à Juve sa poignée de main :
– Mon cher, déclara-t-il d’un air triomphant, l’enquête a fait un grand pas. Tandis que vous étiez à vous balader, j’ai retrouvé, moi, la personne suspecte, la mystérieuse complice, évidemment, de l’assassin, la personne, en deux mots, qui détenait la clé disparue de l’appartement de M. Baraban.
– Et, demanda Juve, la personne qui possède cette clé, c’est mademoiselle ?
Le policier désignait Brigitte, qui sanglotait, la tête entre les mains, sans même s’être aperçue du retour de son amant, lequel, paralysé, demeurait immobile sur le pas de la porte.
L’interruption de Juve navra M. Havard qui comptait produire sur le célèbre inspecteur une formidable impression :
– Ah ça, fit-il, vous le saviez donc ?
– Oui, dit simplement Juve.
– Et alors, poursuivit M. Havard, vous le pensez comme moi ?
– Quoi ?
– Eh bien, dit M. Havard, qui s’impatientait, que l’enquête a fait un grand pas, puisque nous tenons vraisemblablement, non seulement le coupable, mais encore la complice qui s’est faite son indicatrice.
– Vous croyez ?
M. Havard, cependant, estimait avoir triomphé et il voulut avoir tous les honneurs de sa victoire.
– Écoutez bien, recommanda-t-il à Juve, ce qu’elle va me dire.
Puis, se tournant vers Brigitte, le chef de la Sûreté la souleva, la fit asseoir dans un fauteuil.
– Mademoiselle, commença-t-il d’une voix douce, la justice vous saura gré des aveux que vous venez de me faire. Voulez-vous les répéter en présence de ces messieurs ?
Les larmes obscurcissaient les yeux de la malheureuse Brigitte. Elle ne voyait personne. Pas même son amant.
D’une voix entrecoupée de sanglots, elle raconta ce qu’elle avait déjà dit à Jacques Faramont et avoué à M. Havard, à savoir qu’elle avait été au service de M. Baraban, qu’elle était partie de chez lui emportant une clé sans s’en apercevoir, ajoutant enfin qu’elle avait passé la nuit, précisément la nuit du crime, hors du domicile de son amant, et cela à la suite d’une dispute avec ce dernier. Tout cela, on le savait. Mais ce qu’ignoraient Juve et Fandor, ce qu’ignorait également Jacques Faramont, c’est que Brigitte, alors qu’elle se reposait, sommeillant sous les ponts entre deux et quatre heures du matin, y avait fait la rencontre d’un jeune homme dont l’allure et les manières n’étaient certes pas celles d’un homme habitué à rechercher pareil asile.
Tous deux avaient causé gentiment, pleuré ensemble. Ils s’étaient avoué avec naïveté qu’ils étaient des amoureux bien malheureux dans l’existence et que leur cœur leur faisait mal.
– Voyez-vous, reprit M. Havard en ricanant, lorsque Brigitte eut fini de refaire son récit, cette charmante idylle. C’est véritablement fort bien imaginé, et pour un peu, on serait tenté d’y croire si nous ne connaissions pas la vérité.
Juve hocha la tête silencieusement. M. Havard, qui prenait ce mouvement pour un assentiment, poursuivit, l’adressant à Brigitte d’un ton sévère :
– Tout cela est très joli, mademoiselle, mais, malheureusement pour vous, c’est du roman, de la pure invention. Nous n’en sommes pas dupes. Le jeune homme que vous avez rencontré sous les ponts ne vous était certainement pas inconnu. Pour quel motif et dans quel but êtes-vous entrée en relations avec lui ? C’est ce que j’ignore et c’est ce que l’instruction établira. Toujours est-il que je vous informe de l’arrestation de ce personnage présumé auteur de l’assassinat de M. Baraban.
– Mon Dieu, balbutia Brigitte, est-ce possible ? Ce jeune homme si gentil serait un assassin ?
À ce moment, la main de M. Havard se posait sur l’épaule de la jeune femme :
– Quant à vous, déclara-t-il en enflant la voix, je vous arrête également comme complice. Vous aurez à justifier de votre conduite devant le juge d’instruction.
Un hurlement retentit.
Jacques Faramont s’était précipité sur le chef de la Sûreté, il tombait à genoux devant lui :
– Monsieur, monsieur, je vous en supplie ! Épargnez Brigitte ! Ce que vous dites n’est pas possible. Elle est innocente, innocente.
Le jeune homme défaillait.
M. Havard l’avait écarté d’un geste. Michel l’agent de la Sûreté, emmenait Brigitte à demi morte d’émotion, incapable de résister.
M. Havard recommanda à Jacques Faramont :
– Quittez votre domicile le moins possible, monsieur ! Pendant quelques jours, restez à la disposition de la justice.
***
À trois heures du matin, Juve et Fandor causaient encore dans l’appartement du policier, rue Tardieu. Juve était furieux. Au moment où il était rentré, il y avait de cela une heure environ, le policier avait dit à Fandor :
– Je suis assommé. M. Havard est en train de faire gaffe sur gaffe. Cet homme va décidément trop vite en besogne. Il a voulu s’occuper de cette affaire, escomptant sans doute qu’il en retirerait une certaine gloire. Comme il est pressé, il va vite et, dans de semblables circonstances, quiconque va vite risque de buter et de culbuter. Il cherche des assassins partout où, à mon avis il n’y en a pas. Et il est tellement persuadé de l’assassinat de Baraban qu’il vient de décréter officiellement la mort de cet homme, ce qui permet à l’état civil de dresser l’acte de décès, et ce qui ouvre sa succession avec toutes les conséquences.
– Le fait est, reconnaissait Fandor, que c’est aller un peu vite en besogne. Toutefois, Juve, j’estime, moi, que Havard a raison lorsqu’il croit au crime. Je n’ai pas voulu vous faire part de mes impressions lorsque nous avons ouvert celle malle à la gare, mais il me paraît évident qu’elle a dû contenir le cadavre de Baraban. Voyez plutôt les taches de sang qui se trouvent à l’intérieur.
Juve protesta du geste :
– Je ne suis pas du tout de ton avis. D’abord, je ne crois pas que Baraban soit mort. Qui donc d’ailleurs l’aurait tué ? Et pourquoi ?
– Mon cher, vous avez une idée à ce sujet, dit Fandor.
Le policier haussa les épaules :
– Mais non, puisque je ne crois pas à l’assassinat.
– C’est-à-dire que vous considérez comme inutile l’arrestation de Théodore et de Brigitte. Il est vrai que, s’il y avait crime, d’autres gens peut-être pourraient être soupçonnés.
Fandor était, comme Juve, parfaitement d’avis que, ni Théodore, ni Brigitte, n’étaient capables d’avoir commis ce crime aussi audacieux que brutal. Mais alors, quels pouvaient être les assassins ?
Fandor, après avoir réfléchi, expliqua :
– Il faut procéder par ordre. Juve. Oubliez vos théories et répondez-moi franchement. Croyez-vous, oui ou non, qu’il y ait eu un cadavre dans cette malle ?
– Non, déclara nettement Juve, la meilleure preuve c’est que, ainsi que j’ai pu le constater, le fond, le plancher de cette malle, pour ainsi dire, est complètement vermoulu. Si l’on avait mis là-dedans un corps pesant une cinquantaine de kilos, il aurait défoncé la malle.
– Alors, Juve ?
– Alors, j’en reviens à ma thèse : maquillage, mise en scène fictive, combinaison bizarre, trucs extraordinaires, imaginés uniquement pour détourner l’attention, pour faire croire à un crime, alors qu’il n’y en a pas.
– Mais qui aurait procédé de la sorte ?
– Parbleu Fandor, il n’y a qu’un homme qui ait pu se donner tout ce mal, le principal intéressé : Baraban, l’oncle Baraban.
– Juve, Baraban est mort.
– Et moi, je te dis qu’il est vivant.
11 – LE VISITEUR INCONNU
Ce même jour, tandis que Juve et Fandor, ayant été témoins d’événements identiques, en tiraient des conclusions différentes, Fernand et Alice Ricard se trouvaient chez eux, à Vernon, dans leur petite villa à l’aspect tranquille, tout embaumée du parfum des corbeilles de fleurs et doucement caressée par le vent du soir, un vent tiède et exquis à respirer.
Alice Ricard était dans la salle à manger de la maisonnette. Fernand Ricard lui, flânait au jardin, redressant d’un doigt machinal, des œillets trop lourds, des roses trop épanouies qui menaçaient de rompre leur tige en s’écartant du tuteur.
Brusquement, Alice Ricard tressaillit.
Du jardin, la voix de Fernand montait, une voix qui appelait sur un ton fort ému :
– Alice, Alice !
– Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ? Tu m’appelles ?
– Vite, vite allume la lampe !
Affolée, les mains tremblantes, perdant la tête, Alice Ricard s’empressa. Elle entendit son mari courir dans le jardin, elle entendit son pas précipité, elle entendit qu’il courait encore en escaladant les marches du perron.
Fernand Ricard rentra dans la salle à manger, sa femme se jeta presque sur lui :
– Quoi ? Qu’est-ce que tu as ? demanda-t-elle.
Le courtier en vins répondit en brandissant une enveloppe au-dessus de sa tête :
– La lettre, criait-il, voilà la lettre.
Puis il se tut, effaré, car Alice Ricard venait de se laisser choir dans un fauteuil comme anéantie.
– Mon Dieu, que tu m’as fait peur, j’ai cru que c’était…
– Que c’était quoi ? demanda Fernand Ricard surpris.
– Que c’était les gendarmes.
– Bon Dieu, disait le courtier en vins, tu deviens complètement folle ! Les gendarmes, ah ça, pourquoi veux-tu que les gendarmes viennent ici ? Et puis, trêve de plaisanterie, je te dis que voilà la lettre.
– Fais voir, tu es certain de ne pas te tromper ?
– Oh certain. Regarde l’en-tête.
– Oui, c’est cela et pas de doute. Allons, ouvre vite !
En quelques secondes, la lampe était allumée, coiffée de son abat-jour, posée sur la table. La salle à manger avait pris un aspect tranquille, un air d’intimité heureuse.
– Dis, tu ne me croirais pas, Alice, dit Fernand, maintenant le courage me manque pour ouvrir cette enveloppe. Je l’ai trop attendue, si jamais ça ne marchait pas, hein, qu’est-ce qu’on ferait ?
Alice Ricard, elle, ne tenait pas en place :
– Attends, disait-elle, je vais fermer la fenêtre. Oh, et puis ma foi, ce n’est pas la peine, je vais seulement tirer les rideaux pour qu’on ne puisse pas nous voir.
Elle était, une seconde après, aux côtés de son mari ; elle s’appuyait à son épaule :
– Ouvre donc, Fernand, ouvre.
La lettre tremblait dans les mains du courtier en vins. Celui-ci, pourtant, faisant effort sur lui-même, triompha de ses hésitations :
– Bah, le sort en est jeté, dit-il.
Fernand Ricard écorna l’enveloppe, glissa un doigt à l’intérieur de la lettre, la décacheta.
Il jeta seulement les yeux sur le papier déplié, puis, semblant fort joyeux, il empoigna sa femme par les épaules, l’embrassa comme un fou :
– Tiens, ça y est ! Ah, que je suis content !
Et comme Alice avait achevé sa lecture, il reprit avec enthousiasme :
– Tu as vu, hein ? Ça y est. Il nous reste tout juste à dire : oui, et nous voilà riches. Vrai, ça ne sera pas volé tout de même.
Mais, à ces mots, Alice Ricard haussait les épaules :
– Tu en as du toupet, protestait-elle, ça ne sera pas volé dis-tu ? Ah bien, je n’aurais pas trouvé cela moi. Laisse-moi lire, il faut faire bien attention.
– C’est bien cela, hein ? demanda le courtier.
– C’est tout à fait cela, dit la jeune femme.
Et d’une voix lente, bien timbrée, elle commença la lecture sans paraître en éprouver la moindre émotion.
Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous informer que M. Baraban, votre oncle, était assuré sur la vie à votre profit pour une somme de cent mille francs. Nous venons d’être avisés par la préfecture de police que le décès de M. Baraban était déclaré. Nous tiendrons à votre disposition, si vous en manifestez le désir, la somme de cent mille francs, montant de l’assurance dont nous vous sommes redevables.
Nous vous prions, toutefois, de nous faire savoir si, étant donné les circonstances mystérieuses qui ont entouré le décès de M. Baraban, vous acceptez la déclaration du décès promulguée par la préfecture de police, ou si, au contraire, vous préférez attendre la fin des enquêtes.
Dans l’espoir de vous lire prochainement,
Recevez, Monsieur, nos salutations les plus empressées.
– Les imbéciles ! Et dire qu’ils nous demandent si nous voulons toucher, dit Alice Ricard.
– Oui, ils sont plutôt naïfs. Si nous voulons toucher ? Ah certes oui, ça n’est pas pour rien n’est-ce pas, que nous avons eu tant de mal pour réussir notre coup.








