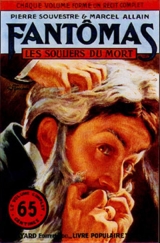
Текст книги "Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Fandor se coulait sans faire de bruit entre des haies, des arbres, de petits sentiers. Il atteignit sans encombre le bouquet d’arbres dont il avait, de loin, décidé de se faire un poste d’observation.
Fandor n’avait point menti en disant que les instructions de Juve, si nettes et si précises qu’elles fussent, comportaient cependant d’étranges obscurités.
Surveiller les Ricard, c’était bien ! Les empêcher de fuir, c’était plus délicat.
– Le cas échéant, pensait Fandor, je me demande ce que je ferai. En somme, je n’aurais aucun droit d’empêcher ces gens de partir en Belgique, si la fantaisie leur en prenait.
Mais Fandor, malgré tout, se rassura à ces mots.
– Bah, songeait-il encore, si Juve m’a envoyé ici, c’est évidemment qu’il redoute ou qu’il espère quelque chose d’important et de grave. S’il ne m’a pas donné d’explications plus détaillées, c’est qu’il estime que les circonstances me dicteront clairement la conduite à suivre. Dans ces conditions, j’aurais tort de m’inquiéter.
Fandor s’installa dans le petit bois, le plus confortablement qu’il put. Il commença par déployer à terre un journal, posa son chapeau sur ce journal, s’étendit sur la mousse, tira des allumettes, des cigarettes et, tranquillement, en fumant, en jouissant de la grande paix de la campagne, commença à monter la garde derrière la maison des Ricard.
– Ce que je voudrais savoir, songeait-il, c’est le temps que je vais avoir à passer ici. M’en irai-je à midi, à cinq heures, à sept heures, à minuit ? Sacré bon sang ! J’espère tout de même que Juve viendra me relever un de ces jours, sans quoi je prendrai racine. D’autant que la mousse est joliment mouillée et que j’ai quatre-vingt-dix-neuf chances sur cent pour faire, le mois prochain, un usage immodéré de pastilles contre le rhume.
Fandor contemplait la maison des Ricard tout en parlant, mais bientôt il se tut.
Une fenêtre de la maisonnette s’était ouverte, et le jeune homme apercevait Alice Ricard qui, ne se sachant point de voisin et ne devinant pas qu’un observateur la surveillait, s’apprêtait à faire sa toilette en léger déshabillé.
– Ma foi, pensa le journaliste, tout à l’heure je regrettais de ne pas être peintre paysagiste. Je vais maintenant déplorer de ne pas être portraitiste. Oh, oh ! Mais de mieux en mieux…
Fandor lorgnait avec admiration et amusement aussi, la jolie Alice Ricard qui, maintenant en cache-corset, les bras nus, refaisait sa coiffure, gracieuse et séduisante, dans une pose toute naturelle.
– Pas mal, l’enfant, murmurait Fandor. Je lui dirais bien deux mots, moi, s’il n’y avait pas le vieux Baraban.
Car, dans l’esprit de Fandor, depuis les découvertes faites au Crocodile, ce n’était point Fernand Ricard qui pouvait être un obstacle à une amourette avec Alice. Fernand Ricard avait, au moins en apparence, toutes les caractéristiques du mari complaisant.
Hélas, pendant que Fandor faisait ses réflexions, tranquillement assis sur l’herbe, un orage d’une violence inouïe éclatait.
– Nom de nom, grogna le jeune homme, il n’y a pas moyen de rester là, je vais être trempé.
Fandor jeta des regards désespérés autour de lui, et soudain, son visage s’illumina :
– J’ai de la veine tout de même, soupira-t-il.
Le journaliste venait d’apercevoir, dressée en face de la villa des Ricard, une masure, fort délabrée, qui parfois servait de refuge aux chasseurs.
En deux bonds, Fandor y fut installé. Il avait la chance inouïe de retrouver dans un coin une cruche d’eau et quelques provisions.
– Ah ben vrai, s’écria le journaliste en dansant de joie, voilà l’endroit rêvé pour y monter la garde. Si après cela, les types d’en face se débinent sans que je les voie, j’en veux des prunes.
Pauvre Fandor. Il avait compté sans sa triomphante jeunesse ! Il est beau de faire le guet, mais les forces humaines ont des limites, et, lorsque après avoir veillé une nuit sans fermer l’œil, Fandor voyait à l’horizon, se lever le soleil, la fatigue le terrassa. Il resta cependant éveillé une partie de la journée, mais quand la deuxième nuit de surveillance commença, les paupières de l’ami de Juve, doucement, se fermèrent peu à peu, le sommeil le rendit insensible et parfaitement indifférent à ce que faisaient les Ricard.
***
– Zut !
Fandor venait de se réveiller.
– Ah mince alors, quel imbécile je fais, quel crétin !
Un bruit insolite avait fait tressaillir le journaliste, qui, depuis près de dix heures consécutives, était dans les bras de Morphée.
Il faisait désormais grand jour, le soleil même était assez bas à l’horizon, annonçant le crépuscule.
Fandor se leva brusquement sur son séant et s’écria, en s’élançant vers la porte de sa cabane :
– Tiens, une automobile ! J’entends ronfler le moteur. C’est même lui qui m’a réveillé. Ah, mais, ça doit même être une assez forte voiture, elle grimpe la côte et l’on croirait bien que le conducteur n’a pas changé de vitesse.
Fandor ne prêta pas grande attention à l’arrivée de cette voiture. Il allait même se précipiter, en affamé, sur les provisions qui lui restaient de son siège de deux jours, lorsque soudain, il lui sembla que le véhicule ralentissait, tout comme si le conducteur eût voulu stopper devant la maison des Ricard :
– Oh, oh, pensa le journaliste, est-ce que ça serait l’incident ?
Quelques secondes passèrent, le grincement d’un coup de frein, le grondement d’un moteur débrayé avertirent Fandor qu’il avait supposé juste, que la voiture venait de s’immobiliser devant la façade de la maisonnette.
– Que faire ? pensa le journaliste.
Il hésitait à se rapprocher, lorsque, très nettement, dans l’air calme de la matinée, un appel retentit.
La voix de Fernand Ricard criait, venant du jardin sans doute :
– Alice, Alice, où es-tu ?
Le journaliste vit la jeune femme se lever, s’appuyer à la barre d’appui de sa fenêtre.
– Dans le salon ! Qu’est-ce que tu veux ?
– Descends tout de suite, Prends un chapeau et descends. C’est urgent !
À cet instant, Jérôme Fandor sortit de sa cabane avec précipitation.
– Que faire ? se demandait le journaliste. Qu’est-ce qui se passe ? On dirait, sacré mille bon sang, que Fernand Ricard parle avec une émotion contenue. Sa voix tremble. Parbleu, une automobile qui arrive, Fernand Ricard qui appelle sa femme, Juve qui m’a dit : « Empêche-les de se débiner ! », je n’ai pas à hésiter.
Fandor ne prit même pas le temps de ramasser ses cigarettes.
Son chapeau à la main, courant aussi vite qu’il le pouvait, et se moquant pas mal des dommages qu’il pouvait ainsi causer à ses fameuses chaussures jaunes, le journaliste se précipitait vers la route.
– Il faut que je voie le bonhomme qui est dans la voiture, se disait Fandor.
Hélas ! à l’instant même, où le journaliste arrivait sur le bord de la route, il apercevait l’automobile démarrant devant la maison des Ricard, gagnant de vitesse. En quelques mètres c’était à toute allure qu’elle passait devant lui.
– Nom de Dieu ! hurla le journaliste. Je suis joué, ils foutent le camp.
***
Que s’était-il passé dans la maisonnette des Ricard au moment où l’automobile mystérieuse avait débouché sur la grand-route ?
Fernand Ricard était tout simplement installé dans le jardin, occupé à rattacher à leur tuteur les rosiers auxquels il tenait beaucoup. Le courtier, tout comme Fandor, entendit le ronflement de l’automobile et se retourna pour l’apercevoir.
Fernand Ricard alors, s’affaira.
La voiture brusquement arrêtée par un coup de frein brutal, fit déraper les roues et crier tout le mécanisme en s’immobilisant à la porte. Un homme, le conducteur, le seul passager d’ailleurs, lâcha alors le volant, sauta à terre, entra dans le jardin.
Cet homme était glabre, avait un masque d’énergie, des yeux extraordinairement perçants, le geste bref, autoritaire.
– Vite, Ricard, ordonnait-il, où est votre femme ?
– Mais qui êtes-vous ?
– Je vous le dirai tout à l’heure. Vite. Obéissez ! Appelez-la. Votre salut est une question de minutes. Allons ! Appelez-la, vous dis-je ! Je vous emmène !
Fernand Ricard ne songea même pas à résister.
– Alice, cria-t-il, vite, vite !
Alice Ricard était, une seconde après, aux côtés de son mari.
– Montez, cria l’énigmatique visiteur, poussant les époux dans sa voiture, montez ! Pas un mot, pas un cri, je suis là pour vous sauver.
Une minute après son arrivée, moins peut-être, l’automobile démarrait.
L’homme glabre, visiblement un virtuose du volant, passa les vitesses avec une habileté consommée. En dix mètres, l’automobile était lancée, le moteur reprenait franchement, la voiture semblait voler sur la route.
C’est à cet instant que l’automobile croisa Fandor arrivant sur le bord du chemin.
– Il était temps, grommela le conducteur.
Mais son pied s’appuyait sur la pédale de l’accélérateur, la voiture augmentait encore la vitesse. Elle fila dans un ronronnement de moteur.
Que pensaient à ce moment les époux Ricard ?
Assis sur la dernière banquette du véhicule, serrés l’un contre l’autre, tremblants, effarés, fous de saisissement et de peur, ils n’échangèrent qu’un mot :
– C’est lui, dit Alice Ricard.
– Oui c’est lui, répondit le courtier.
Et tous deux avaient désigné l’homme qui tenait le volant.
Alors, ce fut une course insensée qui emporta la voiture.
Pendant plus d’une grande demi-heure, marchant aussi vite qu’il le pouvait, prenant les virages à la corde, dérapant sur la route boueuse, se révélant conducteur consommé, l’homme glabre forçait l’allure.
On passa Gaillon, c’est seulement après avoir franchi la côte célèbre, après avoir obliqué ensuite dans la forêt voisine, que l’homme ralentit sa marche. La voiture était peu après engagée dans un petit chemin désert. Le moteur brusquement cessa de bourdonner. Les freins crièrent. Dans un choc, l’automobile s’arrêta.
L’homme, alors, bondissant de son siège, ouvrit la portière et ordonna sèchement à Alice et Fernand Ricard :
– Descendez et causons.
Les deux époux d’une même voix, interrogèrent leur extraordinaire ravisseur :
– Qui êtes-vous ? demandaient-ils. Que nous voulez-vous ?
L’homme à cet instant éclata de rire :
– Procédons par ordre, disait-il, et d’abord laissez-moi vous répondre ce qui est la vérité : je suis votre sauveur.
– Notre sauveur ? Mais enfin, que voulez-vous dire ?
L’inconnu cessa de rire, prit, pour répondre, un ton gouailleur, menaçant presque :
– Vraiment, disait-il, vous ne me reconnaissez pas ? Vous ne devinez pas qui je suis ? Il faut que je me présente, que je vous donne mon nom ? Bah, qu’importe après tout, soyez satisfaits !
Le personnage s’était reculé de trois pas. Il croisa ses bras sur sa poitrine, il regarda Fernand Ricard dans le blanc des yeux, il eut l’air de le juger :
– Fernand Ricard, déclara-t-il alors, je suis Celui qui, par deux fois, est venu mystérieusement vous voir, je suis Celui que vous avez vu apparaître sous les traits de l’oncle Baraban, je suis surtout, Fernand Ricard, je suis surtout, comme je vous l’ai dit, le Maître de tout, de tous, Celui contre lequel on ne lutte pas, Celui auquel on ne résiste pas, je suis Fantômas.
On eût dit qu’à ce nom tragique, le bois frissonnait. On eût dit que la tempête, qui menaçait depuis le matin, attendait ce nom terrible pour éclater.
Brusque, sauvage, âpre, un coup de vent coucha les arbres, souffla au visage des époux Ricard. Des tourbillons de feuilles s’élevèrent, les oiseaux se turent, un nuage noir s’abaissa comme pour écraser de son poids formidable la forêt terrifiée.
– Je suis Fantômas, répétait l’homme, je suis l’Insaisissable, le Génie du crime, l’Homme qui fait peur, l’Homme qui tue. Je suis votre Maître, mes amis, et c’est parce que je suis votre Maître, que tout à l’heure je vous ai sauvés.
– Fantômas, Fantômas, dit le courtier en vins, par pitié, ne nous torture pas. Que veux-tu de nous ? Pourquoi dis-tu que tu nous as sauvés ? Quel danger courions-nous ?
Fantômas, car c’était bien lui qui se trouvait en face de Fernand Ricard, interrompit le courtier du geste :
– Silence ! Taisez-vous ! Devant moi, on ne parle que lorsque je le permets. Et d’abord, disait-il, voici mes félicitations mes amis. Oh, votre invention est admirable, votre coup d’audace très fort, l’oncle Baraban… vous avez inventé là quelque chose de superbe. Son assassinat vous fait le plus grand honneur, vous entendez ? C’est Fantômas qui vous adresse ses félicitations.
Il rit encore, puis brusquement :
– Cet assassinat a été d’autant plus habilement fait, ajouta-t-il, qu’en somme, votre oncle n’est pas mort, vous ne l’avez pas tué ?
– Si, protesta le courtier, nous avons tué notre oncle, nous l’avons assassiné, c’est pour cela que vous, Fantômas, vous qui avez eu l’audace de réapparaître sous ses traits…
Mais il n’acheva pas.
– Inutile de mentir, avait dit Fantômas, je sais tout ! Parbleu, c’était trop étonnant, aussi, que vous refusiez de me dire où était ce cadavre. J’ai voulu deviner votre secret, je l’ai deviné.
Il avait parlé cette fois très vite, c’est très vite encore qu’il reprit :
– Mais la comédie est finie. Impossible pour moi de résister plus longtemps, mes amis, je suis démasqué. L’oncle Baraban que j’étais n’est plus. Fantômas a jeté le masque.
– Vous êtes démasqué, Fantômas ? La police sait que vous teniez le rôle de l’oncle Baraban ?
– Oui, répliqua le Maître de l’Effroi, la police le sait, Juve l’a deviné.
– Alors, nous sommes perdus.
Le Maître de l’Effroi haussa les épaules :
– Pas encore, murmurait-il. Il ne vous reste qu’une chose à faire : m’obéir.
– Vous obéir, Fantômas ? Non. Jamais ! Nous vous haïssons trop, ma femme et moi. Ce qui arrive est de votre faute. Sans vous, nous triomphions, et puis, après tout, que risquons-nous ? Nous dirons la vérité.
Mais encore une fois Fernand Ricard se tut, sans achever sa phrase.
Le regard de Fantômas était posé sur lui.
– Mon ami, vous direz, si vous le voulez, que vous avez tué M e Gauvin, voilà tout ce que vous direz, et tout ce que l’on croira.
– Mais comment ? Mais je n’ai pas tué M e Gauvin.
– Sans doute, Ricard, ce n’est pas vous, puisque c’est moi. Seulement, on ne vous croira pas. On ne vous croira pas, parce que tout vous accuse, mon cher. À partir du moment où Juve m’a eu démasqué, à Paris, tout a été remis en jeu. Vous êtes à nouveau soupçonné d’avoir tué votre oncle. Il vous reste à expliquer, et cela vous est impossible, la disparition de cet honnête vieillard. Vous devrez préciser pourquoi on a retrouvé la malle jaune dans votre puits, et le mouchoir sanglant de votre femme rue Richer. Vous devrez dire comment il se fait que vous m’avez reconnu alors que je n’étais pourtant pas votre oncle. Enfin, je vous le répète, vous devrez vous défendre d’avoir tué M e Gauvin. Car j’ai assassiné M e Gauvin. Cela sera difficile, Fernand Ricard, très difficile, croyez-moi.
Fantômas avait éclaté de rire, semblait très amusé car, maintenant Fernand Ricard suait d’angoisse et se tordait les mains.
– Que faire ? gémissait le courtier, que faire ?
– M’obéir. Il faut m’obéir, là est le salut.
Et comme Fernand Ricard ne disait plus rien, maté, dompté, n’ayant plus la force de résister à son terrifiant adversaire, Fantômas, sans se presser, tirait de sa poche son portefeuille, y prenait deux feuilles de papier à lettre qu’il étalait sur les coussins de la voiture :
– Je vais vous dicter deux lettres, commença-t-il. Voici mon stylographe, allons, vous entendez ?
Les époux Ricard le contemplaient, fous d’épouvante.
– Madame, reprit Fantômas, en regardant Alice de façon impérieuse, je vous attends. Veuillez prendre ce porte-plume, veuillez écrire.
***
Cependant, Jérôme Fandor, demeuré à Vernon, bien malgré lui, fou de rage, désespéré, se hâtait.
– J’en aurai le cœur net, grondait le journaliste, il faudra bien que Juve me dise ce qu’il en est. En tout cas, il me donnera un conseil.
Fandor courut comme un fou jusqu’au petit pays. En route, cependant, il se frappait le front d’un geste désespéré.
– Nom de nom, disait le journaliste, mais c’est dimanche aujourd’hui, et le dimanche, le téléphone ne marche pas.
Fandor, en effet, au moment où la voiture automobile enlevait devant lui Fernand et Alice Ricard, avait immédiatement pensé à prévenir Juve de cet accident.
– Sale administration des Postes, grommelait Fandor. Imbécile d’organisation française. Ah, ce n’est pas en Angleterre qu’on s’arrêterait à des inventions pareilles. Fermer le téléphone. Si ça n’est pas honteux [14] !
Fandor, toutefois, se hâtait toujours. L’esprit fertile du journaliste n’était jamais embarrassé longtemps.
– Je trouverai bien moyen, pensait-il, de téléphoner, en dépit de la fermeture du bureau de poste. C’est bien le diable si à Vernon…
Puis, Fandor s’interrompit brusquement.
– Dieu que je suis bête, je n’ai qu’à aller à la gare. Toutes les gares de chemins de fer, en effet, et Fandor le savait bien, possèdent une ligne téléphonique. Cette ligne, en fait, n’est pas reliée au réseau de l’État de façon permanente, mais étant donné la gravité des circonstances, étant donné qu’il s’agissait de téléphoner à Juve, au policier Juve, Fandor ne désespérait pas d’obtenir de l’administration des chemins de fer ce qui n’était en somme qu’une complaisance :
– Je vais téléphoner au commissaire spécial de la gare Saint-Lazare, pensait Fandor, et je chargerai ce fonctionnaire de téléphoner de ma part à Juve, au quatre cent trente-six zéro zéro [15].
Malheureusement, les diverses formalités à remplir à la gare prirent plus de deux heures. Le journaliste obtint bien, après de nombreuses palabres, l’autorisation de téléphoner au commissaire spécial de la gare Saint-Lazare, il obtint bien encore que celui-ci téléphonât à Juve, mais comme il demandait qu’on l’avertît de la réponse du policier, Fandor devait apprendre avec désespoir qu’il n’y avait pas de réponse, pour la bonne raison que Juve ne se trouvait pas chez lui.
Fandor, alors, se sentit désespéré.
Comme il traversait la salle d’attente, ne sachant trop ce qu’il allait faire, une pensée nouvelle lui vint :
– Bon Dieu, que je suis bête ! J’ai encore un autre moyen de prévenir Juve, je vais lui télégraphier.
Fandor revint supplier le chef de gare et obtint cette fois, sans trop de peine, d’envoyer une longue dépêche au policier.
Cette dépêche, Fandor voulait la faire adresser à deux endroits différents :
– J’en enverrai un exemplaire rue Tardieu, expliqua-t-il, et l’autre à la Préfecture de Police, Juve l’aura toujours à l’un ou à l’autre de ces endroits.
Et, pour rédiger son texte, Fandor, quittant le bureau du chef de gare aux allées et venues continuelles, passa dans la salle d’attente. Or, au moment même où le journaliste se trouvait sur le quai, il s’arrêta, devenu blême de saisissement : devant lui, à quelques mètres à peine, tenant une valise à la main, portant un pardessus sur son bras, ayant tout l’air de s’apprêter à faire un long voyage, un homme :
– Fernand Ricard, dit Fandor. Ah, ça, mais je deviens fou ! Comment ? Le voilà revenu ?
Or, précisément, un employé annonçait sur le quai :
– Les voyageurs pour le train du Havre, avançons s’il vous plaît ! Le rapide est signalé !
Jérôme Fandor entendit cela comme dans un rêve. Quelques secondes encore, le rapide arrivait. Alors, brusquement, Fandor prit une décision :
– Monsieur le chef de gare ! Monsieur le chef de gare !
Comme un fou, le journaliste avait bondi vers le bureau du brave homme.
– Voici ma dépêche.
D’une écriture illisible, Fandor griffonnait :
Je pars pour je ne sais où, Le Havre sans doute, derrière Fernand Ricard qui semble en fuite. Vous télégraphierai rue Tardieu. Amitiés, Fandor.
Le journaliste, rapidement, jetait cela aux mains du chef de gare, qui devant sa précipitation, perdait la tête :
– Mais que faites-vous ? disait le brave homme. Où allez-vous ?
Le rapide allait démarrer, Fandor sauta sur le marchepied.
– Mais vous n’avez pas de billet ! hurla le chef de gare.
– Je m’en fous ! cria Fandor.
La réponse du journaliste se perdit dans le fracas.
24 – CRIME OU SUICIDE ?
– En voiture, les voyageurs pour Vernon, allons, dépêchons !
On claquait les portières, déjà le train s’ébranlait. Un homme qui arrivait en courant, se précipita sur le marchepied, ouvrit une portière de wagon, grimpa dans un compartiment et tomba plus qu’il ne s’assit sur la banquette.
– Ouf, murmura-t-il, il était temps.
Cet homme, c’était Juve.
Le célèbre policier, après avoir été convoqué par M. de Parcelac, directeur du Comptoir National, afin de découvrir l’homme qui avait osé truquer la roue de la loterie, n’avait pas hésité à conclure :
– C’est encore du Fantômas.
L’inspecteur de la Sûreté avait, en outre, eut la certitude qu’il fallait rattacher les diverses aventures de l’affaire Baraban à cette nouvelle affaire.
– Si Fantômas s’est fait passer pour Baraban, se disait Juve, c’est certainement qu’il y avait un intérêt. Le truquage de la roue n’a été fait et combiné qu’en vue de gagner le gros lot de deux cent mille francs. Fantômas sachant que le numéro 6 666 appartenait à Baraban, s’est arrangé pour d’abord, en se faisant passer pour M. Dominet, secrétaire de la Chambre des notaires, s’emparer du cachet du Comptoir National, et ensuite des numéros devant être tirés le soir même. Il les a remplacés par des 6.
Et mentalement, Juve repassait dans son esprit toutes les aventures qui s’étaient déroulées les jours précédents. L’imbroglio de l’affaire Baraban ne se dénouait encore pas tout à fait aux yeux du policier :
– Sans aucun doute, c’est Fantômas qui s’est substitué au véritable Baraban, c’est lui qui a combiné l’affaire du 6 666 gagnant des deux cent mille francs, mais enfin, il y a eu un véritable oncle Baraban. Qu’est-il devenu ? Je vais finir maintenant, par croire qu’il a été assassiné, et assassiné par Fantômas.
Et malgré lui, le célèbre inspecteur se remémorait ses diverses perquisitions au domicile du disparu. Il se rappelait cette mise en scène, à coup sûr voulue, ces taches de sang, tout ce désordre truqué. Juve alors ne pouvait s’empêcher de murmurer :
– Peut-être Fantômas a-t-il pris seulement la personnalité du véritable Baraban pour voler le billet de la loterie, et peut-être aussi le vrai Baraban, l’oncle des Ricard est-il bien le personnage qui est débarqué au moment de l’arrestation à Vernon. Car enfin, je ne vois plus l’intérêt qu’aurait eu Fantômas à sauver les Ricard, à moins qu’ils ne soient ses complices ? Et puis il y a ce notaire, Gauvin, qui détenait le billet de loterie. Est-ce que Fantômas aurait eu l’audace d’aller à Vernon toucher ces deux cent mille francs à l’étude, dans son personnage de Baraban ? Le mieux est d’aller moi-même à Vernon. J’interrogerai d’abord M e Gauvin, et ensuite les Ricard. Peut-être, de la sorte, retrouverai-je la filière de toutes ces aventures et aussi le principal acteur de cette sinistre comédie. Ah, Fantômas ! Fantômas, il ne sera pas dit que vous m’échapperez encore. Cette fois, nous jouons serré. Il s’agit de vie ou de mort. Je n’hésiterai pas, si je vous rencontre sur mon chemin, à vous abattre comme une bête féroce que vous êtes.
Le train filait à toute allure. Les stations passaient les unes après les autres, et bientôt, des voix crièrent :
– Vernon, Vernon !
Son billet à la main, Juve se dirigea vers la sortie de la station. Au moment où il atteignait la barrière, il se heurta à un gros homme, qui n’était autre que le brave chef de gare et qui, à sa vue, immédiatement, pâlit, leva les bras au ciel :
– Ah monsieur, quel malheur, gémissait-il, un si brave homme !
Juve n’eut aucune envie d’éterniser les lamentations du personnage qu’il rencontrait, il pensait qu’il s’agissait du retour de l’oncle Baraban.
Discrètement, il serra la main du chef de gare et s’apprêtait à poursuivre son chemin. Le policier prit donc un ton enjoué pour répondre :
– Bah, il ne faut pas se frapper, tout est bien qui finit bien, l’oncle Baraban est de retour, c’est une affaire terminée.
Mais, au fur et à mesure qu’il parlait, Juve voyait un sentiment d’horreur mêlé de stupéfaction se peindre sur les traits du chef de gare :
– Ah ça, s’écria enfin le fonctionnaire, mais il me semble que je deviens fou, monsieur le policier, vous dites que tout est bien qui finit bien ?
– Sans doute ! répondit Juve bonasse. Dans quinze jours on ne parlera plus de cette histoire-là.
Juve, péremptoire, venait de répondre, il allait s’éloigner en haussant les épaules pour se débarrasser du fâcheux, mais le chef de gare le retenait par la manche de sa jaquette :
– Sûrement, disait le brave homme, vous ne savez pas, monsieur Juve, ce qui est arrivé ?
– Quoi donc ?
– Monsieur Juve, vous ne connaissez pas le malheur de cette nuit ?
– Quel malheur ? Que s’est-il passé ?
– Monsieur Juve, c’est une chose effroyable, abominable ! M e Gauvin, notre excellent notaire, un homme que tout le monde respectait ici, que tout le monde avait plaint lorsque son fils avait paru compromis…
– Oui, oui, alors ?
– Alors, murmura tout bas le chef de gare, ce pauvre M e Gauvin s’est suicidé cette nuit. Il y a deux heures, on l’a retrouvé…
Mais Juve n’écoutait plus le brave homme. Il avait pris sa course et, le plus vite qu’il le pouvait, se dirigeait vers Vernon.
Le policier, à cet instant, était fou d’émotion :
– Ça, pensait-il, c’est plus fort que tout, et j’étais loin de m’y attendre. M e Gauvin se suicidant, allons donc ! C’est extraordinaire !
Et Juve, au même instant, pensait que M e Gauvin s’était suicidé après le tirage de cette loterie où le 6 666 qu’il détenait au nom de Baraban avait gagné les deux cent mille francs.
– Est-ce une coïncidence ? S’est-il tué pour des motifs d’ordre privé ? Ou bien alors, aurait-il craint un scandale ? Pourtant, ce n’était pas sa faute, à ce malheureux, si le billet qui gagnait le gros lot était en sa possession, et si le tirage était truqué.
Lorsque Juve arriva devant l’étude, il n’était point peu surpris d’apercevoir quatre équipages : un vieux coupé de maître et trois automobiles, stationnant à la porte de M e Gauvin.
– Pourtant, pensa le policier, je suppose que la maison est fermée aujourd’hui ?
Juve poussa la porte d’une grille de fer forgé, traversa le jardin, escalada le perron, et, dans le vestibule du petit hôtel, il se heurtait à M. Varlesque, juge d’instruction :
– Eh bien, criait Juve, où en sont les formalités ?
– Enchanté de vous voir, répondit le magistrat qui tenait aux formes. Très heureux de vous rencontrer à nouveau.
– Que savez-vous ? interrogea Juve. Pourquoi s’est-il tué ?
– Qui ?
– M e Gauvin, parbleu !
– Comment. Vous savez déjà ?
– Mais naturellement, tempêta Juve, et je suppose que vous allez me renseigner. Qu’avez-vous découvert jusqu’à présent ? Pourquoi ce suicide ?
M. Varlesque prit l’air grave :
– Je suis en train d’instruire, dit-il. Le suicide est flagrant et M. le procureur…
Au bout du corridor justement, apparaissait un autre magistrat, le procureur de Larquenais.
Juve, laissant brusquement derrière lui l’insignifiant juge d’instruction, bondit à la rencontre de l’arrivant.
– Bonjour, bonjour ! cria-t-il. Et alors, que savez-vous ? Avez-vous deviné pourquoi cet homme s’est tué ?
– Mon cher ami, j’ai été averti à onze heures seulement. Nous arrivons. C’est un spectacle affreux, je vous assure.
À ces mots, Juve fut sur le point de sauter au cou du jeune magistrat et de l’étrangler :
– Mais répondez-moi donc, hurla le policier. Tout cela ça n’est pas intéressant. Je vous demande pourquoi M e Gauvin s’est tué ?
– Je n’en sais rien, répondit tranquillement le procureur de la République. D’abord nous arrivons. Et puis, s’il s’est tué, ajoutait finement le magistrat, c’est qu’il avait assurément des raisons pour cela.
Juve à cet instant, avait perdu tout espoir d’apprendre quoi que ce fût par l’intermédiaire du Parquet de Vernon :
– Bon, fit-il, renonçant à interroger. Où est-il ? A-t-on changé quelque chose à la disposition de la pièce dans laquelle il est mort ? Comment s’est-il tué ? Revolver ? Poison ? Menez-moi vers lui.
– Là, là ! s’écriait le magistrat. Vous me demandez mille choses à la fois ! Voyons, écoutez-moi ! D’abord, on n’a rien changé à l’aspect de la pièce, j’ai ordonné qu’on laissât les choses en état.
– Moi aussi, confirma M. Varlesque, respectueux. J’ai répété vos ordres, monsieur le procureur.
– Ensuite, le malheureux se trouve encore tel qu’on l’a découvert, au premier étage, dans sa chambre.
– Mais qu’est-ce qui cause donc, là-haut ? Les gendarmes ?
– Non, des curieux qui sont venus voir, des voisins.
– Ah ça, demanda Juve, qu’est-ce que vous me chantez là ? Il y a des curieux ? Des voisins ? Mais nom d’un chien, il faut foutre tous ces gens-là dehors. Qu’est-ce qu’ils ont à faire ici ?
Juve se précipita vers l’escalier. En montant, il demanda encore :
– Comment s’est-il tué ?
– Le malheureux s’est pendu.
Arrivé dans l’antichambre du premier étage du petit hôtel, le policier aperçut une dizaine de personnes groupées dans le couloir qui, curieusement, examinaient une pièce par une porte ouverte.
Juve alors n’hésita pas :
– Je ne veux personne ici ! criait-il. Allons, dépêchons, tout le monde dehors ! Sapristi, ce n’est pas un spectacle si attrayant.
La voix de Juve grondait, tonnait, dominait le tumulte. Il y eut des exclamations étouffées, le couloir se vida.
Il ne restait plus en présence que le policier, le juge d’instruction, le procureur et aussi un pauvre garçon affalé sur une chaise qui sanglotait de tout son cœur et qui n’était autre que le petit Théodore Gauvin.
Juve le vit au moment même où il apercevait, se balançant dans le vide au milieu de la pièce, le corps déjà roidi du malheureux notaire. Juve, à cet instant, haussa les épaules. Il oublia un instant ses préoccupations de police pour ne songer qu’aux malheurs du jeune homme.
Le policier courut donc vers Théodore Gauvin.
– Mon pauvre petit, disait-il, je comprends tout votre chagrin et toute votre douleur, mais croyez-moi, ne restez pas ici. Voyons, retirez-vous dans votre chambre, j’irai sans doute vous y retrouver tout à l’heure.
Il y avait dans le ton de Juve quelque chose de ferme et d’impérieux. Le malheureux Théodore Gauvin qui sanglotait toujours, se leva, et, sans mot dire se retira, à bout de force, semblait-il.
– Pauvre enfant, murmura Juve. C’est abominable.








