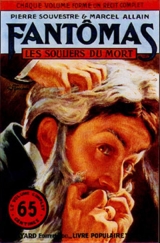
Текст книги "Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
– Allô, avez-vous donc du nouveau ? demanda Juve.
– Peut-être, dit M. Havard, puis, après un temps, le chef de la Sûreté, ajouta :
– Dites donc, Juve, entre nous, autre chose : j’ai payé votre note du Crocodile, reçue ce matin. Mais il me semble que vous avez un peu exagéré. Peste, mon cher, vous ne vous refusez plus rien maintenant. Le menu était fort bon !
On eût annoncé à Juve que Paris s’était écroulé, que la tour Eiffel avait grandi de cent mètres dans la nuit précédente, qu’il n’eût pas été plus ahuri.
– Ma note du Crocodile ? protesta Juve. Allô ? Mon menu ? Ah ça qu’est-ce que vous me racontez monsieur Havard, je n’ai rien pris au Crocodile. J’ai même été à peu près flanqué à la porte.
Mais aucune voix ne répondit. Une employée zélée avait tranquillement coupé la communication.
14 – PERQUISITIONS
Il était tout près de trois heures et Juve, exact comme un militaire, attendait depuis quelques minutes à peine, lorsque le coupé de M. Havard arriva rue Richer et stoppa à la hauteur du policier.
M. Havard sauta de voiture plutôt qu’il n’en descendit. Il paraissait joyeux et apostropha Juve.
– Tiens, voilà notre noceur. Comment ça va-t-il depuis ce matin ?
– Cela va parfaitement, répondait Juve, je vous remercie, mais je tiens à dégager tout de suite ma réputation compromise. Monsieur Havard, foi d’honnête policier, je ne mérite pas d’être traité de noceur.
À cela, M. Havard répondait plaisamment en levant les bras au ciel :
– Qui donc le mériterait, grands dieux ? Savez-vous quel était le total exorbitant de votre dîner d’hier soir ? Cinquante-sept francs.
– Erreur, répondit Juve, profonde erreur. J’ai dîné pour deux francs soixante.
Et comme M. Havard le regardait fort surpris, Juve expliquait :
– Voici la clé de l’énigme, M. Havard, vous avez été victime d’une plaisanterie de mon ami Fandor.
Et Juve, qui venait de déjeuner avec le journaliste, expliqua à M. Havard, fort amusé, les incidents de la nuit précédente.
– Voilà la vérité, concluait-il. Fandor s’est conduit comme un polisson et m’a fait soupçonner d’indiscrétion notoire. En revanche, vous avouerez, patron, que mon jeune ami n’a pas perdu son temps.
Les deux hommes causaient encore sur le trottoir, M. Havard prit Juve par le bras et le poussa vers la porte cochère de l’immeuble du crime.
– Fandor n’a pas perdu son temps, approuvait M. Havard, c’est exact ! Vous non plus, Juve, et moi encore moins.
C’était là bien évidemment des paroles imprudentes, que Juve ne pouvait guère laisser passer sans protester :
– Oh, oh, dit-il, on dirait que vous avez du nouveau ?
– Beaucoup de nouveau, répondit M. Havard. Je vous l’expliquerai tout à l’heure.
Il regarda Juve en riant, puis ajouta :
– Et du nouveau qui vous surprendra, encore !
Or, à ce moment, Juve faisait une mine assez curieuse :
« C’est bizarre, pensa le policier en lui-même, mais Havard a l’air satisfait. C’est qu’il a trouvé quelque chose qui peut lui donner à penser que la thèse de l’assassinat se confirme, or l’assassinat, je ne peux pas y croire. »
Juve toutefois se garda bien d’exprimer ses réflexions à haute voix.
– Patron, répondait-il, je suis prêt à vous écouter quand vous voudrez.
M. Havard, cependant, de façon autoritaire, car il aimait un peu de temps à autre à faire parade de son grade, ouvrit la loge de la concierge.
– Les clés de M. Baraban ? demanda-t-il.
La concierge avait été, en effet, nommée gardienne des scellés, ainsi qu’il est d’usage.
– Seigneur, doux Jésus, s’exclama-t-elle en reconnaissant le chef de la police, c’est-il encore que vous allez monter à l’appartement de ce pauvre cher brave homme ? Connaît-on son assassin ?
– On ne connaît rien du tout, affirma M. Havard.
Et de plus en plus autoritaire, le chef de la Sûreté ajouta :
– D’ailleurs, madame, si vous voulez être renseignée, vous n’avez qu’à lire le journal. Vous y trouverez tout ce qu’il y a d’important à connaître pour vous.
En possession des clés, à peine toucha-t-il son chapeau.
– Gardez votre loge et ne laissez monter personne ! M. Juve et moi nous allons travailler.
M. Havard s’en alla sur ces mots, ne se doutant point qu’en brusquant la digne portière, il venait de s’en faire une ennemie, ce qui n’était peut-être pas très adroit.
Tandis que le chef de la Sûreté, en effet, montait en compagnie de Juve vers l’appartement sinistre, la concierge, femme de bon sens, jugea la situation d’un mot :
– En voilà un crâneur ! disait-elle. Ça a l’air de se croire le Président de la République ! Parbleu, s’il savait quelque chose, il serait bien trop content de le dire. C’est pas M. Fandor, ni M. Juve qui m’enverraient promener comme ça. Mais aussi, tous les deux, ce sont des malins.
Pendant que la concierge monologuait de la sorte, M. Havard et le policier arrivaient à l’appartement tragique.
– Ainsi, commença Juve, vous avez l’intention de perquisitionner à nouveau ?
– Oui, répliqua M. Havard, et de causer avec vous, tout d’abord.
Le chef de la Sûreté brisa d’un doigt, en vertu de sa qualité de commissaire de police, les scellés apposés le jour du crime sur la porte de l’appartement.
– Entrez, mon cher Juve.
Les deux hommes pénétrèrent dans le corridor, se découvrirent et malgré eux, frissonnèrent :
– Bigre, constatait M. Havard, on a beau être habitué, cela fait tout de même un drôle d’effet. Ça sent la mort ici, hein ?
Juve ne répondit point, mais il devait s’avouer, en effet, malgré ses convictions intimes, qu’il était impossible de nier que l’aspect de l’appartement était tragique, effroyable. Comme le disait M. Havard, cela sentait la mort.
Depuis le crime, en effet, nul n’était rentré dans le petit appartement dont Juve avait soigneusement respecté le désordre lors de sa première enquête.
Les meubles apparaissaient toujours renversés, brisés, éventrés. Les couvertures du lit de la chambre à coucher gisaient toujours sur le sol, et surtout, il y avait, aussi bien sur le parquet de la salle à manger que sur les tapis de la chambre, que sur les carpettes des corridors, de larges taches rougeâtres, faites d’un liquide épais, coagulé, des taches de sang.
– Par quoi commençons-nous ? demanda Juve.
M. Havard s’assit :
– Par causer, dit-il. J’ai d’ailleurs une confession à vous faire, Juve.
Or, à ces mots, le policier sursauta :
– Parbleu, vous reconnaissez, chef, que la thèse de l’assassinat ne tient pas debout et vous avez découvert quelque chose qui vous fait admettre ma théorie ? La théorie de la fugue ?
Juve parlait avec une entière bonne foi, librement. Il se mordit les lèvres en entendant la réponse de son chef :
– Sapristi, que vous êtes insupportable, Juve ! Quand vous avez une idée dans la tête, il n’y a pas moyen de vous en faire démordre.
– Aïe, pensait Juve à ce moment, j’ai parlé trop vite, c’est une gaffe. Le patron va se vexer et ne me dira rien.
M. Havard, cependant, après un mouvement d’impatience, redevint souriant :
– Juve, dit-il, regardez autour de vous, et répondez-moi de sang-froid. Voyons, est-ce qu’en présence de tout le désordre de cette pièce, vous pouvez soutenir qu’il n’y a pas eu assassinat ? Est-ce que ce sang, qui traîne sur le plancher… ? Est-ce que ce meuble fracturé… ? Est-ce que ce lit défait… ?
– Monsieur Havard, interrompit Juve, ne discutons pas, si vous le voulez bien, sur des hypothèses. Vous avez appris du nouveau. Quel est ce nouveau ?
M. Havard, cependant, devait être ce jour-là de bien bonne humeur, car, cette fois encore il ne se fâcha pas :
– Vous voulez apprendre ce que je sais de nouveau ? disait-il. Eh bien, soyez satisfait. Voilà…
Juve était tout oreille. M. Havard ne se dépêchait pas de le renseigner. Le chef de la Sûreté s’amusait, évidemment, de l’impatience de l’inspecteur.
– Juve, reprenait-il enfin, j’ai eu, hier soir une excellente idée, en vous quittant au Palais de Justice. J’ai fait convoquer, d’une part, tous les agents plongeurs et, d’autre part, tous les brigadiers de la Sûreté qui étaient disponibles.
– Pour quoi faire ?
– C’est simple. Les agents plongeurs doivent, aux termes de leur règlement, se tenir toujours sur les berges, n’est-ce pas ? J’ai voulu les interroger et savoir si l’un d’eux, par hasard, n’avait pas aperçu Théodore Gauvin et la nommée Brigitte, la nuit du crime, c’est-à-dire si l’alibi invoqué par ces individus était exact.
– Et alors ? demanda Juve.
– Et alors, articula lentement M. Havard, il s’est trouvé que l’idée était excellente. L’agent 66 a été très affirmatif. Il a pu m’affirmer qu’il avait vu cette nuit-là Théodore Gauvin et la jeune femme se promener sur les berges. Cet agent était d’autant plus certain de son fait, qu’il avait remarqué que le jeune Théodore Gauvin semblait être un monsieur vraiment bien habillé pour donner le bras à une femme du genre de Brigitte qu’il avait prise pour une pierreuse.
Juve, à ces mots, se frottait les mains :
– Ma foi, disait-il, vous avez raison, patron, vous n’avez pas perdu votre temps. Cette déposition innocente complètement le petit Théodore et Brigitte.
– Non, dit M. Havard, car enfin l’agent peut se tromper et, en tout cas, rien ne prouve que, très justement, cette rencontre ne soit point un rendez-vous prémédité des deux complices. Mais enfin, tout de même, c’est plutôt une présomption d’innocence. Mais enfin, oui, je conviens que ces jeunes gens ne pouvaient pas être rue Richer à l’heure du crime, puisqu’on les a vus sous un pont au même moment…
Le chef de la Sûreté se taisait, Juve interrogea encore :
– Et pourquoi avez-vous fait demander tous les brigadiers de Sûreté disponibles ?
– Pour leur enjoindre, mon cher Juve, de faire hier soir une rafle parmi les individus qui fréquentent habituellement les ponts, qui y cherchent chaque nuit un abri contre le froid et une cachette contre les sergents de ville.
Juve approuva encore :
– Excellente idée, chef. Je suis confus de ne pas avoir pensé à cela.
– On ne pense pas à tout, dit M. Havard, et, quand on s’occupe d’une fugue, alors qu’il s’agit d’un assassinat… Mon cher Juve, j’ai interrogé ce matin les individus arrêtés hier, et l’un d’eux, un ouvrier terrassier, actuellement sans travail, mais semblant fort honnête, n’ayant en somme d’autre vice que d’être dans la misère, m’a confirmé la déposition de l’agent 66. Il n’y a plus de doute à avoir, il est établi que Brigitte et Théodore Gauvin sont innocents.
M. Havard dit cela d’un ton de triomphe. C’était d’un ton de triomphe que Juve poursuivait la phrase commencée :
– Et cela établi, disait le policier, on tente de démontrer que, peut-être bien, M. Havard, il n’y a pas crime. Le principal argument en faveur du crime, c’était en effet que vous teniez les assassins. Or, les assassins sont innocents. M. Havard, je vous dis qu’il y a fugue !
Obstinément, Juve en revenait à ses théories. M. Havard lui répondit convaincu :
– Je n’ai pas d’assassins en ce moment, reconnaissait en effet le chef de la Sûreté, mais je suis ici pour en chercher. Voyez-vous, Juve, il y a vraiment trop de sang dans cette pièce pour que je croie à une fugue.
Juve, à ces mots, se contenta d’esquisser un geste de doute :
– Mise en scène, dit-il. Rien que mise en scène !
À quoi, M. Havard avec le même geste de doute, répondit :
– C’est une explication qui n’explique rien.
Les deux hommes, dès lors, se levèrent. Juve comprenait bien que M. Havard était sincère, et M. Havard avait, au fond de lui-même, une trop grande confiance en Juve pour le soupçonner de parti pris.
– Voulez-vous que nous cherchions ensemble la vérité ? proposa-t-il.
– Accepté.
– Eh bien, perquisitionnons !
Une besogne longue, compliquée, désagréable, commença.
Juve et M. Havard, pièce par pièce, fouillèrent chaque meuble, examinèrent les papiers, vérifièrent le moindre détail du désordre.
Et, tout d’abord, ils ne trouvèrent rien. C’est seulement après trois heures de recherches, que Juve poussait un cri de surprise :
– Monsieur Havard, appela-t-il.
– Quoi donc ?
– Venez vite !
M. Havard était à ce moment-là dans la salle à manger. Il accourut pour trouver Juve accroupi sur le tapis de la chambre à coucher.
– Vous avez trouvé quelque chose ? demanda-t-il.
– Regardez ! répondit Juve.
Le policier désignait du doigt tendu une cheminée, dont la trappe était baissée, et que M. Havard considéra quelques instants en silence.
– Eh bien ? interrogea le chef de la Sûreté, qui semblait ne pas comprendre. Qu’est-ce qu’il y a de ce côté-là ?
– Il y a du sable, répondit Juve.
Cette fois, M. Havard bondit en avant :
– Du sable ? répétait-il. Dieu me pardonne, mais vous avez raison.
Juve, en effet, ne se trompait pas. Sur le marbre de la cheminée, il y avait des traces de sable, qui, chose curieuse, semblait avoir glissé par-dessous les tôles de la trappe.
– Qu’est-ce que cela veut dire ? commença M. Havard. Quelles conclusions en tirez-vous ?
Juve se releva et s’approcha de la cheminée.
– Jusqu’à présent, disait-il, je ne conclus pas, je constate. Il y a du sable, voilà tout. Je ne l’avais pas vu le premier jour, et cela m’étonne.
Juve, en parlant, relevait du bout de sa bottine, la trappe de la cheminée.
Une exclamation alors, exclamation de surprise, d’angoisse aussi, s’échappa de ses lèvres :
– Bon Dieu, dit le policier, c’est invraisemblable !
La trappe levée, Juve et M. Havard venaient de découvrir que la cheminée était remplie de sable, de gros sable, et que ce sable était rouge, rouge de sang.
– Je ne comprends pas, murmura le chef de la Sûreté.
Juve, lui, ne disait rien. Il s’était armé de pincettes et fouillait parmi l’amas de terre.
– Oh, oh, fit-il d’un coup, devenant très pâle.
M. Havard lui aussi, paraissait très ému.
– Qu’est-ce que c’est que cela ? demanda-t-il.
Au bout de sa pincette, Juve agitait maintenant un chiffon, une loque, une loque rouge.
– Un mouchoir, déclara-t-il, c’est un mouchoir.
M. Havard ajoutait en insistant :
– Et un mouchoir plein de sang.
Mais déjà, Juve avait étalé la loque sur le sol, il l’examinait en tous sens.
– C’est bizarre, constatait le policier. Il y a des initiales. Je ne comprends pas comment des assassins sont assez sots pour laisser derrière eux des pièces si compromettantes.
Le ton ironique dont se servait Juve échappait cependant à M. Havard.
Le chef de la Sûreté, en effet, interrogeait à nouveau :
– Vous voyez des initiales ? Lesquelles ?
– Celles-ci, riposta Juve : A. R.
Puis il questionnait :
– Qu’avez-vous donc Monsieur Havard ?
La question de Juve était justifiée, car M. Havard brusquement, venait de se frapper le front, à la façon d’un homme qui découvre soudain une vérité jusqu’alors insoupçonnée.
– Ce que j’ai ? criait-il, mais j’ai que la chose est claire. A. R. Parbleu, cela veut dire : Alice Ricard ! Eh, voilà l’explication de tout ! Juve, entendez-vous : A. R. Alice Ricard. Ce mouchoir a servi à un des assassins. C’est également dans ce sable que les assassins ont dû enfouir le cadavre du mort et par conséquent…
– Ah ça, disait le policier, qu’imaginez-vous donc encore ?
– Juve, déclarait-il, je n’imagine rien, je comprends tout simplement.
Et il expliqua :
– Baraban a été tué par Alice Ricard, aidée de son mari probablement. Le crime fait, ils ont mis le cadavre dans la malle, la malle verte que nous avons trouvée. Le cadavre ballottait, naturellement. Pour l’empêcher de se vider, pour boire le sang, les assassins ont comblé la malle avec du sable, le sable que nous retrouvons. Je suppose que ce mouchoir sanglant est resté là par mégarde.
M. Havard s’interrompit pour demander :
– Voyons, Juve, vous me suivez bien, je pense ? Vous êtes de mon avis maintenant ?
Mais le policier secouait la tête :
– Assurément non.
Et, se montrant aussi net et aussi précis que M. Havard l’était peu, Juve commençait :
– Alice Ricard, cela est établi, est sortie de la maison à dix heures et demie en compagnie de son oncle, M. Baraban. Un autre fait est établi encore par la concierge, le vieux monsieur est rentré chez lui à minuit. Il était donc parfaitement en vie à minuit.
– Naturellement !
– Or, à onze heures quarante-cinq, c’est-à-dire un quart d’heure avant qu’il rentre, Alice et Fernand Ricard prenaient le train pour Vernon, fait qui est encore établi, et par le témoignage d’un cocher et par une réclamation déposée à la gare. Par conséquent…
M. Havard, déjà, s’épongeait le front.
– Hélas, dit-il, vous avez raison, Juve, l’alibi est formel. Baraban vivait à minuit, alors que Fernand et Alice Ricard étaient partis de Paris, et pourtant ?
M. Havard, une fois encore, s’interrompit. Il regardait Juve et s’étonna de l’attitude du policier. Celui-ci, brusquement s’était levé, il marchait, pris d’un énervement extrême, de long en large dans la chambre.
– Juve, appelait M. Havard, vous pensez à quelque chose ?
– Oui, répliqua le policier, c’est que je suis un crétin.
Juve s’arrêta de marcher, parut hésiter encore, grommela :
– Pourtant, pourtant, il n’y a pas eu crime, nom de Dieu !
Et, avant que M. Havard eût pu l’interroger, Juve ordonnait :
– Restez ici, dites-moi ce que vous allez entendre.
Juve alors, sortit de la pièce, il gagna le corridor. M. Havard prêta l’oreille :
– Il faut que je vous dise ce que je vais entendre ? demanda-t-il.
– Oui, écoutez.
Au même instant, lentement, mais distinctement, les douze coups d’une horloge retentirent.
– Eh bien ? demanda Juve.
– Eh bien, il y a une pendule qui vient de sonner minuit ou midi.
Juve, à cet instant, le visage congestionné, réapparaissait dans la pièce :
– Venez avec moi, Monsieur Havard.
– Où ça ?
– Chez la concierge.
– Chez la concierge, pour quoi faire ?
– Vous allez voir.
Les deux hommes redescendirent l’escalier, le policier entrait dans la loge :
– Madame, demanda-t-il à la portière, voulez-vous nous rendre un service ?
La concierge eut pour Juve son plus aimable sourire :
– Mais certainement, Monsieur, à vous, je ne refuserai rien.
– Eh bien, laissez-moi prendre votre pendule.
Juve, négligeant d’observer l’ahurissement où ses paroles mettaient la portière, prit sur la cheminée la pendule qui avait sonné minuit au moment même où Baraban était rentré.
– Restez dans votre loge, madame, cria-t-il.
Juve, portant la pendule, courut dans le vestibule.
– Écoutez, commanda-t-il à la concierge.
M. Havard, à cet instant, s’approcha du policier :
– Vous allez faire sonner les douze coups, dit-il pour vous assurer que la concierge sait compter jusqu’à douze ?
Mais Juve haussa les épaules.
– Je me fiche pas mal de sa pendule, répondit-il, ce n’est pas elle qu’elle a entendu sonner.
Et Juve, posant la pendule à terre, un peu brusquement même, tira de sa poche un timbre sur lequel, du dos de son canif, il frappa douze coups.
– Madame la concierge, appela-t-il, qu’entendez-vous ?
– J’entends sonner ma pendule, affirma la portière.
Juve s’épongea le front, en regardant M. Havard :
– Vous comprenez ?
– Non, pas du tout.
– C’est pourtant simple.
Juve rapportait la pendule dans la loge, remerciai l’obligeante portière d’un sourire mystérieux, revint prendre Havard par le bras :
– Écoutez, faisait-il, je ne crois toujours pas à l’assassinat de Baraban, pourtant voici quelque chose de troublant. M. Havard, vous avez pu voir que je n’ai pas fait sonner la pendule de la concierge, j’ai tout simplement heurté douze fois le timbre que voici avec mon canif, et la brave femme s’y est trompée. Par conséquent…
Mais cette fois, enfin, M. Havard avait compris :
– Ah sapristi, s’exclama-t-il. Juve, vous êtes génie. Parbleu, je devine ce que vous imaginez. Baraban, dites-vous, n’est pas rentré à minuit, il est rentré vers les onze heures moins vingt, n’est-ce pas ? Ce sont les assassins, qui, pour tromper la concierge, au moment où Baraban rentrait, ont frappé douze coup sur ce timbre. La concierge a cru qu’il était minuit, alors qu’il n’était pas si tard que cela. Baraban n’a pas remarqué la chose, a cru que c’était onze heures qui sonnaient. Peut-être la portière, à moitié endormie, ne s’est pas aperçue qu’il s’agissait d’un autre timbre que celui de sa pendule.
M. Havard appuyé contre le mur du vestibule, n’arrêtait plus :
– Dans ce cas, tout s’explique merveilleusement. Ah mon vieux Juve, quel service vous me rendez là ! Parbleu, voici comment les choses ont dû se passer : Baraban est sorti avec sa nièce à dix heures et demie. Il l’a quittée un quart d’heure plus tard peut-être. Il est rentré chez lui. C’est à ce moment que l’assassin, caché dans son appartement, a trouvé moyen de faire sonner minuit en heurtant douze fois un timbre. C’est à ce moment également que le pauvre Baraban a été tué, et, comme l’heure de minuit ne nous gêne plus, comme nous venons, d’autre part, de retrouver un mouchoir sanglant portant les initiales A. R., tout permet de supposer que ce sont bien les époux Ricard qui ont commis le meurtre. Ils ont eu parfaitement le temps d’aller prendre ensuite le train de onze heures quarante-cinq et même de faire remarquer l’alibi qu’ils s’étaient préparé en déposant une réclamation.
M. Havard, à ce moment, s’interrompit net en voyant Juve éclater de rire :
– Vous êtes bien de mon avis, Juve ?
– Non, répondit Juve.
Et, comme M. Havard le regardait interloqué, Juve s’expliqua :
– Je ne peux pas croire que les Ricard soient des assassins, puisque je ne crois pas au crime.
M. Havard alors, négligea de discuter plus avant avec Juve :
– Dites-moi, demandait-il simplement, comment avez-vous pensé à la ruse du timbre ? Et comment se fait-il surtout que vous aviez précisément aujourd’hui un timbre dans votre poche ?
Or, Juve à ces mots, éclata de rire encore une fois.
– Monsieur Havard, ripostait-il, c’est tout simplement un fait du hasard. Ce timbre n’est pas un timbre quelconque, c’est le timbre même des assassins, d’après ce que vous dites, de M. Baraban partant en fugue, d’après ce que je crois. Figurez-vous qu’hier, comme je venais voir Fandor, la concierge m’a montré cet objet. Je suis très bien avec elle. Cette brave femme me demandait si ça ne venait pas d’une de ses sonneries et si, par hasard, je ne saurais pas arranger cela, vu que sa porte d’entrée ne sonnait plus. J’ai mis l’objet à ce moment-là dans ma poche, sans y prêter grande attention. C’est tout à l’heure que son importance m’a sauté aux yeux. C’est tout à l’heure que je me suis dit : « La concierge a ramassé cela dans le vestibule, est-ce que par hasard, ça n’aurait pas servi à la fugue ? »
Une demi-heure plus tard, Juve venait de prendre congé de M. Havard et il remontait à l’appartement tragique. Juve était soucieux.
– M. Havard se trompe, murmurait-il. Le voilà maintenant décidé à ordonner la mise en liberté de Théodore Gauvin et de Brigitte, mais le voilà aussi décidé à arrêter Fernand et Alice Ricard. Ah, sapristi, que c’est donc assommant qu’il veuille marcher si vite !
Juve, en effet, ne pouvait pas admettre, ne voulait pas admettre au moins, qu’il y ait eu assassinat. Plus il réfléchissait à la mystérieuse affaire qu’il étudiait depuis quelque temps, et plus il lui apparaissait qu’elle devait s’expliquer par la fugue et non par le crime.
« Ce mouchoir, pensait Juve, de nouveau à genoux devant la cheminée où avait été retrouvé cet indice compromettant, ce mouchoir, c’est bien extraordinaire qu’il soit resté dans ce sable. Et puis ce sable, comment serait-il taché de sang, puisqu’en fait, il n’aurait pas servi ? Comment se fait-il, surtout, que, lors de ma première enquête, je ne l’ai point vu et que Fandor non plus ne l’ait pas vu ? »
Or, comme il disait ces mots, Juve sursauta, se redressa brusquement :
– Oh, oh, dit-il, parlant à haute voix. Mais est-ce que ? Tiens, parbleu, cela expliquerait tout… Ça, par exemple.
Juve sortit de l’appartement avec une extrême précipitation.
Il grimpa l’escalier dans une hâte folle, monta jusqu’au sixième étage. Là, il avisa une échelle sous une lucarne, se hissa jusqu’à l’étroit vasistas, l’ouvrit, et se trouva sur le toit.
Juve, alors, courut, risquant une chute, de cheminée en cheminée. Brusquement, il se frotta les mains.
– Cela, par exemple ! disait-il, c’est plus que je ne pouvais espérer. M. Havard est décidément un imbécile.
Qu’était donc venu faire Juve sur le toit ? Que venait-il de trouver ?
Tout simplement il y avait au pied de la cheminée qu’il regardait, de vagues traces de sable. Et Juve raisonnait ainsi :
« Fandor, la nuit dernière, a entendu – il me l’a dit à déjeuner – des bruits mystérieux, dans l’épaisseur de sa muraille. Il a cru que quelque chose s’écroulait, puis il a supposé que de l’eau coulait dans une tuyauterie. Oh, oh, est-ce que par hasard ça n’aurait pas été autre chose ? »
Et Juve imaginait encore :
« Parbleu, je n’ai pas vu de sable dans l’appartement, lors de la première enquête, parce qu’il n’y avait pas de sable à ce moment-là. J’en ai vu aujourd’hui parce qu’on l’y a mis hier, ou plutôt la nuit dernière. Comment l’a-t-on mis ? Mais par la cheminée. C’est ce sable que Fandor a entendu dégringoler. »
Et, après un instant de réflexion, Juve concluait : « Décidément, ce Baraban est très fort, il veut se faire passer pour mort coûte que coûte. La piste de Théodore Gauvin et de Brigitte allait craquer. Il en a inventé une autre, il cherche maintenant à compromettre son neveu et sa nièce. Je parierais bien que c’est lui qui a jeté ce sable, ce sang et ce mouchoir dans la cheminée.
En redescendant du toit, Juve faisait la grimace :
« Comment, par exemple, se demandait-il, persuaderai-je M. Havard de la chose ? Comment l’empêcher d’arrêter les Ricard ? Faut tout de même essayer de pas lui laisser faire trop de gaffes. »
Philosophe, Juve décida, après avoir encore réfléchi quelque temps :
« Après tout, tant pis, qu’on les arrête. Il faudra bien qu’on les relâche. »
15 – L’HOMME AU MONOCLE NOIR
Le lendemain, pour la vingtième fois peut-être depuis une demi-heure, on frappait à la porte du cabinet directorial où trônait M. de Parcelac.
Le haut fonctionnaire, aux mains duquel était confiée la haute direction du Comptoir national, l’établissement de crédit le plus important de Paris, ne put retenir un geste d’énervement et, d’une voix courroucée, lança :
– Entrez, bon Dieu, entrez ! Mais qu’est-ce qu’on a donc ce matin à me déranger de la sorte ?
Le garçon de bureau pénétra dans le cabinet directorial, le dos courbé, n’osant regarder son patron qui fulminait derrière un bureau ministre.
– Monsieur le directeur, dit-il, en lui tendant un plateau d’argent sur lequel se trouvait une carte de visite, c’est un monsieur qui demande à vous voir.
– M. Dominet ? demanda Parcelac, Dominet. Qu’est-ce que c’est que cela ?
Le directeur de la banque retourna la carte en tous sens, son propriétaire n’avait fait suivre son nom d’aucune qualité imprimée, ni même de la moindre indication manuscrite.
– Que veut ce monsieur ? Et pourquoi me l’avez-vous amené ici ? Il aurait pu indiquer le motif de sa visite, je n’ai pas l’habitude de recevoir n’importe qui !
– Monsieur le directeur, j’ai d’abord essayé d’éconduire ce visiteur, mais il a tellement insisté en disant que c’était personnel, et que vous le recevriez, que j’ai cru bien faire.
M. de Parcelac réfléchit un instant :
– Vous allez l’envoyer à… à…
Puis il se rétracta :
– Après tout, non, qu’il entre ! Je saurai bien m’en débarrasser rapidement.
Et, cependant que l’huissier s’éclipsait, le directeur du Comptoir national se carra dans son fauteuil, attendit. Il s’écoula trente secondes à peine, et devant le haut fonctionnaire se présenta un homme à la silhouette élégante, au visage distingué. Il avait cette particularité, assez peu ordinaire, de porter, vissé dans son arcade sourcilière, un monocle en verre fumé, ce qui lui donnait une assez étrange expression.
Très froid, mais dissimulant sa nervosité d’homme pressé, M. de Parcelac, sans lui désigner un siège, l’interrogea :
– Qu’y a-t-il pour votre service, monsieur ?
Le visiteur qu’on n’avait point invité à s’asseoir, prit une chaise et s’y installa :
– Monsieur, j’ai eu l’honneur de vous faire passer ma carte, je m’appelle M. Dominet, ce nom ne vous dit rien, sans doute ?
– En effet, monsieur.
– Au Palais, dans le monde de la Basoche [13], mon nom est plus populaire. Je suis, en effet, le secrétaire de la Chambre des notaires de Paris, et c’est en cette qualité que je viens vous rendre visite.
– Que puis-je pour vous ?
– Voici, fit M. Dominet, vous savez certainement que la Chambre des notaires s’intéresse à nombre de bonnes œuvres, et que notamment elle a pris sous son patronage la loterie destinée à venir remplir la caisse de la Société de secours des orphelins d’officiers ministériels. Je suis moi-même tout particulièrement chargé des intérêts de cette œuvre admirable, qui, d’ailleurs, comme toutes ses consœurs, a perpétuellement besoin de recourir à la charité publique.
« Bon, pensa M. de Parcelac, je me suis fait roulé, c’est un tapeur. »
Et, résigné, pour en finir, il mit la main au gousset. Son interlocuteur vit le geste et lui fit signe d’arrêter :
– Non, monsieur, déclara-t-il avec un sourire, je ne viens pas solliciter votre générosité aujourd’hui, mais simplement vous rappeler que le tirage de notre loterie a lieu ce soir même et, comme c’est le Comptoir national qui veut bien se charger de nous fournir les instruments de tirage, je venais vous rendre visite par déférence d’abord, et ensuite, pour m’assurer que toutes les dispositions étaient bien prises.
« Au diable l’importun », pensa M. de Parcelac qui, cependant, ne montrait rien de son ennui :
– Je suis, en effet, parfaitement au courant, monsieur, mais je ne m’occupe pas personnellement de ces détails.
Le directeur du Comptoir national appuyait sur un timbre, un huissier se présenta :
– Veuillez conduire monsieur au directeur du personnel des services extérieurs.
M. de Parcelac se leva, obligeant de la sorte son interlocuteur à faire de même :
– Monsieur Dominet, lui déclara-t-il, je vous suis bien reconnaissant de l’aimable visite que vous êtes venu me faire. Veuillez transmettre à M. le président de la Chambre des notaires l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Les deux hommes se congratulèrent quelques secondes, chaleureusement, puis, M. de Parcelac ajouta :
– La personne à qui je vous adresse va vous fournir toutes les explications qu’il vous conviendra de recueillir.








