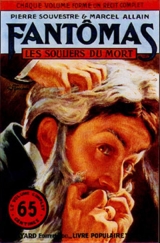
Текст книги "Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Le directeur poussa l’importun vers la porte :
– Au revoir, monsieur Dominet.
– Au revoir, monsieur le directeur.
Cependant que M. de Parcelac revenait avec précipitation à son bureau ministre et que, tout en appuyant sur des timbres divers, il décrochait son récepteur téléphonique pour demander une communication, M. Dominet, toujours obséquieux et poli, s’effaçant chaque fois qu’il rencontrait quelqu’un dans les couloirs de la banque, suivait l’huissier qui le conduisait au bureau des Services extérieurs. Il se trouva là en présence d’un brave homme d’employé, que l’attitude distinguée de M. Dominet, et particulièrement son monocle noir, impressionnèrent au plus haut point.
– C’est bien de l’honneur pour moi, monsieur le secrétaire de la Chambre des notaires, déclarait-il, en faisant force courbettes devant M. Dominet, de recevoir votre visite. Je vais vous montrer, puisque cela vous intéresse, comment nous procédons pour le tirage de ces loteries.
M. Dominet daigna sourire :
– Je suis, en effet, fort intrigué, déclara-t-il, fort anxieux de savoir comment cela se passe.
Les deux hommes passèrent dans une salle voisine du bureau, où se trouvaient des sacs de diverses dimensions, une grande table et des cylindres montés sur un bâti en métal.
– Qu’est-ce que c’est que cela ? demanda M. Dominet.
Son interlocuteur eut l’air étonné :
– Voyons, fit-il ; mais mon cher monsieur Dominet, ce sont les roues pour tirer les loteries. Vous ne les reconnaissez donc pas ? Voilà pourtant trois semaines que nous en avons fait livrer une à votre administration. Vous savez bien. La loterie devait se tirer le mois dernier, et puis, comme toujours, on a dû reculer la date de l’opération, tous les billets n’étant pas placés. Enfin, c’est toujours pour aujourd’hui, n’est-ce pas ?
Si l’employé de la Banque avait été perspicace, il se serait peut-être aperçu que M. Dominet, imperceptiblement, avait tressailli. L’élégant personnage au monocle noir reprenait d’ailleurs aussitôt toute son assurance, et il s’excusa de sa question superflue :
– Je vous demande pardon, fit-il en souriant, je ne connais que ça, en effet, et cette roue que vous nous avez livrée il y a trois semaines, je puis vous le dire en passant, encombre même singulièrement mes locaux. Mais voilà, en entrant dans cette pièce, j’avais mal vu ses sœurs jumelles.
Il ajoutait :
– J’ai malheureusement de si mauvais yeux.
– Oui, dit l’employé, je comprends.
Et il jetait un regard apitoyé sur le monocle noir de M. Dominet.
Celui-ci, cependant, interrogeait :
– Les numéros, pour les tirages au sort, comment les livrez-vous ?
– Oh, fit le directeur des services extérieurs, cela se passe très solennellement. Vous comprenez, dans les loteries de ce genre, il faut que tout se passe de la façon la plus correcte. Voici ce que nous allons faire : votre loterie a lieu, je crois, vers dix heures ? Eh bien, nous vous enverrons à six heures du soir, deux de nos garçons de bureau, porteurs chacun d’un sac contenant les numéros nécessaires pour remplir les roues. Il y a cent cinquante numéros dans chaque sac, numérotés de un à dix, et ainsi de suite. De telle sorte que l’on peut former n’importe quel chiffre. Vous comprenez toute l’importance de ce transport de numéros ? Il faut tant se méfier, par le temps qui court, non seulement des malfaiteurs, mais encore des méchantes gens qui soupçonnent toujours les personnes, même les plus honorables, ou les administrations les plus sérieuses comme la nôtre, de faire des choses indélicates.
M. Dominet approuva :
– Vous avez parfaitement raison, et je dois vous dire que le but de ma visite était de me renseigner exactement sur votre façon de procéder. Afin d’être au courant moi-même, car il va sans dire que j’assisterai ce soir au tirage au sort de notre loterie.
– Vous avez des lots importants ? demanda l’employé de la banque.
– Mon Dieu, fit M. Dominet, d’un air détaché, encore assez. Le gros lot est de deux cent mille francs, et il y en a trois autres de cinquante, vingt et dix mille francs.
– Allons, fit l’employé de banque, en se frottant les mains, espérons que tout se passera bien.
Il appela deux hommes qui travaillaient dans la salle :
– Théophile ! Martial !
Les deux employés se retournèrent, vinrent aux ordres :
– C’est vous, n’est-ce pas, qui êtes désignés pour aller livrer ce soir, à la Chambre des notaires, les sacs de numéros ?
– Oui, monsieur le directeur, répondirent-ils ensemble.
Le personnage se tourna vers M. Dominet :
– Vous voyez que tout est prévu. Ce soir, à sept heures exactement, ces deux employés seront à votre administration.
Et le directeur demanda encore :
– Les scellés sont-ils déjà mis sur les sacs ?
– Ils y sont, monsieur le directeur, répondit Martial.
– Oh, oh, observa M. Dominet, je vois décidément que vous poussez les précautions à l’extrême. Tous mes compliments !
Il tourna sur ses talons, précéda son hôte vers la sortie de la salle.
En longeant une étagère, il aperçut un cachet rouge, sur une feuille de papier blanc.
– Qu’est-ce que c’est ? interrogea-t-il curieusement.
– Eh bien, cher monsieur, fit aimablement le directeur des services extérieurs, c’est précisément le cachet des scellés dont je vous parlais tout à l’heure.
Il prit la feuille de papier.
– Vous voyez, ajouta-t-il, la cire porte les initiales entrelacées de notre raison sociale. C. N. Comptoir national.
M. Dominet gardait le cachet dans la main :
– Le chiffre est joli, fit-il.
Et il confia à l’oreille de son interlocuteur :
– Je vous avoue que j’ai un tempérament de collectionneur et je m’occupe tout particulièrement du gothique. Or, les lettres de votre chiffre sont de l’époque que j’aime, elles ont été gravées par un artiste, assurément, qui s’y connaissait.
– C’est possible ! fit le directeur des services extérieurs, qui ajouta avec emphase :
– Chez nous, monsieur, on fait toujours bien les choses.
M. Dominet insinua :
– Je vais être indiscret, mais les amateurs de mon espèce ont toutes les audaces. Je voudrais ce cachet pour ma collection. Puis-je l’emporter ?
– Ce n’est que cela ? fit l’employé de banque. Mais comment donc, cher monsieur, comment donc !
Le plus cordialement du monde, les deux hommes s’entretinrent quelques instants encore, puis M. Dominet prit congé de son hôte.
– Je suis un importun, dit-il, et je m’excuse. Mais vous avez été si aimable que je suis enchanté d’avoir fait votre connaissance.
– Non, non, protestait le directeur des services extérieurs, je vous assure, monsieur Dominet, que tout le plaisir est pour moi.
Vingt minutes après, l’homme au monocle noir quittait le luxueux établissement de crédit. Avec les plus minutieuses précautions, il avait mis le cachet rouge dans sa poche, entre deux morceaux de carton qui, chose curieuse, semblaient n’attendre rien d’autre.
Et lorsqu’il se retrouva sur le boulevard, l’élégant personnage laissa errer sur ses lèvres un très énigmatique sourire.
***
Tandis que M. Dominet, secrétaire de la Chambre des notaires, sortait de la banque, dans un quartier tout opposé, rue Claude-Bernard, une scène touchante se déroulait.
Jacques Faramont, le jeune avocat stagiaire qui, depuis une demi-heure, allait et venait dans son petit appartement, en proie à une indicible émotion, entendit soudain retentir un violent coup de sonnette. Il était seul chez lui, il courut ouvrir. À peine avait-il entrebâillé la porte, qu’une femme se précipitait à l’intérieur de l’appartement et, toute haletante, poussant des gémissements inarticulés, des cris de joie, elle se jetait à son cou, l’étreignait sur son cœur.
– Jacques, Jacques ! Me voilà, je suis libre !
Le jeune stagiaire rendait froidement à la personne qui venait d’arriver, les tendres caresses que celle-ci lui prodiguait.
– J’en suis fort heureux, Brigitte, déclara-t-il. Viens dans mon cabinet, nous avons à causer.
C’était la jolie maîtresse, en effet, de l’avocat, qui venait de rejoindre son amant. Il y avait trente-cinq minutes à peine qu’elle était sortie de l’affreuse prison de Saint-Lazare, où elle avait passé des heures cruelles, sous la plus terrible des inculpations.
Depuis la veille au soir, elle bouillait d’impatience. Elle n’avait pas fermé l’oeil de la nuit, sachant que son innocence était reconnue, et qu’on allait enfin la libérer :
– Figure-toi, disait enfin la jeune femme, qui, tout à sa joie d’être libre, ne remarquait pas l’attitude étrange de son amant, figure-toi qu’au moment où j’allais sortir de Saint-Lazare, il m’a fallu encore passer au Palais de Justice, pour y signer je ne sais quels papiers. Enfin, j’étais sur le chemin de notre nid d’amour, et cela ne m’a pas trop retardée. J’ai d’ailleurs retrouvé dans ces sales bureaux du tribunal, ce pauvre jeune homme qui a été arrêté avec moi, et dont on m’accusait d’être la complice.
Jacques Faramont tressaillit. Il interrogea durement :
– Tu veux parler de Théodore Gauvin ? Qu’est-ce qu’il t’a dit encore celui-là ?
– À moi ? fit Brigitte. Mais rien de particulier, si ce n’est qu’il était bien content d’être libre. Son père était là aussi. Un brave homme qui semblait fort heureux. Ils sont, paraît-il, de passage à Paris, en ce moment, rapport aux affaires du père.
– Ah, fit évasivement Jacques Faramont, qui interrogea encore :
– Sais-tu quelle est leur adresse ?
Brigitte éclata de rire :
– Eh bien, mon cher, tu as de la veine. Jamais je n’aurais songé à la leur demander, mais il s’est trouvé que par hasard, j’ai entendu le père qui disait à son fils : « Nous sommes au Continental, ta chambre, Théodore, est à côté de la mienne. »
Brigitte cependant, s’apercevait enfin de l’attitude préoccupée de son amant. Elle esquissa une moue :
– Qu’est-ce que tu as ? fit-elle. Tu n’as pas l’air content de me revoir ?
Et elle s’approcha de lui pour l’embrasser. Jacques Faramont sèchement l’écarta. Il quitta le divan sur lequel sa maîtresse l’avait fait asseoir à côté d’elle, et passa dans la chambre voisine. Il en revint avec sa canne et son chapeau.
– Quoi, demanda-t-elle, tu sors ? Tu me laisses toute seule aujourd’hui ? Eh bien, vrai, ça n’est pas gentil. D’ailleurs, tu m’as l’air tout chose, qu’est-ce qui se passe ? Tu m’en veux ?
De plus en plus mystérieux, Jacques Faramont hocha la tête :
– Il faut, déclara-t-il simplement, que j’aille voir ce monsieur Théodore Gauvin.
– Pourquoi ? fit Brigitte.
– Parce que !
En dépit des questions inquiètes que lui posait sa maîtresse, qui l’accompagnait jusqu’au seuil de la porte, Jacques Faramont ne fournit aucune autre explication. Il descendit rapidement l’escalier, laissant Brigitte toute seule.
La jeune femme était interdite et troublée, des sanglots soulevaient sa poitrine, ses yeux se mouillaient de larmes.
– Qu’est-ce qu’il a ? pensa-t-elle.
Dans la rue, cependant, Jacques Faramont hélait un fiacre, se faisait conduire au Continental.
Un quart d’heure après, il était en présence de Théodore Gauvin. Le fils du notaire vint à lui, la main tendue.
– Cher monsieur, lui déclara-t-il, qu’est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite ?
Mais Théodore s’arrêta net dans son accueil cordial. Jacques Faramont ne prit pas la main qui lui était tendue, son attitude était plus énigmatique, plus impassible que celle qu’il avait eue quelques instants auparavant avec sa maîtresse.
Le jeune avocat stagiaire était, en effet, cruellement troublé.
Depuis quelques jours, il avait passé par les émotions les plus terribles. Par moments, il s’était demandé si sa maîtresse n’était pas coupable, et certes, il avait été bien heureux lorsqu’il avait acquis la certitude de son innocence. Et dès lors, dans son âme inquiète et jalouse, était né un autre sentiment, une autre inquiétude.
Et nettement, il l’exprima à Théodore Gauvin :
– Monsieur, lui déclara-t-il sèchement, maintenant que vous en avez fini avec la justice, et M lle Brigitte aussi, il est de mon devoir de vous poser une question, à laquelle je vous prie de répondre avec netteté.
– Je vous écoute, monsieur, fit Théodore Gauvin, légèrement abasourdi par ce préambule.
Jacques Faramont le fixait dans les yeux :
– Vous êtes l’amant de Brigitte ! lui dit-il à brûle-pourpoint.
– Moi ? fit Théodore, en reculant d’un pas.
– Oui, vous, poursuivit Jacques Faramont.
Le fils du notaire était si abasourdi, qu’il ne trouvait d’abord rien à répondre, et Jacques Faramont, devant ce silence, sentait sa colère augmenter, s’imaginant que ce mutisme était un aveu.
Il déclara d’une voix sourde :
– Vous n’êtes pas un assassin, je le sais, mais vous êtes un misérable !
Ce fut au tour de Théodore Gauvin de devenir blême :
– Monsieur, fit-il, je vous défends de me traiter de la sorte et je vous enverrai mes témoins !
– À votre aise, fit Jacques Faramont.
Mais, à la grande surprise de l’avocat, le fils du notaire ricana nerveusement :
– Vous avez joliment tort, fit-il, de me croire l’amant de votre amie. Certes, nous nous battrons mais je tiens à vous dire que jamais, au grand jamais, je n’ai eu le moindre rapport avec votre maîtresse.
– Brigitte n’est plus ma maîtresse, affirma péremptoirement Jacques Faramont, je ne veux plus en entendre parler, à aucun prix.
– Cela vous regarde, fit Théodore Gauvin. Quant à moi, je puis vous dire une chose, monsieur, c’est que si tous ces malheurs me sont arrivés, c’est parce que je suis épris follement d’une autre femme, et d’une femme du monde, entendez-vous.
Il ajoutait d’un air méprisant :
– Vous me connaissez bien mal pour imaginer un seul instant que je serais capable de m’éprendre d’une bonne, d’une domestique.
– Monsieur, fit l’avocat en agitant sa canne, vous dites des bêtises. Car je vous assure que Brigitte n’est pas une bonne comme les autres. Non, monsieur, d’abord, elle est distinguée, élégante, jolie.
– Alice Ricard, interrompit Théodore, est cent fois mieux qu’elle.
– Et puis, continuait Jacques Faramont, sans entendre cette observation, elle est intelligente, instruite. Brigitte a son brevet supérieur et vous ne pourriez peut-être pas en dire autant de votre petite provinciale de Vernon.
– On ne raisonne pas quand on aime, monsieur, et Alice Ricard est très suffisamment instruite pour moi. Quant à être bourgeoise, je ne dis pas, évidemment. D’ailleurs, c’est une affaire d’appréciation et de sentiment. Je vous assure que j’ai été bien malheureux.
Jacques Faramont se calmait peu à peu.
– Je reconnais, fit-il, que vous avez eu des moments bien pénibles.
– Oui, fit Théodore en soupirant.
Il désignait un siège à son interlocuteur, s’assit lui-même, puis, machinalement, sans s’en rendre compte, l’un et l’autre se racontèrent leurs amours.
Tous deux étaient très jeunes et très naïfs aussi, mais ils avaient de l’enthousiasme plein le cœur.
Tout en parlant, les deux jeunes gens, qui sentaient leurs yeux se gonfler de larmes, se regardèrent, puis, spontanément, tous deux se levèrent. Jacques Faramont le premier tendit la main à Théodore.
– Vous êtes un chic type, fit-il.
– Et vous aussi.
Ils déclarèrent solennellement, en chœur :
– Les femmes, voyez-vous, c’est la plaie de ce monde.
Ils demeurèrent quelques instants silencieux, puis se considérèrent désormais sympathiquement, comme deux étrangers qui, tout d’un coup, viennent de découvrir qu’ils sont nés pour être les meilleurs amis du monde. Jacques Faramont demanda :
– Votre amie, cette M me Alice Ricard, ce doit être une femme rudement sympathique, intéressante, désirable ?
– Ma foi, fit Théodore, je ne dis pas le contraire. Mais à mon tour, permettez-moi de m’excuser de ce que j’ai dit de M lle Brigitte. J’étais emballé voyez-vous, et c’est pour vous vexer que j’ai dit qu’elle n’était pas jolie.
– Oh je ne vous en veux pas.
– Vous comptez toujours la quitter ?
– Pourquoi ? demanda Jacques Faramont.
– Eh bien, dit Théodore, qui hésitait cependant à préciser sa pensée, eh bien, parce que si vous n’en voulez plus, on pourrait peut-être…
– Et moi, vous ne m’en voudriez pas si je me faisais présenter à M me Alice Ricard et si je lui faisais la cour ?
Les deux jeunes gens éclatèrent de rire. Quelle allait être l’issue de cette étrange conversation ? Ils ne le surent jamais ni l’un ni l’autre. Un vénérable vieillard entrait dans la pièce. C’était M e Gauvin qui venait chercher son fils.
16 – LE GROS LOT
Il était dix heures du soir. Dans la salle d’honneur de la Chambre des notaires régnait une atmosphère lourde et surchauffée. Il y avait, dans ce local fait pour contenir soixante personnes au maximum, le double d’assistants.
Ceux-ci étaient serrés les uns contre les autres, un grand nombre étaient assis, beaucoup se tenaient debout. Et l’on écoutait avec attention, peut-être aussi, avec une certaine lassitude, un petit homme chauve, à la voix tremblotante, qui, installé sur une estrade derrière une table recouverte d’un tapis vert, lisait un volumineux mémoire où les chiffres revenaient à la suite des chiffres sans que nul n’y comprît grand-chose.
L’orateur, ou pour mieux dire, l’insipide lecteur à la voix monotone, était l’une des personnalités les plus honorées du monde de la Basoche : M e Masson, président de la Chambre des notaires, possesseur de l’une des plus importantes études de Paris.
M e Masson remplissait les fonctions de trésorier de la Société de secours des Orphelins d’officiers ministériels. Et il énumérait les recettes effectuées par l’œuvre, ainsi que les dépenses, n’omettant pas un détail, ne faisant pas grâce d’un sou. Il finit enfin par faire connaître la balance et dire combien la caisse possédait d’argent liquide.
On se rendit compte que c’était fini et l’on applaudit de confiance, d’autant plus que désormais, la partie la plus intéressante du programme annoncé aux auditeurs, allait avoir lieu. Cette lecture du rapport du trésorier, qui succédait à une allocution patriotique d’un représentant du Gouvernement, précédait en effet le tirage au sort de la loterie organisée au profit de la caisse de la Société de secours.
Et, depuis le début de la soirée, les assistants avaient les yeux fixés sur un gros cylindre métallique, qui se trouvait sur une table voisine de celle successivement occupée par les orateurs.
Quand M e Masson eut terminé, on fit un petit entracte pendant lequel on se répandit dans les couloirs et dans les salons voisins afin de se délier les jambes.
Il y avait là beaucoup de dames, vieilles et revêches pour la plupart. C’étaient cependant d’honorables personnes, s’occupant de l’éducation des petits orphelins, personnes qui, au nombre de leurs fonctions, savent qu’elles doivent constituer l’auditoire passif et résigné de ces sortes de réunions où il faut cependant que l’on dise quelque chose pour justifier leur raison d’être.
Il y avait aussi bon nombre de notaires de Paris et de province. Et, parmi ces derniers, il s’en trouvait un que ses collègues entouraient tout particulièrement. C’était M e Gauvin, qui était venu assister à la réunion à un double titre : d’abord, il faisait partie du comité de la société de secours, puis enfin, il avait pour le compte de plusieurs de ses clients, souscrit un certain nombre de billets de loterie.
M e Gauvin était l’objet des congratulations les plus sincères, car on savait le malheur dont il avait été victime.
– Enfin, lui disait-on, le cauchemar est terminé, puisque voilà votre cher enfant libéré par la justice et innocenté des accusations qui pesaient sur lui.
– Oui, déclarait M e Gauvin tout souriant, je suis bien heureux que ce soit fini, j’ai traversé des transes épouvantables.
Une vieille dame intervenait et, d’une voix sifflante, qu’elle voulait rendre aimable, articulait :
– Ces choses-là sont bien ennuyeuses, monsieur, car on a beau dire, quoi qu’il arrive et quoi qu’on fasse, il en reste toujours quelque chose.
M e Gauvin la considéra, légèrement interloqué :
– Il en reste quelque chose ? grommela-t-il. J’espère bien que non et que toute cette histoire-là est finie pour de bon.
Un de ses collègues de Rouen s’approchait et, quelque peu persifleur, il affirmait à son tour :
– Surtout, mon cher confrère, déclara-t-il à haute voix, pour être entendu par le plus de gens possible, que vous n’avez pas de chance, dit-on, avec votre fils. Les mauvaises langues prétendent que, pour se rendre à Paris, votre enfant s’est livré à certains actes indélicats.
M e Gauvin serra les poings, rougit :
– Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mon cher confrère, fit-il aigrement.
Mais le cher confrère protestait d’une voix doucereuse :
– Oh moi, vous savez, je n’affirme rien. C’est un bruit qui courait parmi les clercs de mon étude. Je m’en suis fait l’écho parce que c’était de notoriété publique, et puis que j’estime qu’entre confrères, notre rôle est toujours de nous prévenir.
– Je vous en remercie, fit sèchement M e Gauvin, qui ajouta en balbutiant :
– Il ne s’est d’ailleurs rien passé.
Le malheureux notaire de Vernon était tout dépité. Il se rendait parfaitement compte, à l’allusion narquoise et méchante de son collègue de Rouen, que l’incident fâcheux du vol commis par Théodore, s’était ébruité.
M e Gauvin, d’ailleurs, qui était un homme assez perspicace, se rendait parfaitement compte que les protestations de sympathie qui lui avaient été adressées au cours de cette soirée n’étaient peut-être pas aussi sincères qu’il aurait pu l’espérer.
Le bruit d’une sonnette qui tintait interrompit cependant les conversations généralisées dans les divers locaux de l’immeuble de la Chambre des notaires, où s’étaient répandus les invités.
Sur l’estrade, prirent place deux personnes seulement : M e Masson, président de la Chambre et trésorier de l’œuvre, puis une énorme et vieille dame à la face congestionnée, aux mains potelées et rougeaudes, qui, jusqu’alors, avait profondément dormi dans le fauteuil d’un petit salon voisin.
C’était la directrice d’une de ces œuvres d’hospitalisation où il est d’usage d’envoyer les orphelins des officiers ministériels.
On l’appelait : « marquise » et elle avait, en effet, un nom ronflant, appartenant à la meilleure société. Des revers de fortune l’avaient contrainte, assurait-on, à se dévouer à l’éducation de ces pauvres petits, dont elle assumait la charge et la responsabilité.
La grosse dame s’était réveillée pour la cérémonie du tirage de la loterie.
Lorsque tout le monde fut installé, elle murmura quelques mots à l’oreille du président, et M e Masson, de sa voix chevrotante, déclara :
– Mesdames et messieurs, nous allons procéder maintenant au tirage de la loterie, organisée au profit de la caisse de notre société de secours. Le gouvernement a bien voulu nous autoriser à tirer cette loterie, bien que ces sortes d’opérations soient interdites par la loi. Je rappelle qu’il y a quatre lots. Le premier, le plus important, un lot de deux cent mille francs, sera gagné par le premier numéro sortant de cette roue que vous voyez ici, à ma droite. Nous procéderons de même pour les autres lots, qui sont respectivement de cinquante mille, vingt mille et dix mille francs.
On applaudit un peu. M e Masson reprit ensuite :
– Il nous faut une main innocente pour tirer les quatre numéros qui doivent constituer le chiffre du billet gagnant. Et nous avons pensé que nous ne pouvions faire un meilleur choix que de désigner, pour remplir cette délicate besogne, le plus jeune de nos pupilles : Claude Villars, fils d’un avoué de Remiremont, orphelin de père et de mère, et confié à nos soins depuis dix-huit mois. Claude Villars vient d’avoir treize ans avant-hier.
On applaudissait à tout rompre, de bonnes vieilles dames en avaient les larmes aux yeux. M e Masson mit ses lunettes, se pencha par-dessus la table, esquissa un sourire qui ressemblait à une grimace, et, d’un ton aussi doux que possible, il murmura :
– Voulez-vous monter, mon petit ami ?
Le président n’obtint point de réponse.
En face de lui, au premier rang, un enfant, à ces mots, était devenu cramoisi. C’était le petit Claude Villars, mais il ne bronchait pas, tant il était intimidé. Sans succès, M e Masson répéta son invitation et il fallut l’intervention de l’énorme dame qui portait un titre et un nom ronflants, pour décider le gamin à venir sur l’estrade. Il y grimpa en trébuchant, se prit le pied dans le tapis vert, manqua d’attirer par terre la carafe et le verre d’eau. Ce premier danger écarté, il éprouva le besoin de se moucher, ce qu’il fit avec une sonorité qui déchaîna l’hilarité dans la salle.
Alors, le petit Claude Villars se mit à pleurer et bégaya d’une voix pointue :
– J’en ai assez, je veux m’en aller.
Mais des personnes charitables l’entouraient, et M e Masson lui-même trouvait des arguments convaincants pour décider l’enfant à s’approcher de la grande roue métallique et à y remplir sa mission.
Il y eut encore de nouveaux ennuis. L’enfant ne voulait pas introduire sa main dans le trou ménagé aux roues du cylindre. Il avait peur d’être mordu par une bête et il le répétait avec entêtement.
Il fallut qu’au mépris de tous les principes qui font force de loi dans semblable circonstance, l’énorme dame qui le chaperonnait, plongeât son avant-bras rougeaud dans la grande roue pour lui montrer qu’il n’y avait pas de danger.
Enfin, l’enfant se rassura. On le jucha sur une chaise, et, de plus en plus cramoisi, il introduisit la main dans l’intérieur de la roue.
– Surtout, lui recommandait M e Masson ne prends qu’un numéro à la fois.
Et il lui expliquait :
– Ce sont des petites boules toutes pareilles, que tu dois sentir sous tes doigts.
L’enfant avait compris, il sortit une boule et, dès lors, le silence se fit dans l’assistance, on aurait entendu voler une mouche.
L’enfant tenait la boule dans la main, il la tendit au président ; M e Masson avait ajusté ses lunettes sur son nez, il lut le numéro inscrit :
– 6.
Il y eut une rumeur et, cependant que les uns soupiraient avec satisfaction car les billets dont ils étaient titulaires commençaient par un six, les autres avaient un air navré, s’apercevant qu’ils étaient déjà écartés de toute chance puisque leur série était d’un autre chiffre.
– Encore une boule ? demanda M e Masson.
Et l’enfant s’étant exécuté, le président lut à nouveau :
– 6.
Il expliqua :
– Cela fait 66. Il nous faut quatre chiffres.
Une troisième fois, l’enfant sortit encore un 6.
– 666, proclama d’un ton impassible M e Masson.
Il se tourna du côté de Claude Villars et, par manière de plaisanterie, lui recommanda :
– Tâche de sortir autre chose pour varier.
L’enfant souriait sans comprendre. Il plongea la main dans la roue, amena la quatrième boule.
– Ah par exemple !… s’écria M e Masson, après avoir lu le numéro, c’est encore la même chose, c’est un 6.
Puis, solennellement :
– Le numéro 6 666 gagne le lot de deux cent mille francs.
Ce fut un brouhaha intense et, désormais on chuchotait dans la salle. On s’interrogeait :
– Le titulaire est-il parmi nous ? Connaît-on le porteur du 6 666 ?
Du fond de la salle, une voix s’éleva, tremblante :
– Le 6 666, fit un personnage qui se levait, c’est moi qui l’ai.
Tout le monde se retourna, le regarda. C’était M e Gauvin.
Le notaire était tout pâle, assurément stupéfait du résultat qui venait de se produire.
– M e Gauvin, murmurait-on de tout côté, le notaire de Vernon, le père de ce jeune homme qui… de ce jeune homme que…
Et des paires d’yeux curieux se braquaient sur lui.
M e Gauvin était fort gêné. Après avoir annoncé qu’il détenait ce numéro, il consulta une liste qu’il tenait à la main, cependant qu’il murmurait :
– Mais ce n’est pas moi qui ai gagné, c’est un de mes clients.
– Lequel ? demanda le président, veuillez nous donner son nom, maître Gauvin ?
Le notaire de Vernon s’était peu à peu rapproché de l’estrade, fendant péniblement la foule.
Soudain, il s’arrêta net, poussa un cri de surprise :
– Ah mon Dieu ! murmura-t-il.
On s’empressa autour de lui. Là voix du président se fit entendre :
– Mesdames messieurs, je vous en prie, ordonna M e Masson, laissez approcher notre collègue.
Puis, M e Gauvin ayant fait quelques pas vers lui, le président lui demanda :
– Quel est le gagnant ?
Alors, Gauvin, d’une voix toute blanche, déclara :
– Ce billet, le 6 666, je l’avais vendu à l’un de mes clients, à M. Baraban, qui a péri si tragiquement.
17 – LES VISITES NOCTURNES
Il devait être tout près de minuit et, dans leur paisible maison de Vernon, Alice et Fernand Ricard dormaient profondément, rêvant peut-être des félicités qu’allait immanquablement leur apporter l’héritage de leur oncle qui, ce même soir, quoique mort, gagnait à la loterie des notaires, une somme de deux cent mille francs, ce qu’ils ignoraient encore.
Le courtier en vins et sa femme ignoraient naturellement aussi la découverte du mouchoir sanglant qu’Havard et Juve avaient faite rue Richer et se croyaient donc bien tranquilles, assurés d’une impunité absolue, à l’abri de tout soupçon, et leur repos était en conséquence fort paisible.
Soudain, dans le silence ouaté de la pièce, des pas furtifs semblèrent glisser sur les tapis.
Quelqu’un était donc entré dans la villa ? Peut-être.
Il y eut soudain, malgré les rideaux tirés, un grand jet de lumière.
D’où venait-il ?
Tout simplement de la petite lampe électrique portative que tenait un personnage, un homme vêtu de noir, qui, maintenant, se trouvait au pied du lit et regardait dormir, un sourire railleur errant sur ses lèvres, Fernand Ricard et sa femme.
L’homme qui venait de s’introduire ainsi dans la maisonnette de Vernon n’était autre que le personnage mystérieux et troublant qui, une fois déjà, il y avait de cela quelques jours, avait osé venir proposer aux époux Ricard de s’allier avec lui pour capter l’héritage de leur oncle, dont il les croyait les assassins.
L’homme, après être resté quelques instants immobile, avança d’un pas encore.
Il dirigeait toujours les rayons de sa lampe sur les deux dormeurs, il parut prendre une décision et, appela à haute voix :
– Fernand Ricard, Alice Ricard.
Mais le courtier en vins et sa femme dormaient si profondément qu’ils n’entendirent ni l’un ni l’autre, tout d’abord, cet appel.
L’homme, alors, insista :
– Allons, éveillez-vous !
Il venait de parler très haut, sa voix avait résonné. Brusquement, Fernand Ricard se redressa sur son lit et, ouvrant des yeux encore gonflés de sommeil, regarda l’étranger.








