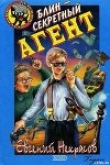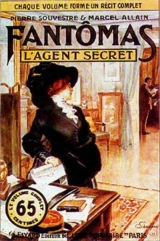
Текст книги "L'agent secret (Секретный агент)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
8 – UNE CHANTEUSE DE BEUGLANT
– Vas-y, Léonce ! t’occupe pas des civils !…
– À la porte, le comique !…
– Nichoune !… Nichoune !… Nichoune !…
Le brouhaha augmentait…
Léonce, le comique, qui se trouvait sur la scène, dut interrompre son monologue. Il se tourna vers la coulisse et, d’une voix piteuse, il appela le régisseur.
La petite salle du concert de Châlons présentait, ce soir-là, son maximum d’animation.
Ce n’était pas d’ailleurs un concert luxueux, produisant, aux feux d’une rampe superbe, des étoiles prestigieuses, que le « beuglant » de Châlons.
Inlassablement, sur les planches, défilaient des chanteurs et des chanteuses, les uns tentant de faire rire par des bons mots vingt fois ressassés, les autres exhibant de maigres poitrines, entonnant de fallacieux couplets et tous également victimes des plaisanteries des spectateurs à vingt sous la place. Or, ce jour-là, messieurs les militaires étaient moins satisfaits que jamais.
Il y avait eu trois « débuts » médiocres, et ils accusaient la direction d’avoir rempli la salle de « civils » qui faisaient la claque.
– À la porte, le comique !
– Chantera pas !…
Puis, on ne savait comment, en une minute, les protestataires groupés ne formulaient plus qu’une revendication, et maintenant, toute l’assemblée hurlait un même nom, sur l’air des Lampions :
– Nichoune !… Nichoune !… Nichoune !…
Nichoune était l’étoile de la troupe.
C’était une assez jolie fille, à figure intelligente, qui, chose rare en ces lieux pourtant dédiés à la musique, chantait à peu près juste et surtout chantait toujours des refrains populaires, intelligemment choisis, que le public pouvait reprendre en chœur.
Le régisseur, qui connaissait son public, bondit dans la loge de cette vedette :
– Allez ! cria-t-il, tu es prête, Nichoune ? Descends vite en scène !…
– On me demande ?
– Ils vont tout casser si tu n’arrives pas !
La jeune femme se levait :
– Ah ! zut, alors, j’en ai un succès, ici ! Si on ne m’augmente pas, ce que je m’en vais plaquer !… Tu verras, le patron sera obligé de me faire revenir…
– Descends, petite !… descends !… chante-leur Les Inquiets, ils seront contents avec ça !
Nichoune dégringola l’escalier qui joignait le premier étage où se trouvaient les loges des artistes avec la scène, et, bonne fille, toute essoufflée d’avoir couru, apparut derrière un portant.
– Alors, on ne veut plus que moi, ici ?…
On ne l’entendit pas, dans le vacarme encore bruyant, mais on vit qu’elle avait parlé… elle était là… Ce parterre de soldats, bon enfant, se calma tout de suite.
Tandis que le comique s’éclipsait, Nichoune descendait vers l’avant-scène.
Elle lança d’une voix crâne le titre de sa chanson :
– Les Inquiets ! musique de Delmet, paroles du même… c’est moi qui chante !
Le piano attaqua les deux premières mesures de la ritournelle, Nichoune, les poings sur les hanches, commença son couplet.
Mais, tandis qu’elle chantait, elle promenait un regard scrutateur sur le public, adressant de petits sourires à ceux de ses admirateurs qu’elle connaissait plus particulièrement.
Nichoune d’ailleurs ne devait point être dans de bonnes dispositions, ce soir-là, car soudain, alors qu’elle devait attaquer son troisième couplet, elle eut une absence de mémoire, sembla hésiter une seconde, puis, sans se démonter, entonna le quatrième couplet.
Il importait peu, au surplus, que sa chanson ainsi tronquée n’eût plus aucun sens ; le public ne s’en apercevait même pas et ne lui en fit pas moins, au moment de sa tirade finale, une chaleureuse ovation.
– Le programme !… le programme !…
D’ordinaire, Nichoune se refusait dédaigneusement à descendre dans la salle.
Mais ce soir-là, elle avait sans doute une raison particulière pour ne point se dérober à l’ovation que l’on continuait à lui adresser, car elle fit « oui » de la tête et, prenant dans la coulisse une pile de petits programmes, elle descendit les quelques marches qui faisaient communiquer la scène avec la salle…
Certes, on ne lui épargnait pas les compliments.
Mais Nichoune était insensible à l’admiration qu’elle soulevait ; elle allait son chemin et soucieuse seulement, semblait-il, de se libérer au plus vite de ce qu’elle considérait comme une corvée.
On se lassait d’ailleurs de ne s’occuper que d’elle.
Une autre chanteuse venait d’apparaître sur le plateau, elle aussi fort goûtée du public, l’attention se reporta sur la nouvelle arrivée.
Nichoune parvenait à ce moment au dernier rang de chaises qui garnissaient la salle du concert, lorsqu’elle s’entendit appeler à voix basse par un homme tout enveloppé dans un grand manteau, et qui se tenait appuyé contre la muraille, debout, tout au fond de la salle.
Nichoune se retourna, cherchant, des yeux, qui venait de prononcer son nom, se demandant bien si c’était cet homme-là qui, jusqu’alors, n’avait point attiré son attention.
La jeune femme hésitait, assez disposée à poursuivre sa route, lorsqu’un instant le bonhomme entrouvrit son manteau, laissait voir une sorte de boîte assez volumineuse, qu’il portait en bandoulière…
Et, comme si la vue de cet encombrant paquet avait éveillé des souvenirs très précis dans l’esprit de la jeune femme, Nichoune se dirigea vers le bonhomme.
– Vous voulez un programme ?
– Rentre immédiatement après le concert, souffla le bonhomme.
– Bien ! répondit la chanteuse d’un ton soumis… C’est-y que vous êtes musicien, vous ?
L’homme répondit :
– Oui, ma petite, je suis musicien moi aussi. Seulement pas de la même façon que vous : c’est pas de la gaieté que je vends…
Et l’inconnu montrait l’accordéon qu’il portait en bandoulière.
***
Tandis que Nichoune, ses programmes distribués, remontait précipitamment dans sa loge, l’homme qui l’avait abordée et lui avait sur un ton de commandement enjoint de venir la retrouver, quittait l’établissement.
Il suivit un itinéraire bizarre, tourna à droite, puis à gauche, parvint enfin à une sorte de petit hôtel d’aspect assez misérable, mais cependant propre, dans lequel il entra.
Endormi déjà à moitié, le garçon lui tendait un bougeoir qu’il allumait avec une allumette de papier enflammée au bec de gaz. L’homme monta dans sa chambre, dont il ferma soigneusement la porte…
Bien seul alors, et s’étant assuré que les volets de sa fenêtre étaient mis et que, par conséquent, on ne pouvait l’observer du dehors, il se débarrassa du long manteau en forme de cape qui l’engonçait, il alluma sa lampe, tira une chaise, s’accouda contre la table… son visage était maintenant en pleine lumière, il était facile de le reconnaître : l’homme qui venait de parler à la maîtresse du caporal Vinson était tout bonnement Vagualame, le mendiant assassin qui avait jadis abordé Bobinette dans une allée du Bois de Boulogne, quelques heures après avoir si audacieusement tué d’un coup de fusil le malheureux capitaine Brocq, au moment où celui-ci passait en voiture sur la place de l’Étoile.
Il n’y avait pas longtemps que Vagualame attendait lorsqu’on frappa à sa porte.
– Qui va là ? interrogea-t-il.
– Moi… Nichoune…
Vagualame se levait, ouvrait :
– Entrez, ma chère amie…
Ce n’était plus le ton de commandement, le ton bref et volontaire. Vagualame se faisait aimable.
Il considérait, d’un œil ravi d’ailleurs, l’amusante frimousse de sa visiteuse et débuta par un compliment :
– Toujours jolie, ma chère… de plus en plus jolie !
– Je suppose que ce n’est pas pour me dire cela que vous êtes encore venu à Châlons ? Vous êtes très en avance, cette quinzaine !… Rien de grave, je pense ?
Vagualame haussa les épaules :
– Mais non, pardieu, vous avez toujours peur !
– Dame !… savez-vous, c’est joliment dangereux, ce que nous faisons tous les deux ?…
– Dangereux ? allons donc !… C’est dangereux pour les imbéciles et pour personne d’autre : nul ne pourra jamais soupçonner que la jolie Nichoune sert d’intermédiaire, de « boîte aux lettres », entre moi et « Roubaix… »
– Vous voulez encore me donner quelque chose pour Roubaix ?
Mais Vagualame évita de répondre directement.
– Vous ne l’avez point revu depuis huit jours ?
– Roubaix ? non…
– Et Nancy ?
– Nancy non plus.
Vagualame semblait réfléchir.
– Eh bien, fit-il enfin, cela n’a aucune importance, car je puis vous annoncer que Belfort passera ici, certainement demain matin…
– Belfort ? mais ce n’est pas sa date.
Vagualame semblait irrité de la remarque.
– Belfort n’a point de date, dit-il un peu sèchement, je vous ai déjà répété que Belfort était son maître et faisait ce qu’il lui plaisait, c’est un divisionnaire…
Il était évident que ces noms de villes, « Roubaix, Nancy, Belfort » désignaient de mystérieux personnages…
– Un divisionnaire, répétait Nichoune, qu’est-ce que c’est au juste ? Est-ce lui qui centralise tout ?
– Vous me posez des questions, maintenant ? Nichoune, je vous ai déjà avertie, et cela ne date pas d’hier, que je n’admettais jamais une demande de renseignements… En tout cas, je vous le répète, Belfort passera ici demain matin, vers les onze heures et demie, midi… Bien entendu, il ne me connaît pas, il ne se doute même pas de mon existence… que je ne me soucie pas de lui révéler, puisque je ne dois avoir affaire qu’à vous. C’est indirectement, très indirectement, que j’ai appris sa prochaine venue… et aussi qu’il aurait occasion de vous prendre entre les mains l’enveloppe que voici…
Vagualame venait de fouiller dans la poche intérieure de son veston. Il tendit à la jeune femme un large papier scellé de cire rouge.
– Attention ! recommanda-t-il, tendant toujours l’enveloppe, je vous signale que ce document est important. On a eu beaucoup de peine à l’avoir… infiniment de peine… il ne faut pas qu’il s’égare, il faut qu’il soit remis le plus vite possible, dites-le à Belfort… Eh bien ?…
Nichoune ne semblait point du tout pressée de prendre le dépôt que voulait lui remettre Vagualame.
Ce dernier répéta :
– Eh bien ? qu’est-ce qu’il y a donc ?
À la question précise, Nichoune éclata.
– Il y a, répondit-elle, il y a que j’en ai assez de tout ça… Zut ! c’est trop dangereux !…
– Comment, petite, vous ne voulez plus être notre fidèle boîte aux lettres ?
– Non !…
– Mais pourquoi donc ?
– Parce que… parce que je ne veux plus ! voilà !…
– Voyons, Nichoune, vous avez bien une raison ?
– Si j’ai des raisons ? je n’en manque pas !… Tenez, Vagualame, après tout, j’aime mieux vous dire la vérité… eh bien, voyez-vous, l’espionnage, ça n’est pas mon fort… Il y a juste trois mois que j’en fais… depuis que vous m’avez embauchée, et je ne vis plus, j’ai tout le temps la frousse d’être pincée… C’est affolant. J’ai déjà rompu avec mon amant… je ne suis plus la maîtresse de Vinson !… Je ne veux plus être la maîtresse d’aucun bonhomme compromis dans vos histoires… Alors, vous comprenez, Vagualame, je ne marche plus !… J’aimerais mieux tout raconter à la justice et me mettre complètement en dehors de tout ça.
– Écoutez, ma belle, répondit-il, vous êtes libre, et si vous venez d’hériter…
– Je n’ai pas hérité.
– Enfin, reprit Vagualame, si vous vous moquez des jolis louis que je vous apportais chaque mois, c’est votre affaire. J’imagine pourtant que vous ne voudrez pas me mettre dans l’embarras ?…
Nichoune semblait hésiter.
– Qu’est-ce que vous allez encore me demander ? demanda-t-elle enfin.
– Peu de chose, ma toute belle… tenez, ceci seulement. Je vous le dis : Belfort passe ici demain. Ce papier que je veux lui faire remettre a une très grande importance… soyez gentille, donnez-le-lui… je ne vous ennuierai plus après…
– C’est bon ! disait-elle, donnez votre enveloppe, Vagualame, mais vous savez, c’est la dernière fois qu’il faut vous adresser à moi… Je ne veux plus être la boîte aux lettres de Châlons… c’est fini !… la dernière levée est faite !…
***
Le lendemain de sa mystérieuse discussion avec Nichoune, vers cinq heures de l’après-midi, Vagualame abordait le patron d’un petit hôtel situé tout à l’extrémité de la ville et fort loin de l’auberge où lui-même avait passé la nuit.
– Mademoiselle Nichoune n’est pas là ? demandait-il.
– Non ! Qu’est-ce que vous lui voulez ?
Vagualame eut un petit rire.
– Des fois, monsieur l’hôtelier, elle ne vous aurait pas prévenu qu’un de ses pays devait venir la voir ?
Le patron de l’hôtel, qui se tenait appuyé contre la muraille nonchalamment, se redressait un peu, presque intéressé :
– Si, fit-il, Mlle Nichoune nous a dit qu’un vieux musicien la demanderait cet après-midi, qu’il faudrait le faire attendre…
– La brave petite fille !
Vagualame jouait à merveille l’attendrissement :
– Ah ! en voilà une courageuse et une travailleuse !
L’hôtelier considérait toujours le mendiant, assez intrigué…
– Vous la connaissez bien ?
– Si je la connais !… parbleu ! mais c’est moi qui lui ai appris à chanter !… Je suis violoniste, moi, monsieur, je n’ai pas toujours pianoté sur ce soufflet…
Vagualame montrait son accordéon et proposait :
– Vous ne voulez pas que je vous en joue une ? C’est-y qu’elle va être longtemps à rentrer, Nichoune ?
L’hôtelier avait un geste de doute :
– Non, je ne pense pas, elle sera là dans un petit quart d’heure… Si vous voulez entrer l’attendre, sa chambre, c’est la pièce au bout du corridor, elle est ouverte…
– C’est que je ne sais point, répondait Vagualame, si c’est très « comme il faut » d’entrer comme ça dans la chambre d’une jeunesse ?…
L’hôtelier eut un bon rire.
Il trouvait la plaisanterie très fine.
– Comme vous voudrez ! dit-il ; moi je vous offre ça parce qu’elle m’a prévenu de votre visite…
Vagualame se décidait :
– Merci, mon bon monsieur, j’vas toujours aller me reposer quelques instants…
Et, clopin-clopant, exagérant sa démarche fatiguée, Vagualame gagna la chambre de l’artiste.
Mais il n’en avait pas refermé la porte derrière lui, qu’immédiatement son attitude changeait :
– Vite ! faisait-il, j’ai un quart d’heure devant moi, il faut en profiter. Ah ! le mobilier n’est pas somptueux… une table, le lit, des chaises, ce fauteuil… Si il y a quelque chose, où cela peut-il être ?
Il réfléchissait quelques instants, puis :
– Voyons la table !
Il renversait le meuble en tous sens, ne trouvait rien.
– Voyons la cheminée !
Un examen attentif paraissait le désoler…
– Que je suis bête ! faisait-il soudain. C’est dans le matelas qu’il faut chercher… Une semblable cachette, c’est classique !…
Il tirait de ses vêtements une longue aiguille et entreprenait de sonder avec elle l’épaisseur du matelas du lit de Nichoune, dont il se gardait bien, crainte d’être pris, de défaire la couverture…
– Parbleu ! fit-il tout d’un coup…
L’aiguille qui lui servait de sonde avait rencontré un objet qui résistait, qu’elle traversait difficilement.
– Je parie que voici mon affaire !
Vagualame, d’un geste habile, glissait sous le couvre-pied sa main fine et sèche ; il retenait mal un cri de satisfaction.
– La petite imbécile ! elle n’a même pas caché cela dans l’intérieur du matelas ; elle s’est contentée de le glisser entre celui-ci et le sommier… C’est une enfant !…
Sa main ramenait deux enveloppes, dont il regardait avidement les suscriptions.
– Oh ! oh ! faisait-il, c’est plus grave encore que je ne le pensais… Il va falloir agir… Ah çà ! mais est-ce qu’elle se moquerait de moi ?… Nichoune ! Nichoune ! tu viens de jouer un jeu dangereux, un jeu qui, dans quelques minutes, pourrait te coûter cher…
Sur la première des enveloppes que tenait Vagualame, le vieux mendiant avait lu un simple mot :
« Belfort »
C’était le document qu’il avait remis la veille au soir à l’actrice. Il n’était, après tout, que médiocrement étonné de constater que Nichoune ne l’avait point remis au divisionnaire annoncé…
Mais l’autre enveloppe, elle, portait comme adresse ces deux lignes :
M. BONNET
Juge d’instruction.
Vagualame considéra longuement cette suscription :
– Elle nous vend ! murmura-t-il, parbleu, c’est certain !… pas de doute ! la petite misérable !… Ah ! elle a des scrupules !… Je m’en vais lui servir une leçon de catéchisme de ma façon…
Le vieux mendiant tenait toujours l’enveloppe, la tournait dans tous les sens.
– Ce qu’il faudrait, monologuait-il, c’est savoir exactement ce qu’elle a écrit là-dedans ?… Mais si je l’ouvre en ce moment, je n’aurai peut-être pas le temps de faire un faux, d’imiter son écriture, de trouver une enveloppe semblable… je risque d’éveiller son attention… Ah ! soyons raisonnable, laissons tout en état… Aussi bien, je m’arrangerai pour prendre ce petit papier, dangereux malgré tout, demain matin, lorsque…
Vagualame s’interrompit soudain, prêtant l’oreille :
– Attention ! faisait-il, je reconnais sa voix… bigre ! j’allais rater mon affaire.
Il remit prestement en place les deux documents qu’il venait d’examiner, puis, rapidement, tirant de sa poche une liasse de lettres écrites à la main et, merveilleux d’habileté, forçant un tiroir de la table, les mêla à d’autres lettres conservées par Nichoune…
– Voilà, ma petite, monologuait-il, de quoi faire honorer ta mémoire !
Nichoune entrait dans la pièce.
– Bonjour ! cria-t-elle.
Vagualame feignait de se réveiller en sursaut :
– Ah !… ah !… ah !… bonjour, Nichoune… Dis donc, tu n’as pas vu Belfort, hein ?
– Comment le savez-vous ? demanda-t-elle.
– Je viens de le rencontrer… il m’a dit qu’il ne t’avait point trouvée au rendez-vous habituel…
Nichoune baissa la tête :
– J’ai cru que j’étais filée…
Vagualame approuva de la tête :
– Bon… bon… ça n’a pas autrement d’importance… Rends-moi toujours mon enveloppe…
– Vous la voulez ?
– Bien entendu…
La jeune femme hésita une seconde… mais pouvait-elle résister ?
– Par précaution, fit-elle, figurez-vous, Vagualame, que je l’avais cachée entre mon matelas et mon sommier… Tenez, la voici…
Nichoune, naturellement, ne tendait au vieux mendiant qu’une seule enveloppe, ne faisant point allusion à la seconde lettre, celle destinée au juge d’instruction, et qu’elle laissa dans sa cachette…
– Merci, petite…
Vagualame sembla indifférent à la remise du document. Il considérait maintenant la jeune femme si attentivement, que celle-ci lui demandait :
– Mais qu’avez-vous donc à me regarder comme ça ?…
– Je te trouve très jolie !…
– Comment ! voilà que vous devenez galant !…
– Galant !… non, tu exagères : je te trouve jolie, Nichoune, mais tu as de vilaines mains…
L’artiste riait et tendait ses deux petites mains.
– Que leur reprochez-vous donc ?
– Elles sont rouges… Je m’étonne qu’une femme comme toi ne pense pas à les faire blanchir… Tu ne connais donc pas le moyen ?
– Non… Que faut-il faire ?…
– Mais, c’est l’enfance de l’art, ripostait le mendiant. Tiens, tu n’as chaque soir qu’à t’attacher les deux mains avec un ruban et à les maintenir levées au-dessus de ta tête.
– Comment ça ? Je ne comprends pas !
– Mais si !… tu mets un clou dans la muraille, n’est-ce pas ?… et puis tu t’arranges que toute la nuit tu gardes les mains levées… Tu verras que le lendemain elles seront blanches comme des lis…
Nichoune paraissait vivement intéressée.
– Vrai ?… J’essayerai cela ce soir… Il faut dormir les mains attachées en l’air, alors ?
Quelques minutes après, Vagualame s’éloignait par les rues de Châlons. L’affreux bonhomme ricanait.
– Les mains en l’air, ma jolie !… essaye cela ce soir ! Avec la petite maladie de cœur que je te connais, j’imagine que le résultat ne se fera pas attendre ! Hé… hé… cela servira d’exemple à ceux et à celles qui veulent écrire au juge d’instruction…
Et Vagualame songeait encore :
– Il va falloir que je fasse très attention ce soir, quand je viendrai me cacher chez cette petite imbécile… il faudra de toute façon que je puisse prendre cette lettre compromettante avant que personne dans l’hôtel se soit aperçu du décès… il faudra surtout que personne ne s’aperçoive… oh ! cela, il est vrai…
Ceux qui croisaient Vagualame croyaient tout simplement rencontrer un vieux joueur d’accordéon…
9 – CHEZ LE SOUS-SECRÉTAIRE D’ÉTAT
– Entrez ! dit, d’un ton excédé Hofferman, fort occupé à écrire.
Un caricatural planton s’introduisit timidement dans le bureau du chef du service des renseignements.
– C’est un huissier du cabinet, dit-il, qui fait demander à mon colonel de bien vouloir descendre tout de suite voir M. le sous-secrétaire d’Etat.
Hofferman leva la tête, étonné.
– Moi ? vous êtes sûr que c’est moi ?
– Oui, mon colonel.
– C’est bien, j’y vais.
Le planton s’éclipsa. Hofferman resta un instant songeur, puis brusquement se levait, entrouvrait la porte de la pièce voisine et s’adressant au commandant Dumoulin :
– Je descends un instant, le sous-secrétaire d’État me demande…
Le colonel, à pas pressés, parcourut les interminables couloirs qui le séparaient du bâtiment dans lequel étaient aménagés les bureaux du sous-secrétaire d’État.
– Que peut-il donc me vouloir ? se demandait le colonel Hofferman en pénétrant dans le cabinet du ministre.
M. Maranjévol n’était pas seul dans son vaste salon : en face de lui, se tenant à contre-jour, se trouvait un homme d’assez haute stature et dont les cheveux rares bouclaient légèrement.
Le sous-secrétaire d’État se leva de son fauteuil et, sans le moindre préambule, fit les présentations :
– M. Juve, inspecteur de la Sûreté… Colonel Hofferman, chef du Deuxième Bureau…
Le policier et le militaire s’étaient salués gravement.
Un peu froids, ils attendaient en silence que M. le sous-secrétaire d’État voulût bien amorcer l’entretien.
M. Maranjévol, en deux mots, expliquait qu’à la suite d’un bref entretien avec Juve, au sujet de la mort du capitaine Brocq, il avait cru nécessaire de le mettre en rapport avec le colonel Hofferman.
– Ma foi, monsieur, déclara-t-il d’une voix sèche, je suis fort heureux de la circonstance qui nous réunit. Je ne vous cacherai pas que je suis étonné, très désagréablement étonné même, de votre attitude depuis quelques jours à propos de ce malheureux drame. J’ai toujours considéré jusqu’à présent que la personnalité privée d’un officier, surtout d’un officier de l’État-Major, était une chose quasi-inviolable. Or, il m’est revenu qu’à la mort du capitaine Brocq vous vous êtes livré, non seulement à des enquêtes minutieuses sur les circonstances ayant accompagné le décès, mais encore que vous aviez perquisitionné au domicile du défunt, sans nous en aviser au préalable. Je ne puis admettre cette façon de procéder, et je me félicite d’avoir l’occasion de vous le dire !
Pendant que le colonel parlait, M. Maranjévol roulait de bons gros yeux étonnés, inquiets, considérant successivement le militaire et le policier.
Mais l’inspecteur était resté impassible sous l’orage ; il dit à son tour :
– Je vous ferai observer, mon colonel, que s’il s’était agi d’une mort naturelle, je me serais contenté de vous restituer les documents qui avaient été recueillis au commissariat de police ; mais, comme vous l’avez su probablement, le capitaine Brocq a été tué, tué d’une façon mystérieuse. Je me suis donc trouvé en présence d’un crime, et d’un crime de droit commun : l’enquête à faire relevait de l’autorité civile et non de l’autorité militaire, croyez bien que je sais mon devoir !
Juve avait prononcé ces paroles avec le plus grand calme, apparent tout au moins.
Le colonel répliqua :
– Je persiste dans mon opinion ; vous n’aviez pas à vous immiscer dans une affaire qui ne regarde que nous ; la mort du capitaine Brocq coïncide avec la disparition d’un document secret, est-ce à vous ou à nous de le rechercher ?
Après une hésitation, Juve rétorqua simplement :
– Vous me permettrez de ne pas répondre sur ce point.
Il y eut encore un instant de silence glacial.
Le colonel Hofferman, avec une brusquerie toute militaire, venait en effet de mettre le doigt sur la plaie, toujours béante, qui irrite depuis de longues années les services de la Sûreté et ceux des renseignements militaires lorsque, par suite des circonstances, ils sont appelés à intervenir parallèlement.
Sans cesse, dans des affaires d’espionnage, il y a conflit.
Le colonel Hofferman, se méprenant à l’attitude du policier, triomphait et, se tournant vers le sous-secrétaire d’État :
– D’ailleurs, poursuivit-il, j’estime que l’on a fait beaucoup trop de bruit autour du décès du capitaine Brocq. Cet officier a été victime d’un accident que nous ne pouvons pas discuter, voilà tout, et peu importe. Nous autres, militaires, nous sommes partisans de la politique des résultats. À l’heure actuelle, un document nous manque, nous le cherchons : qu’on nous laisse agir. Et, monsieur le sous-secrétaire d’État, j’en reviens toujours à ma première question : Que diable la police a-t-elle été faire chez le capitaine Brocq ? Véritablement, plus la Sûreté va, et plus elle s’arroge des pouvoirs inadmissibles.
Juve, non sans difficulté, s’était contenu, mais décidément le colonel Hofferman allait trop loin. À son tour, le policier éclata :
– Monsieur le sous-secrétaire d’État, déclara-t-il de sa voix chaude et vibrante, je ne puis accepter de pareilles observations. J’ai là, dans mon dossier, les preuves matérielles que l’assassinat du capitaine Brocq est entouré des événements les plus mystérieux et aussi les plus graves. En bonne logique, qui veut connaître la fin doit être au courant des moyens, et pour comprendre quelque chose il faut avoir commencé par le commencement. C’est ce commencement que j’apporte, il vaut la peine d’être étudié, monsieur le sous-secrétaire d’État, je vous en fais juge…
Pris entre deux feux, M. Maranjévol faisait une figure désolée… Mais il n’y avait pas moyen de reculer !
M. le sous-secrétaire d’État, décrochant un récepteur de son téléphone privé, avisa le directeur de son cabinet que, par suite d’incidents imprévus, il ne recevrait pas de la matinée.
M. Maranjévol désigna d’un geste las deux sièges à ses interlocuteurs et invita Juve à s’expliquer.
– Mon Dieu, monsieur, commença l’inspecteur qui avait retrouvé tout son sang-froid, je ne vous retiendrai pas bien longtemps. Vous savez dans quelles circonstances j’ai été amené à découvrir que le capitaine Brocq avait été mystérieusement assassiné ! Il m’importait au plus haut point de préciser quels étaient les tenants et aboutissants de cet officier. J’avais à me renseigner sur sa vie privée, à connaître ses relations, ses fréquentations habituelles, afin de pouvoir, étant documenté sur sa personnalité, examiner qui, dans son entourage, aurait eu l’intérêt à le faire disparaître. Je me suis rendu au domicile de Brocq, rue de Lille, pour y recueillir diverses dépositions dont j’ai le texte dans mon dossier. Je vous en épargne le détail. Il en ressort que le capitaine Brocq recevait régulièrement la visite d’une femme qu’il n’a pas encore été possible d’identifier mais que nous connaîtrons prochainement. Faisons, voulez-vous, messieurs, cinq minutes de psychologie. Dans les suppositions que je vais formuler, l’avis du colonel Hofferman me sera fort précieux. Si j’en crois mes enquêtes, le capitaine Brocq était un homme simple, modeste et travailleur, un esprit sérieux, modéré. Définissons l’homme d’un mot : un bourgeois. Cet officier célibataire avait-il un tempérament de coureur ? Vous me permettrez d’en douter ; si le capitaine Brocq avait une liaison et une liaison irrégulière, c’était assurément pour le « bon motif ». Brocq devait être un esprit trop droit pour consentir à l’idée de ne pas régulariser plus tard sa situation. Est-ce là votre avis, mon colonel ?
Hofferman, avec franchise, répondit :
– C’est mon avis. Je vous rends justice, monsieur Juve. Tel était bien le caractère du capitaine Brocq. Mais je ne vois pas où vous voulez en venir ?
– À ceci, reprit le policier : parmi les relations du capitaine Brocq, se trouve la famille d’un ancien diplomate d’origine autrichienne, M. de Naarboveck. M. de Naarboveck a une fille d’une vingtaine d’années, Mlle Wilhelmine, laquelle, au lendemain du décès a fait preuve d’un désespoir profond et d’une émotion intense ; je n’irai pas jusqu’à prétendre que Mlle de Naarboveck était la maîtresse du capitaine Brocq… mais je vous le laisserais volontiers supposer.
– Comment savez-vous, interrogea le sous-secrétaire d’État, que Mlle de Naarboveck a manifesté du chagrin à la mort du capitaine Brocq ?
– Par un journaliste qui a été reçu dans l’intimité des Naarboveck le lendemain du drame.
– Oh ! un journaliste ! protesta le colonel…
Juve sourit finement :
– C’est un journaliste, mon colonel, pas tout à fait comme les autres, puisqu’il s’agit de Fandor.
Et il ajouta :
– Sa venue chez le diplomate autrichien était d’ailleurs non pas la conséquence d’une initiative privée, mais bien l’exécution d’une mission dont il avait été chargé en haut lieu. D’accord avec M. Dupont (de l’Aube), directeur de La Capitale, M. le ministre de la Guerre avait désiré…
Le sous-secrétaire d’État coupa la parole à l’inspecteur.
– Nous sommes au courant de cela, monsieur Juve… Toutefois, je puis vous dire que la personne sur laquelle le ministre voulait être renseigné n’était pas Mlle de Naarboveck, mais bien sa dame de compagnie… une jeune femme appelée Berthe…
– … et surnommée Bobinette… acheva Juve ; je sais, monsieur le sous-secrétaire d’État.
– Que pensez-vous d’elle ? interrogea M. Maranjévol.
– Plus j’y réfléchis et plus je suis tenté de croire que Wilhelmine de Naarboveck était la maîtresse de Brocq… oh ! en tout bien tout honneur… J’entends par là que ces jeunes gens, lorsqu’ils se trouvaient ensemble, devaient s’entretenir uniquement de sujets d’amour… mais derrière eux, subrepticement, une tierce personne pénétrait leur intimité, était dépositaire de leur secret et pouvait de ce chef prendre pas mal de libertés avec eux. Cette personne, c’est Mlle Berthe, dite Bobinette… Messieurs, ou je me trompe fort, ou Bobinette n’est autre qu’une fille de la plus basse extraction, capable de tout et qui aurait été mêlée à la bande de criminels la plus redoutable qui soit au monde, à la bande que j’ai maintes fois poursuivie, décimée, désagrégée, mais qui renaît sans cesse, se reforme, à la manière de l’hydre malfaisante, à la bande, messieurs… de Fantômas.
Juve se tut, s’épongea le front.
La voix sèche du colonel Hofferman rompit le silence :
– Hypothèses, monsieur ! Hypothèses vraisemblables en ce sens qu’il se peut fort bien que Brocq ait eu une maîtresse, – nous en sommes tous là, – mais en réalité, c’est du roman.