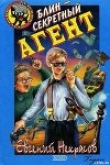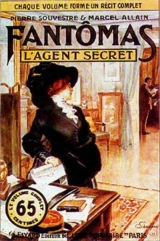
Текст книги "L'agent secret (Секретный агент)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
6 – LE CAPORAL VINSON
Un genou appuyé sur sa valise, Jérôme Fandor, de toute la force de ses bras vigoureux, tirait sur les courroies qu’il ne parvenait pas à boucler.
C’était le dimanche treize novembre, à cinq heures du soir ; l’appartement du journaliste était brillamment illuminé : le gaz brûlait dans toutes les pièces où régnait le plus grand désordre.
Fandor partait en vacances et pour être sûr de ne pas manquer son train, le jeune homme se disposait à aller dîner à la gare de Lyon.
– Ouf ! s’écria-t-il lorsqu’il eut enfin réussi à comprimer l’amoncellement de ses vêtements et à fermer sa valise.
Fandor poussa un soupir de satisfaction. Cette fois il ne pouvait plus douter de son départ, la chose était certaine. Fandor jetait un dernier coup d’oeil dans son logis lorsqu’il s’arrêta net au milieu du couloir.
Le timbre de la sonnerie avait retenti. Quelqu’un sollicitait l’ouverture de la porte d’entrée.
– Ils ne vont pas me refaire le coup ? dit le jeune journaliste.
Et il ouvrit la porte de l’appartement. Sur le palier, un militaire.
– Monsieur Fandor ? demanda ce dernier d’une voix douce, un peu enrouée.
– C’est ici, c’est moi, que désirez-vous ?
Le militaire avança un pas, puis, comme faisant un effort sur lui-même, il articula péniblement :
– Voulez-vous me permettre d’entrer ? je serais désireux de vous dire quelque chose.
Fandor, silencieusement, invita d’un geste de la main l’importun à pénétrer dans l’appartement.
C’était un tout jeune garçon qui portait l’uniforme de l’infanterie de ligne. Sur la manche de sa capote les galons de caporal.
Ses cheveux étaient bruns et ses yeux assez clairs contrastaient étrangement avec le reste de son visage aux tonalités foncées. Une légère moustache noire ombrait sa lèvre.
– À qui ai-je l’honneur de parler ? demanda Fandor.
– Je suis le caporal Vinson. Je n’ai pas l’honneur d’être connu de vous, monsieur, mais moi je vous connais bien, par vos articles… Et j’ai bien besoin de vous parler…
– Encore un raseur, se dit Fandor, qui vient me demander une recommandation.
Le journaliste bouillait d’impatience à l’idée qu’il perdait des minutes précieuses, et qu’il lui faudrait singulièrement écourter son dîner s’il ne voulait pas manquer le rapide.
Néanmoins, désireux d’être poli :
– Veuillez vous asseoir, monsieur, dit-il, je vous écoute.
Le caporal Vinson parut très ému.
– Ah ! monsieur, commença-t-il, excusez-moi d’être venu vous déranger, mais je tenais à vous dire… à vous connaître… à vous exprimer… combien j’apprécie votre talent, votre façon d’écrire… comme j’aime les idées que vous exprimez dans le journal !… Ainsi, votre dernier article, si juste, si… charitable…
– Vous êtes bien aimable, monsieur, interrompit Fandor et je vous remercie ; mais si cela ne vous fait rien, nous pourrions prendre rendez-vous pour un autre jour car je suis très pressé et…
– Ah, monsieur, ne me chassez pas ! Si je me tais aujourd’hui, je n’aurai plus le courage de parler… et pourtant il le faut…
– Eh bien, monsieur, causons.
– Monsieur Fandor… hurla alors Vinson, je suis un traître !
Encore qu’il fût loin de s’attendre à cette déclaration, aussi brutale que surprenante, Fandor ne broncha pas ; il avait l’habitude de ces cas bizarres où les coupables éprouvent le besoin de faire leur profession de foi devant des gens qu’ils n’ont jamais vus, alors qu’ils se garderaient rigoureusement de révéler quoi que ce soit à des intimes.
Fandor se leva lentement de la chaise qu’il occupait, s’approcha du militaire, et lui mit cordialement les mains sur les épaules, l’obligea à s’installer de nouveau dans le fauteuil dont il venait de sortir :
– Remettez-vous, monsieur, je vous en prie, dit-il.
Une réaction se produisait, de grosses larmes coulaient sur les joues hâlées du caporal, et Fandor le considéra, ne sachant quelle consolation apporter.
– Oui monsieur, c’est à cause d’une femme… et puis vous comprenez cela… vous qui écrivez des articles où vous dites qu’il faut prendre en pitié les malheureux comme moi… car on est malheureux lorsqu’une femme vous tient et qu’on manque d’argent… Et puis, avec ces gens-là… lorsqu’on est embarqué dans leurs affaires, on est foutu… il faut obéir… et toujours ils en demandent plus… Ah ! monsieur, quel épouvantable désastre que la mort du capitaine Brocq… voyez-vous, moi… si je suis devenu traître… c’est de leur faute… Ah ! monsieur, vous ne savez pas ce que c’est que d’avoir pour maîtresse une femme comme… celle que j’aime, une femme comme…
Fandor articula :
– Comme Bobi…
Mais il n’acheva pas. Vinson le regardait interloqué, ces premières syllabes ne le frappaient point et il semblait fort surpris, à la façon de quelqu’un qui les aurait entendues prononcer pour la première fois.
Fandor, pour dissimuler son embarras, se gratta la gorge, puis, très vite reprit :
– Je vous demande pardon de vous avoir interrompu, vous disiez donc… une femme comme ?…
– Une femme comme Nichoune !… Nichoune !… ma maîtresse !… ah ! monsieur, tout Châlons sait ce qu’elle vaut. On connaît la méchanceté de cette rosse, et cependant… il n’y a pas un homme qui n’ait voulu…
– Mais mon brave caporal, pourquoi diable me racontez-vous tout cela ?
– Mais, monsieur, parce que… parce que… parce que j’ai juré de tout vous dire avant de mourir !
– Fichtre ! observa Fandor, que comptez-vous donc faire ?
Le caporal, sur un ton de fermeté qui contrastait avec son attitude affolée jusqu’alors, répondit simplement :
– Je compte me tuer.
Désormais, c’était Fandor qui, loin de vouloir aller prendre son train, insistait près du militaire pour obtenir de lui des détails complémentaires sur l’existence de Vinson.
Le caporal Vinson se trouvait depuis quinze mois au service. Fils d’une veuve qui tenait une petite librairie à Levallois-Perret, il avait été des premiers conscrits que touchait la nouvelle loi de deux ans et le recrutement l’avait envoyé au 214e de ligne, en garnison à Châlons.
Ses classes terminées, il avait obtenu les galons de caporal, et, vu sa belle écriture, eu égard également à la protection d’un commandant, il avait passé dans les bureaux de la Place, en qualité de secrétaire. Vinson était fort satisfait de sa nouvelle situation, car le jeune homme, élevé dans les jupes de sa mère et dont toute l’adolescence s’était passée pour ainsi dire derrière le comptoir de la librairie, avait beaucoup plus le tempérament d’un bureaucrate que celui d’un homme actif. Le seul sport qu’il pratiquait avec plaisir, c’était la bicyclette et le seul luxe qu’il se permettait, c’était la photographie.
Un dimanche soir, entraîné par ses camarades, il était allé au Café-Concert de Châlons.
Vinson fréquentait quelques sous-officiers un peu plus riches que lui… Sans être des prodigues, ces jeunes gens avaient la dépense assez facile, et à maintes reprises déjà, Vinson, pour ne pas être en reste avec eux, avait sollicité et obtenu de sa mère des envois d’argent.
Ce soir-là, après le concert, on avait invité quelques chanteuses de l’établissement à venir souper en cabinet particulier et Vinson, au cours de la fête, s’était trouvé attiré, séduit par une grande fille aux cheveux teints, aux joues émaciées, aux yeux brillants et dont l’allure faubourienne et parigote l’avait subjugué.
Vinson, de son côté, visiblement ne faisait pas une mauvaise impression sur la chanteuse. La conversation s’était prolongée fort avant. Vers quatre heures du matin, le caporal et la chanteuse se retrouvaient la tête surchauffée, légèrement grisés par les alcools, sur le boulevard désert de Châlons, alors que le jour pointait. La permission de Vinson n’expirait que le lendemain soir ; Nichoune lui avait offert l’hospitalité de sa chambre meublée… Ensuite ils avaient vécu l’aventure classique et lamentable de ces amants et maîtresses unis dans la débauche par le hasard, et qui se croient liés l’un à l’autre par une chaîne indissoluble.
La chanteuse avait harcelé le caporal de ses demandes d’argent.
Peu à peu, la mère de Vinson avait mis le holà aux dépenses et le caporal, incapable de rompre avec Nichoune, commença à s’endetter dans la ville…
– Il m’arrivait quelquefois, lorsque, à la suite d’une dispute, j’avais momentanément quitté Nichoune, ou lorsque je savais qu’elle recevait un amant, de partir la rage au cœur. Un certain samedi, enfourchant ma fidèle bécane pour abattre des kilomètres sur la grande route poudreuse qui longe le camp, je fis une course rapide, puis m’étant assis à l’ombre d’un arbre, le long d’un fossé, je commençais à m’endormir. Un cycliste, dont le pneumatique était crevé, me demanda de lui prêter ma trousse pour le réparer, et tandis que la dissolution séchait, nous causâmes. C’était un homme d’une trentaine d’années, élégamment habillé. À la façon dont il s’exprimait, on sentait que l’on avait affaire à un homme du monde.
« Il voyageait, me disait-il, en touriste, et visitait précisément les environs de Reims et de Châlons…
« – Pas bien pittoresque le pays ! lui dis-je…
« – C’est intéressant… dit-il, par exemple les routes sont compliquées !…
« Je me mis à rire, et comme il insistait sur la difficulté qu’il éprouvait à se diriger dans la région, je lui offris de regarder avec moi la carte d’État-Major dont j’avais un exemplaire dans ma vareuse… Ah ! monsieur… comme Alfred jouait bien la comédie ! je ne vous ai pas encore dit qu’il s’appelait Alfred ou, du moins, qu’on le désignait sous ce nom-là ? le seul que j’aie d’ailleurs jamais connu… ah, monsieur !
« Il parut absolument stupéfié à la vue de cette carte, cependant très ordinaire et prétendit me l’acheter à toute force. Moi je ne voulais pas, il m’en proposa cinq francs. Comme je m’étonnais qu’il n’attendît point d’être à Châlons, où il pourrait se procurer la même moyennant vingt sous, Alfred me déclara :
« – Bah ! ça me fait plaisir de vous la payer ce prix-là… c’est une façon de vous remercier de m’avoir prêté votre trousse. Ma foi, monsieur Fandor, j’étais bien trop dans la dèche pour refuser. J’ai accepté donc, en m’excusant : le militaire n’est pas riche…
« Je passe sur les détails… En me reconduisant à la caserne, Alfred, en qui j’avais toute confiance, car il avait vraiment l’air d’un chic type, voulut à toute force me prêter de l’argent. Je lui avais parlé de Nichoune et aussi de mes difficultés. Il me glissa d’autorité un louis dans la main :
« – Quand vous serez redevenu civil, dit-il, vous vous arrangerez bien pour me rembourser, et puis d’ailleurs, je vais vous demander d’ici peu de me rendre quelques services, je vous paierai pour cela… Vous comprenez bien, monsieur Fandor, que je n’avais aucune raison de refuser, surtout qu’il m’offrait cela très gentiment et qu’il tombait à un moment où, je dois le reconnaître, j’aurais fait n’importe quoi.
« Nous nous sommes revus bien des fois depuis lors ; Alfred m’invitait toujours, et souvent avec Nichoune ; jamais il ne voulait me laisser payer ; j’avoue d’ailleurs, que la plupart du temps j’aurais bien été en peine de le faire… Nos rendez-vous avaient toujours lieu hors de la ville où il n’aimait pas rester, parce que, prétendait-il, l’air était mauvais pour ses poumons très délicats. Il s’intéressait à tout, particulièrement à l’aviation et sans cesse il me faisait le piloter dans le camp des aviateurs. – Toi qui dessines bien, me disait-il, fais-moi donc un plan de cet appareil… explique-moi comment sont construits ces baraquements… Il m’interrogeait aussi sur les effectifs des régiments, sur les états qui me passaient par les mains dans les bureaux… Enfin un jour, comme je ne comprenais pas où il voulait en venir, Alfred me cassa le morceau :
« – Vinson, me dit Alfred, j’ai confiance en toi, tu connais aussi ma discrétion, eh bien, j’ai une affaire superbe qui va nous rapporter beaucoup d’argent. Un étranger possède un document très intéressant, que l’on apprécierait beaucoup à l’État-Major du 6e Corps. Il a besoin d’argent et serait disposé à le vendre ; j’ai essayé de le lui acheter, mais je n’avais pas les fonds nécessaires… Je cherchais une combinaison, lorsque cet étranger me demanda de lui procurer quelques photographies des casernes de Châlons, en échange desquelles il me donnerait son document. Il a besoin de ces photographies pour faire des cartes postales. Si nous pouvons les lui fournir dans trois jours, non seulement il nous donnera son papier important, mais encore il paiera chaque épreuve vingt francs pièce…
« Ah ! monsieur Fandor, toute cette histoire-là ne tenait pas debout, mais j’eus la faiblesse d’y croire… ou tout au moins de faire semblant !… d’ailleurs, la proposition d’Alfred venait à pic ; je n’avais plus un sou vaillant. Nichoune faisait un tapage épouvantable et c’est à peine si j’osais sortir dans les rues, tant j’avais de créanciers. Plus tard, j’ai su que c’était là un procédé qu’on emploie pour “amorcer” les indicateurs. On leur fait livrer d’abord des choses insignifiantes qu’on leur paie très cher, ensuite, on les boucle… Les photographies faites, j’ai rejoint Alfred qui m’avait dit d’obtenir à tout hasard une permission de quarante-huit heures. Alfred m’a entraîné à la gare. Il avait deux billets, nous partions pour Nancy où se trouvait, disait-il, l’acheteur. À Nancy, personne.
« Soudain, vers quatre heures de l’après-midi, Alfred me dit : Bah ! n’hésitons plus, si l’étranger n’est pas venu c’est qu’il nous attend ailleurs, je sais où… allons donc le rejoindre… à Metz… À Metz ? mais il faut passer la frontière et je n’ai pas… Alfred m’interrompt. Il ouvre une armoire, en tire des vêtements civils, puis dans un tiroir une fausse barbe.
« Au bout d’une demi-heure, nous nous étions travestis. Une heure après nous débarquions en Lorraine. C’est là que, pour la première fois, j’ai commencé à avoir peur, car il m’a semblé qu’en sortant de la gare de Metz, Alfred venait d’échanger un coup d’oeil avec le gendarme de service. Ah ! monsieur Fandor, comme je l’ai regretté ce voyage. Sitôt en pays étranger, Alfred a changé d’attitude à mon égard. Ce n’était plus un ami, mais un maître que j’avais. Il me tenait, le brigand, et joliment bien !
« – Où allons-nous ? lui ai-je demandé. Alfred ricana : – Parbleu ! tu t’en doutes, qu’il me répond, chez le major Schwartz, dans la Wornerstrasse, au Bureau des Renseignements… – Je n’irai pas ! Alfred me lance un coup d’oeil menaçant. – Tu viendras ! me fit-il à voix basse. Songe donc que si tu refusais, au bout de cinq minutes la police t’aurait démasqué !…
« Il n’y avait rien à faire. Je le connaissais déjà de réputation ce Bureau des Renseignements, Alfred m’en avait parlé. C’était un vaste appartement au premier étage d’une maison bourgeoise, où travaillaient de nombreux employés en civil, mais qui tous ont l’allure militaire. On attend dans une large pièce remplie de dessinateurs, de dactylographes, sur le mur s’étale une carte à grande échelle de la frontière des Vosges. Alfred se fait annoncer. Quelques instants après nous sommes introduits dans un bureau. Un gros homme assis derrière une table encombrée de dossiers nous regarde par-dessus ses lunettes. Chauve, une épaisse barbe blonde taillée en carré. Sans mot dire, il examine les photographies, les jette négligemment sur une étagère et prend dans son tiroir dix louis en monnaie française qu’il me compte… De document en échange… plus question.
« Je croyais que tout était fini et m’apprêtais à sortir de ce lieu abominable, mais le gros homme me mit la main sur le bras – c’était le major Schwartz, en personne, – grand chef de l’espionnage, je l’ai su depuis. Il me dit, s’exprimant en français, très correctement, avec à peine un léger accent : – Caporal Vinson, nous vous avons payé largement des communications qui n’ont aucune valeur, mais il va vous falloir nous servir mieux que cela. D’abord, il savait que j’étais affecté à la Place de Châlons, à toutes les écritures concernant le service de l’aviation. Il voulait obtenir un état complet de l’organisation des dirigeables et des aéroplanes, il fallait lui donner les caractéristiques de tous les appareils, les états de service des officiers qui les montaient… il exigeait des renseignements plus confidentiels encore, l’affectation des aviateurs et des dirigeables en temps de mobilisation, toute la lyre, quoi !…
– Et… vous avez… fourni tout cela ?
– J’ai fourni tout cela !
– C’est tout ?
– Pas encore ! Alfred m’avait raccompagné jusqu’à Nancy où j’avais repris mon uniforme, puis j’ai regagné Châlons tout seul.
« Je me suis demandé s’il me serait possible de me débarrasser de mon triste entourage, mais je n’ai pu y réussir… Alfred, chaque jour, me harcelait, me menaçait, j’ai dû lui obéir, comme je viens de vous le dire ; puis aussitôt après il y a eu l’affaire du capitaine Brocq…
« Alors, sans rien dire à personne j’ai demandé mon changement de garnison par la voie hiérarchique ; j’espérais aller dans l’Ouest ou dans le Midi, surtout quitter le sixième corps, fuir le voisinage de la frontière, achever en un mot mon service dans une région où il me serait impossible de faire du “renseignement”, mais je ne sais comment, est-ce par Nichoune – je le suppose, car je lui avais, par malheur, confié un soir ce secret, – Alfred a appris ma décision… Il s’est mis dans une colère épouvantable, puis soudain il a ri, et il a dit : – Mon vieux Vinson, je m’en vais te faire une bonne blague… Elle était terrible la blague, elle l’est encore, monsieur, écoutez… écoutez ce qui est arrivé : J’ai obtenu mon changement en effet, c’est pour cela que je suis aujourd’hui en permission de huit jours, mais lundi prochain 21 novembre, avant midi je dois être rendu à mon nouveau régiment. Or, ce régiment, c’est le 257e d’infanterie, en garnison à Verdun !… Vous comprenez ?
– Je commence… murmura Fandor.
– À Verdun, reprit le caporal qui, s’étant levé, allait et venait dans la pièce, se comprimant les tempes, en proie à une angoisse inexprimable… à Verdun, c’est-à-dire sur la frontière même, c’est-à-dire au milieu de tous ces gens-là, à leur merci !… Ah ! le coup a été bien combiné, j’ai voulu sortir du guêpier, je suis retombé au milieu de la ruche. Alors, monsieur, pour tout vous dire, je perds la tête, absolument ! je sens qu’ils me tiennent, qu’il m’est impossible de me dégager et en outre, j’ai peur d’être pris… oui ; il s’est passé ces jours derniers des choses, à Châlons, qui me terrifient ; je crois que l’on me soupçonne, que l’on soupçonne Nichoune, que mes chefs m’observent, c’est la fin ! Cela est survenu, brusquement, comme un ouragan, à dater du jour où les journaux ont annoncé l’assassinat du capitaine Brocq ! je suis perdu… perdu… j’ai voulu venir vous exprimer toute ma honte pour que vous puissiez mettre en garde, par un article dans votre journal, les jeunes soldats, qui par amour insensé pour une femme abominable ou par un besoin d’argent seraient disposés un jour à suivre mon triste exemple.
– Vinson, soyez brave, dites tout à vos chefs ?
Le caporal secouait la tête…
– Jamais !… monsieur… jamais je ne pourrai. Songez donc que c’est le pire déshonneur, le pire. Vous parliez de ma mère : c’est pour elle que je veux me tuer. Elle deviendrait folle si jamais elle apprenait que son fils a trahi… Ce soir, le caporal Vinson n’existera plus.
Longuement Fandor chapitra Vinson.
Le journaliste se fit tour à tour éloquent, persuasif… il accumula arguments sur arguments, appela à son secours l’amour-propre, le devoir.
Lorsqu’il vit enfin que l’infortuné caporal hésitait, qu’une lueur d’espoir, qu’un vague désir de réhabilitation renaissaient dans son esprit, il s’arrêta court et brusquement, lui demanda :
– Vinson, êtes-vous toujours disposé à vous tuer ?
Le caporal se recueillit une seconde, ferma les yeux et sans forfanterie, mais d’une voix sûre, répondit :
– Oui, j’y suis décidé !
– Dans ce cas, dit Fandor, considérez, voulez-vous, que c’est chose faite et que vous n’existez plus ?…
Le caporal le regardait interdit, Fandor précisait sa pensée :
– À partir de ce moment vous n’existez plus, vous n’êtes plus rien, vous n’êtes plus le caporal Vinson…
– Et alors ? interrogea celui-ci.
Mais Fandor voulait avant tout une promesse :
– Est-ce entendu ?
– C’est entendu…
– Jurez-le !
– Je le jure…
– Eh bien ! Vinson, conclut Fandor, vous m’appartenez, vous êtes ma chose, je vais vous donner mes instructions, auxquelles vous obéirez strictement…