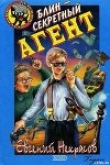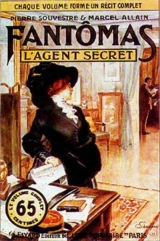
Текст книги "L'agent secret (Секретный агент)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
33 – RÉCONCILIATION
– Que décidez-vous, mademoiselle, préférez-vous les cocardes multicolores ou alors des nœuds de rubans d’une seule teinte ? Nous avons l’un et l’autre au choix en satin de première qualité ?
Comme Wilhelmine de Naarboveck paraissait hésitante, la vendeuse du Paradis des Danses qui, ce soir-là, soumettait à la jeune fille une série d’échantillons, poursuivit :
– Les cocardes aux tons variés font très bien, mais les nœuds de rubans produisent aussi un effet excellent.
– Mettez-en la moitié de chaque…
– Et, quelle quantité ? interrogea la vendeuse.
– Oh ! trois cents suffiront, je suppose.
Devant la jeune fille la vendeuse du Paradis des Danses étalait le reste de son assortiment d’objets de cotillon…
– Nous lançons en ce moment, dit-elle, des bonnets de papier comiques, enveloppés dans des papillotes ; c’est tout à fait nouveau et très amusant… Nous avons aussi des petits sachets de poudre de riz…
Wilhelmine de Naarboveck, que semblaient préoccuper bien d’autres soucis que ceux qui consistaient à choisir des accessoires de cotillon, avec des paroles brèves et des gestes saccadés, acceptait ou refusait les offres de la vendeuse. Celle-ci était de plus en plus stupéfaite.
Elle estimait que si on exécutait à la lettre les ordres de sa cliente, on lui livrerait une série d’objets des plus hétéroclites.
La vendeuse, adroitement, en fit l’observation à Wilhelmine et celle-ci se rendant compte soudain qu’elle avait commandé à tort et à travers, se ravisa, réfléchit un instant, puis, prenant une dernière décision :
– Mon Dieu, madame, déclara-t-elle, vous connaissez le crédit que mon père, le baron de Naarboveck accorde à votre maison pour nous fournir un cotillon complet. Or, vous savez mieux que moi ce qu’il faut. Je m’en remets donc à vous.
La vendeuse décidément, semblait devoir ne jamais en finir, l’interrogea encore :
– Bien entendu, mademoiselle, nous faisons des flots de rubans semblables pour vous et votre conducteur de cotillon ? Toutefois, pourriez-vous me dire si ce monsieur est grand ou petit… car il est préférable de proportionner la longueur des rubans à sa taille ?
Wilhelmine, qui jusqu’alors n’avait prêté qu’une attention médiocre aux propos de la vendeuse, soudain parut troublée.
Hélas ! le conducteur de cotillon, ce devrait être Henri de Loubersac !
Jusqu’à ces derniers jours, la jeune fille avait escompté l’extrême bonheur de pouvoir, au cours de ce bal donné par son père, présenter dans son entourage le brillant officier, comme son futur fiancé.
Mais dans l’intervalle était survenu leur pénible entretien à Saint-Sulpice… et le surlendemain, Henri de Loubersac ne conduirait pas le cotillon avec Wilhelmine de Naarboveck, ainsi qu’il avait été convenu précédemment…
– Ma foi, madame, j’ignore la taille de mon danseur, pour cette bonne raison que je ne le connais pas. Prévoyez donc un flot de rubans qui puisse aller à n’importe qui.
La représentante du Paradis des Danses s’était retirée depuis quelques instants déjà que Wilhelmine de Naarboveck, remontée dans la bibliothèque de l’hôtel, demeurait songeuse.
Wilhelmine qui ne prenait plus désormais qu’un intérêt très relatif à l’organisation de ce bal dont elle avait attendu tant de joies, se disait, en tête à tête avec ses pensées, que rien n’est plus décevant au monde que les préparatifs d’une fête.
L’hôtel de Naarboveck était révolutionné de fond en comble par les décorateurs et les électriciens : toute l’après-midi on avait entendu frapper des coups de marteau. Les meubles, les objets familiers de la maison étalent déplacés, bousculés. On avait démeublé le hall, détruit l’intimité de la bibliothèque pour préparer ce bal du surlendemain, ce maudit bal auquel le baron de Naarboveck avait convié le Tout Paris.
Wilhelmine de Naarboveck s’était tout d’abord vivement intéressée à cette fête.
Le baron la donnait pour consacrer sa situation de diplomate, jusqu’alors en disponibilité, mais qui désormais revêtait un caractère officiel : le baron de Naarboveck venait d’être accrédité en qualité d’ambassadeur.
De Naarboveck voulait profiter de la fête pour annoncer les fiançailles de Wilhelmine avec le lieutenant de Loubersac. Hélas, ce dernier projet…
Wilhelmine réfléchissait, seule dans la bibliothèque, les yeux fixés sur une grande enveloppe scellée de rouge qui contenait les lettres de créance accréditant le baron auprès du Président de la République, lequel devrait, d’ailleurs, être représenté au bal. Ah ! si les espoirs du diplomate se réalisaient, il n’en était pas de même de ceux de la pauvre jeune fille qui voyait un avenir lugubre s’ouvrir devant elle.
Non seulement son cœur avait été déchiré par la brusque rupture avec Henri de Loubersac, mais encore tout semblait craquer autour d’elle. L’intimité familiale dont Naarboveck lui avait un moment donné l’illusion s’évanouissait. Sans doute le diplomate, pour ses affaires, était perpétuellement obligé de sortir et Wilhelmine souffrait de cet abandon. Et Bobinette avait disparu.
Wilhelmine fut soudain arrachée à ses rêveries par l’irruption dans la pièce d’un domestique qui annonça :
– Monsieur de Loubersac demande si Mademoiselle peut le recevoir ?
– Faites entrer.
Quelques secondes après l’officier se présentait devant la jeune fille. Il pénétrait dans la pièce la tête basse, l’air embarrassé :
– Vous ici, monsieur ? interrogea Wilhelmine indignée.
– Pardonnez-moi.
– Que voulez-vous ?
Le jeune officier avait réfléchi. Puis, le cœur torturé, il était allé trouver Juve et très franchement l’avait mis au courant des propos de Wilhelmine.
Le policier n’était pas sceptique comme le militaire et ne parut point étonné lorsque celui-ci lui déclara que celle que l’on considérait comme la fille du baron de Naarboveck se nommait en réalité Thérèse Auvernois.
Cela coïncidait, en effet, avec les pronostics de Juve ; cela expliquait au policier pourquoi la jeune fille allait si régulièrement prier sur la tombe de lady Beltham, car Juve imaginait combien Thérèse Auvernois devait avoir de reconnaissance pour la grande dame anglaise qui l’avait recueillie et élevée.
Cela complétait également les prévisions de Juve et si l’inspecteur de la Sûreté ne l’avouait pas au lieutenant de Loubersac, il ne pouvait s’empêcher de faire dans son esprit un rapprochement entre ce baron de Naarboveck à la personnalité somme toute étrange et l’être redoutable, terrifiant à la poursuite duquel Juve s’acharnait depuis de longues années : Fantômas.
Avant son voyage à Londres, Juve n’avait pas craint d’accuser Wilhelmine d’avoir été la maîtresse du capitaine Brocq. Il agissait ainsi dans le but de provoquer une explication, dont il espérait tirer quelque lumière, entre la jeune fille et son futur fiancé. L’explication était survenue. Dès lors, Juve, renseigné et auquel répugnait son odieuse et indigne calomnie, s’empressa de rassurer le lieutenant de Loubersac. Lorsque celui-ci vint l’interroger, il eut plaisir à lui garantir que Thérèse Auvernois était assurément la plus honnête fille du monde.
L’officier avait été assez surpris du brusque changement d’opinion de Juve, mais le policier avait enveloppé cette volte-face de tant d’arguments probants que l’amoureux, qui ne demandait qu’à avoir confiance, fut vite convaincu.
Toutefois il lui restait à se réhabiliter auprès de celle dont il voulait plus que jamais désormais faire sa femme, et c’est pour cela, qu’Henri de Loubersac avait sollicité une entrevue avec Mlle de Naarboveck. Les circonstances le servaient. Il arrivait à un moment où la jeune fille était seule, en proie aux plus sombres pensées, prête à défaillir de tristesse. Henri de Loubersac, embarrassé devant elle, sollicitait encore son pardon.
– Ah ! que je regrette, murmura-t-il, les propos brutaux et blessants que je vous ai tenus, Wilhelmine !
La jeune fille, qui rougissait encore d’indignation à l’idée du soupçon dont elle avait été l’objet, ne cacha point sa colère, et sur un ton glacial répondit :
– Il se peut, monsieur, que je vous pardonne, mais c’est tout ce qu’il faut espérer…
– Ne pourrez-vous donc plus m’aimer jamais ? supplia Henri de Loubersac.
– Non, fit durement Wilhelmine.
– D’ici peu, dit Loubersac, je quitterai Paris : j’ai demandé mon changement et l’on me fait prévoir au ministère que je vais être envoyé en Afrique, aux avant-postes du Maroc. J’emporterai avec moi, Wilhelmine, le souvenir adoré de votre chère image, et le conserverai vivant dans mon cœur jusqu’au jour où le ciel me fera tomber en brave à la tête de mes troupes…
L’officier, en achevant ces paroles, traversait lentement la bibliothèque et gagnait la porte, accablé.
Mais, comme il allait partir, un appel étouffé s’échappa des lèvres de Wilhelmine :
– Henri.
– Wilhelmine.
Ils tombèrent dans les bras l’un de l’autre.
***
Réconciliés pour toujours, les deux jeunes gens faisaient les plus tendres et les plus séduisants projets d’avenir. Il était déjà une heure fort avancée de la nuit et les bruits familiers de l’hôtel s’étaient atténués.
Wilhelmine interrompit soudain la conversation :
– Henri, observa-t-elle sur un ton de reproche, savez-vous qu’il est minuit passé ?
– Il me semble que je viens d’arriver.
– Vous allez compromettre votre fiancée, cher lieutenant… Imagine-t-on de rester aussi tard chez elle ?
– D’autant qu’elle est toute seule !
– C’est vrai, le baron de Naarboveck n’est pas encore rentré…
– Sauvez-vous, sauvez-vous.
– Wilhelmine.
– Henri.
Un long baiser les unit.
34 – UN TOUR DE FANTÔMAS
Fandor songea :
– Soit, je suis pris et je suis condamné à mort. Puisqu’il faut mourir, sachons au moins mourir courageusement.
L’espace d’une seconde il revécut encore les heures de joie, de lutte, d’énergie qu’il avait connues.
Il se rappela son enfance, les sombres mystères de sa vie tout entière dominée par l’ombre de Fantômas. Il se souvint, avec une intensité plus grande encore que dans son cachot du Cherche-Midi, des incidents de son existence, parce qu’il se souvenait avec cette clarté d’esprit, cette étrange acuité que prend la pensée des mourants…
– C’est logique, déclara-t-il froidement, j’ai lutté contre Fantômas, je suis parfois arrivé à mettre ce bandit en échec, il fallait bien qu’un beau jour il prît sa revanche. C’est lui, je n’en doute pas, qui me tient à merci en ce moment… j’ai perdu la partie, je paie, je n’ai pas à me plaindre…
Le journaliste ne voulait pas se rebeller contre le sort cruel. Ce n’était pas fanfaronnade de sa part, il lui plaisait d’accepter la mort comme un simple incident de lutte, comme une conséquence naturelle de la vie qu’il s’était faite, volontairement, en engageant la bataille contre Fantômas…
Et c’était avec un sentiment de résignation impassible, presque curieuse, que Fandor attendait…
Il attendait la mort ; il attendait ce qui devait arriver fatalement, férocement. Il comptait les secondes ; il écoutait le silence lugubre de l’atelier ; il se disait :
– Pourquoi n’est-il pas là ? est-ce qu’il espère que je vais avoir peur ? que je vais crier ? que je vais me débattre ? ou bien a-t-il inventé un long supplice et dois-je agoniser seul ici, dans quelque torture que je n’imagine pas encore ?
Soudain, sans bruit, dans un glissement qu’amortissait l’épaisseur des tentures que feutraient les tapis, la porte de l’atelier s’ouvrit : des hommes entraient, une vingtaine, solennels, graves, mystérieux…
Ils étaient tous entièrement vêtus de noir. Sur leurs visages, un masque de velours, sorte de loup, était étroitement maintenu, qui empêchait de façon absolue d’apercevoir leurs traits.
Fandor regarda fixement ces inconnus… eux détournaient les yeux, semblaient ne point vouloir le considérer…
Sans un mot, sans un geste, ils gagnèrent le centre de l’atelier puis, en demi-cercle, ils se rangèrent face à Fandor.
L’un d’eux, visiblement un chef, demeurait à l’écart, les bras croisés, tête haute, considérant le journaliste.
Et dans le silence impressionnant de la pièce, l’homme prit enfin la parole et, s’adressant à ses compagnons :
– Frères, dit-il, vous avez juré de défendre par tous les moyens la cause de la Russie. Le jurez-vous encore ?
– Nous le jurons !
D’une seule voix vibrante, convaincue, mystique, les masques énigmatiques avaient répondu.
– Frères, je suis allé vers vous, de ma retraite, parce que les nôtres m’ont dit : « Leurs bras ne tremblent point. leur volonté est droite, leur cœur est pur… » Frères, je suis allé vers vous parce qu’en assurant de vous gouverner et de vous diriger, j’avais conscience que j’allais commander à des braves et à des vaillants. Frères, vous êtes prêts à tout pour notre cause ?
– Nous sommes prêts !
L’homme qui venait de se poser ainsi en chef abandonnait alors son attitude nonchalante et, venant au-devant des conjurés qui baissaient toujours la tête, comme obéissant à une consigne donnée, il les apostrophait :
– Il est un homme dans Paris qui nous a fait plus de mal, à nous autres, tchékistes, que toutes les polices du monde ! Un homme qui a soulevé contre tous l’horreur des peuples, le mépris de l’opinion, en accumulant les crimes les plus hideux, en en rejetant la responsabilité sur nous ; cet homme, moi, Trokoff, j’ai promis de vous le livrer pour que vous en tiriez vengeance… regardez, frères, il est devant vous. Je vous le livre…
En s’entendant désigner sous le nom de Fantômas, en s’entendant menacer par les tchékistes, Fandor, une seconde, avait eu envie de crier de toutes ses forces :
– Je ne suis pas Fantômas ! et votre Trokoff est un traître !… Fantômas, c’est lui. La ruse est cousue de fil blanc.
Mais pouvait-il désarmer l’aveuglement farouche de ces hommes ?
L’essayer, c’était folie ! C’était crier miséricorde ! C’était s’abaisser à une supplication…
Et le journaliste, dans un sursaut d’énergie, décida :
– Je montrerai à Fantômas que Jérôme Fandor sait mourir comme il le saurait lui-même. Il ne faut point que moi, le pourchasseur de ce monstre, je lui donne le droit de me mépriser…
Les Russes, cependant de plus en plus passionnés, de plus en plus furieux, voulaient tirer une vengeance immédiate de celui qu’ils prenaient pour Fantômas.
L’un d’eux s’approcha du journaliste et, le défiant :
– Fantômas, tu as entendu ? tu as entendu que tu allais mourir ? Qu’as-tu à dire pour ta défense ?
Obstiné, Fandor ne répondit point.
– Fantômas, tu ne veux point parler ? tu prétends mourir anonyme, inconnu ? À ton gré !… Mais il est bon que nous ayons vu ton visage, que nous t’ayons connu vivant, pour être plus tranquilles quand nous t’aurons vu mort… Ta cagoule ? je t’en dépouille !…
Le Russe déjà levait le bras et s’apprêtait à arracher l’étoffe qui dissimulait les traits de Fandor, lorsque Trokoff s’élançait :
– Ne le touche pas ! dit-il ; ce misérable m’appartient ! N’insulte pas, frère, celui qui est et qui ne va plus être ! Nous sommes des juges, non des bourreaux…
Et, se tournant vers les conjurés, élevant la voix, Trokoff demandait :
– Avez-vous confiance en moi ?… Voulez-vous m’abandonner cet homme ? C’est de ma main qu’il doit recevoir le coup fatal. C’est de ma main qu’il doit périr : j’ai droit plus que vous sur sa vie : c’est moi qui l’ai attiré ici, qui vous ai mis en face de lui…
– Frère, nous sommes tes fidèles et ce que tu ordonneras, nous le ferons, s’écrièrent les tchékistes.
Trokoff se tourna vers Fandor et, le poing tendu :
– Réveille-toi, Fantômas, recueille-toi, tu vas expier bientôt…
Et, cette menace proférée, le chef conspirateur, d’un geste, entraîna ses séides et disparut avec eux…
– Trokoff va revenir, pensa Fandor. Allons. C’en est fait. Il a raison, je n’ai plus qu’à me recueillir, qu’à être brave !…
Mais, à peine le Russe eut-il refermé sur lui la porte de l’atelier que, soudain, à l’oreille de Fandor, une voix murmurait, haletante :
– Vite, vite, Fandor. Trokoff, vous l’avez deviné, c’est Vagualame ! c’est Fantômas… Coûte que coûte, il faut que nous nous en rendions maître !…
Le journaliste ne pouvait tourner la tête, mais il sentait qu’on coupait ses liens… quelques instants encore et il était libre. À côté de lui, surveillant ses premiers gestes avec une expression d’ardente sympathie, le journaliste aperçut alors,.. Naarboveck…
– Vous !
– Moi !… Fandor, je vous expliquerai… Tenez ! voilà un revolver !… Ah ! les bandits, eux aussi m’avaient pris, moi aussi ils m’ont condamné à mort, mais j’ai pu m’échapper… Tenez, il revient. Sus à Trokoff… vengeons-nous !…
On entendait, en effet, dans l’escalier, un pas lourd qui montait précipitamment. Trokoff allait réapparaître…
Affolé, encore sous le coup d’une abominable émotion, Fandor, serrant machinalement dans sa main le revolver que Naarboveck venait de lui passer, bondissait vers la porte de l’atelier, prêt à sauter sur l’homme qui, s’imaginant trouver un prisonnier ligoté, pénétrait dans la pièce, à coup sûr sans aucune méfiance…
Et Fandor soudain avait ce cri, à l’adresse de Naarboveck, qui, lui aussi, s’était embusqué de l’autre côté de la porte :
– Ne le tuez pas, si c’est Fantômas, c’est vivant qu’il faut avoir Fantômas !…
Mais Naarboveck n’eut point le temps de répondre…
La porte de l’atelier s’ouvrait, elle se rabattait sur le diplomate qui se trouvait ainsi, un instant, empêché de prendre part à la lutte…
Fandor, lui, s’élança, il saisit Trokoff à la gorge et roulant avec lui sur le sol, hurla :
– À moi, Naarboveck ! Fantômas ! Fantômas ! tu es pris ! Rends-toi…
L’étreinte de Fandor avait été si soudaine, si brusque, si inopinée, que Trokoff n’avait pu se défendre… Fandor et lui se débattaient, groupe terrible où les doigts s’entremêlaient, où les membres se nouaient, s’accrochaient.
Et déjà Naarboveck s’élançait, il empoignait Trokoff, hurlait :
– Tu vas mourir ! tu vas mourir !…
Toute cette lutte, cependant, ne durait que quelques secondes… Comme Fandor, ayant réussi à saisir les bras de Trokoff, pensait immobiliser le bandit, celui-ci parvint à se dégager, et le journaliste, stupéfait, entendit une voix familière qui criait :
– Sapristi ! fais donc attention, Fandor ! C’est Naarboveck qu’il faut prendre, hardi !…
Et puis soudain, l’atelier se retrouva plongé dans l’obscurité, une porte claquait, et Fandor ayant la sensation, cependant qu’il trébuchait, violemment repoussé par il ne savait qui au centre de l’atelier, qu’un homme s’enfuyait, hurlait :
– Il s’échappe ! il s’échappe !…
À ce moment, Fandor ne savait plus où il en était, ce qu’il disait, qui restait avec lui, qui venait de fuir…
Mais son ahurissement ne dura qu’une seconde, car la voix qu’il avait entendue au plus fort de la lutte, cette voix qui l’avait nommé, parlait encore, très calme, railleuse…
C’était la voix de Juve !… Elle disait :
– C’est embêtant ! les allumettes de la régie ne valent rien du tout !… Ah ! en voilà une qui se décide à prendre…
Et, à la vague clarté de l’allumette, Fandor, qui s’appuyait à la muraille, aperçut Trokoff, qui, tranquillement, s’approchait d’un meuble, y prenait un candélabre, allumait une bougie, puis se jetait dans un fauteuil en demandant :
– Mais enfin, pourquoi diable, Fandor, t’es-tu costumé en Fantômas ?… Pour un prisonnier militaire, ça n’est pas du tout convenable !…
Trokoff, qu’il avait pris pour Vagualame, pour Fantômas, qui tout à l’heure encore le menaçait de mort, c’était Juve ?
Fandor eut l’air si stupéfait, si ahuri, que Juve-Trokoff, le considérant toujours, reprit en souriant :
– Voyons, mon petit Fandor, tâche donc de rappeler un peu tes esprits et de me répondre clairement… veux-tu ?…
Mais le journaliste haletait :
– Vous ! Juve ! vous êtes Juve !…
Le policier haussait les épaules :
– Il y a des chances ! faisait-il… Enfin ! je vois qu’il faut que je parle le premier, parce que tu ne me semblés pas du tout en état de discourir, toi !… Bon ! écoute : je connais les Russes. Eux s’imaginent que je suis un de leur chef, Trokoff… Chef de conspirateurs, voilà en effet, ma dernière transformation !… Donc, j’ai appris ce soir, que ces imbéciles croyaient tenir Fantômas, ils étaient convoqués ici pour juger ce bandit… je les ai accompagnés en leur disant que c’était moi, Trokoff, qui les avais appelés. Tu saisis ?… Maintenant, reporte-toi au moment où tu nous as vu entrer… Sais-tu qu’attaché à ton poteau tu faisais une épatante figure de Fantômas ? une si épatante figure de Fantômas, que pendant quelques instants, moi, Juve, je me suis presque demandé si ce n’était pas véritablement le vrai Fantômas qui était en face de moi… Par bonheur, j’ai vu tes mains. On ne voyait que cela de toi, grâce à cette cagoule dont on t’avait affublé, et tu n’ignores pas que le dessin des veines sur les mains est absolument caractéristique pour chaque individu, au point qu’à Vienne, le service de l’anthropométrie est entièrement fondé sur ce principe !… Je me suis dit : « Ce Fantômas, c’est mon petit Fandor. » Je n’ai plus eu qu’une idée : faire filer mes Russes. Seulement, quand je suis revenu, vous m’avez sauté dessus, j’ai bien cru y passer… Bon Dieu ! si jamais tu avais tiré un coup de revolver, tu risquais fort de me tuer, moi, Juve, et, après cela, de tomber, toi, Fandor, victime de…
– De Naarboveck… de Naarboveck, qui est Fantômas.
– Tu l’as dit, Fandor, et ce n’est pas malheureux. Vagualame, Naarboveck et Fantômas ne font qu’un. Et une fois de plus, le Maître du Crime ne joue pas sous son vrai visage, que personne ne connaît d’ailleurs.
Mais Fandor soudain se dressa :
– Juve… Juve… nous sommes fous de rester ainsi à discuter. Naarboveck vient de disparaître, il ne peut être loin… Fantômas, à coup sûr, doit passer chez lui, même si, se sentant démasqué, il a décidé de disparaître à tout jamais. Ne le laissons pas échapper ! Juve, pour Dieu, dépêchons-nous…
Mais le policier ne bougea point de son fauteuil…
– Comme tu viens d’éprouver des émotions violentes, je veux bien te pardonner ta naïveté ; Fandor, voyons, il y a déjà trois minutes que Naarboveck s’est enfui, et tu t’imagines qu’il est encore temps de le rattraper ? C’est enfantin !
– Mais, je vous le dis, Naarboveck, forcément, va revenir chez lui. Allons le guetter, établissons une souricière…
– Nous ne pouvons pas arrêter Naarboveck…
– Pourquoi ? Que voulez-vous dire ?
– Fandor, tu ignores encore la dernière ruse de ce misérable. J’ai le droit de mettre la main au collet de Fantômas et, je te le répète, je ne puis appréhender Naarboveck !…
Et, comme Fandor regardait le policier avec des yeux stupides d’émotion, égarés, Juve poursuivait :
– Sans doute, il te semble que je te parle chinois, en ce moment ?… Bien !… Fais-moi confiance, Fandor, je n’ai pas encore le droit de te révéler ce secret, mais n’en doute point, hélas. Naarboveck est inviolable…
– Mon Dieu !
– Bah ! ne t’inquiète pas, Fandor, la partie n’est pas perdue ! j’ai encore une carte à retourner, et je la retournerai cette nuit… donc… laissons cela… songe plutôt que j’ai grande hâte de savoir comment toi, que je croyais tranquillement au Cherche-Midi, tu en es arrivé à jouer les Fantômas dans les ateliers déserts ?…
Fandor raconta donc à Juve l’extraordinaire façon dont il était sorti de la prison militaire :
– Maintenant, qu’allons-nous faire ?
– Attention, Fandor, ne mêlons point les questions ; tu devrais dire : « Que vais-je faire ? Qu’allez-vous faire ? » Toi, Fandor, si tu m’en crois, et tu m’en croiras, tu vas très sagement retourner au Cherche-Midi et demander que l’on te coffre à nouveau… T’être échappé, c’est une faute grave… S’évader, c’est plaider coupable ; or, tu es innocent… donc retourne à ta geôle… Je te promets que tu n’y resteras pas longtemps…
– Et vous, Juve ? que projetez-vous ?
– Oh ! moi, c’est très ennuyeux, dit-il ; il faut que je me mette en habit… je n’aime pas cela… Et puis il faut que je prenne le train, Fandor… oui, ne me regarde pas avec ces yeux ronds… Je vais prendre le train en habit…
***
Mince, élégant, Juve écoutait dans le cabinet de travail somptueux les observations d’un personnage qui lui parlait sur un ton à la fois amical et hautain :
– Non, ce n’est pas possible, vous m’en demandez trop… vous ne vous rendez point compte, Juve, des complications de toutes sortes qu’une intervention de ma part pourrait soulever si, par hasard, vous faisiez erreur…
Le policier gardait son attitude impassible. Une ride lui barrait le front d’un pli obstiné.
– Je ferai respectueusement observer à Votre Majesté qu’il s’agit tout juste d’une signature à donner…
– Mais, Juve, encore une fois, c’est une signature qui peut mettre le feu aux poudres…
– Votre Majesté voudra bien considérer que d’une signature Elle peut tout arranger…
– Juve, vous n’y pensez pas. Pour la centième fois, je vous le répète, je ne puis vous donner ce décret… Le cas est exceptionnel, je suis persuadé que, même en remontant dans les plus lointaines annales, vous ne pourriez me citer un précédent…
– Votre Majesté n’oubliera pas qu’avec son nom, une ligne de son écriture, Elle peut aplanir toutes les difficultés…
C’était, avec d’autres termes, la même phrase que Juve s’obstinait à répondre !
Le roi qu’il entretenait, qu’il sollicitait ainsi avec une passion étrange, se rendait compte de l’entêtement du policier :
– Ah çà ! Juve, dit-il, avez-vous seulement pesé la valeur du décret que vous me demandez ? Savez-vous que, s’il est immérité, ce document fera la honte de mon pays ?
– Sire, je sais que je ne demande rien à Votre Majesté qu’Elle ne puisse m’accorder, qu’Elle ne doive m’accorder… Sire, j’ai jusqu’ici sollicité, que Votre Majesté m’excuse, ce n’est plus le solliciteur qu’Elle a maintenant devant Elle… Votre Majesté me comprend sans doute ? C’est Juve qui demande à Votre Majesté sa signature…
– Je vous comprends, Juve. Jadis, lors de mon voyage officiel à Paris, vous m’avez sauvé la vie, vous avez sauvé la vie à la reine… au péril de votre propre existence, et je vous ai dit, alors, que je n’aurais rien à vous refuser, que je ne vous refuserais rien, jamais… c’est à cela que vous faites allusion ?…
– Sire, je réponds à Votre Majesté que je n’invoquerai point la dette qu’il lui plaisait de reconnaître… Votre Majesté me force à lui rappeler sa parole…
Le roi, qui maintenant se promenait de long en large dans son cabinet de travail, se laissa tomber dans un fauteuil :
– Si je vous donnais ce décret, Juve, demandait-il, vous iriez aujourd’hui même, sitôt rentré en France, sitôt revenu à Paris, le porter à la Chancellerie ?
– Oui, Sire…
– Vous êtes franc, Juve ! vous n’attendriez pas d’avoir d’autres preuves de ce que vous avancez ?
– Non, Sire.
– Il faut donc, Juve, que je m’en rapporte entièrement à votre parole, à votre certitude, à votre conviction ?
– Oui, Sire…
– Juve ! Juve ! si vous l’exigez, au nom de la promesse que je vous fis jadis, je vous signerai ce décret, mais vous perdrez mon amitié, vous aurez surpris ma bonne foi… Décidez. Vous êtes le maître, Juve. Exigez ce décret, je vous le donne !
– Votre Majesté ne pense point ce qu’Elle dit, répondait Juve. Votre Majesté ne voudra point m’acculer à ce dilemme : perdre son amitié, perdre sa confiance, ou laisser échapper l’unique occasion…
– Si, Juve ! je veux vous acculer…
– Alors, Sire, je n’exige pas. Mais c’est ma vie que Votre Majesté brise, Sire, car mon honneur à moi veut que j’en finisse, coûte que coûte. Avec l’appui de Votre Majesté, c’est possible. Livré à mes ressources, tout est perdu !…
– Juve, vous êtes cruel. Ah ! j’aurais presque mieux aimé que vous exigiez ce décret !… Mais, pour Dieu, tout n’est pas fini. Attendez, je vais ordonner une enquête ! Dans quinze jours…
– Dans quinze jours, Votre Majesté sait bien qu’il sera trop tard…
– Juve, pouvez-vous me mettre en face de cet homme ? Pouvez-vous le convaincre d’imposture devant moi ?
– Que veut dire Votre Majesté ?
– Je veux dire, Juve, que, quel que soit le scandale, quelle que soit l’humiliation qui peut en résulter pour moi, je vous donnerais séance tenante le décret que vous me réclamez si j’étais assuré que vous ne faites point erreur… Vous m’apportez des présomptions, vous ne me fournissez point de preuves… Obtenez que cet homme jette, fût-ce une seconde, le masque, et je laisserai votre justice suivre son cours, Juve, oubliez que vous parlez à un roi. Imaginez que je suis votre ami. Pouvez-vous, quels que soient les risques à courir, nous mettre face à face dans de telles conditions que la vérité réapparaisse ?…
Juve soudain baissait la tête, réfléchissait :
– Je vais demander à Votre Majesté, fit-il lentement, une démarche extraordinaire… je vais lui demander de risquer sa vie peut-être, je vais demander à Votre Majesté…
L’émotion de Juve était telle que, obligé de s’asseoir, en dépit de toutes les conventions protocolaires, c’était à voix basse qu’il poursuivit :
– Je vais demander à Votre Majesté de m’accompagner dans trois jours, lorsque…