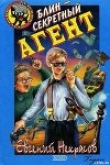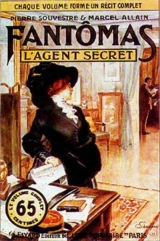
Текст книги "L'agent secret (Секретный агент)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
– Volé ! répéta-t-il, volé, mais par qui ? Où ? Comment ? dans le trajet de la place de l’Étoile, ici ? pendant qu’on amenait le mort au commissariat ?… Juve, c’est invraisemblable…
Le policier, se promenait toujours dans le cabinet du commissaire de police, le front soucieux, la mine inquiète :
– Je n’aime pas ces histoires-là, déclara-t-il, toutes les affaires où sont mêlées des officiers et surtout des officiers du Deuxième Bureau, sont terriblement délicates… On ne sait jamais où elles peuvent vous conduire… ces officiers-là, voyez-vous, monsieur le commissaire, ce sont, en vérité, de par leurs fonctions, les maîtres de toute la défense militaire de la France… et dame !…
Juve s’interrompit brusquement, puis questionna :
– Dites-moi, je pourrais voir le corps de ce pauvre homme ?
– Certes… mais que voulez-vous chercher ?
Le commissaire de police guida Juve vers une des salles du commissariat où le cadavre du capitaine Brocq gisait étendu sur le sol. Des mains pieuses avaient allumé une bougie et, étant donné la qualité du disparu, deux gardiens de la paix veillaient, attendant que l’on vînt réclamer le défunt…
– Vous me disiez tout à l’heure que le professeur Barrel, de l’Académie de Médecine, s’était trouvé par hasard présent au moment du décès ?… demanda Juve.
– En effet…
– À quelle cause attribue-t-il la mort ?
– Tiens, c’est vrai, je n’y pensais plus, vous allez peut-être me renseigner, mon cher Juve. Le professeur prétend que la mort est due à un phénomène d’inhibition… qu’est-ce que cela signifie inhibition ?
– Inhibition… dit-il, peuh !… c’est un mot savant, un mot très savant…
– Qui veut dire ?
– Qui ne veut rien dire… Parfaitement ! ça ne veut rien dire, dit-il… inhibition, c’est l’étiquette dont on catalogue toutes les morts que l’on ne peut pas expliquer… Rigoureusement, cela se traduirait : « mort de peur »… mort de peur ?… pourquoi ? comment ?… quelqu’un qui meurt de peur succombe généralement à une faiblesse du cœur et dans ce cas la médecine dit : mort survenue à la suite de tel phénomène… mais inhibition ! inhibition ! c’est le terme que l’on réserve à toutes les morts inexpliquées, inexplicables… c’est le terme dont la science se couvre quand elle ne veut pas avouer son ignorance…
– De sorte, Juve, que vous concluez que M. le professeur Barrel a déclaré que cet officier était mort par inhibition, parce qu’en fait il ignorait de quoi il était mort ?
– Exactement…
Juve s’était agenouillé sur le sol et penché sur le cadavre, il l’examinait.
– Que cherchez-vous donc, Juve ?
– La cause de cette inhibition…
– Vous ne trouvez rien ?
Juve soudain se releva, et, se tournant vers les agents commanda :
– Déshabillez-moi ce mort !
– Pour quoi faire ?
– C’est utile pour votre rapport.
– Allons donc ! en quoi ?
– Pour ça, fit-il, désignant du doigt la jaquette de l’officier…
– Ça ? quoi ça ?… Je ne vois rien !
– Vous ne voyez rien, déclara-t-il, parce que vous regardez mal… tenez, monsieur le commissaire, penchez-vous et considérez de près cette petite éraflure du drap…
– Oui, eh bien ?
– Eh bien, cela ne vous dit rien ?
– Non, ma foi !
– Déshabillez-moi ce cadavre !
Puis, se tournant vers le commissaire, il ajouta :
– Cela me dit, à moi, que cet homme a été tué d’un coup de fusil ou d’un coup de revolver !…
– Allons donc !
– Vous allez voir…
– Le vêtement n’est pas troué…
Juve se prit à sourire :
– Monsieur le commissaire, dit-il, vous ne devriez pas ignorer que les armes à grande pénétration, tirant des projectiles de faible diamètre, des projectiles rayés, occasionnent, dans les étoffes que leurs balles traversent, des dégâts presque imperceptibles. Maintes expériences l’ont montré : un vêtement de drap peut être, dans certaines conditions, traversé par trois ou quatre balles d’un diamètre inférieur à six millimètres sans que cependant il semble seulement avoir été effleuré… le passage du projectile, voyez-vous, est si rapide, son mouvement giratoire si accéléré, que les fils du tissu sont en quelque sorte, non pas rompus, mais écartés… ils se resserrent après le passage de la balle et l’on peut parfaitement ignorer, à moins d’un examen très attentif, comme celui auquel je viens de me livrer, qu’un projectile les a troués… d’ailleurs…
Juve, du doigt, montra au commissaire de police les deux agents occupés à dévêtir le cadavre.
À peine eurent-ils entrebâillé le gilet de l’officier, que la chemise du malheureux était apparue à l’endroit du cœur, tachée de sang.
Juve s’étant rapproché, continua ses explications :
– C’est bien ce que je disais, une balle de petit diamètre, animée d’une formidable puissance de pénétration a causé la mort immédiate en produisant une blessure qui n’a presque pas saigné, tant la plaie a été faite de façon nette et précise…
Juve à nouveau se penchait sur le cadavre :
– Voyez, répétait-il, cet officier est bien mort d’une balle, d’une balle en plein cœur.
Le commissaire de police cette fois protesta :
– Mais c’est épouvantable et c’est inadmissible ce que vous nous racontez là, Juve ! comment cet homme aurait-il pu se suicider sans que personne s’en soit aperçu ? sans que personne ait retrouvé son revolver ? et cela au moment même où il se penchait par la portière pour donner des indications à son chauffeur !
Juve ne semblait point disposé à répondre…
Après quelques minutes de silence, toutefois, il prit familièrement le bras du commissaire de police, et l’entraînant :
– Voulez-vous que nous revenions dans votre cabinet, demanda-t-il, j’ai deux mots à vous dire ?…
Et quand le magistrat et l’inspecteur de la Sûreté eurent pénétré dans la pièce, quand ils furent seuls, quand le policier se fut assuré que la double porte à tambour était bien fermée et que nul ne pouvait les entendre, Juve, les deux mains appuyées sur le bureau, regardant bien en face le commissaire de police, qui, assis dans son fauteuil, attendait qu’il prît la parole, commença :
– Monsieur le commissaire, nous sommes bien d’accord, n’est-ce pas, sur les conditions de l’accident ?… cet officier est mort d’une balle au cœur, alors qu’il passait en voiture place de l’Étoile, et au moment précis où il se penchait par la portière, cela, sans que personne ait rien vu, ou entendu ?
– Oui, Juve, c’est bien cela… ce suicide est incompréhensible !
– Ce n’est pas un suicide, monsieur le commissaire…
– Qu’est-ce donc ?
– Un crime !
– Un crime ? mais vous êtes fou !
– Cet homme a été tué d’un coup de fusil tiré de loin… d’un coup de fusil, car un revolver n’aurait certainement point permis de viser avec une aussi grande précision… d’un coup de fusil tiré de loin, car nul n’a vu le geste de l’assassin et pourtant la place de l’Étoile était encombrée de monde… d’un coup de fusil tiré de loin encore, parce que, monsieur le commissaire, il y a quelque chose que vous oubliez, et qui cependant a son importance… Ce mort est un officier, un officier attaché au Deuxième Bureau, un officier qui était porteur au moment de son décès, de pièces importantes dont une fait défaut. Il y a eu crime, et le motif est évident.
Atterré, le commissaire de police considéra Juve, en articulant non sans peine :
– Mais c’est impossible, absolument impossible, je vous le répète, Juve, ce que vous inventez là. Vous oubliez qu’un coup de fusil, le coup de fusil d’une arme assez puissante, cela fait du bruit… que diable, on entend la détonation…
– Non, monsieur le commissaire ! il y a maintenant des armes parfaitement silencieuses, des fusils à l’acide carbonique liquéfié, par exemple, qui envoient à plus de huit cents mètres un projectile, sans que l’on entende autre chose qu’un claquement sec au moment du départ de ce projectile…
– Mais enfin, Juve un crime pareil, cela tient du roman, il faut que le criminel tire au milieu de la foule… qui voulez-vous qui ait cette audace ?
– Vous me demandez quel criminel peut avoir osé cela ? quel criminel peut avoir réussi ce meurtre ? Monsieur le commissaire, je n’en connais qu’un…
– Et c’est ?
– C’est… c’est…
Mais Juve, soudain se tut, comme effrayé. Parbleu, dit-il, si je savais le nom du coupable, j’irais l’arrêter…
***
Bobinette, cependant, continuait sa promenade.
– Vous m’arrêterez, commanda-t-elle au conducteur, presque à l’allée cavalière qui passe derrière le Pavillon Chinois…
Arrivée là, elle descendit, paya, s’engagea dans le petit sentier qui court le long de l’allée cavalière. Bientôt Bobinette ralentit sa marche. Un banc inoccupé se trouvait sur le côté de l’allée, elle vérifia l’heure à sa montre, s’assit.
– Nous sommes exacts tous les deux, murmura-t-elle en reconnaissant un promeneur encore éloigné…
Alors, Bobinette, de son manchon tira un petit rouleau de papier…
C’était un minable individu qui s’avançait vers la jeune femme, tout courbé sous le poids d’un accordéon volumineux. Il pouvait avoir une soixantaine d’années, mais en raison de la longue barbe blanche, jamais taillée, fort mal soignée, qui lui dissimulait à moitié le bas de la figure, tandis que sa moustache très fournie et sa longue chevelure coiffée à l’artiste en voilaient le haut, il paraissait beaucoup plus âgé. Un mendiant ? non pas. Nul ne sachant son nom véritable, on l’appelait « Vagualame », tant sa musique inspirait de mélancolie.
Le vieillard avait, lui aussi, aperçu Bobinette.
Vers la jeune femme il s’avançait aussi vite que le lui permettaient ses jambes et dès qu’il fut assez près d’elle pour pouvoir lui parler sans hausser la voix, il interrogea :
– Eh bien ?
– Eh bien ? répéta-t-il anxieux.
– C’est fait dit Bobinette.
Et tendant au mendiant le rouleau de papier qu’elle considérait quelques minutes auparavant, elle ajoutait :
– Voilà ! Je n’ai pu l’avoir qu’à la dernière minute, mais enfin je l’ai et j’imagine qu’il ne se doute de rien…
Aux derniers mots de Bobinette, l’homme eut un ricanement :
– Tu crois cela ?… Il est certain que maintenant il ne se doute plus de rien !…
La façon dont le vieillard avait articulé le mot « maintenant » intriguait la jeune femme.
– Que voulez-vous dire ?
– Le capitaine Brocq est mort.
– Mort !
Bien qu’elle n’aimât guère son amant, Bobinette avait bondi.
– Oui, mort, dit l’homme, froidement. Et d’abord fais-moi le plaisir de t’asseoir. Sapristi, joue ton rôle, tu es en ce moment une jeune femme qui parle à un vieux mendiant. N’oublie pas cela !…
Bobinette, machinalement se rassit.
– Mort ? Que s’est-il donc passé ?
– II s’est passé que tu n’es qu’une sotte. Brocq a parfaitement vu que tu lui as volé le document…
– Il a…
– Oui, il l’a vu… je me méfiais de la chose, heureusement !… Donc ce maudit capitaine s’est jeté dans un taxi et t’a suivie… au moment où ta propre voiture tournait sur la place de l’Étoile, la sienne allait te rejoindre… déjà Brocq te hélait, sans moi, tu étais bel et bien pincée…
– Mon Dieu… mon Dieu… Mais qu’avez-vous fait ?
– Je viens de te le dire… clac ! une balle au cœur et il est resté sur place… sans jeu de mot…
– Mais où étiez-vous ?
– Cela ne te regarde pas !…
– Que faudra-t-il donc que je dise, si par hasard on m’interroge ?…
– Comment ce qu’il faudra que tu dises ? la vérité…
– Je vais avouer que je le connaissais ?…
Vagualame tapa du pied, excédé.
– Que tu es bête, mais comprends donc une chose : à l’heure actuelle il est à peu près certain que l’identité de ce bonhomme est établie. C’est bien le diable si quelque policier n’est pas déjà à son domicile, si l’on n’enquête pas sur la vie du capitaine Brocq. Donc ne nie rien. Tu diras…
Mais Vagualame s’interrompit :
– Voilà du monde, je te quitte, si j’ai besoin de te voir, je te reverrai… Ne t’inquiète pas… Je prends tout sur moi… attention.
Et changeant de ton, soudain, il eut des mots de mendiant.
– Merci bien, ma bonne dame… le bon Dieu vous le rendra en pluie de bénédictions… Au revoir.
3 – L’HÔTEL DU BARON DE NAARBOVECK
Malgré novembre, l’aube et la pluie, Jérôme Fandor, rédacteur au journal du soir La Capitale, chantait à tue-tête, au risque d’ameuter le voisinage.
Dans le très confortable petit appartement qu’il habitait, rue Richer, depuis déjà de longues années, le jeune reporter allait et venait fort affairé : placards, tiroirs, armoires, bâillaient ouverts, des vêtements, des piles de linge se répandaient dans les pièces.
Sur la table de la salle à manger, gisait ouverte une grande valise, dans laquelle, aidé par la femme de ménage, Jérôme Fandor empilait fiévreusement des vêtements de rechange.
Tout en procédant à cette importante besogne, résigné aussi, sachant que l’on s’en va rarement sans oublier quelque chose d’essentiel, le reporter discutait de façon enjouée avec sa vieille bonne :
– Dites-moi, demanda le journaliste, que sont devenues mes chaussettes ?
– Elles sont dans le coin, à droite, sous vos gilets de flanelle…
– N’oubliez pas, en allant me chercher tout à l’heure mon déjeuner, de remonter les journaux !…
– Comme je fais toujours, observa Mme Angélique…
– Comme vous faites toujours, en effet. Et puis vous réglerez ce que je dois chez les fournisseurs, autant arrêter ces comptes-là…
– Ah ça ! monsieur Fandor, interrogea-t-elle, resterez-vous donc bien longtemps absent ?
– Ça n’est pas l’envie qui m’en manquerait, mais si vous croyez qu’on a des congés comme cela dans mon métier…
– Ou alors, peut-être, monsieur Fandor, c’est-y que vous avez l’intention de changer de femme de ménage à votre retour ? pourtant…
– Vous êtes folle, madame Angélique ! voilà au moins vingt fois que je vous répète : je pars en vacances pour une quinzaine de jours. Un point c’est tout. Jamais il ne m’est venu à l’idée de me séparer de vous, bien au contraire, je suis enchanté de vos services… Tenez… je passerai par Monaco… je m’engage à mettre cinq francs pour vous sur la rouge :
– Sur la rouge ?
– Sur la rouge… oui, c’est un jeu et si cela gagne je vous ferai cadeau du bénéfice…, madame Angélique, dépêchez-vous d’aller me chercher ma culotte…
Le journaliste s’arrêta, rit d’un large rire satisfait. L’avait-il désiré ce congé qu’il allait enfin prendre après vingt-deux mois de labeur ininterrompu. Vingt-deux mois pendant lesquels, en sa qualité de reporter chargé de la grande information à La Capitale, il n’avait pour ainsi dire, pas passé une journée, sans avoir quelque déplacement à faire, quelque aventure à débrouiller, voire même quelque criminel à poursuivre. Au surplus, sa profession l’intéressait prodigieusement… Son apprentissage de reporter était à peine commencé qu’il se trouvait, par suite des circonstances, mêlé à diverses affaires mystérieuses qui avaient eu le plus grand retentissement dans le public. Il avait bénéficié, à son entrée dans la carrière délicate du journalisme, de l’appui précieux du policier Juve. Et ainsi Jérôme Fandor dans beaucoup de circonstances ne s’était pas contenté d’être le témoin impassible des événements plus ou moins dramatiques dont il avait à faire l’histoire. Fandor, volontairement ou non, avait été mêlé – ces dernières années surtout – aux crimes les plus sensationnels, aux affaires les plus mystérieuses, y jouant, par suite du hasard ou de sa volonté, un véritable rôle.
Et puis enfin, et puis surtout, il y avait que Jérôme Fandor, comme d’ailleurs l’inspecteur Juve, s’était à la fois, glorifié ou rendu ridicule, mais en tout cas signalé à l’attention publique, par ses combats épiques avec la personnalité la plus angoissante du siècle, l’insaisissable Fantômas.
Mais Jérôme Fandor, tout en sifflant le dernier air à la mode, ne songeait plus à tout cela :
Son esprit était ailleurs, sa pensée, toute joyeuse à l’idée que d’ici quelques heures, profitant enfin d’une permission bien gagnée, il s’installerait dans un confortable sleeping et se réveillerait le lendemain sur la côte d’Azur, parfumée, radieuse d’un éternel été. Alors huit cents kilomètres le sépareraient des bureaux de La Capitale, des commissariats de police, des bouges aux relents pestilentiels, des perpétuels mauvais temps, du froid, de l’humidité, attributs ordinaires de son existence quotidienne. Au diable tout cela, plus de copie à faire, plus de gens à interviewer ; c’étaient les vacances, les congés, la liberté. Soudain la sonnerie du téléphone… Un instant, Jérôme Fandor hésita : allait-il répondre ?
En principe, le journaliste « était parti » depuis la veille au soir.
Mais on ne laisse jamais sonner en vain le téléphone, lorsqu’on est à même de répondre… et puis enfin, c’était peut-être une erreur ou un ami ? Jérôme Fandor décrocha le récepteur. Ayant écouté une seconde, il prit instinctivement une attitude respectueuse comme si son interlocuteur, à l’autre bout du fil, pouvait le voir.
Jérôme Fandor, par brefs monosyllabes, répondit :
– Oui !… non !.. probablement ! soyez sans crainte !…
Il acheva la conversation par ces mots :
– C’est entendu, à tout à l’heure, patron…
Le journaliste en reposant l’appareil changeait de physionomie.
Son visage avait perdu la gaieté de l’instant précédent : le jeune homme fronçait les sourcils, il tirailla nerveusement sa moustache.
– Zut ! vraiment il ne manquait plus que cela !
Jérôme Fandor venait d’être appelé au téléphone par M. Dupont (de l’Aube), le député opportuniste bien connu qui était, en outre, le directeur de La Capitale.
M. Dupont (de l’Aube), adonné depuis de longues années à la politique et que l’on prévoyait comme devant faire un ministre au premier remaniement du Cabinet, s’occupait assez rarement du détail de l’information dont il fallait alimenter son journal. Il était directeur de nom et se contentait le plus souvent de rédiger son éditorial sans même aller lui-même le porter au journal, laissant la direction de fait et son importante publication à son gendre qui remplissait les fonctions de rédacteur en chef.
Jérôme Fandor avait donc été fort étonné, fort surpris, de recevoir un coup de téléphone de celui que, dans la salle de rédaction, on désignait sous le qualificatif de « Grand Patron ».
Fandor était convoqué par lui à la Chambre, pour trois heures de l’après-midi : le patron voulait lui donner des indications au sujet d’un reportage qui l’intéressait particulièrement…
Fandor était intrigué, anxieux…
De quoi pouvait-il bien s’agir et comment se faisait-il que M. Dupont (de l’Aube) s’occupât désormais des articles à faire ?
Et puis Fandor se regimbait, il était en vacances, après tout.
– Bah ! se dit le journaliste, Dupont ignore évidemment ces détails, je vais aller à son rendez-vous, je lui expliquerai mon prochain départ et c’est bien le diable s’il ne repasse pas son reportage à un autre de mes collègues…
– Madame Angélique, dit Fandor, faites-moi vite à déjeuner, puis vous bouclerez ma valise, ce soir je fiche mon camp, coûte que coûte.
***
Depuis deux heures, qui lui avaient paru interminables, Jérôme Fandor, dans la salle des Pas Perdus du Palais-Bourbon, attendait M. Dupont (de l’Aube).
Le député était en séance. Aux dires des huissiers accoutumés aux procédés parlementaires, la discussion menaçait de s’éterniser. Jérôme Fandor s’énervait. À plusieurs reprises il avait eu l’idée de filer purement et simplement à l’anglaise, quitte à s’excuser ensuite, à invoquer un malentendu, lorsque huit cents kilomètres le sépareraient des foudres directoriales… Mais il était trop scrupuleux journaliste, trop professionnellement honnête pour mettre un semblable projet à exécution. Rongeant son frein, Fandor était resté.
Comme pour la cent cinquantième fois, il regardait sa montre, le journaliste se leva soudain et s’empressa vers deux personnes qui débouchaient d’un couloir : c’était M. Dupont (de l’Aube) qu’accompagnait un personnage que Fandor reconnut aussitôt. Le journaliste s’inclina respectueusement devant l’un et l’autre, serra la main cordiale que lui tendait M. Dupont (de l’Aube) qui disait à son compagnon :
– Mon cher ministre, je vous présente mon jeune collaborateur, Jérôme Fandor…
– C’est un nom qui ne m’est pas inconnu, avait répondu le ministre.
Mais, sollicité par d’innombrables occupations, il s’éclipsa aussitôt.
Quelques instants après, dans un des petits salons réservés aux commissions parlementaires, le directeur de La Capitale s’entretenait avec son rédacteur.
– Ce n’est pas, je suppose, mon cher patron, Interrogeait Fandor, pour me présenter au ministre que vous m’avez fait venir ici. À moins que vous n’ayez l’intention de me faire nommer sous-préfet, auquel cas…
– Auquel cas ? interrogea doucement M. Dupont (de l’Aube)…
Fandor, nettement, répliqua :
– Auquel cas, avant même d’être nommé, je vous apporterais ma démission ; ça n’est pas là une profession qui me tente beaucoup…
– Rassurez-vous, Fandor, fit M. Dupont (de l’Aube), je n’ai nullement l’intention de vous envoyer vivre en province. Mais si je vous ai demandé de passer me voir ici c’est qu’il s’agit d’une affaire assez délicate dont j’ai l’intention de vous confier l’instruction. J’insiste sur ce mot.
– Bon, pensa Fandor, voilà mes vacances dans le lac !
Il essaya de poser cette question préjudicielle, mais M. Dupont (de l’Aube), aussi autoritaire que doux dans ses manières, l’interrompait d’un geste de la main :
– Vous partirez quelques heures plus tard, mon cher ami, et vous prendrez huit jours de plus…
Fandor s’inclina, c’était là des choses que l’on ne discute pas… et il gagnait à la combinaison.
– Mon cher Fandor, commença le « grand patron », nous avons publié hier soir, ainsi que vous ne l’ignorez pas, un filet sur la mort du capitaine Brocq…
« Cette mort est assez mystérieuse. Le capitaine, qui, par ses fonctions, dépendait du Deuxième Bureau de l’État-Major, avait des relations dans des milieux qu’il serait intéressant de connaître. J’en ai parlé tout à l’heure avec le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Guerre. Tous deux sont d’accord pour que nous procédions à une enquête assez discrète, minutieuse. Vous êtes l’homme tout désigné…
Une heure après l’entretien qu’il venait d’avoir avec M. Dupont (de l’Aube), Jérôme Fandor, pantalon retroussé, col du pardessus relevé traversait, stoïque sous la pluie, l’Esplanade des Invalides, éclairée par quelques becs de gaz.
Le journaliste arriva de l’autre côté de la place, à la rue Fabert, regarda le numéro de la première maison qui se trouvait devant lui, suivit un instant le trottoir, en tournant le dos à la Seine, puis enfila la rue de l’Université et parvint à l’avenue de Latour-Maubourg.
Jérôme Fandor se rappelait ce qu’avait dit Dupont : interviewer le baron de Naarboveck, lier connaissance avec une jeune personne du nom de Bobinette, telles étaient les grandes lignes de sa mission. Il n’était pas inquiet sur l’issue de son interview. Ce n’était pas la première occasion dans laquelle Fandor faisait pareille besogne, et cette fois la tâche était facilitée par la lettre de recommandation que M. Dupont (de l’Aube) lui avait donnée pour obtenir un entretien de M. de Naarboveck.
Un autre journaliste que Fandor serait évidemment allé droit chez le personnage à interviewer, ne songeant pas à s’écarter de sa mission. Mais Fandor avait une idée de derrière la tête. D’abord inspecter les lieux. Contournant le pâté de maisons qui limitait la rue de l’Université, il était allé dans l’avenue de Latour-Maubourg afin de se rendre compte si l’hôtel était double ou simple, s’il avait une ou deux issues.
Lorsqu’il faisait une enquête, il songeait, certes, à atteindre droit le but qu’il se proposait mais il songeait aussi à l’imprévu.
L’inspection de Fandor fut courte. L’hôtel, en effet, comportait deux entrées : celle de l’avenue de Latour-Maubourg était réservée au service.
La façade de l’hôtel donnait sur la rue Faber. Une cour par derrière le séparait de l’avenue de Latour-Maubourg, il était composé de trois grands étages, bâtis sur un rez-de-chaussée surélevé de quelques marches.
Fandor retourna à l’Esplanade des Invalides et se promena quelque temps sous les arbres, surveillant les allées et venues du voisinage.
Soudain une automobile, une limousine fort élégante, s’arrêta devant la maison de M. de Naarboveck. Un homme d’un certain âge en descendit et s’engouffra sous un portail qui s’était ouvert dès l’approche de la voiture.
– Naarboveck, pensa Fandor. La voiture rentre, le patron ne sortira plus.
Peu après cette opinion était encore confirmée ; le mécanicien ayant enlevé sa livrée sortit de l’hôtel et partit.
– Bon ! observa Fandor, le « client » ne bougera pas de chez lui de toute la soirée !
Ensuite deux femmes, jeunes en apparence, qui entrèrent dans l’immeuble ; puis vingt minutes s’écoulèrent.
Les pièces du premier étage jusqu’alors demeurées sombres s’illuminèrent successivement, l’hôtel sembla s’éveiller et Fandor allait se décider à sonner lorsqu’un taxi-auto amena devant la porte un quatrième personnage. Fandor s’approcha de celui-ci, au moment où il réglait sa course. C’était un jeune homme élégant, distingué, très blond, portant la moustache mince et longue à la gauloise. Ses attitudes trahissaient sa profession : un officier en civil, à n’en pas douter.
Fandor contourna l’immeuble une fois encore, il arrivait devant la façade de l’avenue de Latour-Maubourg, lorsqu’il vit un petit pâtissier s’introduire dans la maison.
Naarboveck habite seul avec sa fille, m’a dit M. Dupont (de l’Aube), se dit le journaliste, c’est donc qu’il reçoit du monde à dîner ce soir. Renonçant à son idée première : se présenter tout de suite au diplomate, Fandor décida après réflexion :
– Ma foi, je m’en vais dîner aussi. Autant leur donner une heure de répit.
Le journaliste savait, par expérience, combien il est mauvais d’interviewer les gens lorsqu’ils sont pressés, attendus, ou à jeun.
Fandor avisa un marchand de vins. Trois quarts d’heure après, Fandor sortait de la boutique, ayant mal dîné, mais complètement renseigné sur l’existence privée et publique du personnage chez lequel il allait se rendre. Il avait fait bavarder ses voisins, le patron de l’établissement ; Fandor aurait pu dire à quelle heure se levait Naarboveck, quelles étaient ses habitudes, s’il faisait maigre le vendredi et le prix qu’il payait ses cigares.
***
– M. de Naarboveck, s’il vous plaît ?
Neuf heures sonnaient, en effet.
– C’est ici qu’il demeure, monsieur, répondit le serviteur.
Fandor tendit sa carte, ainsi que la lettre de M. Dupont (de l’Aube).
– Voulez-vous passer ceci, demanda-t-il et me faire savoir si M. de Naarboveck peut me recevoir ?
Le concierge invita le jeune homme à le suivre.
Ils gravirent les marches du perron, le portier sonna, un valet de pied en petite livrée se présenta aussitôt et prit des mains du portier la lettre et la carte destinées à M. de Naarboveck.
Le domestique, longuement épela le nom de Fandor gravé sur le bristol, regarda l’inconnu, espérant qu’il préciserait d’une parole le but de sa visite, mais Jérôme Fandor demeurait impassible et comme sa qualité de journaliste ne figurait point sur sa carte, le domestique en fut pour sa curiosité.
– Veuillez attendre un instant ici, fit le laquais d’un air assez aimable, je m’en vais aller voir si monsieur reçoit.
Fandor demeura seul dans un vaste hall aux meubles Renaissance où des tapisseries de haute lice déroulaient sur les murs leurs épopées grandioses en somptueux tableaux.
Le valet de pied revint en se hâtant.
– Si monsieur veut me suivre ?
Débarrassé de son pardessus, Fandor obéit.
Une face du hall donnait sur un grand escalier à double révolution dont la pierre blanche, grisée par les ans, s’adoucissait d’un moelleux tapis et qu’ornait une merveilleuse rampe aux rinceaux délicats, œuvre de l’un des maîtres de la ferronnerie du dix-septième siècle.
Le domestique derrière lequel marchait le journaliste ouvrit une porte qui accédait dans un magnifique salon de réception peu meublé, mais du plus pur Louis XIV. Aux murs des glaces à petits panneaux reflétaient des toiles de maîtres, tableaux de famille d’une importante valeur artistique, d’une plus grande valeur encore de souvenir.
Cette pièce traversée, ils passaient encore par des salons d’un goût très sûr.
Fandor parvint enfin au fumoir où l’Empire était judicieusement mêlé aux meubles dont l’Angleterre nous enseigna le confort et dont le cuir fauve s’harmonisait à merveille avec le rouge de l’acajou vieilli aux bronzes hiératiques.
Le domestique lui indiqua un siège et disparut.
– Fichtre ! pensa tout haut Fandor lorsqu’il fut seul, le gaillard est joliment bien installé. Faut croire que de faire de la diplomatie pour le compte du roi de Hesse-Weimar, ça vous nourrit son homme…
Mais le journaliste fut soudain interrompu dans ses réflexions. Une porte venait de s’ouvrir donnant passage à une jeune femme fort élégante.
Jérôme Fandor salua la jolie apparition.