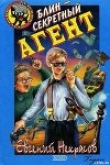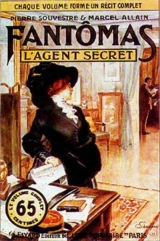
Текст книги "L'agent secret (Секретный агент)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
26 – LE SECRET DE WILHELMINE
– Vous êtes seule, Wilhelmine ?
La jeune fille, qui sortait de l’hôtel de la rue Fabert, eut une agréable surprise. Devant elle, au coin de la rue de l’Université, se dressait la sympathique silhouette du lieutenant de Loubersac.
Ce dernier, dont l’esprit était perpétuellement torturé, dont les inquiétudes augmentaient d’heure en heure, avait en effet décidé d’avoir ce jour-là, coûte que coûte, une explication définitive avec la jeune fille.
– Je suis seule, en effet, avait répondu la jeune fille, et même… plus que jamais…
– Votre père ?
– Parti depuis ce matin. J’ai déjeuné sans lui…
– Et Mlle Berthe ?
– Pas de nouvelles depuis quelques jours. Berthe semble avoir disparu.
L’officier n’ajouta rien. Machinalement, il régla son pas sur celui de la jeune fille. Après un silence, il demanda encore :
– Où comptez-vous aller, Wilhelmine ?
Mlle de Naarboveck expliquait qu’elle avait des courses à faire, mais que celles-ci ne comportaient aucun caractère d’urgence.
– Voulez-vous que nous marchions un peu, tout en causant ?
Machinalement, les jeunes gens avaient traversé l’esplanade des Invalides, remonté le boulevard Saint-Germain, qu’ils atteignaient en suivant la rue Saint-Dominique, puis ils avaient pris la rue Bonaparte, se disant que les jardins du Luxembourg pourraient leur offrir un lieu convenable et agréable pour l’explication suprême qu’ils avaient décidé d’avoir.
– Il y a, ma chère amie, dit le lieutenant, dans votre existence une série de mystères qui me préoccupent et m’inquiètent. Vous savez les sentiments que j’éprouve à votre égard, ils sont sincères et sérieux. Mon amour pour vous est profond, et je n’ai qu’un désir au monde, c’est d’unir ma destinée à la vôtre. Mais auparavant, nous avons certainement l’un et l’autre des choses à nous dire, des choses graves, peut-être des choses, en tout cas, qu’il est nécessaire que nous élucidions…
Wilhelmine décida de parler.
Les jeunes gens étaient à ce moment-là sur la place Saint-Sulpice, et soudain du ciel, qui s’était rembruni, tombèrent de larges gouttes d’eau.
– Entrons à l’église, dit-elle. Nous serons plus tranquilles et j’ai comme l’impression que mes paroles, sous les voûtes de ce saint lieu, auront à vos yeux un caractère de plus exacte vérité. C’est presque une confession…
Henri de Loubersac, ému par ce préambule, redoutait de plus en plus des révélations épouvantables. Il acquiesça sans mot dire. Le couple pénétra sous le porche.
Comme il faisait passer Wilhelmine devant lui, de Loubersac se retourna soudain, considéra curieusement un fiacre aux stores fermés qui venait de s’arrêter non loin du parvis.
– Qu’avez-vous ?
– J’avais comme l’impression d’être suivi… que nous étions filés… Cela n’a pas grande importance, nous devons nous attendre, lorsqu’on appartient comme moi au service des renseignements…
– Oui, observa la jeune fille, vous aussi vous avez des secrets…
– Oh ! fit l’officier, ne se méprenant pas sur la naïveté de cette insinuation, ils n’ont rien que de professionnel. Ma personnalité est nette. Ma vie peut se raconter au grand jour…
Ils étaient installés depuis quelque temps sur de modestes chaises, derrière un pilier et dans l’obscurité ; à mi-voix, Wilhelmine parlait toujours.
Très franchement d’abord, elle avait dit à Henri de Loubersac qu’elle n’était pas la fille du baron de Naarboveck, qu’elle ne portait ni le nom du baron, ni le prénom de Wilhelmine, mais qu’elle s’appelait Thérèse Auvernois.
Ceci n’apprit rien à l’officier…
Wilhelmine, ou Thérèse Auvernois, lui raconta ses premières années passées dans un vieux château des bords de la Dordogne, en tête à tête avec sa grand-mère, la marquise de Langrune. Et puis, un sinistre jour de décembre, un malheur effroyable s’était abattu sur les deux pauvres femmes. La marquise de Langrune avait été mystérieusement assassinée par un jeune homme, fils d’un ami de la famille, et qui s’appelait Charles Rambert. On le croyait du moins. Orpheline dès lors, elle se vit protégée par le père, précisément, de celui qu’on supposait être le meurtrier de sa grand-mère, Etienne Rambert. Celui-ci avait recommandé la jeune fille à lady Beltham, dont le mari avait été lui-même, quelques mois auparavant, mystérieusement assassiné. Thérèse avait vécu alors chez cette lady. Mais quelques mois après, son protecteur, M. Étienne Rambert, disparaissait dans un naufrage. Wilhelmine partait en Angleterre avec lady Beltham pour habiter un château d’Écosse. Deux ans s’écoulèrent, paisibles, au cours desquels Thérèse avait fait la connaissance, chez cette mère d’adoption, d’un diplomate étranger, le baron de Naarboveck. Puis lady Beltham partit pour la France, et un jour, Thérèse devait apprendre que la malheureuse y était morte.
Le baron de Naarboveck, seule personne au monde qui, dès lors, sembla s’intéresser à elle, vint, après six mois, la chercher en Angleterre, la ramena à Paris et décida de la faire passer pour sa fille.
Le baron s’était montré excellent pour la jeune fille. Il lui avait appris, en outre, qu’elle possédait une belle fortune à l’étranger, qu’il lui faudrait aller la chercher un jour.
…Wilhelmine s’interrompit soudain dans son récit.
– Avez-vous vu ? interrogea-t-elle d’une voix inquiète.
– Il me semble en effet, reconnut l’officier, mais peu importe ! C’est quelqu’un qui passe !
– Pourvu, grand Dieu, que l’on ne nous épie pas, murmura Thérèse-Wilhelmine.
– Que craignez-vous donc ?
– Vous vous demandez pourquoi mon existence est entourée, depuis ces dernières années, par tant de précautions mystérieuses ?
– Oui, bien sûr, dit le lieutenant.
– J’en ai parlé à Naarboveck. J’ai lu des collections de journaux à la Bibliothèque, en cachette, bien sûr. Un nom ne cesse de revenir dans toutes nos affaires…
– Ce nom ?
– Et ce nom c’est… c’est le nom qu’on n’ose prononcer… Fantômas…
– Ah ! fit Loubersac.
Les propos de Juve lui revenaient à l’esprit.
Mais bientôt la jalousie reprit le dessus.
Comédie que tout cela, pensa-t-il, et comédie grossière destinée à détourner mes soupçons. On veut amuser ma curiosité. La gaillarde se croit très forte. Elle ne sait pas à qui elle s’attaque.
Et pour en avoir le cœur net, il se leva, et, les yeux dans les yeux, il dit à brûle-pourpoint :
– Wilhelmine de Naarboveck ou Thérèse Auvernois, peu m’importe… Je veux la vérité vraie : oui ou non, avez-vous été la maîtresse du capitaine Brocq ?
Wilhelmine était devenue toute pâle. Un tremblement agita ses lèvres, blanches d’émotion.
Soudain, elle comprit l’incrédulité de l’homme auquel elle avait voué son cœur.
Un instant elle eut l’idée d’expliquer, d’expliquer encore, de vouloir convaincre et aussi de se justifier. Mais elle recula, découragée devant la gigantesque apparence de la tâche. Et puis, que lui importait, du moment qu’Henri n’avait pas confiance ? La jeune fille se contint :
– Vous m’insultez, dit-elle. Retirez ce que vous venez de dire. J’exige des excuses !…
– Je maintiens mon accusation, mademoiselle, jusqu’à ce que vous m’ayez fourni des preuves formelles.
La jeune fille s’était levée. Précipitamment elle se dirigeait vers la porte, descendit les marches de l’église et se jeta dans un fiacre qui passait.
– Adieu, monsieur, pour toujours.
Henri de Loubersac haussa les épaules.
Soudain, il tressaillit ; une silhouette, une ombre, se profila sous le porche de l’église : un être indéfinissable disparut en courant. Henri de Loubersac comprit qu’ils avaient été suivis, épiés.
27 – LES DEUX VINSON
Midi sonnait quand le caporal Vinson, enfermé au Cherche-Midi depuis son arrivée à Paris, entendit une clé grincer dans la serrure du cachot qu’il occupait.
Deux geôliers militaires l’interpellaient :
– Butler ! vous allez être transféré dans l’immeuble du Conseil de Guerre, où vous occuperez la cellule numéro vingt-sept. Notre prison n’est que pour les condamnés ; or, vous n’êtes qu’inculpé, vous ne pourriez y rester…
Tout cela importait peu au faux Butler. Mais l’infortuné caporal frémit d’émotion à l’idée d’être exposé, ne fût-ce qu’un instant, aux regards curieux de la foule.
– Allons-y !
Le caporal ne pouvait se décider à quitter l’ombre de son cachot. Enfin, il fit un effort, tendit ses poignets, accepta sans murmure les menottes et, se plaçant entre ses deux geôliers, quitta la prison.
La lumière du jour, le frappant brusquement au visage, lui fit cligner des yeux et, en arrivant sur le trottoir, le caporal esquissa un mouvement de recul, mais les gardiens l’entraînèrent.
Le pauvre caporal, un peu plus loin, poussa un soupir et se laissa aller de tout son long.
Ses gardiens le portèrent jusqu’à l’entrée de la cour du Conseil de Guerre. Quelques curieux, surpris de la pâleur du prisonnier voulurent suivre, mais les gardiens firent fermer la grande porte de la cour du Conseil communiquant avec la rue, et avant de mener Vinson dans sa cellule, ils assirent le malheureux toujours inanimé sur une chaise, dans la loge du concierge.
Le concierge offrit du vinaigre, on en frictionna les tempes du misérable. L’un des geôliers lui frappa dans les mains. Ce fut en vain : le prisonnier Butler ne donnait plus signe de vie.
– Ma foi, suggéra le concierge inquiet, vous feriez aussi bien de le transporter dans sa cellule et faire chercher le médecin de service. Ce serait plus prudent.
***
– Lieutenant Servin ?
– Mon commandant ?
– Puisque vous êtes substitut auprès du commissaire du gouvernement, et que me voilà redevenu commissaire au gouvernement, vous allez me donner un coup de main pour débrouiller toutes ces paperasses… Il est déjà onze heures et demie et je voudrais bien aller déjeuner…
Le lieutenant Servin sourit, et vivement apporta sur le bureau de son supérieur une pile de documents qu’il classa d’une main experte.
Ce supérieur, c’était le commandant Dumoulin, qui, une quinzaine de jours auparavant, remplissait encore les fonctions de sous-chef du Deuxième Bureau. Depuis quelques jours, Dumoulin avait pris possession de son nouveau poste et comptait se mettre paisiblement au courant des affaires dont s’occupait le Conseil.
Or, voici que la veille au soir il avait été avisé à son domicile, par une communication privée du Ministère, qu’un déserteur inculpé de trahison venait d’être arrêté et qu’il s’agissait du caporal Vinson. À la lecture de ce nom, le commandant Dumoulin avait bondi. L’affaire Vinson, mais c’était aussi l’affaire du capitaine Brocq, de la chanteuse Nichoune, du plan de mobilisation volé, du débouchoir de canon disparu.
Les prévisions du commandant Dumoulin soudain, se trouvaient bouleversées. Ce n’était plus le train-train habituel du Conseil, mais brusquement, pour son entrée en fonctions, le gros procès, la cause sensationnelle. Donc, après avoir fort mal dormi, le commandant était arrivé de bonne heure à son bureau pour travailler avec ses collaborateurs. Heureusement, il avait trouvé, parmi ses substituts, un jeune officier très au courant, zélé, le lieutenant Servin.
– Lieutenant, nous allons procéder sans plus attendre à l’interrogatoire du caporal Vinson. Faites-le demander, je vois sur le registre d’écrou qu’il occupe la cellule vingt-six…
– Pardon, mon commandant. Vinson, écroué ce matin à la prison du Cherche-Midi, doit être actuellement dans les bâtiments du Conseil, où il occupe la cellule vingt-sept.
– Vous faites erreur ; dans la cellule vingt-sept se trouve un individu nommé Butler.
– Oui, mon commandant, Butler, c’est Vinson…
– Je ne comprends pas. Vous devez faire une confusion, lieutenant. Le caporal Vinson a été arrêté hier à la gare Saint-Lazare. On l’a conduit ici et écroué dans la cellule vingt-six. l’en ai d’ailleurs été informé par une dépêche privée, à mon domicile…
– Mon commandant, le caporal Vinson, qui se cachait sous le nom de Butler, a été arrêté cette nuit, ou, pour mieux dire, ce matin, à la gare de Calais, comme il arrivait d’Angleterre. L’arrestation a été effectuée par l’inspecteur de la Sûreté Juve, qui a mené son prisonnier, vers six heures ce matin, au Cherche-Midi : c’est l’occupant de la cellule vingt-sept.
– Voyons, lieutenant, grogna le commandant, vous perdez la tête. Puisque Vinson a été arrêté hier à la gare Saint-Lazare, il est évident qu’on ne l’a pas arrêté cette nuit à Calais. Vinson et Butler, ça fait deux !…
– Je vous demande pardon, mon commandant, ça ne fait qu’un !
– Il suffit, lieutenant Servin. Faites-moi chercher le caporal Vinson qui occupe la cellule vingt-six.
– Bien, mon commandant !
***
– Approchez. Vous êtes bien le caporal Vinson ?
– Non, mon commandant.
– Êtes-vous le caporal Vinson, oui ou non ?
La même réponse, avec la même netteté, tomba des lèvres de l’inculpé :
– Non, mon commandant !
L’officier allait éclater, quand Servin dit à voix basse :
– Mon commandant, quelqu’un désire être reçu par vous, tout de suite.
Le commandant lut sur le bristol : « Juve, inspecteur de la Sûreté ».
– Que veut-il ? demanda le commissaire du gouvernement .
– Mais c’est ce policier qui a arrêté le caporal Vinson…
– Eh bien ! rugit Dumoulin dont l’exaspération s’accroissait, il arrive à pic, ce particulier-là ! faites entrer.
Une seconde après, Juve était dans le cabinet de Dumoulin, qu’il saluait d’un aimable sourire :
– Figurez-vous que cet animal, ajouta-t-il en regardant sévèrement l’inculpé, ne veut pas avouer son identité !…
Juve allait droit à l’officier et, sans regarder le militaire qui se trouvait à contre-jour :
– C’est moi, mon commandant, déclara-t-il, qui ai procédé à l’arrestation du caporal Vinson, en conséquence, j’ai cru devoir venir me mettre à votre disposition…
– Vous avez joliment bien fait, s’écria Dumoulin en coupant la parole à l’inspecteur de la Sûreté ; eh bien ! obtenez donc qu’il avoue. Obligez-le à nous dire s’il est oui ou non le caporal Vinson !
Dumoulin, d’un geste théâtral, désignait à Juve le prisonnier.
Mais le policier resta bouche bée, cependant que le militaire, instinctivement, allait à lui d’un mouvement vif, spontané :
– Fandor !
– Juve !
– Ah ! par exemple, qu’est-ce que cela signifie ?…
– Cela signifie, Juve, que je suis arrêté aux lieu et place du caporal Vinson !
– Pas le moins du monde, j’arrive de Londres et j’ai arrêté Vinson hier soir à Calais !… Mais me diras-tu, Fandor, comment il se peut que je te retrouve sous cet uniforme ?
Le journaliste éclata de rire :
– Mon cher Juve, j’en ai pour deux heures à vous en raconter avant que vous ne compreniez un mot de cette affaire. Mon commandant, je dois vous confirmer qu’en effet je ne suis pas le caporal Vinson, mais bien un journaliste… que vous connaissez peut-être de nom : Jérôme Fandor, rédacteur à La Capitale. Si vous me voyez sous cette tenue, ou pour mieux dire, dans l’espèce, sous ce « déguisement », cela tient à une série d’événements dont je me ferai le plaisir de vous communiquer le détail, lorsque j’aurai moi-même mis un peu d’ordre dans mes idées. Je suis fort heureux de la circonstance qui me réunit à mon ami Juve, lequel pourra vous confirmer, si vous le jugez nécessaire, l’exactitude de mes dires…
Le commandant Dumoulin, de plus en plus interdit, regardait successivement le policier, le journaliste, son greffier… Il se tourna, congestionné, écarlate, du côté du lieutenant Servin. Celui-ci, dès le début de cette scène vaudevillesque, était allé dans son bureau donner un ordre à un secrétaire qui précisément venait de revenir.
Et le lieutenant ayant enregistré la réponse que lui apportait le sous-officier rentrait juste dans le cabinet du commandant au moment où celui-ci le cherchait des yeux. Le lieutenant haletait comme sous le coup d’une émotion indicible.
Enfin il s’expliqua :
– Mon commandant… Monsieur Juve… Un événement inattendu…, une chose invraisemblable que j’apprends à l’instant… Je venais de donner l’ordre de faire amener ici, immédiatement, le caporal Vinson, le vrai, celui que M. Juve a arrêté sous le nom de Butler, or, il paraît qu’en arrivant dans sa cellule, il est mort.
– Qu’est-ce que vous dites ? interrogèrent ensemble Juve et Dumoulin.
– Je dis qu’il est mort ! répéta le lieutenant.
– Mais comment cela ? questionna encore le policier.
Le lieutenant fit venir le sergent d’administration.
– Allez chercher le docteur.
On se tut et quelques secondes plus tard, un jeune aide-major parut sur le seuil du bureau.
– Expliquez-vous, monsieur, qu’y a-t-il ?
– Mon commandant, on m’a fait demander, il y a une heure environ auprès d’un prisonnier évanoui, disait-on. Cet homme, en traversant la rue du Cherche-Midi, avait soudain perdu connaissance et ses gardiens ne pouvant le ranimer l’avaient conduit dans sa cellule. À mon arrivée il était mort.
– Mort de quoi ? interrogea le commandant.
– Il est mort d’une balle au cœur : je m’en suis aperçu en le déshabillant. On retrouvera la balle à l’autopsie, car, vraisemblablement, elle s’est logée dans la colonne vertébrale.
Le commandant Dumoulin s’était levé, marchait de long en large dans son bureau, en proie à une agitation folle :
– Ah çà ! mais, voyons… on ne tue pas comme ça les gens en pleine rue… c’est inouï ! invraisemblable ! une balle, ça suppose un fusil, un revolver, une détonation !… cela fait du bruit !
Le commandant s’approcha de l’aide-major, le prit par les épaules, le secoua et, l’interrogeant les yeux dans les yeux avec une pointe de mépris soupçonneuse :
– Êtes-vous seulement sûr de ce que vous dites ?
– J’en suis sûr, mon commandant.
Pendant cette discussion, Juve s’était approché de Fandor. Au récit du médecin, tous deux avaient étrangement pâli, et Juve, nerveux à l’extrême, murmurait à l’oreille de Fandor :
– Vinson tué d’une balle au coeur !… comme le capitaine Brocq… tué sans doute avec une arme silencieuse… quand il traversait la rue… il y a encore là-dessous… du Fantômas.
Quelques instants après, Fandor prit la parole :
– Excusez-moi, mon commandant, de venir vous troubler, mais je vous serais bien reconnaissant de me faire mettre en liberté…
Cette fois, le commandant Dumoulin éclata :
– Ah ! nom de Dieu ! hurla-t-il en donnant un violent coup de poing sur sa table, vous pouvez vous vanter que vous avez du culot ! non seulement vous vous êtes foutu de moi, mais vous voulez vous en foutre encore !… Ah ! vous n’êtes pas le caporal Vinson !… ah ! vous êtes journaliste !… eh bien ! c’est ce qu’il s’agira de prouver… et quand même vous le prouveriez, j’aime à croire que vous vous êtes fourré dans un bien mauvais cas en vous moquant de l’armée tout entière comme vous venez de le faire ! Gardes, continua-t-il, reconduisez-moi cet homme-là dans sa cellule, et vivement, qu’on double la surveillance !
Fandor n’avait pas eu le temps de placer un mot de protestation. On l’entraînait.
– Je vous assure, mon commandant, qu’il s’agit bien de Jérôme Fandor, commença Juve.
– Vous, hurla le commandant, foutez-moi la paix…
28 – AU «VEAU QUI PLEURE »
– Alors, qu’est-ce que tu t’enfiles ?…
– Qu’est-ce que tu offres ?…
Geoffroy-la-Barrique ébranla d’un puissant coup de poing la table devant laquelle il était assis, au risque de faire s’écrouler la respectable pile de soucoupes qui, à cette heure avancée de la soirée, marquait avec précision son emploi du temps.
– Ce que j’offre ? riposta-t-il, j’offre ce qu’on veut, j’ai pas l’habitude de liarder, moi ; quand je demande : « Mon vieux, qu’est-ce que tu t’enfiles ? » ça veut dire : « Choisis ! »… voilà !
– Passe le catalogue !
Et l’homme s’absorba dans une lecture compliquée des différents alcools baptisés de noms bizarres.
Le compagnon de Geoffroy-la-Barrique méritait son sobriquet de « Malfichu ». Il répondait encore au surnom plus aristocratique de « Sacristain », surnom justifié par son ancienne profession. Il avait jadis été sacristain à Saint-Sulpice et n’avait quitté son emploi qu’en raison de son intempérance.
Où ces hommes s’étaient-ils connus, eux d’aspect si différent ? Par quel lien mystérieux ce petit bonhomme était-il devenu l’ami de ce robuste gars ?
– Et alors, mon vieux, reprenait Malfichu, qui, après avoir consciencieusement étudié le « catalogue », s’était tout bonnement décidé à commander au garçon « une purée… bien épaisse ». Et alors, comment cela se fait-il qu’on ne t’a pas vu depuis tant de jours ?… Qu’est-ce que c’est qui t’est arrivé ?…
Geoffroy-la-Barrique, d’une gorgée, vida son verre, la nuque à la muraille, les poings sur la table, les jambes étendues, écartées, sembla considérer le plafond du cabaret et réfléchir profondément.
– Ma foi, répondit-il, tu ne m’as pas vu parce que tu ne m’as pas vu !… Voilà, Malfichu !… il n’y a pas d’autres explications !… Ah ! tout de même, tu te rappelles que j’avais passé l’examen pour être fort des Halles ?…
– Oui-da, je m’en souviens, quelle fameuse tournée !
– Comme de juste, Malfichu… C’était d’ailleurs ma soeur Bobinette qui payait… Ah ! tu te souviens que j’ai été refusé… Bon. Je suis entré aux Halles quand même… puis, un jour, pour une histoire de rien du tout, j’ai cogné sur un des marqueurs…
– T’as cogné ?
– J’ai cogné. Pour lors, quand j’ai eu cogné sur le chef, il s’est d’abord aplati sur le trottoir. D’autres l’ont emmené, et puis le lendemain ils m’ont foutu à la porte… Dame ! mon vieux, tu vois ça d’ici ? Une fois foutu à la porte, c’était la dèche. Comme de raison, j’avais pas d’économies, j’avais juste placé quelques dettes à droite et à gauche, chez les bistros… enfin, je courais grand risque de me mettre la ceinture et de refiler les comètes… C’est Bobinette qui m’a aidé…
– Ta frangine ?
– Elle, n’est-ce pas, c’est une maligne… d’ailleurs elle a fait des études, elle était pose-bandages à Lariboise… bref, elle a des sous… j’y ai raconté mes malheurs… enfin, elle m’a donné des pépettes et j’ai pu attendre…
– Jusqu’à ce qu’on t’engage au Grand Tonneau ?
– Non… Bobine m’a dit comme ça : « V’là des ors, frérot, c’est tout ce que j’ai, ne reviens pas, faut te débrouiller… »
– Et tu t’es débrouillé ? Comment ?…
Geoffroy-la-Barrique semblait hésiter à répondre. Peut-être avait-il un mauvais souvenir dans sa mémoire, peut-être ne voulait-il pas raconter au juste à son ami Malfichu ce qu’il avait fait durant les quelques mois qui séparaient sa sortie des Halles de son entrée au Grand Tonneau…
Les yeux fixes, il buvait son absinthe à petits coups, à courtes gorgées savourées l’une après l’autre…
– Alors, voilà, je me suis débrouillé…
– J’te demande comment ?
– J’te dis que je me suis débrouillé, puis je suis entré au Grand Tonneau…
– Où t’es…
– Où j’suis…
– T’as remboursé la frangine ?
Mais Geoffroy eut un gros rire :
– Des nèfles ! répondit-il. Tu ne voudrais pas, des fois ? Je l’ai si peu remboursée que d’abord j’savais pas ce qu’elle était devenue… elle avait quitté Lariboise… partie sans laisser d’adresse… z’ou… j’la croyais p’t’être ben claquée, ce qui m’aurait fait de la peine, car c’est une brave fille, lorsqu’avant-hier j’ai reçu un mot d’elle. Bobinette m’a demandé un rendez-vous…
– Tu lui as dit de venir ici ?
– Juste.
– Et comment qu’elle avait ton adresse ?
– Dame ! ça, j’sais pas… Probable qu’elle aura vu mon nom cité l’autr’jour « sur » le Petit Journal dans les vainqueurs du Concours de force. Elle m’a écrit en mettant l’numéro de ma piaule, rue de la Harpe.
– Faut pas s’étonner avec elle, j’te dis qu’elle a d’l’instruction…
***
Minuit et demie venait de sonner.
D’une voix formidable, le patron du Veau-qui-Pleure, le bouge où le grand Geoffroy et son ami passaient la soirée, avertissait :
– Maintenant, les fistons, je ne sers plus que des « sept sous »…
Nulle protestation ne s’élevait. On savait, en effet, que, passé minuit et demie, on se refusait à servir à la clientèle des consommations d’un prix inférieur à sept sous. Sans doute parce que, passée cette heure, la clientèle du Veau-qui-Pleure n’était plus en état de protester.
Geoffroy-la-Barrique resta seul. Il s’était contenté de commander une nouvelle tournée, une tournée de deux verres. Il les buvait l’un après l’autre, ennuyé d’attendre. Un peu essoufflée, un peu intimidée surtout, Bobinette arriva enfin… Pour venir visiter son brave frère, l’élégante demoiselle de compagnie de Wilhelmine de Naarboveck s’était sagement abstenue de faire toilette. Aussi bien, depuis son voyage à Rouen, depuis la rencontre qu’elle avait faite du lieutenant Henri, dans le train avait-elle jugé bon de ne pas reparaître à l’hôtel du diplomate. Elle avait écrit qu’elle était malade.
En réalité, elle était allée s’installer dans un modeste hôtel de la Chapelle, et là attendait les événements, se demandant exactement ce que le lieutenant Henri avait deviné, ce que la police savait… Vagualame ne l’avait point trahie. La police ne l’avait pas inquiétée, elle avait pu rejoindre le lendemain le caporal Vinson, le faux caporal Vinson, bien entendu, mais, en vérité, elle sentait qu’elle était entourée de pièges, que ce n’était plus le moment de plaisanter, qu’il valait mieux disparaître. Bobinette était d’autant plus inquiète qu’elle comprenait moins exactement les événements en train. Après l’arrestation de Vagualame, elle n’avait plus eu qu’une seule idée : se débarrasser le plus vite possible du débouchoir, le livrer, toucher la prime. Or, au lieu du caporal Vinson, qu’elle convoquait suivant les ordres reçus le premier décembre, elle devait apercevoir Fandor…
Elle avait alors écrit à l’Hôtel de l’Armée et de la Marine, s’était travestie en prêtre, ainsi que le lui avait recommandé Vagualame avant son arrestation. Vagualame, qui déjà lui avait fait revêtir ce costume lorsqu’il avait jugé intéressant de la conduire à la frontière et de lui faire rencontrer, sur la route de Verdun, le caporal Vinson. Si Bobinette, en effet, le matin où elle avait rencontré Fandor en Fandor, était elle-même en Bobinette, c’est que la jeune femme s’était fait exactement le même raisonnement que le journaliste…
Fandor s’était dit :
« N’allons pas au rendez-vous du caporal Vinson ; voyons d’abord qui nous convoque. » Bobinette avait pensé :
« Passons en Bobinette sous les arcades, je verrai bien si le caporal Vinson est là, et si par hasard il n’est pas seul… »
Ils s’étaient rencontrés tous les deux sans deviner l’un et l’autre qui ils étaient : Fandor, le faux Vinson ; Bobinette, le prêtre mystérieux… Et ils s’étaient retrouvés sans se reconnaître l’après-midi, chacun ayant repris, à la réflexion et ne jugeant plus la chose dangereuse, sa fausse personnalité.
Ce jour-là, Bobinette avait eu à Rouen une terrible surprise…
Le télégramme reçu au garage, télégramme qui avait tant intrigué le faux caporal Vinson et l’avait en quelque sorte décidé à fuir le lendemain du Carrefour Fleuri, était en effet envoyé à Bobinette par… Vagualame.
Comment Vagualame, qu’elle avait vu arrêter la veille, avait-il pu lui adresser cette dépêche ?
Bobinette se l’était demandé, terrifiée, ignorant qu’il y avait deux Vagualame, un vrai et un faux, et que le faux seul était arrêté…
Dans cette dépêche rédigée en langage chiffré, en langage conventionnel, Vagualame, renseigné par une méticuleuse surveillance de l’Hôtel de l’Armée et de la Marine, l’avertissait d’avoir, coûte que coûte, et le plus rapidement possible, à se séparer du caporal Vinson, qui, lui, n’était pas le vrai caporal Vinson, mais bien un contre-espion…
Bobinette, ou plutôt le faux prêtre, lisant cela, avait pensé s’évanouir d’effroi. Elle n’avait plus eu dès lors qu’une seule idée : disparaître au plus vite.
Mais Vinson craignait que le faux ecclésiastique ne le livrât à l’autorité militaire. Pour parer au danger, il n’avait point voulu permettre à son compagnon de route d’aller coucher à la cure…
Force avait bien été à Bobinette de partager sa chambre avec Fandor-Vinson.
Si bien qu’au petit matin, alors que Fandor proposait de descendre pour préparer la voiture, Bobinette s’était hâtée d’accepter et, perdant la tête, littéralement affolée, s’était enfuie, à pied vers Rouen, tandis que Fandor s’échappait vers Motteville…
Ils laissaient l’un et l’autre dans la chambre le débouchoir qui, quelques heures plus tard, devait occasionner l’arrestation du mécanicien, arrestation qui d’ailleurs, Bobinette l’avait appris par les journaux, n’avait pas été maintenue…
Bobinette rencontrant au cours de sa fuite le lieutenant Henri, et de plus assistant à la gare Saint-Lazare à l’arrestation du faux caporal Vinson, arrestation qui l’ahurissait, avait définitivement compris que les choses se gâtaient pour elle…
Et c’est pourquoi elle avait écrit au baron qu’elle était souffrante. Sans ressources, Bobinette avait mis au Mont-de-Piété les quelques bijoux qu’elle possédait puis, subitement, avait reçu une nouvelle lettre signée « Vagualame ».
Bobinette avait naturellement obéi aux instructions qu’on lui donnait dans cette lettre, plus inquiète de savoir Vagualame libre que de la façon dont il avait pu se procurer son adresse. Elle avait, en effet, eu maintes preuves de la puissance du bandit et n’ignorait pas que celui-ci ne perdait jamais de vue ceux dont il avait intérêt à suivre la piste… Quelques jours avant, s’ennuyant, désireuse aussi de s’assurer une protection qui pouvait, à un moment donné, lui être utile, elle avait écrit à son frère Geoffroy pour lui donner rendez-vous au Veau-qui-Pleure…, histoire de renouer connaissance.
***
– Mets-toi là… proposait Geoffroy-la-Barrique, faisant asseoir Bobinette à ses côtés.
Il ajoutait immédiatement :
– Qu’est-ce que lu prends ?
Bobinette commanda une « consommation de dame », ainsi que le remarqua plaisamment le patron du Veau-qui-Pleure : un sirop de groseille. Puis le frère et la soeur s’interrogèrent sur ce qu’ils étaient devenus. Le brave Geoffroy, avec une naïve franchise, contait ses histoires embrouillées de places prises et abandonnées, de coups de poing donnés et reçus… Pour Bobinette, plus mystérieuse, elle se borna à affirmer à son frère qu’elle était heureuse et tranquille.
– Figure-toi, lui disait-elle, que je suis maintenant demoiselle de compagnie chez une vieille dame, une Russe qui, je crois bien, a eu dans le temps des ennuis avec la police de son pays…
– La police, interrompit le grand colosse ; je n’aime pas beaucoup la police…
– Il vient beaucoup de monde chez elle ! le suis de tous les dîners et de toutes les parties…