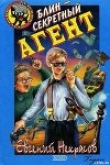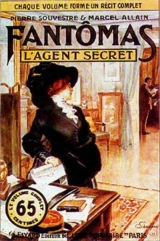
Текст книги "L'agent secret (Секретный агент)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
30 – FANDOR N’EST PLUS FANDOR
Le journaliste trépignait sur sa chaise :
– Enfin, s’écria-t-il, vous n’allez quand même pas prétendre, mon commandant, que je ne suis pas Jérôme Fandor ?
L’entrevue durait déjà depuis une heure et ne ressemblait en rien à celle qui, six jours auparavant, avait affecté les allures d’une scène de vaudeville. Six jours en effet s’étaient écoulés depuis le moment où le commandant Dumoulin avait découvert qu’il y avait au Cherche-Midi non pas un seul, mais deux caporaux Vinson, dont un mort, assassiné d’un mystérieux coup de feu. Depuis, le reporter était resté dans la cellule vingt-sept, rigoureusement au secret.
La seule distraction de Fandor, si toutefois c’en était une, était de passer chaque après-midi de longues heures épuisantes dans le cabinet du commandant Dumoulin, faisant fonction de rapporteur, et de discuter avec l’officier de la ténébreuse intrigue dont il était la victime.
Au début des interrogatoires, le commandant Dumoulin s’efforçait généralement de rester calme, pondéré, logique, mais peu à peu son naturel reprenait le dessus, partait au galop et s’emballait.
… Fandor, pour la vingtième fois, avait crié son identité et l’officier, tapotant de la main son dossier, répondait :
– Évidemment… évidemment… ne me faites pas dire ce que je ne pense pas… Je reconnais, Fandor, que vous êtes bien Jérôme Fandor, exerçant la profession de journaliste – puisqu’il paraît que c’est une profession. Mais la question n’est pas là, le problème que je dois élucider en ma qualité de commissaire du gouvernement chargé de l’instruction de cette affaire est de savoir quand et à quel moment précis le nommé Fandor s’est changé en caporal Vinson ?
– Je vous l’ai déjà dit, mon commandant, relisez ma déposition d’avant-hier. Je vais recommencer :
« Le dimanche 13 novembre, à 5 heures du soir, à mon domicile, rue Richer, je recevais la visite d’un militaire que je ne connaissais pas. Il déclara s’appeler Vinson et m’informa qu’il était engrené dans des affaires d’espionnage, qu’il le regrettait et que ne pouvant s’en retirer il allait se tuer.
« Désireux, d’une part, de permettre à ce malheureux de se réhabiliter un jour, désireux, d’autre part, d’entrer en contact avec la bande d’espions dont il dépendait, j’imaginai de prendre sa personnalité et de profiter de son changement de garnison, de son envoi dans un nouveau régiment où il n’était pas connu pour y aller en son lieu et place. C’est dans ces conditions que je suis parti huit jours après, le dimanche vingt novembre, pour Verdun. »
– Vous prétendez donc, observa le commandant Dumoulin, n’avoir pris la personnalité de Vinson qu’à partir de cette date ?
– Je le prétends en effet, mon commandant.
– Mais, monsieur, s’écria celui-ci, c’est là toute l’affaire et c’est ce qu’il importe de prouver.
– La chose n’est pas difficile. J’ai de nombreux alibis à l’appui de mon affirmation…
– Les alibis !.. les alibis !… s’écria-t-il, vous en venez toujours là, je vous demande un peu, qu’est-ce que cela prouve, les alibis ?…
– La vérité ! mon commandant, car il n’y a pas d’être humain au monde, que je sache, qui possède le don d’ubiquité… quand je suis à Paris, je ne suis pas à Châlons ou à Verdun et réciproquement…
– Peuh ! fit-il, avec des gaillards de votre espèce qui se déguisent perpétuellement et changent de tête comme je change de faux-col, peut-on jamais savoir ?… Fandor…
– Mon commandant ?
– Le mardi vingt-neuf novembre, vous étiez bien dans la peau de Vinson, n’est-ce pas ?
– Oui, mon commandant.
– Eh bien, poursuivit celui-ci triomphalement, ce même mardi vingt-neuf novembre, vous étiez aussi sous les traits de Jérôme Fandor au bal de l’Élysée. Ainsi vous voyez…
– Pardon, mon commandant, rétorqua le journaliste, j’avais une permission de vingt-quatre heures, une permission régulière…
– Ah ! n’en parlons pas de ces permissions. Dieu sait avec quelle facilité, vous autres espions, vous parvenez à vous les faire accorder… Au surplus, déclara-t-il, il y a quelque chose de bien plus grave dans votre cas.
– Quoi donc, grand Dieu ?
– Nous en parlerons tout à l’heure… car auparavant nous allons procéder à la confrontation que vous avez désirée… Lieutenant Servin, ajouta-t-il, voyez si les témoins sont là ?…
Jérôme Fandor tressaillit.
Cédant aux instances du journaliste, Dumoulin avait convoqué deux hommes remplissant les fonctions de plantons à la Place de Châlons : ils avaient vécu aux côtés du véritable Vinson.
Deux soldats furent introduits.
D’un ton rogue, Dumoulin interrogea :
– Hiloire ?
– Présent, mon commandant.
– Comment vous appelez-vous ?…
Le soldat écarquilla les yeux et croyant qu’il s’agissait de donner son prénom, déclara en balbutiant :
– Justinien.
– Quoi, grommela le commandant qui fronçait les sourcils, vous ne vous appelez pas Hiloire ?
Déjà l’homme perdait pied, il esquissa quelques explications confuses : il s’appelait à la fois Hiloire et Justinien. Hiloire étant son nom de famille et Justinien son nom de baptême.
– Bon, déclara le commandant qui procéda ensuite à l’interrogatoire d’identité du deuxième troupier, Tarbottin (Nicodème).
L’officier pour simplifier la procédure les questionnait ensemble :
– Vous êtes bien soldats de 2e classe au 213e de ligne et remplissez les fonctions de plantons d’état-major ?
Avec un bel ensemble les deux hommes répondirent :
– Oui, mon commandant.
– Vous connaissez le caporal Vinson ?
– Oui mon commandant.
Dumoulin, d’un geste de la main, désignait Fandor et poursuivait :
– Est-ce lui ?
– Oui, mon commandant ! répondirent encore les deux soldats…
Mais à ce moment le lieutenant Servin fit observer à son chef que les témoins avaient répondu affirmativement, sans même tourner la tête du côté du pseudo caporal.
Le commandant se fâcha. Il cria :
– Espèces d’imbéciles, avant de dire que l’on reconnaît quelqu’un, il faut commencer par le regarder. Regardez le caporal…
Les hommes obéirent.
– Est-ce le caporal Vinson ?
– Oui, mon commandant !…
L’officier insista encore :
– Vous en êtes sûrs ?
– Non, mon commandant.
Le commandant Dumoulin s’exaspérait de plus en plus contre eux.
– Ah, çà, hurla-t-il, est-ce que vous vous foutez du monde ? je m’en vais vous coller huit jours de boîte si vous continuez à être aussi bêtes que ça. Tâchez de comprendre ce que vous faites.. Savez-vous seulement pourquoi vous êtes ici ?
Après s’être consultés du regard un instant, pour savoir lequel des deux prendrait la parole, Tarbottin, moins timide que son compagnon expliqua :
– C’est le sergent qui nous a dit comme ça, mon commandant, que nous étions envoyés à Paris pour reconnaître le caporal Vinson… alors…
– Alors ?
– Alors, continua Hiloire… on le reconnaît !..
Et tous deux conclurent, fiers d’avoir compris la consigne :
– On a des ordres… on les exécute.
Le commandant était devenu écarlate. D’un violent coup de poing, il envoya promener trois dossiers par terre et s’adressant au lieutenant Servin :
– Je ne comprends vraiment pas le capitaine d’état-major qui paraît avoir choisi exprès les plus grandes brutes de son service. Que diable voulez-vous qu’on obtienne de ces gaillards-là ?
Il interrogeait encore son subordonné :
– A-t-on procédé à la contre-épreuve ? leur a-t-on montré le cadavre du vrai caporal Vinson ?
Le lieutenant répondait affirmativement.
– Et qu’ont-ils déclaré ?
– Rien de précis, fit le lieutenant substitut. Ils étaient très émus à la vue du mort. Les traits sont d’ailleurs décomposés, – on n’a rien pu tirer d’eux…
Fandor prit la parole.
– Mon commandant, déclara-t-il, je suis fort surpris que vous ayez cru devoir ne faire venir que ces deux soldats, c’est tout au moins étrange… Véritablement, sans demander de faveur, j’ai le droit de m’attendre à ce que l’instruction du procès que vous voulez m’intenter soit faite plus sérieusement que cela… Un magistrat doit être impartial et…
– Que voulez-vous dire ?
– Je veux dire, éclata le journaliste, que depuis quarante-huit heures vous faites preuve à mon égard d’une partialité révoltante…
– Mais, s’écria Dumoulin, du fond du cœur et abandonnant toute formule protocolaire, je suis pourtant un honnête homme, moi…
Et le commandant avait raison. C’était le plus digne, le plus respectable des officiers, et s’il instruisait avec ardeur l’affaire dont il était chargé, il prétendait le faire sans la moindre animosité, avec la plus grande conscience.
L’officier, surmontant son émotion, reprit, protocolaire :
– Fandor…
Mais il s’interrompit soudain, jeta un regard courroucé aux deux soldats demeurés plantés au milieu de la pièce :
– Qu’est-ce que vous foutez là ? hurla-t-il…
Les soldats saluèrent sans répondre.
– Lieutenant, grogna le commandant Dumoulin, excédé, sortez-les… et qu’on ne les voie plus… qu’on ne les voie plus…
Puis, éprouvant un violent besoin de prendre l’air, Dumoulin annonça :
– Nous reprendrons l’interrogatoire dans cinq minutes.
Le commandant s’était calmé, Fandor de son côté avait retrouvé son sang-froid. Le journaliste se rendait compte que la scène ridicule qui venait de se produire ne pouvait que tourner à son avantage. L’interrogatoire recommença.
Toutefois, ce n’était plus l’irascible rapporteur et le vindicatif inculpé qui se trouvaient l’un en face de l’autre, c’étaient deux hommes de bonne compagnie qui discutaient, causaient.
– Fandor, reprit le commandant, avec une intonation aimable dans la voix, vous avez évidemment été entraîné par des contingences… que je n’ai pas à apprécier, à commettre des choses irrégulières. Nommez-nous vos complices. Il vous en sera tenu compte ?
– Non, mon commandant, si j’ai cru devoir prendre la personnalité du caporal Vinson, c’est uniquement afin de me documenter sur les relations que ce malheureux entretenait « obligatoirement », presque malgré lui, avec des agents d’une puissance étrangère. Je me proposais, lorsque j’aurais connu ceux-ci de les signaler à la justice…
– Autrement dit, vous prétendez avoir fait du contre-espionnage ?
– Si vous voulez.
– On dit toujours cela ! Au cours de ma carrière, monsieur Fandor, il m’est arrivé d’instruire trois ou quatre affaires d’espionnage, eh bien, la défense des coupables est toujours la même : la vôtre. Ce système de défense ne tient pas debout.
– Je ne puis m’en écarter.
– C’est bien, poursuivit le commandant, le conseil appréciera.
Soudain, le commandant Dumoulin qui décidément ne menait pas mal du tout son instruction, ménageant ses effets, sachant les graduer au moment propice, assena un nouveau coup au reporter :
– Fandor, dit-il… Ces complices que vous vous refusez à nommer, ne vous ont-ils pas rémunéré de vos peines ?
– Qu’entendez-vous par là ? demanda le journaliste.
– Ne vous ont-ils pas donné de l’argent ?
– Non.
– Cherchez bien et soyez franc !
Fandor, consciencieusement, fouilla dans sa mémoire, il tressaillit, l’aventure survenue dans l’imprimerie des frères Noret lui revenait soudain à l’esprit. Convenait-il de nier ? Cela répugnait au caractère franc du journaliste. Néanmoins, Fandor s’était juré de ne rien laisser deviner encore de ce qu’il savait. Il persista dans sa déclaration, baissa la tête :
– Non, mon commandant, je n’ai pas reçu d’argent des espions.
L’officier se tourna vers le greffier et l’interpellant :
– Notez cela, greffier, notez cela en soulignant au crayon rouge. Cette déclaration est capitale.
Le commandant fouilla dans un tiroir de son bureau, il en tira une enveloppe cachetée, l’ouvrit, en tira une autre enveloppe.
Fandor suivait curieusement ce manège, se demandait où voulait en arriver l’officier.
D’une troisième enveloppe, le commandant finit par sortir quelques billets de banque jaunis, froissés et, les montrant à Fandor :
– Voici, fit-il, trois billets de cinquante francs neufs qui portent les indications suivantes : A. 4998 O. 4350 U. 5108… On les a trouvés avec d’autres, dissimulés dans votre paquetage à la caserne Saint-Benoît à Verdun. Reconnaissez-vous que ces billets vous ont appartenu ?
– Comment voulez-vous que je le sache, interrogea Fandor, un billet de banque ne se distingue pas d’un autre !
– Si, fit l’officier, par le numérotage… mais j’admets volontiers que vous n’inscriviez pas les numéros de chacun des billets qui passent par votre portefeuille ; nous avons mieux, pour démontrer que ceux que je tiens à la main sont bien ceux qui étaient en votre possession… Ces billets ont été récemment soumis à un examen approfondi au service anthropométrique. Or, il a été démontré, reconnu, qu’ils portaient les traces très nettes de vos doigts… J’espère, monsieur Fandor, que vous ne contesterez pas l’exactitude du service Bertillon ?
– Non, répondit simplement Fandor, j’accepte la conclusion de l’anthropométrie…
– Vous reconnaissez donc que ces billets étaient en votre possession ?
– Eh bien, oui.
L’officier, s’adressant encore au sergent qui remplissait les fonctions de greffier, ordonna :
– Notez cela au crayon rouge, cet aveu est important, très important…
« Fandor, connaissiez-vous le capitaine Brocq ?
– Non, mon commandant.
– Vous le connaissiez ! insista l’officier.
– Non, mon commandant, répéta Fandor qui, aussi, tôt, pris d’une nouvelle inquiétude, interrogea :
– Pourquoi ?
– Parce que, fit en hésitant cette fois le commandant Dumoulin, parce que…
Puis s’étant arrêté un instant, il reprit :
– Vous n’ignorez pas que chez le capitaine Brocq, mystérieusement assassiné, on a volé un document intéressant le plan de mobilisation ?…
– Je le sais, fit Fandor.
– Ce n’est pas tout, continuait, Dumoulin. On a volé également chez le malheureux officier une certaine quantité d’argent. Brocq avait l’habitude de noter sur un carnet les sommes exactes qu’il possédait, et notamment de noter les numéros de ses billets de banque. Or, de son tiroir-caisse, des billets de banque ont disparu ; ceux qui manquaient portaient les numéros A 4998 ; O 4350 ; U 5108… Ce sont ceux que l’on a retrouvés dans vos poches.
Il y eut un silence angoissant. Fandor parut atterré par cette dernière découverte. Tout se liguait contre lui, décidément. Ah ! il était pris, pris comme une souris dans une souricière. D’où lui venaient ces billets que le commandant déclarait avoir été retrouvés dans son paquetage à Verdun ? Parbleu, c’était bien simple, c’étaient les billets que lui avait traîtreusement glissés dans la main l’un des frères Noret, les imprimeurs, billets dont le journaliste ne pouvait alors soupçonner l’origine.
Évidemment, Fandor, dès son départ de Paris sous l’uniforme du caporal Vinson, avait été percé à jour par la bande de traîtres qu’il voulait découvrir. Sans s’en douter, il avait été le gibier que l’on chasse alors qu’il prétendait être le chasseur, et ce chasseur de pacotille était niaisement tombé dans le piège…
Soudain, une inquiétude terrible.
Un être au monde était capable de cela, et Fandor qui n’avait pas voulu y croire quelques semaines auparavant, lorsqu’il en discutait avec son ami le policier, devait désormais en accepter l’hypothèse comme certaine, tant par ses actes invisibles, sa personnalité s’imposait.
C’était signé : Fantômas.
Fandor eut beau faire et se débattre, désormais le commandant Dumoulin était convaincu que son instruction avait franchi un pas immense. Il estima que l’interrogatoire devait s’achever sur un dernier mot, une dernière phrase, qu’il proférait solennellement, donnant ainsi le coup de grâce au malheureux Fandor :
– Fandor, s’écria-t-il, non seulement vous êtes accusé du crime de trahison et d’espionnage, mais eu égard aux aveux formels que vous venez de faire, je vous inculpe, dès à présent, de l’assassinat du capitaine Brocq et du vol de ses documents ainsi que de son argent.
31 – UN DRAME DANS UNE ROULOTTE
Il pleuvait toujours.
Sur la route de Sceaux, tenant tête à la tempête, fonçant dans les rafales qui lui jetaient au visage de véritables trombes d’eau, faisaient envoler les pans de sa longue mante, collaient ses cheveux à son front et par moments la suffoquaient au point que pour respirer elle devait mettre la main devant la bouche, une gitane avançait…
Il fallait en vérité que cette jeune femme courût à un rendez-vous d’importance extrême pour avoir osé se risquer sur la grande route, à pareille heure, par un tel temps…
À une église voisine, l’horloge avait sonné onze coups et la tempête redoublait de vigueur. Il importait peu à la malheureuse fille, qui se répétait :
– Vagualame m’a dit qu’il serait à la première borne kilométrique, passé les hangars d’aviation. Il faut que j’y aille, et j’irai !…
C’était en effet Bobinette, cette gitane, Bobinette qui, obéissant encore une fois aveuglément à celui qu’elle considérait comme son maître, se dirigeait vers le mystérieux rendez-vous que le bandit lui avait fixé il y avait cinq jours…
Ce n’était pas que la fausse gitane fût sans crainte.
Et d’abord, que lui voulait Vagualame ? Bobinette ne s’était jamais avoué qu’elle ignorait à vrai dire qui était Vagualame…
Mais elle était trop fine, trop intelligente pour avoir pu se défendre de noter certaines coïncidences, de remarquer certains détails qui lui avaient fait pressentir que le joueur d’accordéon n’était autre que… Fantômas.
Les trois syllabes résonnaient, à cette heure, dans son cerveau torturé, comme un glas, comme une menace imprécise, indéfinissable, terrible.
Vagualame lui avait dit qu’il lui donnait rendez-vous sur la route de Sceaux, pour lui remettre de l’argent, pour l’expédier à l’étranger, hors d’atteinte de la police… étaient-ce bien là les intentions du bandit ?
Et tout en avançant, Bobinette frémissait en songeant à la bizarrerie de cette rencontre, la nuit, sur une grande route, là où il n’y avait ni chemin de fer, ni moyen de communication d’aucune sorte qui pût vraiment faire supposer un départ à l’étranger…
Une seule chose la rassurait…
Elle sentait à chacun de ses pas battre sur son front le collier de sequins qu’elle avait épinglé à ses cheveux en guise de serre-tête, à la mode des bohémiennes. Elle croyait entendre encore le marchand qui lui avait vendu ce collier, un vieux revendeur des environs du Trône, lui chanter la chanson célèbre des gitanes andalouses :
« Le corail luit sur ma peau brune,
« L’épingle d’or à mon chignon,
« Je m’en vais chercher fortune… »
…Était-ce vraiment vers la fortune qu’elle courait par la nuit mauvaise ? N’importe !
Bobinette se disait, qu’après tout, puisque Vagualame l’avait convoquée en tenue de gitane, c’est qu’évidemment il avait bien l’intention de favoriser sa fuite. Elle n’imaginait point, autrement, qu’il ait pu prévoir la nécessité de ce déguisement…
Bobinette, tout en réfléchissant, avançait d’un bon pas, levait la tête, tentait de s’orienter. La veille, pour ne pas risquer de manquer au rendez-vous que lui avait désigné Vagualame, elle s’était rendue sur la route de Sceaux, elle avait été reconnaître l’endroit où la nuit suivante elle devait rencontrer le bandit. Elle pouvait maintenant se rendre compte qu’elle n’était plus très loin de la borne kilométrique, terme mystérieux de sa course nocturne… Or, Bobinette, soudain, eut un sursaut de frayeur…
À gauche de la route, toute bordée de grands arbres que l’hiver avait dépouillés de leurs feuilles, qui se dressaient, mélancoliques, avec des airs de fantômes décharnés, elle venait d’apercevoir quelque chose de sombre, comme une tache noire, plus noire encore que la nuit environnante…
Qu’était-ce ?… Au même moment, dans la nuit, une plainte s’était élevée, plainte étrange, longue, sourde, profonde, comme exhalée de quelque gosier infernal, cri, hurlement, appel, grondement, elle n’aurait su le dire, et voilà qu’elle s’arrêtait, tremblante, glacée d’effroi, les oreilles encore bourdonnantes, le cœur étreint d’une abominable frayeur. Doutant de ses sens, Bobinette demeura un instant immobile, n’osant plus faire un pas…
Et soudain, dans la rafale qui passait en sifflant dans les branchages des arbres, elle entendit une voix railleuse, sèche, impérative, voix de menace, voix de commandement.
C’était la voix de Vagualame :
– Avance donc, grande sotte, pourquoi t’arrêtes-tu ?
Bobinette fit effort sur elle-même, reprit sa marche.
Elle arrivait quelques secondes après, aux côtés de Vagualame qui venait au-devant d’elle :
– Avez-vous entendu ?
Elle haletait en songeant au mystérieux grondement qu’elle venait de surprendre…
Vagualame haussait les épaules :
– J’ai entendu, répondit-il, le vent qui hurle, la pluie qui grésille, les arbres qui s’inclinent… et voilà tout…
– On a crié ?
– Qui, on ? nous sommes seuls ici !… Bobinette, tu es seule avec moi !…
Le bandit se tut puis il reprit avec une intonation de raillerie :
– Tu n’as pas peur ?
– Non, Vagualame, je n’ai pas peur, mais…
– Mais tu trembles, dit le bandit avec un éclat de rire qui sonna étrangement faux…
Il passait soudain son bras sous le bras de Bobinette, la jeune femme sentait qu’il l’empoignait d’une étreinte de fer, qu’il la forçait à avancer :
– Viens ! Viens t’abriter.
Et vers la tache sombre que Bobinette n’avait point encore identifiée, Vagualame attira la jeune femme :
– Mettons-nous là, disait-il ; ici, du diable si nous pourrions jamais causer… or, nous avons à causer !…
Ils étaient, quelques secondes après, tous deux accotés contre une roulotte de bohémiens, rangée sur le bas côté de la route.
– Ton futur domicile, dit Vagualame en montrant la voiture à Bobinette, complètement ahurie. Mais ce n’est pas encore l’heure d’emménager, nous avons à causer.
Le bandit était enroulé, des épaules aux pieds, dans une sorte de cape sombre qui empêchait de rien distinguer de son habillement. Bobinette voyait tout juste sa silhouette. Il lui était impossible d’apercevoir son visage, sans doute dissimulé par le bord rabattu du feutre mou qu’elle apercevait, se détachant par instants à la lueur des éclairs, sur le ciel. Pourtant elle frissonna, elle avait clairement compris qu’une menace était contenue dans les dernières paroles de son maître !
– Que voulez-vous dire ? que m’ordonnez-vous ?
Vagualame fit quelques pas en avant, puis, revenant en arrière, s’arrêta droit devant la jeune femme, toujours appuyée à la roulotte de bohémiens :
– Bobinette, écoute-moi ! écoute-moi de toute ton âme ! car, par Dieu, voilà les dernières paroles qu’il te sera jamais donné d’entendre !…
Et sans laisser le temps à la jeune femme de l’interrompre :
– Dis-moi, que connais-tu de plus misérable, de plus bas, de plus méprisable, de plus honteux que la trahison, le piège tendu ? que la souricière combinée contre celui que n’a jamais été que votre ami, que votre défenseur ? Dis-moi, Bobinette, qu’y a-t-il de plus haïssable que le Judas qui vous vend d’un baiser ? Dis-moi, Bobinette, qu’y a-t-il de moins digne de pitié que la lâcheté du criminel qui trahit son complice ? du bandit qui livre son chef, pour rien, pour de l’argent, peut-être, pour moins, par peur ! pour se sauver lui-même ?… Allons ! réponds ! réponds, Bobinette ! je te l’ordonne !
– Je ne vous comprends pas !… j’ai peur !…
– Vraiment ! dit-il enfin, tu ne me comprends pas ? Tu as peur ?… Allons donc ! si tu as peur, c’est que tu me comprends !…
Dans un râle, Bobinette hurla :
– Mais vous êtes fou ! Vagualame… que croyez-vous ? Pitié !… pitié !…
– Bobinette, tu te trompes étrangement !… Je ne suis pas de ceux à qui l’on crie pitié… Je ne connais point ce mot ! je n’ai point cette faiblesse ! je ne l’ai jamais eue ! je ne l’aurai jamais, pour personne !…
Il se tut une seconde, puis reprit, comme emporté dans une subite colère :
– Et tu crois que je suis fou ? Ah çà ! Bobinette, mais quelle femme es-tu donc pour essayer de me tromper ? Quelle est donc ta folie, à toi, pour penser que tu vas me duper ? moi ?
– Vagualame, qui êtes-vous ? dites-le-moi…
– Qui je suis ! pardieu !… tu le demandes ? tu veux le savoir ? Eh bien ! qu’il soit fait suivant ta volonté !… C’est ta dernière volonté !… Qui je suis ?… regarde !
Lentement, d’un mouvement digne et sûr, Vagualame déroula la longue cape dans laquelle il était enveloppé.
Il arracha son chapeau qu’il jeta à ses pieds et les bras croisés, fixant Bobinette, il l’apostrophait :
– Ose dire mon nom, ose me nommer !…
Le mendiant de tout à l’heure, sa cape enlevée, dépouillé de son chapeau, apparut soudain, non plus comme un vieillard au corps tassé, mais comme un homme à coup sûr jeune, vigoureux, superbement musclé. Il était vêtu, ganté plutôt, d’un maillot collant de laine noire qui, des pieds jusqu’au cou, le gainait étroitement…
Bobinette ne pouvait apercevoir son visage : celui-ci était dissimulé par une longue cagoule noire enveloppant entièrement sa tête. Seuls les yeux d’où sortaient deux reflets fauves, deux regards de feu, lumineux, impressionnants dans leur fixité, étaient apparents…
Cette vision, la vision de cet homme, sans visage, sans ressemblance avec un autre homme, la vision de cette apparition au masque anonyme, au corps de statue, de cet être qui n’était aucun être reconnaissable, avait quelque chose de si précis en son mystère que Bobinette, un quart de seconde, l’ayant contemplé, hurla d’une voix rauque, inhumaine, mourante :
– Fantômas ! ah ! vous êtes Fantômas !
… L’orage redoublait de violence, la tempête déchaînée multipliait ses hurlements sinistres, la nuit se faisait plus sombre, la pluie plus lourde, le vent plus impétueux.
– Fantômas ! vous êtes Fantômas !
Comme à dessein, comme jouissant du trouble de la pauvre fille, le bandit ne se hâtait pas de répondre :
– Eh bien, oui ! faisait-il enfin, je suis Fantômas !… Je suis celui que le monde entier recherche, que nul n’a jamais vu, que nul ne peut reconnaître ! Je suis le Crime ! Je suis la Nuit ! Je n’ai pas de visage, pour personne, parce que la nuit, parce que le crime n’ont pas de visage… Je suis la puissance illimitée ; je suis celui qui se raille de tous les pouvoirs, de toutes les forces, de tous les efforts. Je suis le maître de tous, de tout, de l’heure, du temps. Je suis la Mort. Bobinette, tu l’as dit, je suis Fantômas…
Il semblait à la malheureuse que la respiration lui manquait.
Tandis que le bandit prononçait sa sinistre apologie, tandis qu’il se vantait de l’impunité qu’il avait su toujours s’assurer, en ne se laissant jamais voir sous sa véritable forme, en trompant toujours ceux qui s’acharnaient à sa poursuite, Bobinette croyait mourir, croyait s’écrouler sur le sol… ses jambes vacillaient, un vertige l’entraînait toute, elle tomba à genoux :
– Pitié ! maître !… pitié ! Fantômas !
Il railla encore :
– Fantômas avoir pitié ! Ah ! Bobinette, comme ton cerveau est petit ! comme ton intelligence est médiocre ! vouloir accoler ces deux mots : Fantômas et pitié… Quelle dérision !
Il poursuivit, pris d’une colère furieuse :
– Fantômas ne fait point merci ; Fantômas ordonne et qui lui résiste disparaît…
– Mais qu’ai-je fait ?… maître, Fantômas… qu’ai-je fait ?…
Lentement, le bandit qui avait ramassé sa cape, s’enroula dans le vêtement mystérieux. Encore qu’il eût lâché Bobinette, il ne pouvait venir à la pensée de cette dernière de tenter seulement de prendre la fuite. De toute la force de sa volonté, Fantômas l’immobilisait comme un oiseau est hypnotisé devant le chat qui le guette. Il jouait avec elle. Il était certain d’en être maître au moment où il lui plairait de s’en saisir…
– Ce que tu as fait ? tu as voulu me trahir. Tu as indiqué à la police, à Juve ou à Fandor, à mes ennemis personnels, à ceux qui veulent ma mort, aux seuls hommes qui jusqu’ici aient su déjouer mes plans, le repaire des Russes.
– Je ne l’ai pas fait, hurla Bobinette. Je vous jure…
Mais Fantômas était convaincu que la jeune femme l’avait trahi. Pour une fois son admirable perspicacité se trouvait en défaut. Il ne soupçonnait pas comment Juve avait pu savoir cette adresse. Il était persuadé que seule Bobinette avait pu la fournir, et il dédaigna de répondre directement à la protestation de la jeune femme :
– Tu vas mourir, dit-il… Mais il ne sera pas dit que moi, Fantômas, j’aurai jamais porté la main sur l’un de ceux qui me servent, sur l’un de ceux que j’emploie… tu vas mourir, mais ce ne sera pas de ma main, je te donne à la mort, je ne veux pas te tuer…
***
Bobinette entendait des cloches carillonner. Il semblait à la jeune femme qu’elle ne reposait pas sur le sol, qu’elle était légère, légère… Et puis, tout à coup, Bobinette avait la sensation que rien ne la soutenait plus, qu’elle croulait, qu’elle roulait dans un abîme. Bobinette fit un effort sur elle-même, voulut ouvrir les yeux, tenter un mouvement, elle se dressa, s’assit, souleva ses paupières… elle ne rêvait pas. Bobinette comprit qu’elle s’était évanouie et qu’elle avait imaginé les sensations ressenties la minute d’avant alors qu’elle revenait à la vie peu à peu… Elle revenait à la vie. Cela lui semblait surprenant, au point qu’encore étourdie, elle se demanda si il était bien vrai qu’elle vivait encore. Fantômas l’avait menacée de mort, et elle vivait, cela n’était pas possible. Et ce fut soudain une minute d’angoisse qui la tenaillait. Où était-elle ?
Bobinette se sentait si faible, si étourdie, qu’elle demeura assise, sans tenter un mouvement… Que s’était-il passé exactement ?… Oui ! c’était bien cela… Au moment où Fantômas lui disait qu’elle allait mourir, elle était tombée sur la route, sa jupe était encore mouillée… elle avait froid… mais qu’était-il arrivé depuis ?
Bobinette entendit le vent qui soufflait. La pluie tombait toujours, mais elle remarqua qu’elle ne la recevait plus sur le visage…
– Où suis-je ?
Nette, la réponse à la question lui apparut soudain :
– Fantômas m’a enfermée dans la roulotte, c’est dans la roulotte contre laquelle nous étions appuyés que je suis prisonnière…
Elle tâta le sol autour d’elle… Elle était bien sur un plancher, grossièrement raboté… elle s’agenouilla, elle étendit les bras et heurta une paroi… Vraiment oui, elle était dans la roulotte, elle pouvait craindre que Fantômas soit tout près, elle pouvait redouter son apparition… Elle n’était pas sauvée.
Mais si l’effroi qui avait jeté Bobinette par terre, évanouie, privée de sentiments, avait été terrible, il était moins causé par la crainte de la mort que par la surprise d’être face à face avec Fantômas. Maintenant qu’elle était seule, la jeune femme redevenait maîtresse d’elle-même. Fantômas lui avait dit : « Tu vas mourir ! »