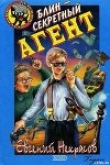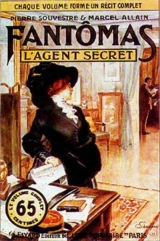
Текст книги "L'agent secret (Секретный агент)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Elle décidait au contraire qu’elle vivrait, qu’elle se sauverait. Il fallait qu’elle échappât…
Bobinette se remettait peu à peu de son malaise. Au fur et à mesure que l’inquiétude la reprenait, elle se sentait plus forte, plus disposée à la lutte aussi.
Elle pensa :
– Si Fantômas était là, je l’entendrais. Il a dû partir ? Il faut que je m’évade de cette prison avant son retour…
Bobinette se leva. La roulotte avait bien une porte, une fenêtre ?… elle réussirait à briser un panneau de bois ? à arracher une grille ? Elle était forte, et c’était sa vie qu’elle défendait.
Bobinette promena ses mains sur la paroi de la voiture. Elle entreprit d’en faire le tour… Il y avait déjà quelques instants qu’elle tâtonnait de la sorte – la roulotte devait être vide, sans aucun meuble, car elle suivait exactement la paroi sans rien rencontrer qui la fît trébucher – lorsque soudain elle sentit que sa main venait de frôler quelque chose d’indéfinissable, de doux, de chaud, qui bougeait.
D’un bond, Bobinette s’était jetée en arrière. Ah çà ! elle était folle ! qu’imaginait-elle ? La jeune femme, après quelques secondes d’attente, s’avança à nouveau… à nouveau ses doigts frôlèrent, quoi ? elle n’aurait su le dire…
Mais tandis qu’elle s’efforçait de définir l’étrange objet que sa main heurtait, voici qu’elle sentait que cet objet se reculait, se dérobait à sa caresse… et soudain la roulotte s’emplissait d’un grognement formidable, terrible, abominable, un grognement qu’elle reconnaissait, qui était la répétition du cri qu’elle avait entendu, une heure avant, dans la nuit, lorsqu’elle se rendait au sinistre rendez-vous. Bobinette faillit mourir d’effroi : elle avait compris, elle avait deviné. Au fond de la roulotte dormait un fauve. C’était un ours qu’elle venait de réveiller. Fantômas l’avait enfermée avec un fauve pour la faire dévorer vive… Blême, retenant sa respiration, pensant mourir de peur, Bobinette s’était reculée à l’extrémité de la roulotte et, de longues heures, elle attendait… Que faire ?
Par bonheur, l’animal avait dû se rendormir. Elle entendait sa respiration lourde et au fur et à mesure que l’air devenait plus rare dans la voiture hermétiquement close, l’odeur de la bête la prenait à la gorge.
– Que faire ?
Et Bobinette terrifiée, toute la nuit, songea :
– Il dort… mais il va se réveiller demain matin, il se jettera sur moi ! je suis perdue !
***
Après des heures interminables d’attente, d’immobilité, de stupide hébétement, devant la mort inévitable, horrible, torturante, on commençait à y voir clair.
Elle avait entendu, peu à peu, décroître la fureur du vent. La pluie s’était arrêtée. Dehors, un petit jour blafard venait de se lever, et dans les parois de bois de la roulotte, de minces lézardes laissaient passer des traits de lumière…
Bobinette vit l’ours se réveiller, se retourner, bâiller et soudain accroupi, la considérer fixement…
– Que faire ? Que faire ?…
Bobinette avait lu jadis qu’il était possible, par le regard, d’effrayer une bête féroce…
Elle s’efforçait de mettre dans ses yeux une énergie farouche, mais, hélas ! elle avait trop peur elle-même, pour pouvoir faire peur au monstre…
L’ours se léchait.
– Que faire ?
De temps à autre Bobinette entendait passer, contre sa prison, de rapides grondements. Elle se rendait compte que c’étaient là des automobiles, qui, sur la grande route, s’en allaient vers Versailles ou vers Paris, dépassant la roulotte abandonnée bien loin de se douter du terrible drame dont elle était le théâtre…
Appeler ?
C’était folie !
Comment supposer qu’on entendrait ses cris ?
Comment supposer que les conducteurs de ces voitures passant à toute vitesse, insoucieux, auraient jamais l’idée de s’arrêter près de la roulotte, de venir lui porter secours ?… Non ! certes, c’était réveiller la colère de l’ours, c’était l’exciter, c’était hâter la mort…
***
– Hue !… sacré carcan !… il est vrai que je dois être un bien mauvais charretier… cette bête n’a pas du tout l’air de me prendre au sérieux !…
Au long de la route de Sceaux, un homme marchait à grands pas, vêtu en habits de travail et conduisant une maigre haridelle, la conduisant d’ailleurs en dépit du bon sens.
– Nom d’un chien ! faisait-il, si je devais aller loin, j’aimerais mieux abandonner mon cheval que de m’obstiner à le diriger… évidemment, je n’ai pas la voix qu’il faut !… Diah !… diah !
Le cheval, malgré l’ordre impératif du charretier, tourna franchement à gauche…
Soudain, l’homme blêmit.
– Ai-je rêvé ? dit-il.
Puis, ayant de nouveau prêté l’oreille, il s’élança au pas de course à travers champs.
– Arriverai-je trop tard ?
Le charretier courait à perdre haleine, approchait de la roulotte abandonnée.
Arrivé à celle-ci, il colla l’oreille à la porte. Et soudain, d’une détente, il enfonça la porte à coup d’épaule.
Un coup de feu troua le silence de l’aube.
Bobinette était écroulée, le visage tailladé.
Le charretier posa la main sur la poitrine de la jeune fille :
– Elle vit… N’ayez plus peur, Bobinette, c’est Juve qui vous parle.
32 – DE CHARYBDE EN SCYLLA
Il ne restait plus qu’un accusé à juger, et l’on pressentait, au mouvement de l’auditoire ainsi qu’à la rumeur confuse qui s’échappait de la salle, que l’audience allait bientôt être levée.
Six heures venaient de sonner à l’horloge du vieux bâtiment où siège le conseil de guerre et les juges militaires commençaient à se fatiguer d’une séance qui durait depuis midi et demie.
Fait curieux et de nature à surprendre quiconque connaissant les habitudes du tribunal militaire, et le peu d’attrait qu’il exerce en temps ordinaire sur le public, la salle était ce jour-là, très encombrée. Une assistance nombreuse suivait les péripéties des insignifiantes affaires que l’on jugeait.
Au public interlope et quelque peu minable qui se pressait sur les bancs de la salle, se mêlaient, évoluant plus librement dans les couloirs et dans l’enceinte réservée, un certain nombre d’avocats en robe.
Quelques journalistes aussi, des reporters photographes de temps à autre jetaient un coup d’œil à l’entrée du prétoire, s’intéressant aux préparatifs d’aménagements et de barricades déjà pris, semblait-il, en vue d’une prochaine et importante audience.
Dans quelques jours, en effet, le 28 décembre, le premier conseil de guerre allait avoir à se prononcer sur le cas du journaliste Jérôme Fandor, dont l’instruction avait été rapidement menée, très militairement, par le commandant Dumoulin, commissaire du gouvernement. Celui-ci renvoyait le prévenu devant les juges militaires, sous de multiples inculpations dont la moins grave était peut-être encore celle d’espionnage.
Déjà le président du conseil, le colonel Marétin, avait été l’objet de multiples demandes de cartes, et l’on pressentait que si de sérieuses précautions n’étaient pas prises, la modeste petite salle d’audience serait très vite trop envahie le jour du procès.
***
Isolé dans la lugubre cellule qui, depuis une quinzaine lui servait de rigoureuse et monotone demeure, le malheureux Jérôme Fandor ne savait absolument rien de tout ce qui se passait, ignorant du tapage que faisait dans le monde parisien l’affaire dont il allait devenir le héros.
Certes, – il fallait rendre cette justice au rapporteur, – la captivité de Fandor avait été adoucie dans la mesure du possible. Fandor pouvait faire venir ses repas du dehors et des livres de la bibliothèque. Mais le prisonnier se préoccupait fort peu de sa nourriture, et n’avait guère l’esprit à lire les romans insipides ou les poésies maussades que l’autorité militaire voulait bien lui prêter.
Fandor aurait voulu avoir une communication quelconque avec le dehors. Bien entendu son vœu le plus cher eût été de voir Juve, mais l’entrée de la prison avait été rigoureusement interdite au policier qui, vraisemblablement, aurait à intervenir au procès en qualité de témoin. Fandor aurait pu s’entretenir avec son avocat, s’il avait jugé bon de s’en assurer un, mais tout au début de son incarcération, le journaliste avait décliné avec indignation le droit absolu qu’il avait de se faire assister d’un conseil. Il se méfiait des bavardages, – même d’un maître du Barreau – qui n’aurait sans doute pas compris son rôle exact, et Fandor, sûr de lui, préférait défendre lui-même sa cause.
Par la suite, il s’était rendu compte que peut-être l’appui d’un avocat aurait pu présenter cet avantage de le mettre en communication avec l’extérieur, mais tout compte fait, Fandor ne voulant pas revenir sur sa décision prise, ne voulant pas avoir l’air de capituler, s’était résigné à ne rien changer à sa situation.
Ah, s’il avait pu recevoir un journal, un simple journal !
L’infortuné Fandor, pendant les longues heures qu’il passait dans sa cellule, en tête à tête avec ses pensées, déplorait dès lors plus que jamais son isolement dans le monde, car Juve mis à part, il ne comptait aucun intime, il ne se connaissait aucun parent qui pût venir lui apporter une consolation, lui murmurer à l’oreille quelques paroles de tendresse et d’affection.
***
Ce soir-là, le journaliste fut tiré de ses réflexions absorbantes par un bruit connu de lui, mais qui se produisait à un moment inaccoutumé.
La clé de la grosse porte de sa cellule tourna dans la serrure, et comme la porte s’entrebâillait, Fandor entendit cette fin de conversation entre son geôlier et un inconnu :
– Je vous préviens aussi, mon brave, disait la voix ignorée de Fandor, que mon secrétaire viendra tout à l’heure me rejoindre…
Le geôlier répondait :
– C’est une affaire entendue, Maître, j’en aviserai le collègue qui me remplacera dans un quart d’heure.
Un avocat en robe entrait dans la cellule. Le prisonnier crut d’abord qu’il s’agissait de l’avocat d’office que le Conseil de guerre lui imposerait à l’audience, conformément à la loi. Nullement disposé à s’entretenir avec ce défenseur obligatoire, il s’apprêtait à fort mal le recevoir, lorsque ayant regardé le visage du nouvel arrivant, Fandor demeura interdit. Il venait de reconnaître sous la toge, quelqu’un dont la physionomie était profondément gravée dans son souvenir, bien qu’il ne l’eût rencontré qu’une fois :
– Naarbo… laissa-t-il échapper.
Mais l’interlocuteur, d’un geste brusque lui coupait la parole, et précipitamment, referma derrière lui la porte de la cellule.
Lorsque ce fut fait, l’étrange avocat s’approcha de Fandor et à mi-voix :
– N’ayez pas l’air de me reconnaître, déclara-t-il, oui je suis bien le baron de Naarboveck, mais c’est grâce à un subterfuge que j’ai réussi à vous approcher… Ne me demandez pas comment j’ai pu réussir à pénétrer auprès de vous sans éveiller les soupçons de ceux qui sont chargés de vous garder, j’ai obtenu un permis de communiquer en me donnant pour l’avocat que le bâtonnier vous a désigné d’office et dont vous recevrez demain la visite… Monsieur, reprit après une pause le baron de Naarboveck, un bienfait n’est jamais perdu quand on n’a pas affaire à un ingrat. Il y a quelques semaines, lorsque vous êtes venu m’interviewer au sujet du déplorable assassinat du capitaine Brocq, après m’être laissé aller à parler devant vous, je vous ai demandé votre parole de ne point publier sur mon compte une série de détails, comme les journalistes à l’ordinaire, aiment à en émailler leurs articles ?
– En effet, répliqua Fandor, je m’en souviens.
– J’avoue, continua le baron, que je m’attendais fort peu à de la discrétion de votre part… dame., un journaliste. Depuis lors j’ai suivi avec attention et même sympathie les ténébreuses aventures auxquelles vous avez été mêlé et ce n’est pas sans émotion que j’ai appris votre fâcheuse situation. J’irai droit au but, je viens vous tirer d’affaire.
Fandor ne put réprimer un geste de joie, il prit dans ses deux mains celles de Naarboveck et les serra chaleureusement.
– Ah ! Monsieur, puissiez-vous dire vrai !
Le diplomate, hâtivement, s’arrachant à l’étreinte du journaliste, ouvrit la lourde serviette d’avocat qu’il portait sous son bras et en tira une toge noire, semblable à la sienne, une toque, un pantalon foncé :
– Tenez, poursuivit-il, tandis que Fandor absolument abasourdi considérait cette étrange garde-robe, tenez habillez-vous rapidement et nous partirons ensemble…
Naarboveck était-il devenu subitement fou ? Était-ce une plaisanterie ? Fandor hésitait, mais Naarboveck, sans paraître s’apercevoir de son trouble, à mots précipités, insistait :
– Il faut absolument que vous partiez d’ici, je sais où vous aurez les preuves de votre innocence, nous n’avons pas une minute à perdre, au surplus moi-même, eu égard à ma qualité de diplomate, j’ai le plus vif intérêt à ce que le document volé chez le capitaine Brocq soit retrouvé. Je sais où il est, je veux que ce soit vous qui le rendiez au Gouvernement ! Ce sera là la preuve la plus éclatante que vous puissiez donner de votre innocence !
Fandor croyait rêver et, machinalement revêtait la tenue bizarre, mais ingénieuse, qu’était venu si mystérieusement lui apporter le baron. Certes, Fandor se demandait bien quel était le formidable intérêt qui avait poussé le diplomate à oser s’introduire ainsi, en dépit des dangers courus, auprès du prisonnier, à lui proposer même de se faire le complice de son évasion ? Mais Fandor avait vu tant de choses bizarres et incompréhensibles au cours de son aventureuse existence qu’il n’en était pas à se préoccuper de semblables détails.
Et au surplus, que risquait-il ?
N’avait-il pas maintes fois, au cours de ses crises de désespoir, caressé en pensée l’irréalisable désir de profiter d’un moment d’inattention pour s’enfuir, même en employant la force, de l’odieux cachot dans lequel on l’avait enfermé ?
– Le plus dur, murmura Naarboveck à l’oreille du journaliste, sera de nous faire ouvrir la porte de la prison. Heureusement, j’ai prévenu le geôlier que j’attendais mon secrétaire… Espérons qu’en vous voyant, il vous prendra pour lui et que nous bénéficierons de la confusion.
***
La prison militaire du conseil de guerre de Paris n’est pas une prison comme les autres et c’est pourquoi le plan de Naarboveck pouvait avoir des chances de réussir, tandis qu’il aurait certainement échoué si on l’avait tenté à la Santé.
Le rez-de-chaussée où se trouvaient évidemment, au siècle dernier, les cuisines et les communs, constitue à proprement dire la prison, car dans ces locaux sont aménagées les cellules où les inculpés attendent leur comparution devant les juges.
Nul, à moins d’être au courant de ces dispositions immobilières, ne se douterait que la porte basse que l’on remarque à peine dans le vestibule d’entrée, juste en face de l’escalier qui accède au premier étage, n’est autre que l’entrée de la prison. En effet, sitôt cette porte basse franchie, on est dans le couloir sur lequel donnent les cellules.
À la porte de la prison se tient d’ordinaire un gardien, dont le rôle est moins de surveiller les prisonniers et de prévenir leurs tentatives d’évasion que d’ouvrir aux personnes qui ont besoin d’entrer dans le sinistre local.
Lorsque arrive la nuit, la surveillance se relâche souvent. Le gardien est en même temps chargé de l’entretien des bureaux et lorsqu’il a sa clé dans sa poche, certain que nul n’enfoncera la lourde fermeture, il va et vient dans la maison.
De Naarboveck qui, évidemment, s’était renseigné au préalable, était non seulement au courant de ces détails, mais savait que ce jour-là, comme les jours précédents d’ailleurs, comme les jours à venir jusqu’à la date du procès Fandor, vu l’affluence de curieux, d’avocats, etc., on avait décidé de donner au gardien un aide et que celui-ci prenait son service à partir de six heures. Il était six heures passées.
Selon toutes probabilités, lorsque les faux avocats frapperaient de l’intérieur de la prison pour se faire ouvrir la porte communiquant avec l’extérieur, ce serait le gardien supplémentaire qui viendrait leur livrer passage !
Non sans émotion, Naarboveck tapa de son index au judas ménagé dans la lourde clôture.
Un bruit de verrous retentit, la prison s’entrouvrait, la silhouette du gardien apparut et Fandor réprima un soupir de satisfaction : c’était un geôlier qui ne le connaissait pas, c’était le remplaçant prévu, escompté !
– Tiens ! s’écria celui-ci, en saluant militairement les gens de robe, vous étiez donc deux ?…
– Naturellement mon brave, répliqua Naarboveck d’un ton prodigieusement calme, votre collègue ne voua a-t-il pas prévenu que mon secrétaire m’avait rejoint ?
– J’avais compris qu’il allait venir, fit l’homme, je ne savais pas qu’il était déjà là.
Mais le baron de Naarboveck l’interrompait et, avec un gros rire :
– Nous partons ensemble…, quoi de plus naturel ?
– C’est votre droit, grommela l’homme, vous avez fini d’interroger le prévenu Fandor ?
Le geôlier allait entrer dans la prison pour vérifier si la cellule du prisonnier était bien fermée… Naarboveck l’arrêta par le bras.
– Mon brave, dit-il en lui glissant une pièce d’argent dans la main, nous ne sommes pas en tenue convenable pour sortir dans la rue, et nos vêtements civils sont restés au Palais de Justice, faites-nous donc le plaisir d’arrêter un fiacre que nous prendrons devant l’entrée de la cour.
Le geôlier précéda les deux avocats dans la cour et, sur le pas de la porte cochère, attendit le passage d’un véhicule : Un taximètre flaira le client. L’automobile vint se ranger le long du trottoir. En moins d’une seconde, le baron de Naarboveck s’y était précipité avec Jérôme Fandor, pâle d’émotion, et tout en saluant de la main le gardien respectueux qui s’inclinait profondément, il jeta au mécanicien cette adresse :
– Au Palais de Justice.
***
– Monsieur Fandor, que dites-vous de cela ?
– Ah baron ! comment pourrai-je jamais vous exprimer toute ma reconnaissance, mais, désormais, m’expliquerez-vous ?…
De Naarboveck sourit d’un sourire étrange et mystérieux. Prolongeant son silence à plaisir, il s’amusait à considérer le journaliste dont la stupéfaction ne cessait de croître.
Échappés du Cherche-Midi, le baron et Fandor s’étaient gardé d’aller au Palais de Justice. Le taxi-auto dérouté avait gagné la rue Lepic et s’était arrêté dans une petite rue déserte, devant une maison en ruine, éclairée de très loin par un bec de gaz vacillant.
Naarboveck avait réglé la course, puis les deux hommes en toges avaient traversé un petit jardinet inculte et bourbeux.
Ils arrivaient devant un pavillon. De Naarboveck s’y introduisait suivi de Fandor.
Par un escalier en colimaçon les deux hommes gravirent un étage, puis le diplomate ayant tourné un commutateur, le journaliste s’aperçut qu’il était avec son sauveur dans un atelier de peintre, vaste et assez élégamment meublé. Des rideaux épais cachaient une large baie vitrée ; le plafond très élevé était à peine mansardé. Pour créer cet atelier, on avait dû réunir l’une à l’autre trois ou quatre pièces, car plusieurs colonnes de fer, grosses colonnes de soutènement, traversaient par le milieu l’atelier, rompant ainsi, assez malheureusement d’ailleurs, l’harmonie de la vaste salle.
Curieusement, Fandor avait inventorié cet atelier, cherchant un objet familier, un meuble, un tableau qui pût lui faire savoir où il se trouvait.
Mais rien. Tout ce qui ornait cette pièce était inconnu du journaliste.
M. de Naarboveck, sitôt arrivé, s’était dépouillé de sa toge et, désormais, plus libre de ses mouvements, allait et venait. Le diplomate était vêtu d’un élégant complet.
Le journaliste, lui aussi, avait enlevé la bienheureuse robe d’avocat grâce à laquelle il s’était échappé. Il portait le pantalon noir que Naarboveck lui avait fourni et demeurait en manche de chemise, n’ayant pas de veston et ayant laissé dans la cellule sa tunique militaire.
– Savez-vous, monsieur Fandor, où nous nous trouvons ?
– Je n’en ai pas la moindre idée, déclara le journaliste…
– Cherchez un peu, poursuivit le diplomate…
Fandor fouillait des yeux les alentours, torturait sa mémoire, il eut un geste vague, avoua
– Je n’en sais décidément rien !
– Monsieur, déclara alors de Naarboveck, en se rapprochant du journaliste comme s’il craignait d’être entendu en parlant haut, vous n’êtes pas sans connaître, au moins de nom, un certain individu énigmatique qui joue un rôle important dans les affaires dont nous sommes l’un et l’autre les victimes à des titres différents. Nous sommes chez lui.
– Son nom ?
Le baron de Naarboveck qui, tout en considérant Fandor, allait et venait, écoutant par moments, mais semblant en outre lire dans la pensée du journaliste, reprit la parole :
– Votre ami Juve, fit-il, monsieur, qui est un policier de la plus grande valeur, s’est depuis quelque temps acharné à la poursuite de notre hôte d’aujourd’hui, de ce Vagualame chez qui nous nous trouvons… Cela lui a occasionné d’ailleurs pas mal de mésaventures qui lui ont prouvé que Vagualame n’était pas l’imbécile qu’il paraissait, et peut-être Juve s’en apercevra-t-il encore d’ici peu… cependant…
– Mon ami Juve, questionna-t-il, ne court, je l’espère, aucun risque ? je vous en supplie, monsieur renseignez-moi sur ce point, car désormais je suis libre…
– Attention, monsieur Fandor !… souvenez-vous que vous êtes un évadé et qu’à l’heure actuelle votre fuite doit être connue… méfiez-vous donc.
Puis il changea de sujet. Brusquement, sans ordre, d’une façon bizarre :
– Vagualame, chez qui nous sommes, reprit-il, avait une collaboratrice, mademoiselle Berthe, dite Bobinette. Bobinette a eu des torts, des torts graves, mais, monsieur, paix à sa mémoire, n’en parlons plus, elle a expié.
– Bobinette est donc morte ?
Fandor digérait cette nouvelle, lorsque soudain, au moment où le dernier coup de dix heures sonnait au cartel du mur, la lumière s’éteignit, l’atelier fut plongé dans une obscurité profonde… et le journaliste se sentit appréhender, ligoter avec une brutalité inouïe, cependant qu’au préalable on l’enveloppait, croyait-il, dans un grand linge qui lui immobilisait les bras. Sur son visage des mains mystérieuses fixaient une sorte de masque souple, on lui enfonçait quelque chose sur la tête, un chapeau peut-être, puis, attiré dans le noir, cependant que les cordes serrées lui meurtrissaient les chairs, Fandor se rendit compte qu’on l’immobilisait, debout, le long de quelque chose, probablement l’une de ces colonnes qui traversaient l’atelier du plancher au plafond. Le journaliste crut percevoir une voix lointaine qui murmurait :
– Comme Bobinette est morte, tu mourras… par Fantômas.
Mais avait-il bien entendu ? n’était-ce pas une hallucination, n’était-ce pas lui-même qui avait crié, car, cependant qu’il était l’objet de cette rapide agression, Fandor qui, jusqu’alors, avait l’esprit rempli de Vagualame, spontanément avait songé à Fantômas.
Tandis qu’il essayait vainement d’arracher, de rompre les liens qui le maintenaient, Fandor pensa aussi au baron de Naarboveck. En dépit du risque qu’il courait peut-être, le journaliste hurla :
– Naarboveck à moi…
Mais rien ne répondit d’abord…
Ce ne fut qu’au bout d’un long instant que Fandor identifia, loin, très loin de lui, comme un gémissement étouffé.
Tiens, la lumière de nouveau.
Fandor dont les yeux n’étaient pas bandés, bien que son visage fût recouvert d’un masque souple – il en sentait le contact sur sa peau – inspecta vivement le mystérieux atelier dont l’installation lui était déjà familière et dans lequel venaient de se passer des événements si extraordinaires. Mais l’examen auquel se livrait le journaliste devait lui révéler des choses plus bouleversantes encore.
En face de lui, sur le pas d’une porte qu’il n’avait point remarquée au début, immobile, rigide, se tenait un individu à la découverte duquel Fandor faillit perdre connaissance, car il l’avait déjà vu cet homme, cet être étrange, énigmatique, redoutable, il l’avait vu, – oh ! deux ou trois fois à peine, au cours de sa vie et encore, l’espace d’un instant, – mais il l’avait vu ou pour mieux dire, aperçu, dans des circonstances si tragiques, en des occasions si extraordinaires que sa silhouette s’était à jamais gravée dans sa mémoire… Il n’y avait pas de doute possible, c’était bien son ample manteau noir, sa cagoule, son grand chapeau abaissé sur les yeux, sa silhouette à la fois indécise et inimitable. Fandor avait devant lui Fantômas…
Fantômas !
Le journaliste fit une tentative désespérée pour rompre ses liens. Mais tandis qu’il s’épuisait en efforts surhumains, que ses épaules se courbaient en avant, comme il ne quittait pas des yeux la terrifiante apparition de Fantômas, Fandor s’aperçut que l’insaisissable bandit faisait exactement les mêmes gestes que lui !… Le journaliste regarda plus attentivement encore.
Des détails curieux lui apparaissaient peu à peu…
Il croyait voir des cordelettes liant les jambes de Fantômas, montant à sa ceinture, étreignant son corps !
Soudain Fandor hurla…
Rêvait-il, était-il éveillé ? était-ce la folie ?… qui se trouvait devant lui ?… tout simplement lui-même, Fandor, dont l’image se réfléchissait dans une glace placée à quelques mètres en face et c’était lui Fandor… qui avait la silhouette de Fantômas.