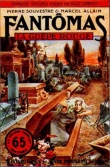Текст книги "Le pendu de Londres (Лондонская виселица)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
11 – EXAMEN À SCOTLAND YARD
Juve réfléchissait…
Bien qu’il ne fût guère que trois heures de l’après-midi, il avait soigneusement clos les volets de ses fenêtres, rabattu les rideaux, fait la nuit complète dans l’appartement de la rue Bonaparte qu’il habitait depuis de longues années…
Il régnait dans son cabinet de travail une lueur indécise, falote, paisible, qui lui permettait tout à loisir de suivre les volutes bleuâtres de la fumée de sa cigarette – de son éternelle cigarette – tandis que couché sur son divan, les mains croisées derrière la tête, les coudes levés en oreiller, il s’absorbait dans sa rêverie.
– Ou il est fou, monologuait Juve, ou il lui est arrivé quelque chose… Trois heures et demie bientôt… Je ne pourrais plus attendre que le courrier de huit heures… Mais, sapristi de sapristi, quinze jours sans nouvelles !
Juve aspira de profondes bouffées de tabac, se retourna sur son divan, jeta sa cigarette, en alluma une autre, la rejeta encore, puis, sur son séant et les mains posées sur le divan, le corps penché en avant, regardant vaguement et sans le voir le dessin du tapis, il reprit à haute voix :
– Quinze jours sans nouvelles ! non, c’est inimaginable, c’est impossible… Il m’annonçait une lettre, s’il ne me l’a pas écrite c’est que… Ah ! bigre de bigre !
Juve, enfin, se redressa, comme pris d’une inspiration soudaine, il traversa la pièce, alla derrière son bureau, et d’un vigoureux coup de poing, il fit résonner un gong pendu à la muraille…
On eût dit qu’il s’agissait d’une mise en scène bien réglée, qu’en une coulisse mystérieuse, un personnage attendait ce signal pour entrer en scène : le bronze résonnait encore que la porte du cabinet de travail s’ouvrait, et que, sans bruit, Jean, le vieux et fidèle domestique de Juve, faisait son apparition.
– Monsieur m’appelle ?
– Jean ! il n’y avait pas de lettres ce matin pour moi ?…
– Monsieur sait bien que non ; c’est la dixième fois de la journée que monsieur me le demande…
– Cela ne fait rien, Jean. Et ce matin vous êtes bien sûr d’avoir fidèlement remis à la poste le nouveau télégramme que je vous ai donné pour Londres ?…
– Oui, monsieur. Monsieur me l’a aussi demandé…
– Jean, c’est que ce télégramme était pour Fandor, et que je n’ai pas de réponse.
– Dois-je laisser monsieur ? Monsieur veut-il que j’aille…
– Au diable, Jean… au diable…
– C’est bien, monsieur, se contenta de répondre Jean, je m’en vais… Mais la lampe file…
Juve trouva inutile de protester contre cette dernière affirmation. La lampe ne filait nullement, mais Jean ne pouvait souffrir de voir l’extraordinaire façon dont Juve passait ses après-midi…
Allumer une lampe alors qu’il faisait grand jour semblait sacrilège au vieux serviteur, aussi s’autorisant de la tranquillité de Juve, Jean, le plus posément du monde, allait-il ouvrir les rideaux, entrebâiller les volets, puis il souffla la lampe et, de la sorte, ayant, à son idée rétabli la saine ordonnance des choses telles qu’elles devaient être, il s’apprêtait à abandonner Juve à ses réflexions.
Mais comme le vieux Jean, la main sur le bouton de la porte, sortait du cabinet de travail, le maître policier le rappelait :
– Jean, ne va pas au diable…
– Bien, monsieur !…
– Va faire ma valise !…
– Laquelle, monsieur ?…
Juve hésitait une seconde, puis, très net :
– Le numéro 6.
– Le numéro 6 ! Monsieur part pour longtemps ?…
– Je pars chercher du travail… dépêche-toi… Dans une heure il faut que ce soit prêt…
Préparer la valise N° 6, c’était clair, c’était net, cela signifiait que Juve avait l’intention d’entreprendre une de ces périlleuses expéditions dont il était coutumier.
Depuis longtemps, en effet, le policier avait réglé, pour la commodité des ordres, la série de ses bagages sous des numéros différents…
Lorsque Jean préparait la valise « N° 1 », il savait qu’il convenait tout bonnement de disposer les quelques affaires nécessaires à une courte absence. Plus compliquée déjà était la valise « N° 2 », mais si Juve demandait la valise « N° 6 », il convenait, dans les compartiments d’une mallette spéciale, d’enfourner toute la série des fards, des perruques, des fausses barbes, des costumes les plus invraisemblables, la gamme des déguisements complets, en un mot, dont Juve, en merveilleux artiste, usait souvent avec une habileté déconcertante.
Or, tandis que le vieux domestique s’empressait à sa besogne, Juve de son côté ne restait pas inactif.
C’était en souriant qu’il avait vu le manège de son serviteur, éteignant la lampe, ouvrant rideaux et volets : il s’en félicitait, maintenant…
– Cet animal me force à prendre une décision, songeait-il… Bah ! après tout, qu’est-ce que je risque ? Je ne peux pas rester plus longtemps dans l’incertitude ! Et puis le « petit » a peut être besoin de moi…
Le « petit » c’était Fandor…
Le matin même il avait encore envoyé un télégramme pressant à Fandor…
Le silence du journaliste devenait angoissant.
– Le « petit » a reconnu Fantômas, pensait-il, pourvu que Fantômas ne l’ait pas reconnu, lui… Il n’écrit pas, peut-être est-il en danger ? peut-être a-t-il besoin de moi ?… Pardieu, demain matin je serai à Londres…
Dans le cabinet de toilette, le vieux Jean accumulait dans la valise tout ce qui constituait l’équipement compliqué que Juve désignait sous l’étiquette « valise N° 6 ». Dans le bureau, Juve s’occupait, avec un zèle non moindre, à écrire toute une série de lettres sur du papier d’aspect administratif aux en-têtes rébarbatifs : « Préfecture de police », « Services de la Sûreté », « Brigades des Recherches », « Divisions des Anarchistes ».
***
Juve n’était pas marin. Il n’aimait pas exagérément même se trouver sur un bateau par une mer agitée. Bien qu’à l’abri des désagréables effets du tangage et du roulis, Juve avouait franchement préférer au sol mouvant que constitue le pont d’un navire, le sol ferme et sûr d’une route, voire même d’un champ…
Pourtant, comme le Dieppe se trouvait au milieu du détroit, filant à pleine allure vers les côtes anglaises, Juve, la cigarette aux lèvres, allant de bord sur bord, d’avant à l’arrière, semblait d’humeur guillerette.
La traversée, il est vrai, était superbe. La mer, calme comme un lac, avait des reflets de moire, des phosphorescences subites. Au ciel pur, piqueté d’étoiles, la fumée du steamer déroulait un long panache noir que ne brisait aucun vent, qui s’inclinait seulement en raison de la marche rapide qui emportait le navire loin de France.
… Juve était d’excellente humeur, parce qu’il se sentait libre, pour une fois, d’agir exactement comme il lui conviendrait. Le chef de la Sûreté lui avait confirmé que sa présence à Paris n’était pas nécessaire, lui avait volontiers appris que les procès en cours, procès dont Juve, officiellement, devait s’occuper, ne réclamaient pas son activité, même il avait obtenu un congé régulier de plus d’un mois.
– Encore un petit bout de chemin, encore un petit peu de temps et je vais être à Londres, se disait Juve, ah ! si seulement j’étais certain d’y rencontrer Fandor… pauvre petit !… que diable a-t-il pu lui arriver ?… Fandor à Londres… oui, parbleu, mais Fantômas y est aussi… ah ! quelque jour pourtant il faudra bien que j’arrive à arracher le masque de cet épouvantable bandit.
L’âme de Juve était, en effet, à ce point bizarre, qu’au moment même où il venait d’apprendre que la silhouette lugubre de Fantômas se dressait encore à l’horizon, que la lutte allait reprendre avec ses risques possibles, il se félicitait, il s’applaudissait d’avoir encore à exposer sa vie pour une cause qui lui était chère, la cause du Devoir, la cause du Bien…
Et en cela, Juve pensait exactement de la même façon que Fandor…
***
– Vous avez tous remis vos papiers ? oui ? Vous avez rempli les circulaires ? Vos actes de naissance ? vos recommandations et apostilles ? eh bien, alors, au gymnase !… Il faudra vous raser, mon garçon, cette barbe vous fait une étrange figure !… Allons, venez, messieurs !…
L’homme qui tenait ce discours, d’une petite voix sèche et pointue, désagréable à la perfection, incarnait à merveille le type du fonctionnaire.
C’était, d’ailleurs, l’employé modèle, le bureaucrate parfait. Si son esprit d’initiative laissait à désirer, il avait un respect profond des traditions qui suffisait, à lui seul, à lui valoir l’estime de ses chefs, la confiance de ses pairs et le haut emploi qu’il occupait à Scotland Yard, en qualité de président du jury, à voix prépondérante, pour le recrutement et l’acceptation des policemen chargés d’assurer le maintien de l’ordre dans la Capitale anglaise.
On l’appelait mister Chatham ; on s’inclinait en grandes courbettes devant lui, et il en concevait, souvent, beaucoup d’arrogance…
Scotland Yard, d’ailleurs, ressemble peu à la Police française. Il ne s’agit plus là d’une administration telle qu’en conçoit et en complique l’esprit français, d’une administration subdivisée en quantité de bureaux comportant un chef, un sous-chef, un premier expéditionnaire, etc., mais au contraire un rouage administratif précis, net, simple, où tout homme a une fonction bien déterminée, suffisante à employer toute son activité et l’employant de son mieux.
C’est ainsi, par exemple, que les policemen – analogues à nos gardiens de la paix – sont minutieusement choisis, à Londres, à la suite d’épreuves rigoureuses qui permettent de s’assurer, avant leur nomination, de leur capacité.
Or, M. Chatham, ce matin-là, accompagné de deux autres de ses collègues, devait précisément procéder à l’examen de quatre candidats.
Il venait d’examiner soigneusement les titres invoqués par les candidats, il avait vérifié leur état civil, leurs preuves d’honnêteté, maintenant il les conduisait avec ses collègues vers un gymnase où devaient avoir lieu les épreuves pratiques.
M. Chatham, descendu dans les sous-sols de Scotland Yard fit entrer les quatre futurs policemen dans une grande cave aménagée de façon bizarre. Aux murs des agrès de gymnastique, au fond de la salle des barres parallèles, une échelle, une corde lisse, à droite, un tremplin, avec une fosse remplie de liège en copeaux, contre le mur, des cibles.
– Le gymnase, messieurs !…
Et, tout de suite, Chatham ajouta :
– Vous savez, n’est-ce pas, pourquoi tout à l’heure, dans mon cabinet, je vous ai fait distribuer des menottes ? vous êtes priés, au cours de ces exercices pratiques, et à l’improviste, de vous les passer les uns aux autres au commandement… Comme il n’y a que deux places à prendre et que vous êtes quatre… j’imagine que deux d’entre vous seulement arriveront à passer les menottes à leurs camarades… Ce sera une première élimination…
Les quatre candidats inclinaient la tête, souriant, trouvant l’épreuve originale…
– Voyons, poursuivit M. Chatham qui faisait tout par lui-même et paraissait, seulement pour la forme, consulter de temps à autre d’un coup d’œil rapide ses collègues, voyons, passons à l’épreuve des revolvers. Vous savez qu’il convient d’être tireur et bon tireur chez nous ?… Voici des armes, modèle d’ordonnance, prenez-les et, l’un après l’autre, passez devant la cible… Vous d’abord, vous êtes Belge ?
L’un des candidats s’avança, hochant la tête affirmativement…
– Oui, pour une fois, monsieur, tu sais…
L’homme se campa sur la planche et, bien d’aplomb, déchargea sur un carton les six balles de son arme. Deux mouches, trois noires, une balle hors cible…
– Pas trop mal ! fit M. Chatham, indulgent…
Et, prenant un autre revolver, il le tendit au second candidat :
– Vous êtes Français, mon ami ?
– Oui, monsieur…
– Bien. Allez…
Mais l’aspirant policeman, au lieu de tirer, traversait la salle, se dirigeant vers la cible :
– Eh bien ? demanda, surpris, le chef du jury, que faites-vous ?…
– Je cache la mouche…
Le candidat, en effet, retourna sur la plaque de tôle le carton cible. Il revint alors prendre position au fond du stand et là, tranquillement, presque sans prendre le temps de viser, haussant six fois de suite le bras d’un mouvement régulier, il tira…
Les six balles trouèrent le carton, exactement en son centre, se couvrant l’une l’autre, émiettant la mouche, écornant à peine le noir !…
Un tonnerre d’applaudissements saluait cette performance. Pour M. Chatham, bon tireur lui-même, il n’en croyait point ses yeux.
– Dieu gracieux ! murmurait-il, je comprends maintenant les éloges de vos anciens chefs, mon ami, je n’avais jamais vu tireur comme vous… vous recommenceriez ce tour d’adresse ?
– Je recommencerai, monsieur…
– Par curiosité, essayez-le donc…
Le candidat prit des mains même de M. Chatham un second revolver, tendait le bras, pressait la gâchette… Un claquement sec… la cartouche ne partait pas !…
– Tiens… qu’y a-t-il donc ?
Le candidat sourit :
– Excusez-moi, monsieur, fit-il tranquillement, en ouvrant sa main gauche où scintillaient six culots de cuivre, je me suis tout simplement amusé à décharger ce revolver pendant que vous me le passiez, afin de vous montrer mon adresse.
– Quoi ! murmura-t-il, vous avez eu le temps, sans que je m’en aperçoive, de décharger ?…
– Il paraît.
Peut-être le chef du jury aurait-il voulu recommencer l’épreuve, si à ce moment l’un de ses collègues, subitement inspiré, n’avait crié, suivant le signal convenu :
– Menottes !
M. Chatham n’avait pas le temps d’articuler le commandement que le candidat qui venait de l’émerveiller s’était rapproché de lui, lui avait saisi la main droite, l’avait emprisonnée dans une menotte, cependant qu’il emprisonnait dans deux autres poucettes les mains des deux autres membres du jury…
Les candidats n’avaient point encore achevé de ligoter, chacun, un de leurs camarades, qu’à lui seul, le Français avait à l’improviste enchaîné les trois membres du jury.
– Excusez-moi, messieurs, dit-il, d’en agir ainsi avec vous… Mais j’avais, précisément des menottes sur moi… et cela m’amusait de vous montrer que je sais me servir de ces instruments assez rapidement…
Aucun des membres du jury ne protesta…
M. Chatham, comme ses deux collègues, faisait d’ailleurs en ce moment piteuse figure, les mains prises, l’air attrapé…
– Vous êtes extraordinaire, commença M. Chatham…
– Merveilleux, poursuivit l’un de ses collègues.
– Stupéfiant, dit le troisième…
Le candidat, en un tour de main, libéra ses victimes improvisées…
Avec un petit haussement d’épaules modeste, il se contentait d’affirmer :
– Il est parfois utile de savoir agir vite.
Puis, le ton encore plus soumis, il concluait :
– En revanche, messieurs, si, comme policier, je puis prétendre connaître mon métier, et même me targuer d’une certaine habileté, je reconnais qu’en ce qui concerne les exercices de gymnastique, les exercices de pompiers, il me faudra solliciter toute votre indulgence car je n’ai jamais eu l’occasion de m’entraîner…
– Il suffit, déclara M. Chatham, ne vous tourmentez pas de cela, mon ami. Dès maintenant le jury vous accorde l’admission… D’ailleurs nous ne vous soumettrons pas aux exercices qui vous inquiètent, et je vais vous délivrer tout de suite votre brevet…
M. Chatham fouilla dans la serviette remplie de dossiers qu’il portait sous le bras, et tandis que ses deux collègues continuaient à examiner les autres candidats policemen, il se retourna vers l’inconnu qui venait de si brillante façon de lui prouver ses talents :
– Vos certificats, disait-il, vous donnent le nom français de Durand… nous ne pouvons pas admettre, vous le savez, que vous preniez votre service sous un nom véritable, vous ferez donc en sorte de choisir un pseudonyme… Autre chose : dans votre demande d’examen je vois que vous sollicitez d’être exclusivement affecté à Londres… vous êtes sans doute marié ?…
– Non, monsieur…
– Enfin, vous avez des raisons pour désirer rester dans la capitale ?…
– Oui, monsieur…
– Bien. Comme je n’ai pas à vous refuser quoi que ce soit après la brillante façon dont vous venez de satisfaire aux exercices, voulez-vous me désigner vous-même le quartier où il vous plairait d’être affecté ?
Celui qui s’était donné le nom de Durand sembla hésiter quelques minutes.
– Puis-je être incorporé dans les brigades volantes, monsieur ?
– Certes… Mais vous n’ignorez pas que c’est surtout là que se reçoivent les mauvais coups ?
– Je ne les crains pas.
– Que le service y est pénible ?
– Peu m’importe…
– Que la solde n’est pas plus élevée ?…
– Cela me laisse indifférent…
– Vous m’intriguez, dit M. Chatham enfin, et je ne vous comprends pas. Vos certificats émanent des plus hautes autorités françaises, vous êtes à coup sûr très habile, et pourtant vous cherchez un poste peu envié… Quelle est donc votre ambition ?
L’extraordinaire Durand, le plus froidement du monde, répondit :
– Je désire, monsieur, être incorporé dans les brigades volantes parce que j’imagine là, plus qu’ailleurs, avoir occasion de me signaler… Si je pouvais attirer l’attention d’un des membres du Conseil des Cinq… de M. Tom Bob, par exemple…
M. Chatham coupa court :
– Tom Bob, disait-il, a autre chose à faire que de s’occuper des policemen, mon ami… Toutefois, c’est évident, vous pouvez vous signaler dans les brigades volantes, et avancer rapidement…
Suivant l’usage, vous prendrez votre service dans huit jours.
***
Sur le bateau le Sussex, quittant l’Angleterre pour la France, Juve, le jour même où Durand venait d’être engagé parmi les policemen de Londres, avait pris place.
Mais Juve n’était plus d’aussi bonne humeur que lors de sa première traversée.
Juve songeait :
– Qu’est-ce que tout cela veut dire ? j’ai bien retrouvé Nini Guinon, j’ai bien vu le mystérieux petit Jack son fils… Je me suis bien aperçu que lord Duncan était notre ami Ascott, toutes choses que Fandor avait probablement découvertes… même en ce moment, je file cet infecte crapule qui a nom Le Bedeau et qui rentre en France, je ne sais trop pourquoi ; mais, en somme, j’ai complètement échoué dans mes recherches… Tom Bob ? oui, c’est entendu, j’ai acquis la certitude qu’il y avait un Tom Bob, membre du Conseil des Cinq, mais je n’ai pas pu l’approcher, je n’ai même pas pu le voir. La consigne à Scotland Yard semble être de cacher Tom Bob… pourquoi ? que veut dire cette invisibilité d’un détective ? Tom Bob… m’a-t-il fui ? et puis Fandor ?… qu’est devenu Fandor ?…
Ah ! Juve, en d’autres temps, eût été fort joyeux d’avoir réussi en quelques heures à retrouver dans la pègre londonienne des individus aussi intéressants que ceux qu’il avait rencontrés, il se fût applaudi d’avoir rejoint Le Bedeau, de le tenir en filature… mais il avait en ce moment d’autres préoccupations, de graves inquiétudes.
– Fandor, songeait Juve… Fandor a disparu !… À son hôtel on m’a dit qu’il était parti sans même payer sa note. Ailleurs, je n’ai pas pu retrouver sa piste… Mon Dieu… qu’est-ce que tout cela signifie ?… où est le « petit ? », que lui est-il arrivé ?…
Et si le policier était à bord du Sussex, s’il filait Le Bedeau, l’ancien lieutenant de Fantômas, c’était moins à vrai dire pour continuer ses enquêtes relatives au bandit, que dans l’espoir d’apprendre, en pistant l’apache, quelque détail qui pût le renseigner sur la subite disparition de Jérôme Fandor…
12 – LE MYSTÉRIEUX BOUCHER DU « SUSSEX »
Si les voyageurs qui se rendaient ce jour-là d’Angleterre en France n’avaient pas été éprouvés, de façon presque générale, par les terribles affres du mal de mer, ils auraient peut-être remarqué qu’à Dieppe, descendait du Sussex un passager qui ne s’était point embarqué à Newhaven.
Phénomène étrange, en vérité, car il est assez inaccoutumé qu’entre son point de départ et son point d’arrivée, un steamer embarque des passagers !…
C’est qu’à tout dire, s’il débarquait à Dieppe un robuste gaillard, vêtu d’une blouse bleue lui tombant jusqu’aux pieds, le visage barré d’une forte moustache noire, – l’air d’un boucher en rupture d’abattoir – il ne débarquait plus un mince jeune homme d’une trentaine d’années, au visage rasé entièrement, et qui n’était autre que le détective French…
Habile aux déguisements, French s’était embarqué à bord du Sussex sous son apparence habituelle, mais une fois descendu dans la cale du steamer, il s’était empressé de dépouiller ses vêtements ordinaires et, bien que muni d’un billet de première classe, s’était rendu vers l’avant du bateau, vers les troisièmes où l’on avait vu ainsi tout le temps de la traversée l’inélégante silhouette qu’il s’était savamment composée dans son accoutrement.
…Et de la sorte, à Dieppe, il n’était pas, en vérité descendu du bateau un passager de plus, mais bien un autre passager…
Or, tandis que les voyageurs s’empressaient, qui vers le bureau de poste installé à la gare maritime de Dieppe, qui vers le buffet où des tasses de thé et de chocolat fumaient, toutes prêtes, à leur intention, le toucheur de bœufs, car c’était en vérité, l’apparence qu’il avait, évitant de se faire voir, se dirigeait vers le train de marée rangée le long du quai et où des hommes d’équipe s’empressaient d’entasser, avec une brutalité effrayante, les bagages les plus fragiles des voyageurs.
French avisait un compartiment de seconde classe – les trains de l’après-midi ne comportant pas de troisième – et y prenait place.
***
Le détective anglais qui, bien que jeune, était arrivé à la situation de membre du Conseil des Cinq, possédait avant tout un esprit réfléchi.
À peine parvenu dans son wagon, il se rencogna confortablement et se prit à songer.
Aussi bien, French était ému…
Pour la première fois de son existence de détective, il devait s’occuper d’une affaire de police qui le touchait en quelque sorte directement, à laquelle il portait un intérêt personnel…
Il s’agissait pour lui de sauver son collègue, son confrère Tom Bob, et même un peu son patron, car, jadis, Tom Bob l’avait protégé, avait voté pour lui au moment où il avait été élu membre du Conseil des Cinq.
Pour sauver Tom Bob, il fallait retrouver Mme Garrick, prouver ainsi que Tom Bob-Garrick n’était pas un assassin… French se rendait compte que sa mission était simple dans son exposé, mais complexe dans ses détails.
Car enfin, où pouvait être Mme Garrick ? dans quel coin perdu de la France – à supposer qu’elle fût vraiment en France – s’était-elle réfugiée ?…
French n’en avait et ne pouvait en avoir aucune idée.
Tom Bob, il est vrai lui avait affirmé qu’il y avait en France un homme qui, à coup sûr, arriverait à retrouver rapidement Mme Garrick…
– Voyez Juve, avait conseillé le détective prisonnier, dites à ce policier qui me connaît un peu que vous êtes envoyé par Tom Bob, et que lady Garrick était en réalité la femme de Tom Bob… Je suis persuadé qu’après cela il se mettra tout à votre disposition et fera tout son possible pour vous aider à joindre ma femme…
Malheureusement, si Tom Bob avait ainsi tracé le plan de conduite utile pour arriver à retrouver son épouse en fuite, il n’avait pas indiqué à French où il lui serait possible de rencontrer Juve…
Juve, parbleu, French ne l’ignorait pas, n’était pas un policier ordinaire. On ne pouvait aller le demander à la Préfecture. Juve, c’était en quelque sorte un inspecteur hors cadre, qui depuis de longues années n’avait qu’une mission, qu’un but, qui avait consacré toute sa vie à la poursuite d’un criminel, et ce criminel c’était Fantômas. Fantômas, le génie du crime, Fantômas, l’insaisissable assassin, dont l’existence même était mise en doute par les sceptiques…
Où trouver le policier qui s’était fait un devoir de poursuivre un coupable si fantastique ?
French craignait que Juve, toujours à la poursuite du monstrueux bandit, ne fût très difficile à interviewer… À peine avait-il pour se guider une vague indication…
Il avait appris en effet à Scotland Yard qu’un apache français du nom du Bedeau était récemment passé à Londres, puis s’était décidé à regagner la France. De Scotland Yard, une note avait été envoyée à Paris, pour signaler le retour du Bedeau, que recherchait la police française. Juve était-il sur sa piste ?… étant donné que le Bedeau avait été jadis un des lieutenants de Fantômas, French pouvait l’espérer, mais c’était à vrai dire bien vague et bien problématique…
Et French raisonnant de la sorte, concluait :
– J’ai trois personnes à poursuivre : le Bedeau, qui m’amènera à rencontrer Juve, Juve qui me conduira à Mme Garrick, Mme Garrick enfin…
Le train filait au long de la voie, avait depuis longtemps dépassé Rouen, s’approchait à toute vapeur de Paris, prenant les aiguilles, en dépit des règlements, à pleine allure, passant en grand vacarme dans les petites stations de banlieue, franchissant avec un bruit de tonnerre les ponts métalliques jetés sur les boucles de Seine, que French réfléchissait toujours.
Il importait de plus en plus, d’ailleurs, de prendre un parti. Dans quelques minutes maintenant l’express allait stopper gare Saint-Lazare, il était huit heures du soir, il convenait de décider le plan de campagne à suivre.
– Bon ! songeait French, celui que j’ai le plus de chance d’atteindre, est évidemment le Bedeau. Donc, commençons par rechercher le Bedeau.
Le Bedeau, avait appris French, était un ancien ébouillanteur des abattoirs de Montrouge. À l’époque où il n’avait pas encore renoncé au travail, le Bedeau exerçait le sinistre métier qui consiste, aux abattoirs, à ébouillanter les porcs fraîchement abattus.
C’était donc l’un de ces grands gaillards qui vivent continuellement dans l’atmosphère sanglante des boucheries et qui, du matin au soir, en habit taché de rouge, demeurent au milieu des cris des bêtes que l’on égorge, que l’on torture un peu même, à l’occasion, pour rien… pour rire entre camarades.
Or, dans l’esprit de French, l’ancien métier du Bedeau avait une importance extrême.
Dès lors que le Bedeau avait quelque temps avant éprouvé le besoin de passer en Angleterre, c’était évidemment qu’en tant qu’apache, il devait être brûlé dans le quartier de la Chapelle, qui, les fiches de Scotland Yard le lui avaient appris, avait été son quartier général. Brûlé à la Chapelle, il y avait des chances pour que le Bedeau, revenu en France, n’osât aller s’y installer tout de suite. Où irait-il donc ?
French savait fort bien que les individus du genre du Bedeau passent la moitié de leur vie dans les cabarets borgnes des barrières.
Et French se demandait tout simplement en quel genre de cabaret louche il avait chance de rencontrer le Bedeau dont il possédait le signalement…
De la Chapelle aux Halles, les allées et venues sont fréquentes. C’est la même série d’apaches que l’on rencontre en ces deux quartiers… et même une brigade de policiers est chargée de la surveillance de ces deux centres de la pègre…
– Je vote donc pour Vaugirard, se dit French. Il y a gros à parier qu’il est là… ancien ouvrier des abattoirs de la rue des Morillons, il a des camarades de ce côté, c’est dans les bouges de Vaugirard qu’il doit, ce soir, boire alcool sur alcool…
French, ainsi que son surnom de détective l’indiquait, avait longtemps habité la France et parlait français avec un pur accent faubourien, que n’eût pas désavoué la plus franche gouape de la capitale.
Il lui était facile de se faire passer pour français, pour parisien. En sautant sur le quai, French était résolu à commencer cette nuit-là même à visiter les bouges où il pensait que devait se trouver le Bedeau…
Perdu dans la foule des voyageurs, French sortit de la gare Saint-Lazare par la rue d’Amsterdam et, ne s’occupant pas du bagage, d’ailleurs fort restreint, qui l’attendait à la consigne, s’en alla les mains dans les poches, l’air d’un badaud qui se promène, jusqu’à un petit mastroquet de modeste apparence où il fit un dîner rapide.
Puis il se mit en chasse.
– Les choses les plus bêtes, pensait French, sont parfois celles qui réussissent. Il est à l’heure actuelle neuf heures et demie, les bouges ne sont intéressants à visiter qu’à partir de onze heures, moment où la clientèle arrive. Donc, j’ai le temps. Commençons par nous rendre rue Bonaparte, domicile légal de Juve, quand ce ne serait que pour n’avoir pas le remords de n’y être pas allé.
French raisonnait juste en accordant peu de valeur policière à la visite qu’il tentait ainsi. Rue Bonaparte, la concierge, à laquelle il demandait : « M. Juve ! », lui rit au nez :
M. Juve était en voyage depuis près de six mois, on n’en avait aucune nouvelle et nul ne savait quand il reviendrait. Les termes de son loyer étaient payés d’avance…
– Bon, se dit French, aucune importance. Maintenant, à Vaugirard !
***
Quiconque n’aurait pas été du quartier, quiconque n’aurait pas connu la maison, aurait certainement pu passer devant l’étroite entrée sans se douter qu’elle menait à un bar.
C’était une porte basse, à demi dissimulée par un avancement de la maison voisine que ne surmontait aucune enseigne. Elle était faite d’un lourd panneau de bois sculpté de haut en bas d’inscriptions faites au canif, et représentant dans un pittoresque désordre des devises, des noms, des dessins emblématiques, cœurs transpercés d’une flèche, oiseaux à formes d’hirondelles et puis encore couteaux, eustaches, surins…
Cette porte donnait sur un étroit couloir qui, au bout de deux mètres, se coupait d’une série de marches presque usées, gluantes, verdâtres de mousse. On avançait de quelques pas, puis on se heurtait à une nouvelle porte plus épaisse que la première dont il fallait, dans l’obscurité, découvrir le loquet. Cette deuxième porte c’était l’entrée du Cabaret des Égorgeurs.
Là, dès la nuit tombante, se réunissait pour des saouleries interminables qui ne s’achevaient qu’au petit matin le plus souvent par une rixe générale, la population flottante qui vit de commissions, de besogne de raccroc, autour des abattoirs de Vaugirard.
Le Cabaret des Égorgeurs – dont le titre eût pu donner à penser qu’il avait pour clientèle les robustes gars chargés de mettre à mal les bestiaux nécessaires à la nourriture de Paris – n’était, en réalité, pas du tout fréquenté par ceux qui avaient un emploi régulier aux abattoirs municipaux. Il servait de rendez-vous aux apaches du quartier qui, rassurés par la réputation de l’établissement où la police, d’ailleurs, osait rarement tenter des rafles, venaient en toute liberté régler leurs comptes et préparer leurs méfaits.
Dans la vaste salle, des tables, des tabourets, et au centre, sur une sorte de piédestal, le phonographe géant qui beuglait d’ineptes refrains populaires.