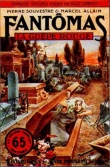Текст книги "Le pendu de Londres (Лондонская виселица)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
– La gonzesse, répétait Beaumôme d’une voix de plus en plus embarrassée, la gonzesse de Willesden, elle a bien roulé Nini… et c’est ce qui m’a fait rigoler…
– La « gonzesse de Willesden »… voilà déjà une indication, pensa Juve, l’indication du quartier où habite cette femme.
À tout hasard, il affirma, plaidant le faux pour savoir le vrai :
– Celle qui demeure dans Wilbur street… pas vrai, Beaumôme ?
– Pas du tout, je vois bien que tu n’y comprends rien, à cette histoire-là… La gonzesse de Willesden n’habite pas dans Wilbur street, mais, au contraire, dans Rosendal avenue… Si tu connais ce quartier-là, c’est la dernière maison avant le pont du chemin de fer…
Juve, notant le renseignement, s’efforçait de demeurer impassible.
En réalité, il éprouvait une joie immense. Décidément, ses enquêtes marchaient bien… Non seulement il venait d’arrêter Beaumôme, de découvrir l’horrible crime de Nini Guinon, mais encore il avait la conviction que la grande dame de Willesden, qui détenait l’enfant de Françoise Lemercier, ne pouvait être autre que… lady Beltham.
L’aube pointait. Beaumôme parlait toujours.
Mais, peu à peu, les vapeurs de l’ivresse s’appesantirent sur son esprit.
La langue desséchée, la gorge brûlante, les paupières lourdes, Beaumôme s’affala sur le sol et s’endormit comme une masse.
Ses compagnons alors se levèrent, sortirent de la cellule que leur ouvrit doucement un gardien…
…Et tandis que Juve s’entretenait longuement avec le sergent, l’inspecteur qui avait passé la nuit en compagnie de Beaumôme pour cuisiner le prisonnier commençait un rapport accablant.
26 – JUSTICIÈRE ET COMPLICE
Les trains du Northwestern Railway qui partent de Euston Station à Londres pour aller desservir l’Écosse entière, traversent, avant de s’enfoncer dans la verte campagne, une banlieue pittoresque peuplée de jolis cottages, entourée de grands arbres.
Cette région septentrionale de Londres est quelque peu accidentée, et la voie du chemin de fer passe fréquemment à travers des tranchées, et même sous des tunnels.
Au bout de dix minutes, le train, qui n’a pas encore pris son élan définitif, ralentit sensiblement puis s’arrête le long des quais d’une vaste gare, généralement silencieuse et déserte, dont le nom se découvre difficilement sur les murs au centre d’affiches multicolores innombrables.
C’est Willesden Junction, gare de raccordement de la ligne du Nord, avec les voies des autres Compagnies ; gare grâce à laquelle certains trains peuvent contourner la capitale de l’Angleterre sans avoir à pénétrer dans l’intérieur de la ville.
C’est une sorte d’Asnières gigantesque, un Orléans ou un Est-Ceinture d’une importance extrême.
Tous les trains, même les plus grands rapides, qu’ils aillent dans un sens ou dans l’autre, marquent l’arrêt à Willesden Junction.
Lorsque les convois qui montent vers le Nord de l’Angleterre se mettent en route, lentement, comme tous les trains anglais, remarquables par leur douceur de démarrage, le voyageur qui considère le paysage à travers les grandes glaces du compartiment voit, à la sortie de la station, défiler devant ses yeux un joli panorama de banlieue verdoyante qui peu à peu se transforme en pleine campagne.
En considérant les petites maisons alignées, uniformes, puis les cottages isolés les uns des autres, et enfin les propriétés de plus en plus grandes, on a l’impression de traverser successivement Neuilly, Bois-Colombes, Argenteuil et Poissy…
Le quartier de Willesden est éminemment calme et paisible.
Habité par de braves bourgeois tranquilles, le silence absolu s’y affirme dès les premières heures du crépuscule, et sitôt la nuit tombée, l’ombre envahit le quartier d’une façon universelle, on s’y couche de bonne heure et la plupart des intérieurs sont éteints…
***
…Par une des larges avenues tracées dans ce quartier de repos, une femme enveloppée dans un manteau sombre cheminait ce soir-là avec une hâte fébrile.
Elle semblait mal connaître la région qu’elle parcourait et, comme la nuit était tombée, profitant de la lueur falote des ampoules électriques installées aux carrefours, elle étudiait avec attention les plaques indiquant le nom des rues.
C’était le soir, ou pour mieux dire la nuit qui suivait celle où Juve avait arrêté l’apache Beaumôme, cependant que Nini Guinon, sans nouvelles de son complice, restait seule jusqu’au lever du jour dans l’appartement tragique où gisait, à côté de son cercueil, le cadavre de Françoise Lemercier.
La promeneuse affairée s’engagea dans Rosendal Avenue.
C’était évidemment l’itinéraire qu’elle devait suivre, elle reconnaissait son chemin, car, désormais, malgré l’obscurité, elle avança d’un pas plus assuré.
Parvenue à l’extrémité de l’avenue, la promeneuse avisa la dernière maison, et d’une main qui tremblait légèrement, elle appuya sur le bouton de la sonnette placée à côté de l’entrée du jardin.
Ayant sonné deux fois, elle vit la grille s’ouvrir, déclenchée par un mouvement automatique.
Délibérément la visiteuse pénétra dans la propriété.
Elle avisa au fond du parc une masse sombre : c’était la maison vers laquelle elle allait se diriger.
Par les allées semées de gravier que faisaient crisser les pas, elle se rapprocha de l’immeuble.
Le jardin était vide. Aucun autre bruit que celui de la marche saccadée de la promeneuse.
Le porche de l’habitation, vers lequel elle se dirigeait, était éclairé par un rayon de lune qui faisait miroiter la plaque de cuivre, recouvrant la dernière marche du perron.
Les grands arbres, de part et d’autre de l’allée frissonnaient avec un bruissement doux sous la caresse d’un vent tiède.
La visiteuse était arrivée.
De sa main finement gantée, elle frappa trois coups à la porte, et au bout de quelques instants celle-ci s’entrouvrit sur un trou noir.
L’intérieur de la maison n’était pas éclairé.
Une voix dans l’ombre murmura ce simple mot :
– Daniel…
Et l’arrivante, d’un ton mal assuré, répondit :
– Françoise…
La porte qui s’était seulement entrebâillée s’ouvrit plus grande, la voix qui venait de l’intérieur reprit :
– Entrez, madame…
La visiteuse obéit, la porte se referma sur elle. L’arrivante sentit alors qu’on lui prenait la main, et qu’on la conduisait à tâtons.
Une autre porte grinça, et la visiteuse eut l’impression que l’on passait du vestibule dallé de mosaïque, dans une pièce au sol garni d’un tapis.
Tant de mystère l’inquiétait, et elle ne put s’empêcher d’observer à mi-voix :
– Comme il fait noir, pourquoi n’a-t-on pas de lumière ici ?
La mystérieuse personne qui avait introduit ainsi l’énigmatique nouvelle venue tint compte de la remarque qui lui était faite, car un instant après on entendit le claquement sec d’un commutateur électrique, et la pièce s’éclaira.
Dans un salon coquettement décoré de meubles clairs, aux formes élégantes, les deux femmes se dévisagèrent.
Toutefois celle qui venait d’ouvrir à l’autre, en apercevant sa visiteuse, laissa échapper un grand cri de stupéfaction :
– Nini Guinon, s’écria-t-elle…
Nini Guinon, car c’était elle, en effet, qui venait d’arriver dans la maison solitaire de Rosendal Avenue, parla à son tour.
– Mais qui êtes-vous, demanda-t-elle, en apercevant la personne qui venait de la reconnaître…
Nini Guinon était en face d’une grande femme, jeune, élégante et mince, dont l’abondante chevelure blonde avait des reflets étincelants d’or fauve.
Cette femme avait une ligne majestueuse, une silhouette admirable. Instinctivement, on était tenté de dire qu’elle avait un port de reine.
Ces traits, cette tournure, Nini Guinon, peu à peu croyait pouvoir les identifier. Elle connaissait cette physionomie, ce visage.
Elle creusa sa mémoire, et soudain la lumière se fit dans son esprit.
– Madame Garrick… vous êtes madame Garrick… n’est-ce pas ?
La grande dame blonde ne broncha pas, mais un imperceptible tremblement confirma Nini Guinon dans sa supposition.
– Pourquoi est-ce vous ? comment se fait-il que je vous trouve ici, chez moi, alors que j’attendais Françoise Lemercier ?…
Nini Guinon prit une mine hypocrite, elle feignit un air désolé :
– Françoise Lemercier, murmura-t-elle, madame n’est plus de ce monde… elle est morte hier… elle m’a chargé de la remplacer auprès de vous…
Mme Garrick – ou tout au moins cette femme que Nini Guinon avait identifiée comme telle, sur la foi de sa ressemblance avec les portraits publiés par les journaux de la femme disparue, – eut un rire ironique, et d’une voix frémissante d’indignation, elle apostropha son interlocutrice :
– Nini Guinon, dit-elle, vous êtes un monstre… si Françoise Lemercier est morte, c’est parce que vous l’avez assassinée… Ah, j’ai été prévenue trop tard… il aurait fallu agir plus tôt…
Nini Guinon pinça les lèvres, serra les poings.
Peut-être l’horrible femme regrettait-elle son audace, peut-être maintenant qu’elle se sentait découverte, démasquée, craignait-elle d’être tombée dans un piège tendu par un redoutable adversaire, par quelque subtil justicier…
Nini Guinon paya d’audace :
– Je viens chercher, dit-elle, l’enfant de Françoise Lemercier…
Nini Guinon fit quelques pas vers la pièce voisine, où elle venait d’apercevoir, sommeillant sur un fauteuil, le jeune enfant de la malheureuse défunte.
Mais son interlocutrice se jeta devant elle, l’empêchait de passer :
– Nini Guinon, déclara-t-elle, c’est assez d’avoir volé Daniel une première fois, vous ne recommencerez pas…
Nini Guinon pâlit affreusement… Cette femme savait donc tout… Qui pouvait-elle bien être ?
Mais Nini Guinon, soudain, eut un éclair.
Les dernières paroles de la grande femme blonde venait d’orienter son raisonnement, elle avait désormais le souvenir, de plus en plus précis d’une silhouette mystérieuse… de la silhouette de la personne qui, quinze jours auparavant, une certaine nuit, alors que Nini Guinon était ivre et reposait sur son grabat, gorgée de whisky, était venue lui enlever le petit Daniel que jusqu’alors Nini Guinon faisait passer pour Jack.
Perdant toute mesure, la meurtrière de Françoise Lemercier menaça son interlocutrice :
– Ah ! je sais maintenant, s’écria-t-elle, je sais tout… C’est vous qui avez pris Jack, c’est vous qui m’avez volé mon fils… Rendez-le moi… Madame qu’en avez-vous fait ?
La grande dame ne se laissa pas intimider par les imprécations de Nini Guinon.
– Eh bien oui, reconnut-elle, c’est moi… c’est moi qui ait été reprendre Daniel chez vous, Nini Guinon, car je sais aussi que le petit Jack est mort, et que pour tromper votre mari, vous avez fait passer Daniel à sa place…
– Misérable, cria Nini Guinon qui se précipita sur la grande dame, vous me perdez…
Celle que Nini Guinon prenait, à juste titre peut-être pour Mme Garrick ne recula pas, et toisant dédaigneusement l’abominable pierreuse :
– C’est possible, fit-elle… je vous perds, mais vous le méritez…
– L’enfant, je veux l’enfant…
– Inutile, vous ne l’aurez pas, et, l’auriez-vous, qu’il ne vous servirait à rien. Lord Duncan est prévenu de l’horrible substitution que vous avez faite…
– Prévenu… hurla Nini Guinon… par qui ?…
– Prévenu par moi.
Ces paroles étaient tombées comme un glas. Il y eut un silence.
Mais soudain, l’interlocutrice de Nini Guinon poussa un cri de terreur.
La pierreuse, trompant la surveillance dont elle était l’objet, avec la rapidité de l’éclair s’était élancée dans la pièce voisine où sommeillait le petit Daniel.
Elle était armée d’un poignard.
Nini Guinon, au paroxysme de la colère, se précipita sur l’enfant, et dans un geste affreux, lui perça la poitrine de l’arme dont elle s’était emparée.
Daniel ne poussa pas un soupir, mais un flot de sang rouge jaillit de sa blessure, cependant que soudain ses lèvres blanchissaient…
– Voilà, hurla Nini Guinon… vous n’avez pas voulu me le rendre. Il ne sera pas à vous non plus…
Nini Guinon n’acheva pas.
Une détonation retentit, la misérable s’écroula sur le plancher en poussant un cri.
Son interlocutrice venait de la foudroyer d’un coup de revolver à bout portant…
Désormais sur le tapis moelleux du salon, le sang de Nini Guinon venait se mêler à celui de l’innocente victime, que la misérable avait assassinée, l’instant précédent, pour assouvir sa rage folle.
Mais à la vue de ces deux cadavres la femme blonde pâlit à son tour, manqua défaillir en considérant le spectacle.
Ainsi donc, en l’espace de quelques instants, deux êtres avaient trouvé la mort. Ce salon délicat, charmant, meublé avec goût, une véritable bonbonnière, devenait brusquement le théâtre du plus affreux carnage.
La grande dame s’appuyait au chambranle de la porte, sentant ses jambes se dérober sous elle :
– Qu’a-t-elle fait, gémit-elle, la malheureuse qu’a-t-elle fait ?…
Puis elle murmurait encore :
– Et moi-même, qu’ai-je fait ?
– … Vous avez fait justice, madame, déclara une voix grave.
La meurtrière se retourna, et cette fois à la vue du personnage qui se présentait devant elle, elle demeura muette de terreur.
Le nouvel arrivant la considérait impassible, les bras croisés.
La femme blonde s’effondra, elle tomba à genoux dans le sang :
– Juve, fit-elle… c’est vous… Juve… comment êtes-vous ici ?…
Mais le policier se précipita et, de ses mains nerveuses, il serrait le poignet de la femme tragique :
Celle-ci dans un effort suprême avait repris le revolver avec lequel elle avait abattu comme un chien Nini Guinon, et sa main tremblante l’appuyait sur son front :
– Qu’alliez-vous faire ?
– J’allais me tuer, je veux en finir, tout est perdu…
Juve, cependant l’avait désarmée, il l’obligeait à se lever, à quitter la pièce où reposaient les cadavres, la contraignait à s’asseoir dans une bergère basse du salon voisin.
– Lady Beltham assura-t-il, calmez-vous, ce que vous venez de faire est excellent. Tranquillisez-vous, je ne viens pas en ennemi…
Lady Beltham – c’était elle en effet devant qui se trouvait le policier – se passa la main sur le front : ses yeux magnifiques se fermaient, s’ouvraient, se refermaient encore, des yeux d’hallucinée.
– Vous ne venez pas en ennemi ? à quel titre alors venez-vous ?
– Je viens, madame… en parlementaire…
– Parlementaire… ? et de qui ?
Lady Beltham haletait, sa poitrine se soulevait, la grande dame semblait éperdue de terreur et d’anxiété. Mais Juve très pondéré :
– De Fantômas…
– De Fantômas, répéta lady Beltham, accablée, ne comprenant plus… Vous Juve, vous venez de la part de Fantômas ?
– Oui madame, et si je vous épargne, c’est parce que je veux sauver quelqu’un que Fantômas a fait disparaître. Quelqu’un qu’il m’a promis de retrouver si de mon côté je vous retrouvais…
– Ce quelqu’un, interrogea lady Beltham, c’est ?…
– C’est celui que j’ai toujours considéré comme le plus digne et le plus noble des amis, c’est l’être que je chéris comme un fils… c’est Jérôme Fandor.
– Est-ce possible ? fit-elle,… Fantômas a fait disparaître Fandor… Il vous a promis de vous le rendre si vous arriviez à me retrouver ?…
– C’est cela même, madame…
– Mon Dieu, mon Dieu… s’écria lady Beltham, l’heure suprême a-t-elle donc sonné ? Fantômas atteint-il enfin son but ? est-ce l’achèvement de ses crimes ?
– Que voulez-vous dire ?… Parlez…
– Je vais tout vous dire : Fantômas a dans sa vie un secret… un secret terrible, un fait… ou plutôt un être, dont l’intervention quelque jour modifiera entièrement son existence. Quand devait sonner l’heure de la réhabilitation ?… je l’ignorais, mais voici que vous m’apprenez la capture de Fandor… de Fandor vivant, de Fandor conservé comme otage… Je sais dès lors que l’heure attendue où le secret de Fantômas sera révélé, approche.
– Mais, supplia Juve, si vous savez, vous, madame, où est Fandor, dites-le moi… Où est-il ?
Lady Beltham hochai la tête, se tordit les bras désespérément :
– Je ne le sais pas, je ne le sais pas… et cependant pour le sauver, pour vous sauver, il faut que je le sache.
– Fantômas vous le dira.
– Fantômas, mais je ne puis pas le voir, je ne dois plus le rencontrer…
– Vous le verrez, assura Juve…
C’était lady Beltham qui cette fois se révolta.
– Revoir Fantômas, fit-elle, revoir l’homme qui m’a indignement trompée, l’homme qui m’a blessée jusqu’au fond du cœur, qui m’a torturé l’âme, l’homme qui avait une maîtresse… revoir Fantômas, l’amant de Françoise Lemercier… Jamais.
Juve insista.
– Vous le reverrez, madame, il le faut…
Les yeux de lady Beltham étincelaient. La grande dame était superbe à voir. Son corps merveilleux frémissait d’indignation à l’idée qu’il lui faudrait encore revenir, s’humilier, supplier, prendre les ordres de son amant, de celui qu’elle avait tant aimé, et qui pour elle n’était plus qu’un traître…
Mais lady Beltham se rendait compte aussi qu’elle était prise au piège, et qu’assurément si elle refusait d’obéir à Juve, Juve saurait se venger…
Et puis ses yeux s’emplissaient de larmes, car malgré tout, lady Beltham aimait encore, aimait toujours Fantômas.
Mais il était bien temps de tomber en pâmoison.
– C’est sans tarder, madame qu’il faut agir, sans quoi demain à pareille heure, Garrick sera pendu.
Lady Beltham se ressaisit aussitôt.
Oui, il était impossible de laisser mourir son amant, il fallait le sauver, le sauver à toute force.
Désormais lady Beltham était résolue, sa passion triomphait de sa jalousie. Et puis Françoise Lemercier était morte. Décidément le dieu d’Amour était favorable à lady Beltham…
La grande dame toutefois, franche et catégorique, s’expliqua :
– Pas d’arrière-pensées, pas d’équivoques, dit-elle. Vous avez ma parole, monsieur, et je vous suivrai, j’obéirai… Mais vous savez quelles sont les conséquences de la visite que je rendrai à Fantômas, et ce qui peut résulter de la présence en face du condamné de celle que l’on reconnaîtra pour être Mme Garrick ?…
Juve hocha la tête :
– Je le sais, madame, lorsque vous vous serez révélée, vous aurez, de ce fait, innocenté Garrick du crime qu’on lui reproche…
Lady Beltham précisa :
– Garrick sera donc libre… Fantômas sortira de prison…
– À ce prix, répliqua Juve, j’achète la liberté de Fandor…
– Mais, poursuivit lady Beltham, Garrick une fois libre, qu’adviendra-t-il de Fantômas ?…
Juve, franchement déclara :
– Je n’ai rien promis… la lutte reprendra plus que jamais. C’est une trêve entre nous, un pacte que nous signons. Soyez assurée que je veillerai à ce que Fantômas tienne sa parole…
– Et, interrogea lady Beltham, il accepte ces conventions ?
– Il les accepte, madame…
Lady Beltham se leva, son visage affectait désormais un calme imperturbable. Sur ses traits se peignaient les signes d’une froide résolution :
– Vous croyez à la parole de Fantômas, dit-elle, consentez-vous à croire à celle de lady Beltham ?…
– Certes.
– Monsieur Juve, poursuivit dès lors la grande dame, dites-moi ce que je dois faire, je vous obéirai. Quand partons-nous ?
À travers les rideaux mal joints, paraissait l’aube. Juve consulta sa montre :
– Nous avons trois heures, dit-il, trois heures encore au terme desquelles vous viendrez avec moi, madame, au greffe de Pentonville où vous déclarerez vous appeler Mme Garrick…
***
Vers sept heures du matin, Juve, les traits tirés, le visage défait, en homme qui vient de passer une nuit blanche, et de vivre l’émotion la plus intense de sa vie, se présentait au greffe de la prison.
Un gardien chef l’aperçut :
– Ah, c’est vous déjà, « 416 ». Peste, vous arrivez de bonne heure. Je croyais que votre service ne commençait qu’à neuf heures du matin. Hé, hé, c’est votre dernier jour de garde. On pend Garrick demain. Dans vingt-quatre heures, à l’heure qu’il est, son cadavre sera déjà froid…
– C’est à savoir, dit énigmatiquement le policier, qu’à la prison, on ne connaissait que sous le nom du policeman 416.
– Que voulez-vous dire ?
– Supposez qu’un fait nouveau survienne… que par exemple, Mme Garrick songe à se présenter devant la justice… ceci tendrait peut-être à prouver que son mari ne l’a pas assassinée ?
– Mme Garrick… Mme Garrick… répéta le gardien chef, en effet, l’événement serait peu ordinaire, mais j’aime à croire qu’il ne se produira pas. Et puis vous savez, policeman, depuis deux jours, il y a du nouveau…
– Vraiment, fit Juve, c’est-à-dire ?
– Il y a du nouveau en ce sens que Mme Garrick n’est pas Mme Garrick…
Juve réprima un tressaillement.
– Que signifiaient les déclarations de cet homme ?
Le gardien s’arrêta soudain de parler, mais Juve allait être renseigné :
Quelqu’un qui venait d’entendre le son de sa voix, entrouvrant la porte d’un petit bureau voisin, l’appelait :
C’était Shepard.
– Policeman 416, disait le détective, puisque vous êtes arrivé, venez donc avec nous.
Intrigué, Juve s’était introduit dans la pièce où l’appelait Shepard et où se trouvait déjà un magistrat, M. Tilping, le coroner qui avait été chargé de l’instruction du procès Garrick.
Juve salua et attendit qu’on voulût bien l’interroger.
Sans toutefois paraître se préoccuper de sa présence, le coroner continuait sa conversation avec Shepard. Le magistrat tenait à la main plusieurs photographies, que Juve ne put apercevoir sans une vive émotion.
C’étaient des portraits de lady Beltham.
Le coroner déclarait :
– Shepard, il faut l’arrêter au plus tôt. Cette femme, nous assure-t-on, se cache en Angleterre. Il est de notre devoir d’opérer sa capture.
Shepard opinait de la tête :
– Vous pouvez être assuré, monsieur le coroner, que nous allons faire l’impossible pour nous saisir de lady Beltham… ce qui nous permettra de savoir pourquoi la maîtresse de Fantômas a fait assassiner French et pourquoi elle voulait se faire passer pour l’épouse défunte du condamné Garrick.
Juve ne bronchait pas, mais son inquiétude augmentait. Qu’était-il donc arrivé ? et si l’on avait découvert que Mme Garrick et lady Beltham ne faisait qu’une, s’était-on aperçu aussi que le formidable bandit détenu dans la prison sous le nom de Garrick n’était autre que Fantômas ? Or, chose extraordinaire, Juve, qui aurait été si satisfait d’une telle solution quelque temps auparavant, la redoutait à présent, car il se disait :
– Fantômas démasqué, lady Beltham arrêtée, c’est le châtiment assuré pour les deux coupables, mais c’est aussi la perte certaine de Fandor, car les bandits, convaincus que je les aurai trahis, se refuseront à tenir leurs promesses, à me dire ce qu’est devenu mon malheureux ami.
Mais Shepard venait de l’appeler auprès de lui, le détective lui expliquait :
– Il faut que je vous mette au courant, policeman, des derniers événements, car nous allons avoir besoin de vous. Voici la photographie d’une femme, regardez-la bien.
Shepard montrait à Juve le portrait de lady Beltham.
– Cette femme, continuait le détective, nous avons cru un moment que c’était Mme Garrick, mais nous avons appris par des communications venues de France, par les aveux du Bedeau, arrêté hier à Paris, par de nouvelles déclarations de Beaumôme, incarcéré, grâce à vous, par d’autres détails encore, que cette femme, qui prétend être Mme Garrick, sans doute pour dissimuler sa véritable personnalité, n’est autre que lady Beltham, la maîtresse du sinistre bandit, la maîtresse du formidable Fantômas. On ignore qui est Fantômas, où il est… et cela n’est pas notre affaire pour le moment, de chercher à le découvrir. Mais nous savons que lady Beltham est en Angleterre, à Londres. Elle y a été vue, tout récemment. Plusieurs de nos agents s’occupent de la découvrir. Je connais vos qualités, policeman 416, et d’accord avec M. le coroner, nous avons décidé de vous confier le soin de rechercher la maîtresse de Fantômas.
Cependant que Juve blêmissait, Shepard, en lui tendant un mandat d’arrêt, sur lequel figurait le nom de lady Beltham, mandat que venait de signer le coroner, ajoutait à l’oreille de son subordonné :
– Cette arrestation, policeman 416, vous vaudra, je vous l’assure, vos galons de sergent…
Ah ! décidément, la vie aventureuse et mouvementée que menait Juve lui ménageait les plus extraordinaires surprises ! Voici que par un hasard miraculeux, au moment où précisément il amenait lady Beltham à la prison de Pentonville, il apprenait que la police anglaise, découvrant soudain l’identité de la grande criminelle et lui contestant la qualité d’épouse de Garrick, se disposait à l’arrêter.
Et c’était lui, Juve, que l’on chargeait de cela.
Et c’est à lui que l’on disait ignorer où se trouvait Fantômas, alors que Juve savait qu’il se trouvait dans la cellule toute proche.
Juve songea un instant qu’il avait désormais à son entière merci le couple des formidables criminels. Lady Beltham amenée par lui, impatiente, anxieuse de voir Fantômas, l’attendait dans une voiture, à quelques mètres de la porte de la prison. D’autre part, derrière les sombres murs de Pentonville, Fantômas, enfermé dans son cachot, attendait sans s’en douter la décision de Juve…
Jamais la situation n’avait été meilleure, et cependant Juve n’en profiterait pas.
Ah ! une terrible lutte se livrait en lui ! Sa conscience lui commandait d’agir, lui dictait cette déclaration :
« Oui, cette femme dont vous avez sous les yeux la photographie, c’est bien lady Beltham, la maîtresse de Fantômas, et elle se trouve, ne soupçonnant rien, à cent mètres d’ici. Quant à Garrick, que vous maintenez en prison, que vous allez pendre demain matin, c’est Fantômas lui-même. Il suffira d’un mot, d’une confrontation des deux bandits, pour le proclamer à la face du monde entier. »
Mais ces paroles, Juve ne les prononça pas…
Parler ainsi, provoquer la déchéance des monstres, c’était assurément signer l’arrêt de mort de Fandor, que Fantômas tenait à sa merci.
Ah ! l’effroyable dilemme.
Il fallait commettre une iniquité pour en empêcher une autre.
Juve, pour sauver Fandor, devait devenir le complice de lady Beltham et de Fantômas…
Sans qu’un muscle de son visage n’ait tressaillit, Juve avait envisagé ces diverses hypothèses.
Estimant qu’il fallait enfin répondre quelque chose, il se tourna vers Shepard :
– M. le détective, déclara-t-il, je regrette de ne pouvoir accepter la mission que vous me confiez. Pour des raisons qui me sont personnelles, je désire résilier mes fonctions. J’irai toutefois, jusqu’au bout de la mission qui m’a été assignée, et j’assisterai, conformément à votre désir, à l’exécution de Garrick… Demain toutefois, après la mort du coupable, le policeman 416 vous redemandera sa liberté.
Aux interrogations cordiales, aux objurgations chaleureuses du détective, longtemps Juve opposa d’irrévocables dénégations.
– « 416 » demanda Shepard, ce n’est pas votre dernier mot, je suppose ?
– Monsieur le détective, poursuivit Juve, je ne puis revenir sur cette décision… Peut-être un jour pourrai-je vous expliquer les motifs qui m’ont déterminé à la prendre.
– C’est bien, dit Shepard, je prends note de votre démission, vous n’appartiendrez plus à la police anglaise à partir de demain, dix heures du matin.
Juve salua le coroner, Shepard, puis se retira lentement.
Le policier quitta la prison, et à peine arrivé dans la rue, rejoignit la voiture où l’attendait toujours lady Beltham.
– Eh bien ? interrogea celle-ci, dont le majestueux visage se dissimulait sous de longs voiles sombres.
Le policier jeta une adresse au cocher, puis s’installant dans la voiture, à côté de la grande dame, il chuchota :
– Nous avons failli tout perdre…