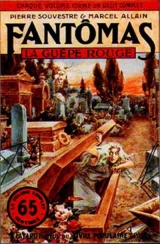
Текст книги "La guêpe rouge (Красная оса)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
– Monsieur le président, ripostait l’avocat, qui a les honneurs, doit avoir les charges. Je n’ai point l’avantage envié d’être à votre place, mon rôle n’est point de décider, mais de plaider.
– Évidemment.
– Monsieur le président me permettrait-il de lui suggérer un nom ? demanda M e Faramont. Il y a, ce me semble, une personnalité toute désignée pour remplir ce rôle de séquestre, personnalité en qui j’ai toute confiance, en qui la société L’Épargnea certainement aussi toute confiance, personnalité qui a déjà rendu de si grands services en l’espèce que…
– De qui parlez-vous ? demanda le juge.
– Du policier Juve. Juve a déjà retrouvé le tableau, c’est lui qui l’a rapporté ici, je pense qu’il accepterait ?
– Monsieur Juve, demandait le président, voulez-vous accepter d’être séquestre ?
– Assurément, répondit le policier, si cela peut rendre service, je ne vois pas pourquoi je refuserais.
– La mission est dangereuse, répéta le juge.
– Raison de plus pour qu’elle me plaise.
Juve venait de répondre à voix basse. Des bravos n’en crépitèrent pas moins.
– Silence, glapit l’huissier, pas de manifestations ici ou l’on fait évacuer la salle.
Tant bien que mal, l’ordre se rétablit.
– Monsieur Juve, déclarait alors le juge des référés, je vais donc, dans quelques instants, vous commettre en qualité de séquestre. Mais dans le placet que j’ai sous les yeux, je vois que vous avez fait citer un témoin, le nommé Bouzille ; pour quel motif désirez-vous que j’entende cet homme ?
– Parce que, monsieur le juge, Bouzille peut donner toute la clé du mystère ; d’après ce qu’il m’a dit, il sait dans quelles conditions ce tableau a été truqué.
– Vraiment ? Je vais l’entendre.
Derrière le magistrat, l’huissier se leva :
– Bouzille, appela-t-il, avancez, Bouzille.
– Dame, je voudrais bien, mais je ne peux pas.
La voix venait du fond de l’auditoire ; il y eut un brouhaha. Bouzille enfin apparut :
– Mon Président, dit-il avec un sourire aimable, faut pas m’en vouloir d’être en retard, c’est rapport à ce que j’avais enlevé mes souliers pour les faire sécher sur le calorifère. Alors, comme j’ai beaucoup marché, mes pieds avaient gonflé, et dame…
Derrière le chemineau, naturellement, la salle éclatait de rire.
– Taisez-vous, Bouzille !
– Je me tais, mon Président, je me tais.
– Votre nom ?
– Je me tais, mon Président, je me tais.
– Dites-moi votre nom.
Mais Bouzille, à ce moment, souriait aux anges et posait un doigt sur sa bouche.
– Chut, fit-il d’un air malin.
Et il apparaissait alors, ou qu’il était complètement abruti, ou qu’il se moquait du juge avec une aimable ironie.
La scène se fût peut-être prolongée, si l’huissier, au même moment, n’avait eu une fâcheuse inspiration.
Ce fonctionnaire venait de remarquer, en effet, que Bouzille avait jusqu’alors conservé son chapeau haut de forme sur la tête. Il glapit, terrible :
– Témoin, découvrez-vous.
Bouzille ne broncha pas.
– Découvrez-vous, Bouzille, répéta l’huissier. Ôtez votre chapeau.
Bouzille eut un geste navré :
– Ça va faire un malheur, dit-il.
– Comment, ça va faire un malheur ? demanda l’huissier.
– Évidemment, mais je vous ai prévenu.
Bouzille, à ces mots, empoignait son chapeau qu’il enlevait. Mais le bord ne tenait pas à la calotte, car il avait été artistement collé. Bouzille, ayant donc retiré son chapeau, apparaissait coiffé d’un tuyau de poêle invraisemblable. Son aspect était si comique, que M. Charles lui-même en eut le sourire.
– Voyons, mon ami, disait-il paternellement, ne donnez pas à rire ainsi. Enlevez votre chapeau, comme tout le monde.
– Très bien, répondit Bouzille, j’enlève mon chapeau.
Il enleva en effet la coiffe et immédiatement, sur le sol, tombait autour de lui une infinité de bouts de cigarettes ; car Bouzille avait, en effet, l’habitude d’enfermer sous son couvre-chef les mégots qu’il ramassait dans la rue.
– Silence, glapit l’huissier. Silence !
M. Charles recommença à questionner Bouzille :
– Qu’est-ce que vous savez au sujet de ce tableau ?
– Ah, bien des choses, mon Président, ripostait-il. Bougrement bien des choses. Seulement, il faudrait que je m’assoie pour vous dire tout ça. Y en a long et long. C’est un truc qui a amené un tas de manigances, c’est pas un tableau comme tous les tableaux, voyez-vous.
– Mais je ne vous demande pas cela. Je vous demande ceci : savez-vous, oui ou non, si on a truqué ce tableau ? Savez-vous si un nommé Sunds a été chargé par quelqu’un, par Fantômas, peut-être, de peindre un autre tableau par-dessus ?
– Oui, ripostait Bouzille, je sais cela, j’ai été à Bagatelle le jour où Sunds a fait le coup, il est resté le dernier et j’ai vu qu’il commençait à barbouiller dessus. Moi, n’est-ce pas, je me suis en allé parce que je me suis dit que ça allait faire des histoires. Mon Président, je ne regrette pas d’être parti, seulement, foi d’honnête homme, Sunds, voyez-vous…
– Allez vous asseoir, ordonna le magistrat excédé.
Mais Bouzille protestait :
– Déjà ? disait-il, j’ai déjà fini d’être témoin ? C’était pas la peine de m’habiller, alors.
Il restait debout devant la barre. Il fallut que l’huissier le prît par les épaules :
– Partez, ordonnait le fonctionnaire. Vous comprenez, on vous dit de partir. Ou on va vous arrêter.
– Ça serait contradictoire, murmura Bouzille.
Le chemineau allait cependant s’éloigner, lorsque le président le rappela.
Juve, en effet, venait de lui dire quelques mots à voix basse.
– Bouzille ? questionna le juge, encore un mot. Sunds vous a-t-il dit, par hasard, qu’il connaissait Fantômas ?
– Oui, affirma Bouzille, il me l’a dit, mais après, il m’a dit le contraire. Alors, n’est-ce pas, je ne sais pas. Foi d’honnête homme, voyez-vous, mon président, ce pauvre Sunds…
On renvoya Bouzille.
– Vous avez la parole, Juve.
– Monsieur le Juge, dit le policier, je n’en abuserai pas. Toutefois, puisque je vais avoir la charge et l’honneur d’être séquestre de ce tableau, je vous demanderai de bien vouloir inscrire à votre ordonnance une description exacte de cette toile. J’imagine que M e Faramont ne se refusera pas à dicter en personne une description et, par conséquent…
Or, à ce moment, du fond de la salle, une voix s’élevait, une voix d’homme, une voix impérative, railleuse aussi, qui criait :
– J’en demande bien pardon au tribunal, mais au nom du public, je proteste : la toile qui figure là n’est pas la véritable toile, il s’agit d’une copie du tableau, ce n’est pas le tableau authentique.
Cette déclaration naturellement fit stupeur.
Tous les regards se tournaient vers l’homme qui avait parlé, un homme jeune, aux moustaches fines, à la longue barbe noire, à la stature imposante : un artiste, semblait-il, si l’on s’en rapportait aux boucles de sa chevelure fine et soyeuse.
– Monsieur, commanda le juge, imposant du geste silence à son huissier, veuillez vous approcher de la barre ; vous prétendez que ce tableau est faux. Veuillez nous le prouver. Je vous préviens que si vous avez inutilement interrompu l’audience et fait scandale, je prononcerai contre vous une condamnation.
– À votre aise, monsieur le président.
L’inconnu s’avança lentement vers la barre.
Or, au moment même où l’artiste s’approchait du bureau derrière lequel siégeait le président des référés, au moment où il s’avançait au milieu d’un silence impressionnant parmi les rangs serrés du public, un double cri, une double exclamation retentissait.
Debout près de la barre, Juve avait poussé un cri :
– Fantômas, c’est Fantômas !
À l’autre bout de la salle d’audience, la voix de Jérôme Fandor avait retenti :
– Juve, prenez garde, il a un poignard.
Ce qui suivit se passa en un éclair. À peine Juve avait-il crié : « Fantômas, c’est Fantômas » que le soi-disant artiste s’arrachait la barbe, la moustache et la perruque :
– Eh bien oui, hurlait-il, c’est moi, Juve, et si je suis là, c’est que je veux vous tuer !
Plus vif que la pensée, Fantômas s’élança, brandissant un long poignard :
– À nous deux, Juve !
– À nous deux, Fantômas !
Epouvantés, les assistants s’écartaient. Le bras de Fantômas s’abaissa, la lame du poignard décrivit un clair chemin dans l’air.
– Touché, hurla le bandit.
– Non, hurlait Juve.
– En voilà un méchant, déclarait au même moment une voix en colère, veux-tu bien finir, il ne te parlait pas.
Alors que Juve, pour éviter le coup de poignard que lui lançait Fantômas se laissait tomber à terre et cherchait à renverser le bandit en l’empoignant par les jambes, un personnage, qui n’était autre que Bouzille, avait tranquillement saisi Fantômas par le bras gauche et le tirait en arrière.
– Laisse donc Juve, disait-il, tu vas avoir des histoires.
Bouzille était en colère.
L’inénarrable chemineau qui ne semblait d’ailleurs pas apprécier la gravité de la minute, eut peur pourtant, tout d’un coup, effroyablement peur en apercevant le visage contracté de Fantômas qui se retournant, fou de rage, bondissait vers lui.
– Bouzille, disait le bandit, tu vas me payer cher cette intervention-là !
Le poignard de Fantômas se leva de nouveau. Il allait frapper le chemineau au cœur, Bouzille était perdu… Et tout cela se passait si vite, que nul n’avait le temps d’intervenir. M. Charles, debout derrière son bureau, s’égosillait en vain :
– Arrêtez-le ! Arrêtez-le !
L’huissier, pris de peur, s’était enfui. M e Faramont hurlait : « Au secours ». Seuls, dans l’espace vide, dans la demi-lune du prétoire, demeuraient Fantômas, Bouzille et Juve.
Juve, se relevant sur le plancher, vit Bouzille perdu, il comprit que celui qui venait de le sauver, en somme, allait immanquablement avoir la poitrine trouée.
Il n’y avait plus rien à faire. Sauver Bouzille, c’était impossible. Ce fut l’impossible que Juve tenta.
– À nous deux, Fantômas ! cria-t-il.
Et aussi vite que l’avait fait le bandit, Juve, sans prendre le temps de se relever, saisissait sur la table le célèbre tableau, cause de tout le débat, et l’empoignant par le cadre, au hasard, en assenait un coup formidable sur le crâne de Fantômas.
Le bandit n’avait point prévu cette agression. Son bras dévia, il toucha Bouzille, mais ne l’atteignit pas de son poignard. Le chemineau tomba à son tour, Fantômas se retourna. Juve était devant lui. Juve terrifié, Juve considérant le malheureux tableau à demi déchiré par le coup qu’il venait de porter.
– Juve, hurla encore Fantômas, Juve, nous nous retrouverons !
Fantômas, alors, fit mine de bondir sur le policier, mais tandis que Juve se ramassait sur lui-même, prêt à une dernière lutte, Fantômas sautait de côté, par méchanceté, sans but, il crevait au passage, avec son poignard, la toile célèbre qu’il lacérait, réduisait en morceaux irréparables, puis il bondit par-dessus le bureau du président.
D’un coup de poing, Fantômas assomma le malheureux magistrat. Nul n’était encore revenu de la surprise que Fantômas, déjà, avait eu le temps d’ouvrir la porte de la chambre de conseil, qu’il s’était enfui, qu’il avait disparu.
Bouzille, alors, se releva.
– Eh bien, déclarait tranquillement le chemineau, c’est tout de même gentil ce qu’il a fait là, Juve. Il a crevé un tableau de cinq cent mille francs pour me sauver la vie. Je vaux cher tout de même. Ça, c’est d’un frère. C’est pas comme cet idiot de président et cet imbécile d’huissier.
***
Une heure plus tard, comme l’émotion se calmait au Palais de Justice, comme on perdait définitivement l’espoir de retrouver Fantômas, à la souricière, on écrouait Bouzille.
Le pauvre diable avait été si joyeux d’être sauvé au prix d’un tableau de cinq cent mille francs qu’il en avait profité pour prononcer de sottes injures à l’adresse de la magistrature tout entière.
On était fort nerveux au Palais de Justice ce jour-là, Bouzille en supporta les conséquences. On le coffra purement et simplement. Mais cela ne le troublait guère, car l’hiver approchait.
25 – LES JUSTICIERS
– Vous pleurez ?
Cette interrogation était formulée par Hélène. La fille de Fantômas était en face de son père, debout devant le sinistre bandit, lequel était effondré dans une bergère tandis que de grosses larmes lui coulaient sur les joues.
Il pouvait être dix heures du soir. Le père tragique et la fille mystérieuse se retrouvaient face à face dans cet hôtel somptueux de l’avenue Malakoff où le bandit s’était installé avec l’argent qu’il avait volé si audacieusement au bâtonnier Henri Faramont.
C’était là le repaire actuel de Fantômas. Mais il semblait que le bandit prît encore moins de précautions qu’auparavant.
Il s’enhardissait de plus en plus et ne se gênait en aucune façon pour aller et venir, lui et sa bande, autour de cet hôtel.
Fantômas, en coup de force, avait obtenu que sa fille vînt loger, chez lui. Hélène, provisoirement, avait accepté cette hospitalité. Elle y avait été contrainte pour ainsi dire, lorsque, après s’être enfuie de chez Érick Sunds, elle s’était trouvée sans gîte et sans argent.
Hélène était donc avenue Malakoff et lorsqu’elle avait voulu enfin s’enfuir de chez son père, coup sur coup, étaient survenus la mort du Danois, et enfin le dernier crime de Fantômas, le plus audacieux, le plus téméraire, la lacération du tableau de Rembrandt au Palais de Justice.
Le regard dur, le sourcil froncé, Hélène regardait son père, sombrement.
Fantômas paraissait ravagé par la douleur et l’émotion. La jeune fille se rendait bien compte, encore qu’elle ne le vît que rarement en tête à tête, que le génial bandit était vraiment beau.
Hélène ne pouvait s’empêcher de l’observer avec admiration et épouvante à la fois. Il était, malgré tout, superbe à voir avec son visage énergique, sa robuste carrure, son expression intelligente et volontaire et Hélène se prenait à avoir une sorte d’admiration superstitieuse pour un tel homme.
Mais si, par moments, elle se laissait aller à ces sentiments, il lui suffisait de regarder les mains de Fantômas, blanches, soignées, délicates, distinguées, pour sentir aussitôt une insurmontable répulsion, une véritable horreur monter en elle. Hélène ne pouvait oublier en effet que ces mains-là avaient semé le deuil et la mort autour d’elles. Ces mains-là c’étaient les instruments du Crime. C’étaient elles qui, impitoyables, obéissant à la volonté farouche du monstre, faisaient partir les coups de feu ou serraient les cordes destinées à étrangler.
Non. Hélène avait beau invoquer la voix du sang, elle ne pouvait arriver à éprouver le moindre sentiment d’affection naturelle, pour cet homme qu’elle épargnait par devoir, uniquement.
Et Fantômas cependant, ce soir-là, faisait pitié. Lorsque le bandit ne songeait pas à sa propre sécurité ou à sa vengeance, il faisait un retour sur lui-même et, dés lors, son cœur saignait à la pensée de la mort de celle qu’il avait tant aimée, de lady Beltham.
Hélène, après un long silence, se rapprocha de lui ; il y avait des années que les mains de la jeune fille n’avaient touché celles de son père, que ses lèvres n’avaient effleuré son front.
Elle ne voulut pas faire ce geste de douceur, mais elle interrogea d’une voix moins rude qu’à l’ordinaire :
– Vous souffrez ?
Fantômas hocha la tête.
– Je souffre, dit-il, de ne pas savoir, de ne rien pouvoir faire.
– De quoi s’agit-il donc encore ?
– De quoi il s’agit ? répéta-t-il en la fixant de son regard perçant, il s’agit d’Elle, de lady Beltham.
– Vous savez bien, fit-elle, que lady Beltham est morte.
Fantômas ne répondit point tout de suite. Il regarda longuement sa fille, puis, après un léger hochement de tête :
– Je ne sais pas.
Mais Hélène répéta d’un ton catégorique :
– Lady Beltham est morte.
– Écoute, il faut que je te dise…
Le bandit raconta la visite qu’il était allé faire quelques jours auparavant à la maison mystérieuse de Ville-d’Avray, il avoua à sa fille qu’à peine était-il arrivé dans le jardin, de l’intérieur de la maison avait surgi une vision affolante, un véritable spectre.
– C’est une hallucination.
– Les coups de revolver, dit-il, que l’on a tirés sur moi étaient pourtant réels, et je me demande d’où cela peut provenir. Qui donc pouvait m’en vouloir de la sorte ?
Brusquement, Fantômas prit les mains de sa fille qui tressaillit :
– Hélène, interrogea-t-il, on te soupçonne dans divers milieux d’être la femme mystérieuse qui se dissimule parfois dans la maison de Ville-d’Avray. Sois franche. Dis-le-moi. Est-ce toi ?
– Non, ce n’est pas moi.
Une lueur d’espoir traversa le regard de Fantômas :
– J’aime mieux cela. Néanmoins il faut percer à jour ce mystère ; je veux savoir et je saurai ce qui se passe dans cette maison de Ville-d’Avray.
– Mon père, fit-elle, ignorez-vous donc que la police tout entière a l’attention attirée sur cette maison mystérieuse où il se passe des choses ?
– Peu importe, cria Fantômas dont la résolution semblait désormais définitive, j’irai là-bas, pas plus tard que ce soir, et je saurai.
Puis, comme s’il se parlait à lui-même, il ajouta :
– Je crois à quelque chose d’insensé, d’invraisemblable, je crois que lady Beltham habite cette maison. Je vais m’y rendre en me dissimulant. Je ne me montrerai pas tout d’abord.
– Pourquoi ?
– Ceci est mon secret.
En réalité, Fantômas, qui parlait à sa fille, plaidait un peu le faux pour savoir le vrai.
Sans doute, l’extraordinaire vision qu’il avait eue auparavant lui permettait de croire, d’espérer que peut-être lady Beltham était vivante, encore que cela lui parût invraisemblable, et que peut-être elle habitait cette demeure. Mais si c’était la vérité, pourquoi lady Beltham avait-elle tiré sur lui ? Devait-il considérer désormais sa maîtresse adorée, celle qui avait commis les plus épouvantables crimes pour lui, comme une adversaire redoutable ? Un seul pouvait – pensait le bandit – le renseigner sur ce point, c’était celui qui s’était accusé d’avoir fait mourir la grande dame, c’était le vengeur qui se dissimulait sous le nom de Dick, c’était le fils de l’acteur Valgrand.
Or, ce soir-là, si Fantômas était si énervé, si ému, c’est qu’il avait rendez-vous avec Dick. Le jeune homme devait venir le trouver, ayant, paraît-il, des choses importantes à lui dire.
À ce moment, la sonnerie du téléphone intérieur retentit. Fantômas bondit à l’appareil, son visage s’éclaira : on venait de lui annoncer l’arrivée de Dick. Il se tourna vers sa fille.
– Laisse-moi, dit-il, et dans une heure je partirai pour Ville-d’Avray.
Hélène avait réfléchi ; elle aussi avait un mystérieux besoin de savoir et de se rendre compte :
– Dans une heure, je partirai également pour Ville-d’Avray.
– Je te remercie, Hélène, de bien vouloir m’accompagner. C’est la première fois que je vois ma fille aussi douce à mon égard… J’aurai une automobile, à minuit, qui nous attendra à l’entrée de la porte de l’hôtel.
– J’irai seule, déclara-t-elle, et de mon côté.
Hélène quittait la pièce. Fantômas lui demanda auparavant :
– Où vas-tu donc, maintenant ?
– Ai-je des comptes à vous rendre, fit-elle, et ne suis-je pas libre, libre absolument ?
Fantômas baissa la tête et ne répondit point.
Une seule personne au monde pouvait enfreindre sa volonté sans s’attirer la colère et les représailles du monstre : Hélène, sa fille.
***
Le visage de Fantômas était désormais transformé. Ses traits avaient repris leur impassibilité, car Fantômas était en face de Dick.
Sur le visage de ce dernier se lisait également une sombre résolution.
– Que voulez-vous ? demanda Fantômas.
– La paix.
Et Dick demeura les bras croisés devant son interlocuteur :
– Il faut en finir, déclara-t-il.
Un sourire cruel erra sur les lèvres de Fantômas :
– C’est mon avis, dit-il, et qu’entendez-vous par là ? Quelle est la conclusion que vous me proposez ?
– Fantômas, je renonce à la lutte, vous êtes trop fort, et je suis trop amoureux. Et puis je n’ai pas une âme de bandit, et je souffre de savoir Sarah perpétuellement exposée. Vous voyez que je suis venu vers vous sans arme et que, s’il vous plaisait désormais de me faire mourir, vous pourriez le faire.
– Je vous épargne, fit Fantômas, vous le voyez bien, mais pourquoi m’avez-vous provoqué ?
– Il le fallait, soupira Dick. J’avais à venger la mort de mes parents et c’est pour cela que j’ai tué lady Beltham.
Fantômas serra les poings :
– Vous osez, Dick, répéter devant moi cette horrible chose ?
– Oui, fit l’acteur nettement.
D’une voix sourde, inquiète, Fantômas interrogea :
– C’est bien vrai, n’est-ce pas ? Vous êtes bien l’assassin de lady Beltham ?
– Je suis le justicier. Lady Beltham est morte par ma volonté.
D’une voix hésitante qui suppliait presque, le bandit questionna encore :
– Et ne l’avez-vous jamais revue depuis ?
Si cette question était extraordinaire, venant après l’affirmation de Dick, la réponse de l’acteur fut plus étrange encore.
Il se passa la main sur les yeux :
– Si, je l’ai revue, mais ce n’était pas elle, c’était son spectre, c’était un cauchemar, une image évoquée par ma conscience. C’est pour cela que je viens vers vous, Fantômas, c’est cela que je veux oublier. Faisons un pacte, voulez-vous ? Oubliez-moi, je vous oublierai. Épargnez Sarah.
Le bandit eut un sourire cruel ; se rapprochant de l’acteur, il souffla ;
– Je pourrais vous perdre, désormais. Vous tuer. Vous êtes à ma merci.
Mais Dick protesta :
– Ma mort serait vengée, dit-il, car Sarah est prévenue de ma visite et elle m’attend au-dehors. Si dans un quart d’heure je n’étais pas sorti, la police serait prévenue de l’endroit où vous vous cachez et votre repaire serait cerné.
Un instant, Fantômas parut réfléchir, puis il proposa, paraissant accéder au désir de son interlocuteur :
– Je suis prêt à m’entendre avec vous, dit-il, à une seule condition. C’est que nous irons ensemble, sans plus tarder, à la maison mystérieuse de Ville-d’Avray. Vous avez vu apparaître devant vous le spectre de lady Beltham. Moi aussi. Vous prétendez que c’est un spectre, une vision de cauchemar, moi je me demande si ce n’est pas lady Beltham elle-même. Que cela vous paraisse extraordinaire, peu m’importe. Il faut que vous veniez avec moi, il faut que nous allions là-bas ensemble.
– Soit.
– Je vous épargnerai comme je vous l’ai promis à la condition que vous vous écartiez de mon chemin dès ce soir, après notre visite à Ville-d’Avray.
***
Cependant, Hélène, quittant son père, s’était vêtue en hâte. Elle était descendue dans la rue et y cherchait une voiture pour se rendre à la gare, afin d’y prendre un train pour Ville-d’Avray, lorsque soudain elle poussa un cri de surprise.
En face d’elle se trouva une femme qu’elle reconnut.
– Sarah !
– Hélène !
Les deux jeunes filles se toisèrent. Elles étaient seules dans l’avenue Malakoff. Machinalement, elles marchèrent l’une à côté de l’autre, en silence jusqu’au carrefour de l’avenue du Bois.
Que signifiait cette rencontre, et pourquoi Sarah Gordon se trouvait-elle dans ces parages, épiant, semblait-il, ce qui se passait dans l’habitation du bandit ?
Hélène ne tarda pas à être renseignée. L’Américaine, d’une voix suppliante et douce, qu’Hélène ne lui connaissait pas, articulait faiblement :
– Mademoiselle, nous sommes deux malheureuses.
– Je suis malheureuse, répliqua Hélène, mais pas vous.
Et elle ajouta en soupirant :
– Vous êtes aimée comme moi, sans doute, mais il vous est permis d’aimer. Et je ne vois qu’une chose à faire, pour vous, c’est de fuir au plus tôt avec celui qui vous aime.
– Je ne demanderais pas mieux, répondit Sarah Gordon, si cela se pouvait, mais Dick…
– Dick acceptera de s’en aller si vous le décidez, et vous pouvez le faire désormais. Oui, poursuivit la fille de Fantômas, il y a quelques semaines, à Enghien, j’ai vu Dick pour la première fois de mon existence et j’ai consenti, avec lui, une entente. Je m’engageais même, au prix d’un mensonge, à vous retenir coûte que coûte à Paris, à vous empêcher de partir en Amérique, comme vous en aviez l’intention. C’est pour cela que je vous ai raconté que j’étais sa maîtresse. Or, je vous jure sur l’honneur que ce n’était pas vrai.
– Je sais, fit Sarah Gordon, mais que serait-il arrivé si vous n’aviez pas joué cette comédie à mon égard et si je n’étais pas restée ?
– Si vous étiez partie, Dick serait parti avec vous et, au préalable, il aurait tué mon père. C’est ce que je ne voulais pas. Hélas, la situation a changé désormais et nos promesses respectives n’ont plus de valeur. Dick et mon père se poursuivent de leur haine, et ils se tueront si nous n’intervenons pas.
– Que faut-il faire ? Je sens que je deviens folle, protégez-moi !
– Il faut les séparer l’un de l’autre, obtenir qu’ils s’épargnent mutuellement, qu’ils s’oublient. Vous évitez Fantômas, en habitant l’Amérique. Partez, partez, Sarah Gordon, au plus vite, et emmenez Dick avec vous !
– Ah, dit l’Américaine, Dieu veuille que je puisse faire ce que vous dites. Il faudrait pour cela que nous puissions les joindre, leur parler.
De plus en plus émue, elle confiait à Hélène :
– Un remords effroyable torture le cœur de Dick et ne lui laisse pas un instant de repos. C’est lui qui a tué lady Beltham et sa conscience d’honnête homme lui reproche le crime qu’en tant que justicier il a commis pour venger ses parents. En admettant qu’il renonce à la lutte, votre père consentira-t-il à l’épargner, à renoncer à sa vengeance ?
– Je crois, fit Hélène, que nous parviendrons à réaliser nos vœux. Dick est en ce moment avec mon père, il est certain que tous deux vont se rendre à Ville-d’Avray d’ici peu. Il faut, Sarah Gordon, que nous y allions aussi.
– À Ville-d’Avray ? Pour quoi faire ?
– Pour y retrouver quelque chose, ou pour mieux dire quelqu’un, dont la présence atténuera la haine de mon père pour vous et aussi les remords de celui que vous aimez.
– Est-ce possible ?
– Je vous le jure, dit Hélène, qui pensait à lady Beltham dont l’existence, une fois découverte, constituerait en effet la meilleure solution de nature à atténuer la colère de Fantômas et à écarter de l’esprit de l’acteur les remords qui bourrelaient sa conscience.
Les deux jeunes femmes venaient d’aviser une voiture :
– Ne perdons pas un instant, dit Hélène en y montant. Chauffeur, à Ville-d’Avray !
***
Dick était descendu avec Fantômas, et ils arrivèrent dans l’avenue du Bois de Boulogne quelques instants après le départ des deux femmes. Ils marchaient l’un à côté de l’autre, silencieux, dans l’avenue déserte où ne passaient que quelques promeneurs attardés.
– Eh bien ? interrogea Fantômas railleusement, où est Sarah Gordon ?
Dick regardait de tous côtés, paraissant fort surpris, fort ému de ne point voir l’Américaine, qui devait l’attendre dans le voisinage. Il ne voulut pas confier ses appréhensions à Fantômas, car Dick se demandait si Sarah, impatiente, inquiète de ne point le voir revenir n’était pas allée prévenir la police.
Il déclara simplement :
– Nous sommes peut-être descendus trop tôt.
– Ou trop tard.
Dick feignit de ne pas l’entendre ; il continuait à regarder autour de lui. Cependant Fantômas sentait la colère gronder en son cœur.
« Il ne me sert à rien d’être bon, pensait-il, et ce misérable que je viens d’épargner jusqu’ici me trahit encore. Mais il ne perd rien pour attendre. Sa vie ne vaut pas cher en ce moment. »
Il dissimula sa pensée. Il venait d’apercevoir, rangée le long du trottoir, une superbe limousine automobile qui attendait.
C’était sa voiture.
Fantômas suggéra d’une voix douce, aimable, pour ne point inquiéter son compagnon :
– Partons, voulez-vous ? Allons ensemble à Ville-d’Avray sans nous occuper de Sarah ?
Dick était si troublé qu’il accepta la proposition. Il hésita cependant en voyant Fantômas le conduire vers l’automobile. L’acteur connaissait le bandit pour n’avoir pas de pitié. Un instant, il eut peur de monter avec lui.
– J’ai votre parole, demanda-t-il, vous épargnerez mon existence jusqu’à ce que nous ayons vu si lady Beltham existe ou non ?
Fantômas ne répondait rien. Il ouvrit la portière du véhicule, fit un signe à l’homme qui était sur le siège, qui aussitôt descendit pour mettre la voiture en route.
Dick résigné, résolu aussi à en finir, monta dans la limousine.
Fantômas s’installa à côté de lui. Le véhicule démarra.
Le bandit, cependant, avait un air sinistre, et, désormais seul à seul avec Dick, dans la voiture, il le regardait d’une si terrible façon que le malheureux acteur eut l’impression qu’il était perdu.
Il répéta en balbutiant :
– Vous m’avez promis, n’est-ce pas, de m’épargner ?
Alors, Fantômas, lentement, s’expliqua :
– Je vous ai promis, Dick, de vous épargner si Sarah, comme vous me l’aviez annoncé, avait été là auprès de ma demeure à vous attendre, mais elle n’y était pas.
La voix de Fantômas devenait frémissante :
– Elle n’y était pas, et j’en conclus qu’impatiente de vous revoir, elle m’a trahi, elle a couru me dénoncer à la police. Ah, voyez-vous, Dick, on ne se joue pas impunément de Fantômas.
Un râle effroyable lui répondit, un cri d’angoisse et de douleur indicible retentissait.
Ce cri se perdit dans la nuit silencieuse, il fut couvert par le ronflement du moteur et l’appel de la sirène qui troubla la nuit.
Seul, peut-être, avec Fantômas, un autre homme avait entendu ce cri d’agonisant : c’était le conducteur du véhicule. Mais cet homme avait bien trop l’habitude des drames et des crimes. Il connaissait bien trop son maître pour s’en émouvoir un seul instant. L’automobile, à ce moment, lancée dans une avenue droite du Bois de Boulogne, accélérait son allure.
***
Cependant à cette même heure, la plus grande animation régnait dans les bureaux de la Sûreté Générale.
Une vingtaine d’agents de la Sûreté attendaient dans un couloir sur lequel s’ouvrait le cabinet de M. Havard. On allait et venait, les ordres se succédaient les uns aux autres. Tantôt un homme ou deux se détachaient du groupe des inspecteurs qui attendaient, tantôt il en revenait d’autres essoufflés, haletants, que l’on introduisait d’urgence dans le cabinet du chef de la Sûreté.
Juve, arrivé enfin, aperçut Léon et Michel, ses deux collègues et amis, mais il leur serra la main en hâte et pénétra dans le bureau de M. Havard.
Dès que le chef suprême vit le policier, il déclara :
– Vous aviez raison, Juve, le domicile actuel de Fantômas est bien cet hôtel de l’avenue Malakoff, mais on me téléphone à l’instant que notre filature a dû être éventée, et qu’il vient d’en partir.








