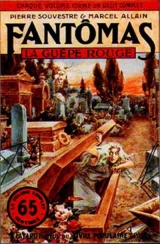
Текст книги "La guêpe rouge (Красная оса)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
– Plaisante si tu veux, Fandor, dit-il, mais j’y pensais précisément, et d’ailleurs, après tout, avec ce gaillard-là, nous en avons vu bien d’autres.
23 – LA MORTE
Qui donc cependant, alors que Fantômas, après avoir quitté le bric-à-brac de la mère Toulouche, était à Ville-d’Avray pour y reprendre le fameux tableau acheté par la grande dame en automobile, avait osé tirer sur le Maître de l’Effroi ?
Quelle était tout d’abord cette mystérieuse femme aux cheveux blancs, à l’attitude toujours grave, toujours sombre et triste, qui paraissait sous le coup d’un effroyable chagrin, d’une douleur immense et tragique ?
Tandis que, sous les coups de feu tirés dans la nuit, Fantômas s’enfuyait du jardin de la villa abandonnée, la mystérieuse dame était debout, sur le perron de son petit hôtel, tremblante, livide, prête à défaillir, et pourtant, semblant prête à la lutte, fouillant l’ombre de ses regards, prêtant l’oreille et murmurant tout bas d’une voix chargée de haine :
– Je le tuerai. Je le tuerai.
Cette femme extraordinaire demeurait sur ce perron de longues minutes, elle ne paraissait pas avoir conscience du temps, elle paraissait oublier tout ce qui l’entourait, comme prise par la hantise d’une idée fixe, comme entraînée par ses propres réflexions, comme courbée sous la rafale de sentiments.
Et puis, brusquement, elle tressaillit.
Cette femme qui, pendant de longues minutes avait paru incapable d’action, sur le point de s’évanouir, se redressait. Le masque de son visage devenait à nouveau volontaire, impérieux. À nouveau, dans ses yeux, la volonté mettait une colère, un éclat brutal.
– Est-ce lui encore ? se demandait-elle.
Elle avait une main fine et délicate, la main soignée d’une grande dame, elle leva son revolver, et rapide, habile, fit sauter les cartouches tirées qu’elle remplaça par d’autres cartouches.
– Si c’est lui, murmurait-elle, je le tuerai.
Elle attendit longtemps. Les bruits qui venaient de la faire tressaillir se répétèrent dans l’ombre, c’étaient des bruits de pas.
Bientôt, des chuchotements les accompagnèrent. La femme mystérieuse descendit alors dans le jardin. Elle se mêla à la nuit, et, frissonnante, farouche, l’arme au poing, s’avança dans les massifs.
Or, elle avait à peine fait quelques pas, qu’une inexprimable expression de douceur passait sur son visage.
Il semblait que cette femme qui, un instant avant parlait de tuer, eût été soudainement émue, attendrie.
– Pauvres enfants, murmurait-elle.
Elle s’était arrêtée, elle reprit sa marche, hâtant le pas.
– Monsieur Jacques, appelait-elle bientôt.
À quelques pas d’elle, un couple passait, enlacé. Jacques Faramont et Brigitte, qui de nouveau s’étaient rendus dans le jardin de la villa mystérieuse pour, en échappant à toute surveillance, tenir des propos d’amour.
Les deux jeunes gens n’avaient même pas entendu le bruit des détonations qui venaient de retentir quelques minutes avant, ils allaient, perdus dans un rêve, et tout ce qui les entourait leur était à ce point étranger, que cet appel même ne les fit pas se retourner tout d’abord.
– Monsieur Jacques, appela encore la mystérieuse femme aux cheveux blancs.
Cette fois, le fils du bâtonnier tressaillit.
– Qui va là ?
Devant lui, la silhouette de la grande dame se dessina soudain.
– Monsieur, dit-elle, je vous avais prié de ne pas revenir chez moi et vous me l’aviez promis.
À la minute, la petite Brigitte perdait la tête :
– C’est la dame d’à côté, souffla-t-elle. Ah, Jésus-Marie, ça va faire encore des histoires. Venez-vous-en, Jacques. Partons. Faut lui demander pardon et ne plus revenir.
Mais Jacques Faramont avait mis le chapeau à la main, et saluant fort aimablement.
– Madame, répondit-il, il faut que je vous demande, en effet, mille fois pardon, pour la nouvelle indélicatesse dont je viens de me rendre coupable. Il est exact, en effet, que je vous avais promis de ne point revenir ici, mais votre jardin est si calme, si tranquille, si attirant, que je me suis laissé entraîner…
Il allait continuer à parler, reprenant un peu d’assurance au fur et à mesure qu’il s’écoutait, lorsqu’il fut brusquement interrompu par un éclat de rire de la vieille dame :
– Vous trouvez que mon jardin est calme ? En vérité, monsieur, vous vous trompez étrangement.
– Monsieur Jacques, il faudrait partir, répétait Brigitte, cette dame n’est pas contente et elle a raison, ça va faire des histoires.
Brigitte préoccupée avant tout de ne pas perdre sa place, et par conséquent de ne pas s’exposer à des « histoires » comme elle le disait, n’avait qu’une préoccupation : s’enfuir.
Plus poli, Jacques Faramont tenait à s’excuser encore. Le fils du bâtonnier d’ailleurs, se souvenait à cet instant, des interrogations dont l’avait un jour accablé Fandor relativement à la femme mystérieuse qu’il avait un instant devant lui. Qui était-elle, cette personne ? Avait-elle été mêlée d’une façon ou d’une autre à l’extraordinaire attentat qui avait, sans nul doute, failli coûter la vie à son propre père ? D’où venait-elle ? D’où revenait-elle plutôt, puisqu’elle se trouvait à nouveau dans cette maison, après s’en être absentée au lendemain du crime avorté ?
– Madame, recommença le jeune homme, je vais vous demander la permission de me retirer, sans chercher à comprendre pourquoi il vous apparaît si bizarre que votre jardin passe à mes yeux pour parfaitement tranquille. Toutefois, je ne voudrais pas m’en aller, avant d’obtenir de vous que vous me pardonniez. Vous nous serez indulgente, n’est-ce pas ?
La dame de la villa vide souriait toujours. À la demande du jeune avocat, cependant, elle retrouva son sérieux. Le rire, mêlé de sanglots s’arrêta net, comme brisé.
Toutefois, Jacques Faramont sentait que la mystérieuse personne, à cet instant, le regardait fixement. Elle paraissait agir en somnambule, c’était en hallucinée qu’elle s’avançait vers lui, les mains frémissantes et jointes dans un geste de prière :
– Monsieur, disait-elle lentement, si vous êtes un homme d’honneur, et je veux le croire, il faut que j’obtienne de vous un serment. Ce n’est pas pour moi que je le demande, c’est pour vous. C’est à cause de vous qu’il est nécessaire, il faut vous en aller d’ici, mais il faut me jurer que vous n’y reviendrez jamais.
– Madame, nous allons nous retirer, puisque vous nous le demandez. Ne pourrais-je, contrairement à la prière que vous m’adressez, vous demander l’autorisation de revenir quelquefois rêver sous vos arbres ?
– Jamais, monsieur, jamais je ne vous accorderai pareille chose. Fuyez, partez. C’est épouvantable ce que vous me demandez là. Oh, je ne peux pas vous expliquer, mais il faut me croire. Venir ici, chez moi, dans mon jardin, c’est courir d’épouvantables dangers, c’est risquer la mort à toute minute. Non, non, jurez-moi, au contraire, que vous ne reviendrez jamais. Il faut me le jurer ! Tenez, vous voyez bien que je suis armée, oh, c’est épouvantable, ne revenez pas, monsieur, ne revenez pas !
Recommandations étranges en vérité, menaces étranges aussi que faisait cette grande dame à la fois si douce et si impérieuse.
Jacques Faramont fut très troublé par l’apostrophe violente et douce à la fois de la mystérieuse personne. Pourquoi parlait-elle de dangers ? Pourquoi brandissait-elle un revolver ? N’était-elle pas un peu folle ?
– Madame, murmura le jeune homme, je ne pensais pas vous importuner si gravement, mais il suffit. Je comprends que j’ai été indiscret, je vous fais toutes mes excuses, vous avez ma parole d’honneur que je ne reviendrai pas chez vous.
– Merci, monsieur.
À l’instant, la dame aux cheveux blancs s’éloigna. Elle revint soudain avec violence sur ses pas :
– Il faut encore me jurer de ne rien dire de tout cela.
– J’allais vous adresser la même prière, madame.
À la réponse de Jacques Faramont, elle se remit à rire, de son rire de folle.
– Oh, moi, faisait-elle, je me tairai. Moi, il faut bien que je me taise, vous n’avez pas à être inquiet !
Dans la nuit, sans se retourner, la vieille dame était repartie.
Mais quelle était donc cette femme ?
Si Fantômas, sur qui elle venait de tirer, l’avait bien vue, si Juve, si Fandor, avaient pu l’apercevoir, si Dick Valgrand l’avait contemplée en face, ils eussent crié son nom avec quelle stupeur !
Cette femme, c’était une morte.
C’était lady Beltham !
Lorsque lady Beltham, deux mois auparavant, avait été trouver Juve et lui avait dit : « Sauvez-moi, car Fantômas veut me tuer, car il a assez de sa maîtresse, car il songe à se débarrasser de moi, car j’ai peur », lady Beltham s’était trompée.
Jamais Fantômas n’avait pensé à se détacher de celle qu’il aimait, de celle qui, au début de sa vie, l’avait arraché au couteau de la guillotine.
Les menaces qui épouvantaient alors lady Beltham n’émanaient nullement du tortionnaire. Elles venaient de Dick, de Dick Valgrand, qui se faisait passer pour un autre Fantômas, cela précisément pour approcher de lady Beltham, pour venger la mort de son père, la mort de sa mère aussi.
Juve, tout comme lady Beltham, et parce qu’il n’était renseigné que par lady Beltham, s’était trompé. Lui aussi, avait cru que c’était Fantômas qui menaçait la grande dame, et Juve croyait toujours que c’était lui qui avait tué lady Beltham, comme lady Beltham pensait que c’était Fantômas qui avait voulu l’asphyxier dans son appartement.
Des jours d’horreur avaient suivi.
Veillée par Juve, enfermée dans sa chambre, que le policier avait en quelque sorte blindée, lady Beltham, se croyant menacée par Fantômas, avait connu l’angoisse d’attendre la date fixée pour son trépas.
Cette date était arrivée.
Juve, stupide d’effroi, avait découvert le lendemain matin, la jolie femme étendue froide, inanimée, glacée, dans son grand lit.
Comme un fou, le policier avait couru jusqu’au Laboratoire municipal. Un médecin avait confirmé la mort de lady Beltham. Juve avait trouvé et prouvé qu’elle avait été empoisonnée par les émanations d’une conduite de gaz, rompue dans le sol, sous le plancher de son appartement situé au rez-de-chaussée d’un bel immeuble, avenue Niel, à Paris. Et l’inévitable, l’effroyable, s’était alors accompli. Lady Beltham était morte.
Cette morte, on l’avait mise en bière, on avait clos sur elle la planche qui ferme le cercueil des humains. On avait transporté son corps au cimetière, on l’avait enfouie dans un caveau, ainsi qu’elle le demandait dans son testament.
Lady Beltham était morte ?
Non.
La destinée de cette femme était vraiment une destinée d’horreur. Elle qui était riche et jolie, elle qui rencontrait partout où elle se présentait les succès les plus enthousiastes, les hommages les plus flatteurs, les adulations les plus folles, devait se réveiller dans l’épouvante d’une tombe.
Lady Beltham n’était pas morte.
L’asphyxie l’avait tout simplement plongée dans la léthargie, et le froid, l’humidité suintant du sépulcre, son horreur, la ranimaient petit à petit.
Lady Beltham, alors, avait ouvert les yeux. En vain. Elle ne voyait rien. Elle voulut bouger, et ne put faire un mouvement. Elle se sentait emprisonnée, enserrée dans une étreinte qu’il lui était d’abord impossible de définir. L’air manquait à sa poitrine haletante. Une odeur de camphre lui entêtait l’esprit. Sous elle, du sable crut-elle, du son plutôt, lui meurtrissait les reins. Où était-elle ?
Lady Beltham qui, en s’éveillant, n’avait point compris, devait bientôt se rendre compte de l’effroyable réalité des choses.
Elle était dans son cercueil, elle était morte, et morte assassinée par son amant, assassinée par Fantômas.
Enterrée vive, conservant toute sa lucidité, elle goûtait véritablement à la mort, elle mourait lentement, minute par minute.
Pourtant c’était une pensée qui la rongeait, qui la rongeait vive, qui la faisait crier de douleur :
– C’est Fantômas qui m’a tuée ! C’est l’homme que j’aimais, qui m’a assassinée !
Ah certes, elle l’avait aimé Fantômas, elle l’avait aimé au-delà de tout, plus que le devoir, plus que l’honneur !
Pour lui, la grande dame s’était abaissée jusqu’aux plus infâmes complicités, pour lui, elle s’était roulée jusqu’au crime, pour lui, ses mains s’étaient teintes de sang, c’était elle, en somme, qui avait déclenché le couteau du bourreau sur la tête de l’innocent Valgrand.
Lady Beltham, clouée dans sa bière, enfermée dans sa tombe, murmurait :
– Fantômas, ah que je te hais.
Mais que pouvait bien sa haine, hélas ?
Elle était plus morte qu’une morte, elle se savait au tombeau. La haine, cependant, accomplit des miracles. Elle a des flammes qui torturent, elle a des morsures qui raniment les énergies les plus défaillantes. Lady Beltham affolée, incapable de vouloir quoi que ce soit, se tordit dans sa bière, prise d’une véritable crise nerveuse.
Effroyable était sa situation. L’air contenu en son cercueil se raréfiait, elle allait être asphyxiée. Cette fois, véritablement, elle allait périr.
Et soudain, comme brisée des convulsions qui venaient de la secouer, elle demeurait pantelante, sa pensée, machinalement, instinctivement, lui souffla :
– Il y a de l’air encore puisqu’il est possible que tu respires. Il y a de l’air.
Elle imagina alors que la bière était mal clouée. C’était fou de penser à se sauver, et pourtant lady Beltham espéra.
– Il faut que je vive, murmura-t-elle, il faut que je vive pour me venger.
Dans son cercueil, elle médita, horrible chose, le moyen de sortir du sépulcre. Mais sort-on d’un sépulcre ? Même, si elle voulait briser sa bière, ne se trouverait-elle pas au fond de son caveau, d’un caveau que murait inexorablement le poids formidable de la pierre tombale ?
Vanité des vanités, Lady Beltham songea que jadis, elle avait elle-même pris soin de faire édifier au cimetière la pierre de grès qui devait assurer le repos de ses cendres, et qui maintenant la condamnait à mort. Et sa pensée, à ce moment, était un tourbillon.
Alors qu’elle désespérait, elle espérait. Au moment où elle comprenait qu’on ne sort pas du sépulcre, elle voulait en sortir.
Une crispation encore, effroyable, tordit ses membres ; dans la bière où elle étouffait, son corps s’arqua, se détendit. Elle se retourna sur elle-même, elle eut le visage enfoui dans le son que l’on avait mis au fond de son cercueil pour absorber la pestilence de ses chairs décomposées.
Sur ses genoux, sur ses bras, elle voulut se soulever, elle était mourante, puis, soudain, une force extrême semblait être à sa disposition, le couvercle de la bière craqua, une vis lâcha, une autre céda encore, ce fut une chose brusque, imprévue, qu’elle ne comprit même pas, dans l’état d’affolement où elle était réduite.
Elle venait de défoncer sa bière.
La bière s’ouvrait.
Quelques secondes, lady Beltham demeura encore immobile au fond de son cercueil.
Puis, elle se jeta hors de la boîte sinistre. Elle roula sur le sol et, respirant à pleins poumons, un rire de folle sur les lèvres, les bras étendus, elle demeura encore quelques instants, n’osant comprendre qu’elle avait déjà fait ce premier pas vers la vie, qu’elle était sortie de son cercueil.
Lady Beltham, plus folle que raisonnable, bientôt se redressait. Elle était toujours dans le noir, à genoux, elle sentait, de ses doigts tremblants, la maçonnerie grossière, humide, suintante, du caveau.
Au-dessus d’elle, son bras étendu, elle cria à la nuit :
– Je ne peux pas sortir de là, on enterre les morts bien trop profondément, je vais périr. Oh, j’aurais tant voulu me venger.
L’abattement qui l’avait reprise, durait peu, cependant.
Elle se redressa tout à fait. Son cercueil, qu’elle repoussait du pied, lui servait d’échelle. Elle le dressa contre la muraille du sépulcre, elle se hissa sur lui. Glacée, frissonnante, elle s’était enveloppée de son suaire. Dans l’ombre du tombeau, c’eût été une vision fantastique, que celle de cette femme enterrée vive, dressée sur son cercueil et voulant remonter du fond de la tombe jusqu’à la vie.
Lady Beltham, debout sur la bière, les mains saignantes, les genoux écorchés, une effroyable douleur mettant un vertige dans sa tête, longtemps palpa, sous ses doigts, la surface unie de la pierre tombale.
Elle sentait bien qu’il lui serait impossible de soulever cette pierre, mais, pourtant, elle frémissait en pensant que si jamais elle était capable de l’arracher du sépulcre, elle pourrait sortir de la mort, et retourner parmi les vivants.
Or, en poussant la pierre tombale, en se meurtrissant les doigts à vouloir la soulever, lady Beltham se rendait compte soudain, avec une joie affolée, qu’elle la faisait légèrement glisser, qu’elle la déplaçait.
La pierre n’était pas encore fixée.
Enterrée la veille au soir, très tard, par crainte de manifestations, la pauvre femme avait été abandonnée dans sa tombe, sans que les fossoyeurs eussent eu le temps de sceller son sépulcre.
Cela devait la sauver.
La pierre tombale qui fermait la fosse était en effet encore en équilibre sur des rotins de bois. Elle put, lentement, péniblement, la déplacer, la faire rouler.
Au terme d’une heure d’efforts, dans la nuit, dans la paix du cimetière, dans l’immensité tranquille du champ de repos où la lune répandait une clarté blafarde, où les croix tendaient leurs bras dénudés, lady Beltham sortit de sa tombe, et pantelante, épuisée, au pied même de cette tombe, la tête sur la pierre funéraire, elle s’écroula.
La malheureuse resta là jusqu’au petit matin.
C’était la fraîcheur de l’aube, l’humidité de la rosée glaciale et pure qui la tirait de son assoupissement.
Le suaire dont elle s’était enveloppée était trempé, elle le rejeta. La robe dont elle était vêtue lors de son ensevelissement était maculée de sable, qu’importait, elle s’y enroula étroitement et, consciente cette fois, prise d’un grand désir de vengeance, elle referma sa propre tombe, y enfouit le grand suaire, puis elle prit la fuite par la porte qui venait de s’ouvrir.
Lady Beltham alla se cacher dans la maison déserte de Ville-d’Avray. C’est là, dans cette retraite qu’elle s’était ménagée depuis longtemps pour le jour où il lui faudrait disparaître, le jour où Fantômas l’abandonnerait – car elle avait vécu dans la crainte de cet abandon – que lady Beltham s’était terrée.
Chose effroyable, ce n’était plus une jolie femme, qui se dissimulait dans la villa déserte. Lady Beltham avait eu l’épouvante, en se contemplant devant un miroir, de s’apercevoir des irréparables outrages que la terreur, l’angoisse, la mort frôlée, avaient affligés à sa beauté dédaigneuse.
Son teint nacré avait jauni, ses yeux purs s’étaient ridés, sa nuque gracile ployait sous le poids trop lourd de sa tête, ses cheveux mêmes, ses cheveux fins et souples, qui faisaient jadis une auréole triomphale à sa beauté, avaient blanchi.
Dans le sépulcre, la jeune et jolie femme était devenue vieille, vieille de cent ans, c’était une ruine désormais.
***
Lady Beltham, depuis lors, n’avait vécu que pour se venger.
Elle n’avait rien compris aux incidents tragiques qui s’étaient passés dans sa villa, et qui avaient failli coûter la vie au bâtonnier Faramont. Elle avait soupçonné que Fantômas était pour quelque chose dans cet attentat, et ce n’était point vrai.
Elle avait cru depuis, que Fantômas avait voulu, ayant appris qu’elle vivait, la revoir, et ce n’était point vrai encore.
C’était Dick Valgrand, une première fois, qui s’était rendu chez elle.
La veille, enfin, lady Beltham, en achetant le tableau, n’avait eu d’autre but que d’attirer auprès d’elle Fantômas, Fantômas qu’elle accusait toujours d’avoir voulu la tuer.
Cette fois-là, c’était bien sur Fantômas qu’elle venait de faire feu, c’était bien le bandit que ses balles avaient frôlé.
Mais Fantômas n’avait pas été atteint, il n’avait même pas été blessé, et lady Beltham, frémissante sous le vent du soir, immobile sur son balcon, songeait :
– Il reviendra. Je le connais trop pour croire qu’il puisse avoir peur, il doit s’imaginer que le tableau est ici. Il viendra pour le reprendre. Et alors je me dresserai, à l’improviste, devant lui, et alors, je me vengerai, ah, je me vengerai !
24 – UN RÉFÉRÉ MOUVEMENTÉ
– Eh bien, mon cher maître ?
– Eh bien, mon talentueux contradicteur ?
– Je crois qu’il y aura foule aujourd’hui, aux référés.
– Cela m’a l’air probable.
– Jamais monsieur Charles, le distingué président du siège, n’a vu une assistance aussi élégante.
– Cela se conçoit un peu, vous savez. On annonce que Juve en personne va comparaître ; de plus, on prétend que le tableau, le fameux tableau va être représenté.
– En tout cas, il y a déjà beaucoup de monde.
– J’allais vous le dire.
Dans la grande salle des Pas Perdus, au palais de Justice, les avocats devisaient.
L’attention, ce jour-là, se concentrait sur les groupes qui stationnaient un peu à gauche de la grande horloge, à l’entrée de la salle des référés, groupes qui discutaient avec âpreté et où les initiés reconnaissaient des figures connues, des personnalités éminentes du monde parisien, des représentants de ce que l’on est convenu d’appeler « le Tout-Paris ».
Il y avait là M. de Keyrolles, directeur de la Compagnie d’assurances L’Épargne, qui s’entretenait avec M. Havard, il y avait M e Faramont, flanqué de son fils qui parlait à un jeune homme à physionomie extraordinairement intelligente dont le nom était sur toutes les lèvres : Jérôme Fandor. Il y avait enfin des artistes, des experts, des représentants du monde des arts, du monde des lettres et encore des députés, des conseillers municipaux.
Quel était donc le référé qui allait se plaider ?
M. Germain Fuselier, l’éminent magistrat instructeur, célèbre désormais dans tout Paris pour avoir été chargé des affaires de Fantômas, traversait justement la salle des Pas Perdus, venant de la galerie Marchande [17]. Un vif mouvement de curiosité se dessina. Vingt avocats l’entourèrent à la minute :
– Eh bien, cher monsieur, quoi de nouveau ? Sans violer le secret professionnel, peut-on vous demander… ?
Fendant les groupes, Jérôme Fandor vint saluer le magistrat :
– Vous avez vu Juve ? demanda-t-il.
– Je le quitte à l’instant, répondait Germain Fuselier, opposant un mutisme souriant à tous les bavards. Juve arrive.
– Il ne vous a rien dit ?
– Non.
Mais en même temps, il passait son bras sous celui du journaliste et l’entraînait à l’écart.
– Juve est inquiet, murmurait Fuselier. C’est pourquoi il attend la dernière minute pour venir. Il a le tableau sous le bras. Je suis chargé de vous demander de sa part, mon cher Fandor, de rester, tout le temps de l’audience, à côté des portes de la chambre. Vous guetterez tous ceux qui entreront.
– Juve se méfie donc de quelque chose ?
– Et vous ? Et vous mon cher ami ? Est-ce que vous ne croyez pas qu’avec Fantômas, tout est possible, et qu’il convient d’être toujours sur ses gardes ?
Jérôme Fandor allait répondre, lorsqu’il en fut empêché par la surprise.
Un petit homme extraordinaire, vêtu d’une longue redingote qui eût fait l’honneur et la joie d’un pasteur protestant, coiffé d’un extraordinaire chapeau haut de forme, venait d’allonger une bourrade dans les côtes du journaliste.
Fandor se retourna.
– Bouzille ! Ah, çà, que faites-vous ici ?
– Monsieur Fandor, je promène mes élégances.
– Peste, vous avez donc l’intention de lancer la mode, Bouzille ?
– Quelque chose comme cela, monsieur Fandor, et puis je suis témoin. C’est la première fois, constatait-il avec une certaine satisfaction que je viens dans un palais de Justice sans avoir la frousse, monsieur Fandor. Cette fois-ci, je suis témoin et rien que témoin. J’ai rien vu, par conséquent, on ne peut pas me faire d’ennuis.
Mais l’audience commençait.
Il y avait dans la salle, outre le Président et son greffier, une dizaine de personnages aux allures d’agents de police qui surveillaient l’entrée des arrivants. Il y avait surtout, devant la table en demi-cercle sur laquelle les plaideurs et référés viennent d’ordinaire s’appuyer pour parler, un tableau, un grand tableau que le public immédiatement reconnaissait : c’était le véritable Pêcheur à la lignede Rembrandt.
À droite de cette table enfin, debout, l’air grave, un homme à l’aspect énergique attendait, découvert. Ce n’était autre que Juve, le célèbre policier.
– Affaire de la Compagnie d’assurances L’Épargne, appelait l’huissier. Monsieur Juve, maître Faramont intervenants, Monsieur Bouzille, témoin, avancez à la barre, je vous prie.
Un vif mouvement de curiosité se dessina : tout le monde était debout.
– Je vous écoute monsieur, commença le Président.
Il se tournait vers un avocat, représentant évidemment la partie demanderesse.
– Pour qui vous présentez-vous, maître ?
– Pour le groupe des intéressés, monsieur le Juge. J’ai un peu fonction de ministère public. Je demande une mesure sauvegardant les intérêts de tous.
– Veuillez me rappeler les faits de la cause.
– Monsieur le Président, ils sont fort simples. Un tableau a été volé à l’exposition de Bagatelle, ou plus exactement, a disparu. Ce tableau appartenait à maître Faramont, ici présent, qui m’assiste. C’est le tableau, monsieur le Président, que vous avez sous les yeux. Ce tableau a disparu parce qu’il a été recouvert d’un autre tableau peint sur lui, ce qui fait que l’on a pu croire qu’il y avait eu substitution de toile. La Compagnie d’assurances L’Épargneayant assuré le tableau, l’a payé à maître Faramont. Or, il se trouve que le policier Juve, également présent, a découvert la ruse employée par l’escroc, qui, évidemment, ayant peint un tableau sans valeur sur un tableau de prix, pensait pouvoir acheter ce tableau sans valeur fort bon marché et restaurer ensuite le tableau de prix. Le policier Juve demande à se dessaisir du tableau de prix. Maître Faramont, d’autre part, remboursé par la Compagnie d’assurances, ne veut plus de son tableau, dont il affirme qu’il est désormais la propriété de ladite Compagnie. D’autre part, la Compagnie ne veut plus du tableau qu’elle affirme avoir remboursé à Maître Faramont parce que le tableau avait disparu ; du moment que le tableau est retrouvé, du moment qu’en fait il n’a jamais cessé de figurer à l’exposition de Bagatelle, elle prétend que son remboursement découle d’une erreur et, qu’en conséquence, elle est fondée à obliger M e Faramont à reprendre son tableau et à lui restituer les fonds qu’elle lui a précédemment versés. Cette cause, monsieur le Président est actuellement pendante au principal, devant le Tribunal de la Seine.
– Alors, maître ?
– Alors, monsieur le Président, j’ai l’honneur de demander que vous vouliez bien ordonner qu’il soit nommé un séquestre par mesures conservatoires, peu importe à M e Faramont ou à la Société L’Épargne, le nom de ce séquestre, ni M e Faramont, ni la Société n’ont l’intention de faire d’opposition à votre choix ; mais l’un et l’autre de ces intéressés tiennent à la nomination d’un séquestre pour voir sûreté de leurs gages.
L’avocat toussait, puis, ayant ainsi expliqué de façon très compliquée quelque chose qui était très simple, à savoir que nul n’étant d’accord pour décider à qui appartenait le tableau en définitive, il y avait lieu de charger quelqu’un de le conserver en attendant que le procès soit jugé, il reprit avec une grande autorité :
– J’attire en outre votre attention, monsieur le Président, sur ce point tout spécial. Il y a lieu dès à présent, de chercher à connaître, par témoignages, s’il s’agit bien là du tableau exposé à Bagatelle. Si votre ordonnance de référé, monsieur le Président, peut décider de la question, ce sera un grand point d’acquis pour le procès au principal.
– En effet, approuva le Président.
Une hésitation cependant semblait demeurer dans la pensée du magistrat :
– Je crois, commençait-il, qu’il convient d’abord de décider qui sera séquestre. Nous verrons ensuite à identifier le tableau. Voyons, maître Faramont, voulez-vous accepter ce séquestre ?
Si le magistrat venait d’hésiter, M e Faramont, lui, n’hésita pas. Tandis qu’un rire discret courait dans la salle bondée de public, l’éminent bâtonnier se hâta de répondre :
– Je prie très respectueusement monsieur le président de bien vouloir ne pas me nommer comme séquestre. La charge est honorable, certes, mais périlleuse aussi. Monsieur le Juge voudra se rendre compte que j’ai déjà été assez suffisamment éprouvé par les aventures occasionnées par ce tableau. J’ai été volé de cinq cent mille francs, j’ai eu d’incessantes angoisses et, par conséquent…
Un léger signe de tête du magistrat fit comprendre à M e Faramont qu’il était inutile d’insister :
– M e Faramont déclinant l’offre d’être séquestre pour des motifs personnels, le représentant de la société L’Épargnevoudra bien, je pense, accepter cet office ?
– La Société que je représente, déclara le jeune avocat appuyé à la barre, croit devoir décliner l’offre qui lui est faite, monsieur le Président. Ce tableau est d’un prix élevé, il a suscité déjà de multiples convoitises, sa possession semble périlleuse, la société L’Épargnecroit avoir fait tout son devoir vis-à-vis de M e Faramont et refuse de s’associer à d’autres risques que ceux consentis par l’assurance dont il vous a été parlé. Je refuse donc, en conséquence, monsieur le président, d’être nommé séquestre, à moins que vous n’en décidiez autrement par autorité de justice.
Cette fois, l’embarras du président siégeant apparut manifeste. Ni M e Faramont, ni la société L’Épargnene voulaient accepter le tableau. À qui pouvait-il le confier ? Il n’est pas d’usage de nommer de force des séquestres, la chose eût été d’autant plus désagréable en l’espèce que les incidents déjà survenus semblaient bien établir qu’il n’était point sans danger de détenir le Pêcheur à la ligne.
M. Charles interrogea, considérant l’avocat qui, le premier, avait parlé :
– Maître, puisque vous représentez tous les intéressés, voulez-vous me permettre de vous nommer séquestre ?
– Je remercie monsieur le président de l’honneur qu’il veut bien me faire en pensant à moi pour une mission si délicate, mais je la décline en raison de mon incompétence. Je ne connais rien aux tableaux, et, de la meilleure foi du monde, je risquerais de ne pas être pour celui-ci le bon et sage dépositaire dont parle le code.
Cette fois, le juge hésita, avant de reprendre la parole :
– Maître, déclara-t-il enfin sur un ton légèrement agacé, il faudrait être pourtant raisonnable, vous me demandez de nommer un séquestre, je ne vous le refuse pas en principe, mais je ne peux pas trouver, vous en êtes témoin vous-même, quelqu’un qui veuille accepter cette mission ; dès lors, que dois-je faire ?








