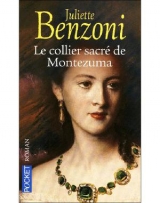
Текст книги "le collier sacré de Montézuma"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
DEUXIEME PARTIE
L’OMBRE S’ÉPAISSIT…
6
L’ÉVENTAIL ENVOLÉ
Avec sa débauche de bois précieux aux teintes chaleureuses, ses lumières douces, ses marbres, ses glaces miroitantes et son extraordinaire café baroque aux moelleux sièges de cuir, le Métropole de Bruxelles était l’un des quatre ou cinq hôtels du monde qu’Aldo Morosini préférait et c’était toujours pour lui une satisfaction d’y revenir. Il s’y sentait un peu chez lui et, en arrivant, il commença par se précipiter justement au café pour s’y faire servir un confortable petit déjeuner. Après quoi, il gagna sa chambre, prit une douche, se rasa, changea de vêtements, puis s’accorda une pause de réflexion et descendit dans le hall pour s’en aller conférer avec le portier qui, le connaissant depuis plusieurs années, l’avait reçu à son arrivée avec un visible plaisir :
– Je peux quelque chose pour Votre Excellence ?
– Si vous êtes toujours l’homme le mieux renseigné de Bruxelles, je pense que oui. En un mot, je voudrais savoir si le château de Bouchout est de nouveau occupé ou si…
– … s’il serait possible d’y faire une visite… en forme de pèlerinage ?
– C’est tout à fait ça ! Comment avez-vous deviné ?
– Votre Excellence n’est pas la première à me poser cette question. L’auréole tragique laissée par la défunte impératrice Charlotte frappe bien des esprits et il semble qu’avec le temps sa légende grandisse. Particulièrement auprès des femmes. Cela dit la visite n’est pas autorisée mais… lorsqu’il s’agit de personnes… distinguées, il arrive que le concierge consente à accompagner le visiteur ou la visiteuse dans son pèlerinage. Mais seulement l’après-midi.
– Moyennant, j’imagine, une honnête rétribution ?
– Cela va de soi.
– Merci, Louis… Ah, veuillez me faire livrer deux douzaines de roses rouges par le fleuriste d’à côté. Je les prendrai en partant… Vous me retiendrez aussi un taxi…
– Certainement, Excellence !
Un peu avant trois heures, Aldo, ses fleurs dans les bras, sortait de l’hôtel pour gagner le véhicule dont le voiturier lui tenait la portière ouverte quand quelqu’un de soyeux et de parfumé se jeta littéralement sur lui en s’écriant :
– Ah ! Vous êtes là ? J’aurais dû m’en douter… mais mon Dieu, quelle chance !
Agathe Waldhaus ! Emmitouflée de vison, des violettes de Parme piquées à son manchon, fraîche et volubile, c’était elle qui, une fois de plus, lui tombait dessus. Le voiturier rattrapa les roses de justesse.
– Baronne ! Je commence à croire que c’est votre façon habituelle d’aborder les gens ! Vous devriez prévenir…
– Oh, je suis tellement désolée ! Mais ne me gâtez pas ma joie de vous retrouver si vite ! Il y a là un signe du destin et je…
– Certainement pas ! Je vais même vous demander de m’excuser ! Comme vous le voyez, j’allais partir…
– Quelles jolies fleurs ! Vous avez rendez-vous avec une dame, j’imagine ?
Décidément, cette femme était collante et en plus elle était indiscrète. Il s’arma de froideur :
– C’est vrai ! Je vais voir une dame… et vous comprendrez que je ne veuille pas la faire attendre ?
– Je l’envie ! Néanmoins elle me concédera bien une ou deux minutes ? Il faut absolument que je vous parle ailleurs que sur un trottoir encombré ! Nous pourrions prendre le thé ensemble ?
– Désolé mais je compte le prendre où je vais !
– Alors venez dîner à la maison ! Ma mère sera positivement ravie de faire votre connaissance…
– Un plaisir que je partagerais volontiers si…
Soudain, il y eut des larmes dans les yeux dorés de la jeune entêtée :
– Ne refusez pas, je vous en supplie ! J’ai des choses à vous dire ! Tenez, voici notre adresse, ajouta-t-elle en lui fourrant dans une main un bristol tiré de son manchon. Soyez là à huit heures !
Cette fois, il n’eut pas le temps d’émettre le moindre son. Toujours à son allure de tempête, elle se dirigeait déjà vers un luxueux magasin de dentelles où elle disparut. Libéré, Aldo glissa la carte dans sa poche, et monta en voiture après avoir demandé au chauffeur s’il connaissait le château de Bouchout.
– Le portier m’a prévenu. Ce n’est pas loin. À la périphérie de la ville…
En s’installant au fond de la voiture, les fleurs posées à côté de lui, Aldo se sentit mécontent de tout et de lui-même. Il détestait se montrer grossier envers une femme et, en d’autres circonstances, il l’eût écoutée volontiers, mais son temps ni sa personne ne lui appartenaient plus… En outre, les problèmes conjugaux de la petite baronne ne pouvaient que lui compliquer la vie. Même si son dernier regard mouillé lui laissait un désagréable sentiment de culpabilité. Ce soir, au lieu de se rendre chez les dames Timmermans, il se ferait représenter par d’autres roses accompagnées d’un mot disant que, obligé de repartir à Paris, il lui serait impossible de venir leur présenter ses hommages…
Cette décision prise, il s’efforça de ne plus y penser.
Appartenant au domaine royal qu’en Belgique on concevait seulement entouré de parcs immenses plantés de beaux arbres, le château de Bouchout, rêvant sur un étang entouré de frondaisons magnifiques, apparut à Morosini comme essentiellement romantique : un vaisseau du passé à peine rattaché à la terre par le lien d’un pont-levis. En dépit de son donjon carré et de ses grosses tours rondes et crénelées, il n’avait rien de rébarbatif, peut-être à cause des nombreuses fenêtres dont on l’avait éclairé. Il était bien le cadre où pouvaient s’amarrer les rêves imprécis d’une princesse malheureuse…
Malgré le temps devenu affreux – la pluie s’était mise à tomber au moment où le taxi quittait l’hôtel ! – aucune impression de tristesse ne s’en dégageait, sans doute parce que le domaine était parfaitement entretenu et qu’à entendre le gardien l’intérieur du château recevait la visite des préposées au ménage trois fois par semaine. Des femmes pas autrement rassurées et qui exécutaient leur travail en un temps record : l’impératrice n’était pas morte depuis huit jours que quelqu’un assurait avoir vu son fantôme…
– Les femmes, ça voit des fantômes partout, expliqua l’homme tout en guidant à travers les jardins le visiteur qu’il abritait d’un grand parapluie noir. Remarquez, c’est possible qu’elle revienne, notre pauvre dame, mais elle ne doit pas être si terrifiante. Toujours habillée de jolies robes de soie blanche ou rose, ou bleue, avec des bijoux ou alors avec des fleurs – elle les adorait ! –, et quand on la rencontrait, toujours aimable. Il est vrai qu’il y avait ces jours où elle restait enfermée au château, même par beau temps, et on savait ce que ça voulait dire : c’était quand ça n’allait pas, qu’elle avait ses humeurs noires. Paraît même qu’elle devenait méchante, qu’il lui arrivait de mordre ou de griffer ses serviteurs. Pourtant on l’aimait et on la plaignait…
D’abord méfiant mais vite mis en confiance par le gros billet offert par Morosini, l’homme devint intarissable, évoquant Charlotte canotant sur le lac, s’attardant dans les serres, bavardant avec les jardiniers, se promenant en calèche ou faisant de la musique toutes fenêtres ouvertes, au point que le visiteur croyait apercevoir le balancement d’une crinoline au détour d’un bosquet ou la fuite soyeuse d’une traîne derrière un massif de houx.
À l’intérieur, la volonté de reconstituer le décor était évidente même si l’image que l’on s’en faisait au siècle précédent n’avait que fort peu de chose à voir avec celui conçu au XIIe siècle par Godefroi le Barbu, premier bâtisseur. Aldo détestait le style troubadour mais ses excès, son romantisme échevelé devaient convenir à un esprit troublé et, en parcourant les pièces désertes, il ne pouvait s’empêcher d’évoquer Louis II de Bavière et ses châteaux fantastiques : comme à Bouchout, un être jeune et beau y avait affronté la folie…
Dans la chapelle gothique où demeurait le prie-Dieu de velours rouge, il déposa ses fleurs sur les marches de l’autel après en avoir prélevé une qu’il plaça sur l’appui du petit meuble, après quoi il s’agenouilla pour une courte prière avant de poursuivre sa visite.
Le reste du château ne lui apprit rien de plus. Certes, les meubles étaient toujours en place ainsi que les tentures, mais il ne restait aucun de ces mille objets, précieux souvent, que l’on disposait sur les tables, les consoles ou les cheminées.
Quand on sortit, la pluie continuait de tomber avec une obstination annonçant qu’elle persévérerait. Les deux hommes cohabitèrent de nouveau sous le parapluie et Aldo essaya de savoir si son guide pourrait le renseigner sur les dernières suivantes et servantes de Charlotte :
– Oh ! Moi, je n’avais jamais affaire à elles. Ma femme en saurait peut-être davantage. Il lui arrivait de travailler au château… Si vous voulez bien vous donner la peine d’entrer dans la maison, elle doit être là…
Elle y était, en effet. Petite femme brune à l’air timide et doux, elle était occupée à repasser dans la grande pièce d’une propreté flamande qui servait à la fois de cuisine et de salle commune. Sur le coin de la cuisinière en fonte noire où chauffaient les fers, résidait la traditionnelle cafetière que l’on y tenait au chaud toute la journée. En voyant entrer cet homme élégant que son époux annonçait comme étant un prince, elle rougit furieusement et perdit contenance au point d’abandonner, au profit d’une espèce de révérence, l’outil brûlant sur la chemise qu’elle repassait. S’en apercevant, Aldo empoigna un tampon de protection, saisit l’instrument et le reposa sur le support prévu à cet usage.
– Je suis vraiment désolé de vous déranger, Madame, mais M. Labens, votre époux, m’a conseillé de venir vous demander des renseignements…
Ce faisant, il se trouva face à la cheminée sur le manteau duquel trônait, en belle place, un objet pour le moins insolite dans un tel endroit : un éventail de soie peinte à branches de nacre déployé sur la boîte oblongue de cuir bleu, et frappée au fer à dorer d’une couronne impériale, qui avait dû le contenir. Sous le choc de l’émotion, sa gorge se serra. Se pourrait-il…
– Oh, que c’est joli ! s’exclama-t-il. Et combien précieux, j’imagine !…
– Ça, vous pouvez le dire ! approuva Labens. C’est le trésor de Mme Labens ! Sa Majesté elle-même le lui a offert le jour où elle a sauvé de la noyade son petit chien tombé dans l’étang… Elle l’aime tellement qu’elle ne peut pas le laisser dans sa boîte. Ce serait pourtant plus raisonnable : c’est fragile, ces trucs-là !
– Je la comprends, c’est un tel plaisir pour les yeux ! Voulez-vous me permettre de le voir… de plus près ? Je suis antiquaire…
La voix de l’épouse se fit enfin entendre :
– Ouiiii… mais faites bien attention !
Comme s’il s’agissait du saint sacrement, Aldo enleva l’éventail, le considéra un instant avec respect avant de le poser sur la planche à repasser puis prit la boîte, l’ouvrit… Son cœur battait la chamade. Si les pierres étaient dedans, comment s’y prendre pour les en faire sortir ?
Il n’eut pas à s’interroger longtemps. Il ne pouvait y avoir un double fond… Toujours avec la même lenteur et les mêmes précautions, il remit l’ensemble dans l’état exact où il l’avait trouvé puis se tourna, souriant, vers Mme Labens :
– En dehors de sa valeur sentimentale pour vous, sachez, Madame, que c’est un objet de valeur : cet éventail a été peint au XVIIIe siècle !
Il pensait à une œuvre de Boucher mais il ne le précisa pas. Cela pouvait paraître étonnant de trouver une pièce de musée chez un concierge de château mais l’impératrice pouvait avoir donné ce qu’elle avait sous la main et, au fond, il n’aurait pas été autrement surprenant, si l’on considérait son esprit dérangé, que l’éventail eût été serti de diamants…
Pour le remercier de son « expertise », Mme Labens se hâta de chercher des tasses et d’empoigner sa cafetière. Sachant que là-dedans le café bouillottait doucement depuis des heures, Aldo recommanda son âme à Dieu et trempa ses lèvres dans le breuvage qu’il additionna de cassonade. Moyennant quoi, il l’avala d’un trait et le déclara délicieux.
– Avant de vous quitter, je voudrais vous poser une question, Madame : connaîtriez-vous les dernières dames attachées au service de Sa Majesté à l’époque de son décès ?
– Non. S’il arrivait qu’on me demande au château pour aider, et ce n’était pas souvent, alors j’avais seulement affaire à Mme Moreau, Marie Moreau, la femme de chambre particulière de l’impératrice, mais elle est partie avec les autres quand on a fermé le château…
– Et vous n’avez pas son adresse ? Ni celle d’aucune de ses compagnes…
– Non. Je suis désolée.
– Ne le soyez pas ! C’est sans importance et je vous remercie, vous et votre mari, du bon moment que je viens de passer…
Il ne mentait pas, ayant apprécié l’accueil et la gentillesse de ces braves gens. Il se sentait tout de même un peu perdu. Où chercher la boîte à éventail truquée ? Eva Reichenberg avait dit que l’impératrice en avait une quantité. Dieu sait à qui elle avait pu les distribuer sur un coup de cœur comme elle l’avait fait pour Mme Labens. Sans compter que les plus précieux – sauf lubie imprévisible ! – devaient être répartis entre ses nièces et petites-nièces belges, autrichiennes et aussi françaises, puisque le défunt roi Louis-Philippe était son grand-père. Cela représentait déjà la moitié du tour de l’Europe, difficile à réaliser dans le temps imparti, et si l’on y ajoutait les femmes qui l’avaient servie, soignée, durant près d’un demi-siècle d’internement, cruel tant qu’elle avait été aux mains des Autrichiens et infiniment plus clément depuis que sa famille belge la leur avait pour ainsi dire arrachée, cela équivalait à vider l’océan avec une cuiller à soupe. Il écartait la possibilité que le double fond ait pu être décelé et les émeraudes découvertes. Aucune femme n’aurait été capable de garder le secret pour elle et il y a longtemps qu’elles seraient remontées à la lumière du jour…
Sentant l’accablement l’envahir, il décida de remettre au lendemain l’examen du problème, quand il ne serait plus seul à en débattre. Alors d’abord rentrer à l’hôtel, boucler ses bagages et prendre le premier train pour Paris !
Il se réinstallait dans son taxi quand, ouvrant la vitre de séparation, le chauffeur demanda d’une voix traînante :
– Je ne sais pas si vous avez remarqué, Monsieur, mais on a été suivis à l’aller…
– Vous êtes sûr ? Et qu’est-ce que c’était ?
– Un taxi que je ne connais pas. Quand on est arrivés au château, il s’est arrêté un peu plus loin et il est resté là un bon moment. J’aurais bien été voir, mais comme personne n’est descendu, je n’ai pas osé. Il a fait demi-tour et il est reparti quand on vous a vu revenir à la maison du gardien. J’ai relevé son numéro, si ça peut vous être utile, ajouta-t-il en lui tendant un morceau de papier.
– Vous êtes un homme précieux. Je vous remercie beaucoup… mais pourquoi le faites-vous ? Vous ne me connaissez pas, et ce pourrait être quelqu’un de la police ?
– Dans un taxi ? Jamais de la vie ! Chez nous, la police a l’air de ce qu’elle est. On ne peut pas se tromper ! Quant à ce que je viens de vous dire, j’l’ai fait parce que… quelqu’un qui va porter des fleurs à une pauvre princesse morte, ce ne peut être qu’une personne bien. Vous comptez rester au Métropole ?
– Je pensais partir ce soir mais je vais remettre à demain si vous pouvez m’avoir le renseignement.
Il sortit une carte de visite, inscrivit le numéro de sa chambre et la tendit à cet homme obligeant avec un billet triplant à peu près le prix de la course.
– Ben dites donc ! C’est un plaisir de vous promener… mon prince ! Vous aurez ça avant dix heures ce soir ! Parole d’honneur !
En sortant sa carte, Aldo avait retrouvé celle remise par la baronne Waldhaus. Bien qu’il eût renoncé à quitter Bruxelles dans la soirée, il n’était pas question de la rejoindre. Aussi, en arrivant à l’hôtel, il alla chez le fleuriste, avisa une sorte de buisson d’azalées roses, renouvela ses regrets en quelques mots et expédia le tout à Mme Timmermans puisque c’était chez elle qu’on l’avait invité. Après quoi, il se fit retenir une place dans le train du matin, une table au restaurant, puis se rendit au bar boire une ou deux fines à l’eau. Il en avait le plus grand besoin. D’où pouvait sortir son suiveur ? À moins que…
Il fut à peine surpris quand à la fin du repas – absolument parfait ! – on lui apporta le billet promis par le chauffeur. Le seul détail des violettes piquées sur un manchon suffisait à identifier la « jeune dame » blonde portant un beau manteau de fourrure ! Il eut même envie de rire : celle-là était obstinée mais au moins elle n’était pas dangereuse ! Il l’oublierait très vite !
Prudent néanmoins, il prévint le portier qu’il allait se coucher et ne voulait être dérangé par aucune communication extérieure. Cela fait, il s’accorda quelques heures de bienheureux repos et dormit comme une souche.
Le retour à Paris fut agréable. Le temps avait changé dans la nuit et un soleil tout neuf caressait les campagnes picardes que traversait le grand express. Superstitieux comme ses compatriotes, Aldo y vit un encouragement céleste. Des idées neuves lui étaient venues au réveil : une annonce répétée dans les principaux journaux européens, par exemple, suffisamment discrète pour ne pas exciter les convoitises. Il pourrait en outre faire jouer ses relations afin de toucher certaines chancelleries, certains confrères… sans compter son ami Gordon Warren à Scotland Yard. Il lui fallait à tout prix apprendre, en premier lieu, au bénéfice de qui s’était fait le partage des nombreux joyaux de l’impératrice Charlotte. Quoi qu’il en soit, en sautant sur le quai de la gare du Nord, à Paris, il se sentait revigoré. Presque optimiste…
Cette belle illusion ne résista pas à la lecture du journal qu’il acheta à un jeune vendeur avant d’aller prendre un taxi. On venait de repêcher dans la Seine le corps de Lucien Servon, le majordome fugitif de Gilles Vauxbrun…
Du coup, au lieu de rentrer rue Alfred-de-Vigny, il se fit conduire quai des Orfèvres.
– Il est d’une humeur de dogue ce matin, prévint le nouveau planton qui l’introduisit dans le bureau du « grand chef ». Vous êtes sûr de ne pas préférer revenir plus tard ?
– Ce ne sera pas une première pour moi. Je l’ai déjà vu furieux ! rassura Aldo en s’installant sur l’une des deux chaises qui faisaient face au bureau noir sur lequel un vase de barbotine débordant de primevères mettait une note réconfortante, à l’unisson du kilim d’un beau pourpre foncé, propriété de Langlois, qui réchauffait l’affligeant parquet de la République.
Dominant l’ensemble, le président, Gaston Doumergue, souriait benoîtement dans son cadre accroché au mur principal.
Un violent courant d’air suivi d’un claquement de porte remit Aldo sur ses pieds. Le fauve avait regagné sa cage et donnait de la voix :
– Le téléphone ! Vous connaissez ? Qu’est-ce qui vous prend de venir me déranger à cette heure-ci ?
– J’ignorais qu’il y en avait une où l’on pouvait s’y risquer sans danger ! Je veux seulement vous poser une question.
– Laquelle ?
Morosini lui étala le journal sous le nez :
– Ça. Suicide ou meurtre ?
– Meurtre ! On aurait bien voulu nous faire croire à un suicide mais ce qu’on lui a attaché aux pieds a dû se défaire. Le malheureux trempait dans l’eau depuis un bout de temps… Vous l’auriez su plus tôt si vous aviez été chez vous. Où êtes-vous encore allé ?
Le ton était raide. Aldo réagit derechef :
– C’est un interrogatoire ? Je vous préviens que c’est la dernière chose dont j’aie besoin.
– Vous savez que non, mais vous m’exaspérez, vous et les vôtres : il faut toujours que je réponde mais quand c’est moi qui pose les questions, je me heurte à la conspiration du silence. Vos « dames » sont aussi muettes que des huîtres !
– Tout dépend de ce que vous demandez. Entre parenthèses, elles n’aimeraient pas être comparées à des huîtres. Cela dit, que voulez-vous savoir ?
– D’abord, d’où venez-vous ?
– De Vienne, viaBruxelles, lâcha Aldo en reprenant possession de sa chaise.
– Qu’y faisiez-vous ? Mme von Adlerstein est malade ?
– Si c’était le cas, je ne vois pas ce que je serais allé fabriquer à Bruxelles. Non, je cours après cinq émeraudes fabuleuses dont j’ai appris ici même la sortie en Méditerranée…
– Celles que Vauxbrun est accusé d’avoir volées ?
– Non. Les vraies, celles que l’impératrice Charlotte a rapportées du Mexique sans le savoir. Et je ne vous cache pas…
– Un instant !… Pinson !
Le planton apparut aussitôt :
– Du café ! Et fort et avec deux tasses ! À la suite de quoi, vous veillerez à ce que je ne sois pas dérangé… et à ce que personne n’écoute aux portes ! Et au trot !
Il fut obéi dans un temps record qu’il occupa en allant explorer l’un des cahiers d’un grand cartonnier, d’où il tira un flacon poudreux et deux petits verres, ferma la porte à clef, servit son visiteur et revint s’asseoir en face de lui :
– Pour reprendre votre dernière phrase, il est urgent, je pense, que vous ne me cachiez plus rien. Vous pourriez commencer, par exemple, en me parlant du soir où une certaine voiture noire est venue vous chercher rue Alfred-de-Vigny ?
– Comment le savez-vous ? souffla Aldo, sidéré.
– Oh, c’est simple. L’inspecteur Lecoq avait reçu mission de veiller sur vous de façon à ne pas vous gêner. Comme vous ne bougiez pas, c’était relativement facile mais ce soir-là, Dieu sait pourquoi, il a prolongé sa faction et vous a vu partir. Il a enfourché sa bicyclette pour vous suivre mais la dernière fois qu’il l’a aperçue, la voiture filait en direction du Bois et de la porte Dauphine. J’ajoute qu’elle était trop rapide pour lui… et qu’un de ses pneus a crevé !
– Vos inspecteurs en sont encore au vélo ? Je croyais que depuis Clemenceau et ses Brigades du Tigre, vous aviez…
– Évidemment, on a, mais Lecoq est un mordu du vélo qui voudrait courir le Tour de France. C’est aussi un têtu ! Maintenant à vous de jouer !
– Le malheur c’est qu’au cas où je préviendrais la police…
– Le prisonnier sera abattu ! ricana Langlois. La rengaine classique ! Pardonnez-moi si je vous choque, Morosini, mais à mon avis, Vauxbrun est déjà mort ! Et peut-être même le soir du mariage. Sinon, comment expliquer les déménagements successifs de la rue de Lille ? Ces gens-là savent qu’il ne reviendra pas leur demander des comptes.
– Qu’attendez-vous pour les arrêter ?
– Sous quel prétexte ? Vous savez bien que Mme Vauxbrun peut agir à sa guise… Mais nous nous égarons. Continuez !
De deux doigts, Aldo frotta ses yeux fatigués et soupira :
– Finalement, c’est certainement ce que j’ai de mieux à faire ! Je me trouve devant un obstacle à peu près infranchissable !
Il raconta ses pérégrinations : l’entrevue du bois de Boulogne, sa visite à Eva Reichenberg, son pèlerinage au château de Bouchout, laissant seulement de côté la petite baronne qui n’avait strictement rien à voir là-dedans. Il ajouta pour faire bonne mesure les idées qui lui étaient venues à Bruxelles et qui à présent lui semblaient dérisoires…
– Voilà où j’en suis, conclut-il, en recevant le verre de cognac. Quelques semaines seulement pour retrouver une collection d’éventails disséminée sans doute à travers l’Europe… Au fait, puisque Lecoq a vu la voiture noire, il a dû faire comme Marie-Angéline et relever le numéro ?
Langlois haussa les épaules :
– Je ne sais pas si vous allez goûter le sel de la chose mais c’est l’une de celles de l’ambassadeur de Belgique.
– On avait pris le numéro ou on avait volé la voiture ?
– Disons qu’on l’avait empruntée, en profitant de l’absence du ministre. Le chauffeur s’est aperçu le lendemain qu’une des voitures avait roulé pendant la nuit…
– Insensé ! Quelle audace !
– Cela vous surprend ?
– Pas vraiment. Au fait, avez-vous des nouvelles de Phil Anderson ?
– Oui… et en français ! Il a accusé réception de mon courrier, m’a prié de « secouer les mains » avec vous et annoncé qu’il se mettait à l’ouvrage. Rien de plus. Je pense qu’il faut attendre… Qu’avez-vous l’intention de faire à présent ?
– Prendre un bain en fumant un paquet de cigarettes. C’est comme ça que je réfléchis le mieux. On verra bien ce qui en sortira…
En arrivant rue Alfred-de-Vigny, Aldo ne trouva que les serviteurs. Mme la marquise et Mlle du Plan-Crépin assistaient à des funérailles à Saint-Philippe-du-Roule, ce qui signifiait qu’au retour Tante Amélie serait de fort méchante humeur : ce genre de cérémonie lui donnait toujours l’impression d’assister à la « couturière » d’un théâtre. Ce qui ne manqua pas :
– Les gens qui sont là se demandent visiblement quel âge vous pouvez avoir et si vous ne jouerez pas bientôt le premier rôle ! maugréa-t-elle en ôtant les grandes épingles à tête d’améthyste qui fixaient sur sa tête le plateau chargé de bouillonnés de mousseline violette qui lui servait de chapeau.
– Pourquoi y allez-vous alors ? Envoyez Marie-Angéline !
– Ils seraient trop contents. Ils penseraient que tous les espoirs sont permis et que je suis à l’agonie ! Mais passons, as-tu fait bon voyage ?
– Excellent, merci. Lisa vous embrasse. Ainsi que Marie-Angéline.
– Elle était là-bas ?
– Elle est venue m’y attendre mais je vous raconterai plus tard. Vous avez lu le journal ce matin ?
– Oui. Ce pauvre garçon ! Fallait-il qu’il désespère de la vie pour mettre fin à ses jours ! La Seine doit encore être glaciale !
– Il ne s’est pas suicidé : c’est un meurtre. Je suis passé chez Langlois avant de rentrer et il me l’a affirmé. Il paraît même qu’il est mort depuis un moment…
– Si j’ai compris, fit Plan-Crépin, on ne l’a laissé partir de la rue de Lille que pour le reprendre au piège un peu plus loin ? Il n’aurait jamais dû s’en aller et aurait mieux fait d’imiter la cuisinière : ouvrir ses yeux et ses oreilles, et ne pas piper mot… En tout cas, cela fournit un prétexte en or au commissaire Langlois pour retourner enquêter chez M. Vauxbrun ?
– Quel prétexte ? Servon est parti volontairement, au vu et au su de la maisonnée ! Ils sont blancs comme neige !
Dans l’après-midi, Aldo se rendit boulevard Haussmann dans les bureaux de Maître Lair-Dubreuil qui régnait alors sur le petit monde des commissaires-priseurs et se révélait incontournable dès qu’il s’agissait de joyaux historiques. Il le connaissait de longue date et c’était un réel plaisir pour le prince-expert de le rencontrer, même si leur dernière collaboration avait tourné à l’histoire de fous (12). Il n’en reçut pas moins un accueil chaleureux.
– Avez-vous encore déniché quelque bijou-catastrophe, cher ami ? lui dit cet homme paisible et volontiers renfermé, mais capable de s’enflammer dès qu’un diamant plus ou moins célèbre montrait le bout de son nez.
– Non, rassurez-vous ! Je voudrais seulement que vous me parliez de la succession de l’impératrice Charlotte du Mexique, décédée il y a un peu plus de trois ans. Vous me direz que vous n’êtes pas belge, mais elle possédait un véritable trésor en bijoux, dont certains remarquables, et je suis persuadé que vous vous y êtes intéressé d’une façon ou d’une autre.
– En effet, mais vous-même ?
– Je n’étais pas chez moi et pas davantage en France à cette époque et c’est mon fondé de pouvoir, M. Guy Buteau, qui y a porté son attention, mais ce qu’il a pu m’en dire, à mon retour, c’est qu’il n’y a pas eu de vente.
– Avez-vous consulté mes confrères bruxellois ?
– Non. Je les connais mal, sinon pas, et aucun ne vous vient à la cheville puisqu’il arrive que d’importantes ventes belges passent par vos mains.
Maître Lair-Dubreuil apprécia d’un sourire mais ne releva pas le propos :
– Malheureusement, je n’ai pas grand-chose à vous apprendre et M. Buteau avait raison : il n’y a pas eu de vente.
– Autrement dit, les héritiers de la princesse se sont partagé les joyaux entre eux. Sauriez-vous qui a eu quoi ?
Le commissaire-priseur se carra dans son fauteuil et fronça son nez comme s’il allait éternuer :
– Vous allez être surpris mais ce qu’ils ont eu à se partager fut maigre…
– Maigre ? C’est impossible !
– Oh, que si ! La fortune de cette malheureuse se montait à plusieurs millions. Elle a été confiée à son frère, le feu roi Léopold II de Belgique, ainsi que les joyaux les plus précieux qui ont été déposés dans le coffre d’une banque. À l’ouverture dudit coffre les nièces et les neveux s’attendaient à découvrir un trésor fabuleux, mais il n’y avait plus que quelques perles et des améthystes…
– C’est tout ? Mais où sont passés les diadèmes, les bijoux légués à Charlotte par sa grand-mère, la reine Marie-Amélie veuve de Louis-Philippe, la parure de saphirs offerte à l’occasion du mariage par l’archiduchesse Sophie sa belle-mère, le collier de gros diamants, cadeau de Léopold II (13)lui-même, sans compter les…
– Je sais tout cela, mon cher prince. Et vous aussi puisque vous n’ignorez sûrement pas que le roi Léopold a englouti des fortunes dans son projet sur le Congo. Celle de sa sœur n’y a pas échappé… et pas davantage ses bijoux. Remarquez qu’il pensait être dans son droit : l’entretien de l’ex-impératrice, son train de vie au château de Bouchout coûtaient cher. Il s’est dédommagé. Quant à l’argent, il pensait qu’il ne serait jamais mieux placé que dans la grandiose aventure congolaise. Quoi qu’il en soit, le fait est là : le contenu du coffre s’est volatilisé, dispersé peut-être aux quatre coins de l’Europe ou en Amérique. Mais permettez-moi à présent de me montrer indiscret…
– Entre nous, il n’y aura jamais d’indiscrétion.
– Pourquoi vous intéressez-vous à ces joyaux ? Ou, pour être plus précis, lequel cherchez-vous ?
– Aucun en particulier. En revanche, je voudrais savoir ce qu’est devenue la collection d’éventails.
– Tiens donc ! Ce n’est guère votre partie ?
– Vous oubliez que je suis d’abord antiquaire. En outre, certains de ces « objets de vanité » étaient ornés de pierres précieuses et d’autres sont de véritables œuvres d’art. J’en ai découvert un, notamment, dans la maison du garde de Bouchout, peint, à ce qu’il semblerait, par Boucher. Cadeau personnel de l’impératrice pour avoir sauvé son petit chien !
– Vous êtes allé là-bas ?
– Je dirais que j’en viens. Le château est entretenu, l’intérieur est intact, les meubles en place mais on n’y trouve plus le moindre bibelot, sans doute trop facile à emporter…
– En ce cas, pourquoi ne pas être allé au château de Laeken demander à être reçu par la reine Élisabeth ? Vous portez un nom qui ouvre largement les portes et vous pourriez certainement obtenir la liste des personnes présentes à Bouchout au moment de la mort, sans oublier ce qui a peut-être été attribué aux nièces : l’archiduchesse Stéphanie et la princesse Clémentine Napoléon. Vous auriez la possibilité de les rencontrer ?





