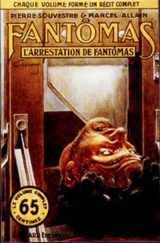
Текст книги "L'Arrestation de Fantômas (Арест Фантомаса)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
– Voyez donc, affirmait la mère Zizi, si ça n’est pas une preuve qu’il comprend que l’hiver on est en vacances, que c’est le moment de prendre du bon temps.
Dans la bizarre industrie qu’ils exerçaient, le père et la mère Zizi faisaient de l’année deux parts inégales : du mois de février au mois d’octobre, ils étaient bohémiens, couraient la campagne, gagnant piètrement leur vie en présentant des spectacles forains, puis, le mois d’octobre arrivé, ils regagnaient en toute hâte la banlieue parisienne, s’installaient dans la plaine de Saint-Ouen et là, prenaient leurs quartiers d’hiver en vivant de petite besogne d’occasion : paniers tressés, oiseaux apprivoisés, tous métiers qui ne les rendaient pas millionnaires, mais qui les aidaient à passer la mauvaise saison. Et la mère Zizi trouvait plaisant de remarquer que, pendant les beaux mois de l’année, Papillon mangeait cent fois moins.
– Cette bête, affirmait-elle, elle est sobre comme un chameau, tout cheval qu’elle est. Quand elle travaille, elle se contente de peu de chose, quand elle ne fait rien, elle passe son temps à manger.
En fait, l’explication était plus simple : Papillon, qui était un philosophe, préférait tout bonnement l’avoine qu’on lui servait pendant l’hiver à l’herbe fraîche qu’on lui laissait brouter le long des routes l’été.
Ce jour-là, le père et la mère Zizi, installés depuis quelque temps déjà dans la plaine de Saint-Ouen, avaient projeté de se rendre au marché aux oiseaux.
Ils avaient donc dételé le matin Papillon, l’avaient attaché à l’envers, la tête près de la roulotte, puis, ils étaient partis de compagnie vers le Quai aux Fleurs.
Les affaires avaient bien marché. Le père Zizi avait gagné quelques sous et, le soir venu, les deux Bohémiens décidèrent, après avoir toutefois versé à Papillon sa ration habituelle d’avoine, d’aller faire un tour chez le petit bistro voisin.
Le père et la mère Zizi s’étaient donc éloignés de leur roulotte, en devisant. Ils avaient traversé l’extraordinaire agglomération que constituent les cabanes de chiffonniers, des biffins parisiens qui habitent en grand nombre derrière la porte de Saint-Ouen, sur les terrains de zone militaire.
Aussi bien les deux bohémiens échangeaient en passant de nombreux bonjours, donnaient force poignées de mains. Ils étaient populaires, les deux époux, il y avait bien dix ans qu’ils venaient chaque année camper à la même place, et il n’était pas un seul biffin qui ne tînt à honneur de leur présenter ses devoirs.
– Et alors, ça va, la mère Zizi ?
– Pas trop mal, mon vieux, pas trop mal. Et vous, la chiffonnerie ?
– Euh, le cuivre ne donne rien cette année, il y a un peu de boîtes de sardines et des bouteilles d’eau minérale, mais c’est bien tout.
– De quoi joindre les deux bouts, alors ?
– Comme vous dites, la mère Zizi. Mais il y a un gosse de plus à la maison.
Le père Zizi éclatait de rire.
– Ah bien vous, alors, vous suffiriez à repeupler la France. Combien donc que vous êtes ?
– Quatorze, maintenant. Tous bien portants et travailleurs.
Plus loin, par-dessus la haie, se trouvait un petit enclos, dont le sol était exhaussé d’un amas de détritus tirés des poubelles parisiennes et classés avec un soin extrême : à droite des bouchons, un peu plus loin des vieux papiers, plus loin encore les morceaux de ferraille.
Un autre couple interpellait le père et la mère Zizi :
– Eh là, les deux rentiers, la santé est bonne ?
– Mais oui, mais oui, et vous-mêmes ?
– Toujours excellente chez nous. Dites donc, vous avez des nouvelles de votre môme ?
– Non, vous l’avez vue ?
– Elle est chez l’Accapareur.
– Eh bien, elle fera quelques sous.
– Sûr et certain, si elle est travailleuse.
– Oh, elle l’est.
Quelle était donc « la môme » dont on demandait des nouvelles au père et à la mère Zizi ?
Huit jours avant, alors que les deux bohémiens venaient à peine d’arriver aux portes de la capitale, tandis qu’ils s’occupaient d’installer leur campement, ils n’avaient pas été peu surpris de voir apparaître devant eux celle qu’ils avaient surnommée « la merveilleuse jeune femme », et qui n’était autre que la fille de Fantômas.
– Bonjour, père et mère Zizi, comment donc allez-vous ?
De stupéfaction, le père et la mère Zizi avaient failli tomber à la renverse.
Après l’accident de Morlaix, l’accident au cours duquel leur compagne, si malencontreusement, avait blessé un malheureux jeune homme, puis s’était vue arrêtée, les deux bohémiens, effrayés, terrifiés même, s’étaient hâté de reprendre la route.
Ils avaient voyagé à marche forcée. Alors qu’ils s’apprêtaient à faire encore campagne pendant un mois, le père et la mère Zizi brusquement avaient décidé de regagner Paris, espérant bien que la police, la justice, institutions qui veulent du mal aux pauvres gens, perdraient leurs traces et ne les retrouveraient pas dans la plaine de Saint-Ouen.
Hélène avait été avare d’explications.
– Bah, ne vous faites pas de mauvais sang. Tout s’est très bien arrangé. On a reconnu que j’étais innocente. On m’a remise en liberté. En liberté provisoire, et vous le voyez, je me suis hâtée de vous suivre à la piste, pour reprendre ma place dans la roulotte.
– Mais ma pauvre petite, c’est que pendant l’hiver on ne peut pas t’employer. Nous avons juste, le père et moi, de quoi ne pas mourir de faim.
Par bonheur, l’esprit inventif du père Zizi avait trouvé moyen d’arranger les choses.
Il savait que la jeune fille était travailleuse, il savait aussi qu’elle avait besoin de gagner sa vie, il n’avait pas hésité à lui proposer une place :
– Allons, j’ai assez de relations pour pouvoir te caser. Ici, vois-tu, ma fille, nous sommes au centre des installations de biffins. C’est bien le diable si je n’en trouve pas un qui veuille t’engager.
La fille de Fantômas avait accepté d’enthousiasme, et, deux heures plus tard, en effet elle était « engagée » par l’un des chiffonnier les plus importants de la plaine Saint-Ouen, un chiffonnier qui s’occupait tout spécialement des vieux métaux, et que, par plaisanterie, ses compagnons avaient surnommé « l’Accapareur ». Hélène était ainsi devenue chiffonnière. Elle gagnait sa vie. Mais était-ce bien pour gagner sa vie qu’elle avait accepté ce rude métier ? N’avait-elle pas une raison secrète de ne pas quitter les époux Zizi ?
***
– Chauffeur, vous me mènerez à la porte de Saint-Ouen.
Juve qui venait de sauter dans un fiacre et de donner cette adresse vague, s’enfonça sur la banquette de la voiture, s’accouda, parut profondément réfléchir.
– De plus en plus bizarre, murmurait le policier, d’un air préoccupé, c’est à n’y rien comprendre, et je me demande si jamais je renouerai les fils rompus de cet extraordinaire écheveau. Où est le portefeuille ? Nikita m’écrit qu’il ne trouve rien. Diable, cela c’est le plus grave de tout. Mais il y a mieux. Qu’est devenu Fandor ? Lui me télégraphie que la fille de Fantômas est arrêtée, puis ne me donne plus de nouvelles. Pourquoi ? Qu’est devenue même la fille de Fantômas ? « Détenue dans la prison de Brest », m’a télégraphié Fandor. Je t’en fiche, à la prison de Brest, il y a bien eu, en effet, une jeune fille répondant au signalement d’Hélène, mais elle a trouvé le moyen de s’enfuir, avec l’aide probable d’un jeune chirurgien-dentiste. Un complice de Fantômas ? C’est possible, mais ce n’est pas certain. Et puis où a été Hélène ? Ah, nom d’un chien de nom d’un chien, il faudrait pourtant que j’arrive à comprendre quelque chose avant que ça commence à se gâter.
Juve avait raison de s’inquiéter.
Non seulement il n’avait pas de nouvelles de Fandor, ce qui, étant donné leurs conventions, ne devait pas le tourmenter outre mesure, mais encore il n’avait pas la moindre idée de ce qu’avait pu devenir le portefeuille.
Quand Fandor et lui l’avaient caché dans le creux de la falaise, se rendant compte qu’ils n’avaient aucun moyen de l’emporter en sécurité jusqu’à Paris et qu’il valait mieux le laisser en lieu sûr pour détourner sur eux l’attention de Fantômas et laisser au lieutenant Nikita le temps de venir le chercher, Juve avait été persuadé que nul n’avait pu le voir dissimuler le précieux document. Nikita cependant n’avait rien trouvé dans la cachette. Quelqu’un l’avait donc pris ?
– Fantômas, songeait Juve, nous a attaqués, Fandor et moi, à la petite gendarmerie, où il a tué le malheureux Pancrace. C’est la preuve certaine que Fantômas ne se doutait pas, ne pouvait pas se douter de ce qu’était devenu le portefeuille. Il croyait à ce moment-là que nous l’emportions, Fandor et moi. Il ne soupçonnait nullement que nous avions caché l’objet. Rien n’a pu le faire changer d’opinion. Rien n’a pu lui faire découvrir notre cachette. Or, l’explication est la même pour Sonia Danidoff et Ellis Marshall. Ils nous poursuivaient, donc ils croyaient que nous possédions le portefeuille. Donc ce ne sont pas eux comme ce n’est pas lui qui sont allés le reprendre. Qui, alors ?
Juve, de réflexion en réflexion, de déduction en déduction, en était arrivé à se demander s’il ne fallait pas croire qu’une seule personne avait pu voler le portefeuille rouge, une personne qui n’était autre que la fille de Fantômas.
– Elle, songeait Juve, ne nous a jamais poursuivis. J’ignore ce qu’elle a fait depuis le naufrage du Skobeleff. Ne serait-il pas à supposer qu’embusquée derrière un rocher, elle ait pu nous voir, Fandor et moi, en train de dissimuler le portefeuille ? Dès lors, pourquoi ne l’aurait-elle pas retiré de sa cachette ? pourquoi ne l’aurait-elle pas volé, soit pour le remettre à son père, soit par haine de la police, soit encore pour s’en faire une arme terrible contre quiconque – agents russes ou agents français – voudrait attenter à sa liberté ?
Donc, il fallait le retrouver. Comment ? Fandor le bec dans l’eau, Hélène évadée, restaient les Zizi.
La fille de Fantômas a été bouclée par surprise, elle n’a pas dû avoir le temps de prendre ses précautions, se disait Juve, n’est-il pas possible qu’ayant le portefeuille rouge en main, l’ayant caché à l’intérieur de la roulotte quelque temps avant son arrestation, elle n’ait pas eu le loisir depuis de revenir le prendre ?
***
Il faisait nuit noire, quand le policier parvint en vue de la roulotte.
– Ah, ah, s’écria Juve, qui, mal vêtu, grimé en terrassier avec un pantalon de velours bouffant maintenu par une ceinture rouge, dont le pan flottait derrière une petite veste bleue courte de compagnon, ne paraissait nullement déplacé dans le quartier, oh, oh, je crois que le hasard me favorise. On jurerait qu’il n’y a personne.
Personne, en effet, dans la roulotte, puisque le père et la mère Zizi, tout heureux du succès de leurs affaires au marché aux oiseaux, s’étaient rendus chez un mastroquet voisin.
Sans le moindre scrupule, Juve s’introduisit dans la roulotte par une des petites fenêtres mal close, et immédiatement il se livra à une perquisition des plus minutieuse.
Cela dura une bonne heure. Juve, hélas, ne trouva rien. Le policier, toutefois, ne se décourageait pas pour si peu.
– Eh bien, monologuait-il, je n’ai véritablement pas de chance. Tout me dit que le portefeuille doit être là, à côté de moi, et je ne peux pas mettre la main dessus.
– Si le portefeuille n’est pas dans la roulotte, se répétait-il, où peut-il être ?
Juve, après avoir minutieusement examiné le voisinage et n’avoir rien aperçu dans l’ombre propice qui fût de nature à l’inquiéter, sortit de la roulotte. Il jeta un regard indifférent à Papillon, qui, tranquille, ruminait le nez dans sa mangeoire, puis se glissa sous la roulotte.
Juve ne s’était pas trompé.
Entre les quatre roues du pauvre véhicule se trouvait une grande caisse de bois. Elle était remplie des matériaux les plus extraordinaires. Là voisinaient de vieilles assiettes cassées et des piquets destinés à la tente de toile. Une cage démolie s’enfonçait sous le poids d’un fourneau portatif de cuisine. Des monceaux de vieux journaux, des bouteilles vides voisinaient avec de vieilles couvertures de lit. Cette caisse en bois était le débarras de la famille Zizi.
Accroupi sous la roulotte, le policier commença à perquisitionner dans la caisse. Il se passionna même tellement à sa besogne, qu’il finit par enjamber les parois de la caisse en bois, entra dedans, il s’y coucha presque. Or, Juve s’était à peine introduit de la sorte dans cette grande caisse qu’avec une inquiétude soudaine il releva la tête, écouta.
– Sapristi, murmura-t-il, on a marché. J’ai entendu marcher. Pourvu que ça ne soit pas le père et la mère Zizi qui reviennent. Je serais frais, s’ils me trouvaient là.
Juve jeta autour de lui un regard soupçonneux. La nuit très noire ne lui permettait pas de voir bien en détail ce qui l’entourait. Il pouvait tout juste distinguer un horizon restreint, et cet horizon apparaissait parfaitement désert. Devant lui, entre les deux roues constituant l’avant-train de la roulotte, Juve aperçut d’abord les quatre pattes du cheval, puis un peu d’herbe descendant en pente roide, enfin le fossé des fortifications. À droite, entre la roue avant et la roue arrière, Juve apercevait toute la plaine de Saint-Ouen, mais il n’en distinguait rien de précis : il la devinait plutôt, aux lumières clignotantes qui scintillaient par moments dans les baraques voisines des chiffonniers.
Juve se retourna sur lui-même, voulant examiner ce qui se passait à gauche de la roulotte et ce qui se passait en arrière. Or, le policier n’eut pas le temps de se livrer à cet examen. Alors que rien n’avait pu lui faire deviner la chose, soudain ce fut la catastrophe.
Juve, abasourdi, sentit la roulotte s’ébranler, elle avança un peu, lentement d’abord. Juve vit le cheval reculer en se cabrant, puis soudain la roulotte augmentait l’allure, Juve avait tout juste le temps de s’accroupir au fond de la boîte, miraculeusement détachée de la roulotte, pour n’être pas guillotiné par l’essieu arrière qui lui frôlait la nuque. Le véhicule dévalait la pente, entraîné par sa masse, pour se jeter, écrasant sous lui le malheureux Papillon, au fond du fossé des fortifications.
Juve sorti comme un diable de sa boîte, la pluie des invectives s’abattit sur lui. Appelés dehors par le fracas de l’accident, les chiffonniers avaient aperçu le policier et ils s’étaient précipités sur lui qui ne les attendit pas pour détaler, franchir une haie, sauter le fossé.
Mais qui soudain devant lui faisait pousser ce sourd juron par l’homme poursuivi ?
Une silhouette noire qui s’enfuyait en silence, se confondant avec la nuit, la silhouette d’un homme moulé dans un maillot noir, dont le visage se dissimulait derrière une cagoule noire, qui glissait sans bruit, souple, vif comme l’éclair.
Juve n’eut pas besoin de la regarder longtemps pour la reconnaître.
– Fantômas, hurla Juve, tu ne m’échapperas pas toujours.
Et en même temps, toujours courant, le policier tirait son revolver, tendait le bras, faisait feu.
Imprudence.
C’était se signaler à ceux qui le poursuivaient.
– Je suis fichu, songea Juve, ils vont m’écharper vif.
Sa situation semblait, en effet, d’autant plus désespérée que, par une inconcevable malchance, il venait, courant au hasard, de pénétrer dans une impasse où il était pris comme dans un piège.
Or, tandis qu’affolé il revenait sur ses pas, une véritable fusillade éclatait dans la plaine de Saint-Ouen ; le coup de revolver du policier avait encore surexcité les biffins, acharnés à s’emparer du misérable qui avait précipité dans le fossé la roulotte des Zizi. Allaient-ils se tuer entre eux ? Mais subitement le policier s’arrêta, figé sur place, ne sachant plus où donner de la tête. Devant lui, à quelques mètres, revolver au poing, portant des torches, les biffins se précipitaient. Là Juve eut une inspiration : au lieu de fuir, il s’élança vers ses adversaires :
– En arrière, en arrière, cria-t-il, il a fui par là.
Et trompés par ce cri, les autres, le prenant pour l’un d’eux, rebroussèrent chemin.
Hors d’haleine, Juve s’arrêta, cependant qu’autour de lui s’agitait tout un peuple de chiffonniers maintenant réveillés, furieux, ne comprenant rien à ce qui se passait, soupçonnant une rafle de police et fuyant en désordre. À ce moment précis, Juve éprouva une violente surprise. Un camelot porteur d’un énorme paquet de journaux passa en effet près de lui en courant, et Juve l’entendit lui crier distinctement :
– Foutez le camp, nom d’un chien, je me charge du reste.
Qui était-ce ? Que lui voulait-on ? L’avait-on reconnu ?
Mais Juve n’avait plus rien à faire dans la plaine de Saint-Ouen. Fantômas, à coup sûr, était loin. Les chiffonniers continuaient à tirailler, mais cela n’avait guère d’intérêt.
Hochant la tête, Juve, très préoccupé, se dirigea vers la barrière où, maintenant, des gardiens de la paix attirés par les coups de revolver, apparaissaient. Mieux vaut tard que jamais.
18 – LA TRIPLE MATHILDE DE BRÉMONVAL
Pas à pas, pensif et ronchon, le lieutenant prince Nikita descendait l’escalier assez roide et fort peu luxueux de l’immeuble qu’habitait Juve, rue Bonaparte.
– Ce policier n’est pas chez lui. Comment expliquer sa disparition ? Il a pourtant dû recevoir mon télégramme l’avertissant que je n’avais pas retrouvé le portefeuille rouge ? Alors ? comment se fait-il qu’il ne m’ait pas attendu ? et que vais-je faire ?
Débarqué le matin du rapide de Bretagne, le prince russe s’était immédiatement rendu chez le policier, mais comme il ne l’avait pas trouvé, il se sentait perdu.
– Aller à l’ambassade ? songeait-il, ce serait absurde. Il est absolument inutile de mettre notre excellent ambassadeur au courant de ma déconvenue. Alors ? Il faut avouer que, depuis trois jours, je fais un drôle de métier. Avant-hier, le long de la falaise, je retournais des pierres comme un imbécile, à la recherche d’un portefeuille absent d’ailleurs. Puis je sauvais cette jolie femme qui a nom Mathilde de Brémonval, puis encore j’apprenais que son prétendu assassin était le plus honnête homme du monde, au lieu qu’elle-même était une gourgandine. Allez y comprendre quelque chose. Je ne suis pas policier, moi.
Le prince Nikita, tout en songeant de la sorte, suivait le quai en direction du pont des Arts.
– Encore, pensait l’officier, si cet imbécile de Jean-Marie m’avait parlé clairement. Qu’est-ce que c’est que cet individu-là ? pourquoi m’a-t-il affirmé qu’une femme avait volé le portefeuille, que cette femme était en prison à Brest, et que Juve était une fripouille ?
Il fallait prendre une décision.
– Ma foi, se dit-il, je vais toujours tenter l’aventure. Mathilde de Brémonval m’a dit qu’elle habitait rue Laurent-Pichat, allons rue Laurent-Pichat. Si je n’apprends rien d’elle, j’aurai toujours eu le plaisir de la revoir.
Bien que très brave et fort audacieux, le lieutenant prince Nikita eût à coup sûr frémi s’il avait su au juste chez qui il se rendait, alors qu’enfoncé sur les coussins d’un taxi-auto, il réfléchissait à la visite qu’il allait faire, et évoquait par la pensée l’exquise Mathilde de Brémonval.
Il était à cent lieues d’imaginer que cette créature de luxe et de rêve était en réalité… Lady Beltham, maîtresse de Fantômas.
Lorsqu’à la suite des dénonciations de Raymonde, la fille de Fantômas, après les tragiques aventures survenues à Paris-Galeries, Juve et Fandor avaient soupçonné la véritable identité de Mathilde de Brémonval, celle-ci brusquement avait disparu.
Qu’était devenue Mathilde de Brémonval ?
Fantômas, audacieux comme il l’était, n’avait guère eu de peine à persuader sa maîtresse qu’elle pouvait, sans le moindre risque, réapparaître à Paris sous le nom de M mede Brémonval.
– Nul ne connaît ton identité, avait affirmé le bandit ; nul, sauf, il est vrai, Juve et Fandor, mais j’imagine que, cette fois, ni Juve ni Fandor ne peuvent s’en prendre à toi.
Lady Beltham s’était laissée convaincre.
***
– M mede Brémonval est-elle chez elle ?
La concierge hésitait :
– Je ne sais pas, monsieur. Je ne saurais vous dire : J’ai vu rentrer sa dame de compagnie, mais j’ignore si M mede Brémonval l’accompagnait. Voulez-vous prendre la peine de monter, monsieur. C’est au premier étage, à droite.
– Je vous remercie, madame.
Quelques minutes encore, il attendit, puis la porte de l’appartement s’ouvrit. Une avenante soubrette l’introduisit dans un grand salon richement décoré.
– Qui dois-je annoncer, monsieur ?
Le prince Nikita venait de tirer son portefeuille, il tendait sa carte de visite, un transparent bristol, somptueusement gravé :
– Veuillez annoncer, mademoiselle, à M mede Brémonval que je ne la retiendrai que quelques instants.
– Je ne sais pas si Madame est là, monsieur. Si Monsieur veut attendre quelques secondes, je vais voir.
Déjà la servante avait disparu.
Le prince Nikita ne put s’empêcher de songer qu’en vérité le domicile de la jolie créature était soigneusement gardé.
Le prince Nikita en était là de ses réflexions et se demandait, avec l’anxiété d’un jeune homme qui vient voir une jolie femme, si M mede Brémonval « allait être là » pour lui, lorsqu’il entendit des pas légers au long de la galerie voisine.
– C’est elle, se disait-il, c’est elle…
La porte s’ouvrit : une très vieille dame entra.
– Vous désirez parler à M mede Brémonval ? Pour affaire personnelle, monsieur ?
– Oui, madame. Ne pourrais-je pas la voir ?
– Je crains que cela ne soit difficile, monsieur. M mede Brémonval est encore en voyage ; je l’ai devancée de quelques jours. Je suis sa dame de compagnie, M meBrigitte.
À coup sûr, tout autre que le prince Nikita se serait excusé, aurait regretté sa démarche vaine, corné sa carte, serait parti.
Le prince Nikita était bien trop épris pour agir de la sorte. Il était venu Voir Mathilde de Brémonval en s’affirmant qu’il voulait par elle apprendre quelques détails relativement à la personnalité de Jean-Marie, à son séjour au château de Kergollen, au portefeuille rouge, mais en réalité, s’il se trouvait dans l’appartement de la rue Laurent-Pichat, c’était en raison du désir qu’il avait de revoir la jolie Mathilde.
– Madame, commença-t-il, je suis fort étonné, j’avais rendez-vous avec M mede Brémonval.
– Et vous regrettez beaucoup, monsieur, de ne point pouvoir joindre M mede Brémonval ?
Mais sans doute, tout en parlant, la vieille femme se rendait compte de ce que sa question avait d’étrange, car elle se hâta d’ajouter :
– Vous pouvez me répondre en toute franchise, monsieur. Si vous connaissez bien M mede Brémonval, elle a dû vous dire que Dame Brigitte était un peu plus auprès d’elle qu’une simple dame de compagnie. Je prétends à son amitié.
– En effet, madame, je regrette infiniment de ne pas rencontrer M mede Brémonval. Je regrette même à un tel point que, si j’osais me permettre de douter de vos paroles, j’insisterais pour que vous m’assuriez encore une fois que M mede Brémonval est absente.
– Mais monsieur, je vous l’ai déjà dit.
– Je demande une simple confirmation.
– Ah ?
– Madame, madame, reprit le prince Nikita, dites à M mede Brémonval… qui n’est pas là… que je lui serais mille fois reconnaissant de bien vouloir, pour moi, consentir à être là.
– Vous demandez l’impossible, monsieur, répondit Dame Brigitte, mais vous le demandez si bien que je ne puis vous résister plus longtemps. Veuillez attendre quelques instants.
Et elle sortit. Le lieutenant se prit à songer.
Soudain, Mathilde de Brémonval elle-même entra dans le salon, mais, à vrai dire, elle ne paraissait pas le moins du monde en colère. Plus jolie que jamais, plus blonde qu’un rayon de soleil, elle fit son apparition dans la pièce, souriante, bien que gardant une attitude un peu hautaine et fière, une attitude séduisante autant que mystérieuse.
– Monsieur, déclara-t-elle en saluant l’officier, qui, très bas, s’inclinait devant elle, vous faites vraiment un avocat extraordinaire. Je n’étais ici pour personne, vous avez su convaincre ma gouvernante que j’y étais pour vous. C’est un véritable succès d’éloquence.
– Laissons ce succès, madame, il n’ajoute rien au bonheur que j’ai à me trouver devant vous.
– Cela vous fait donc bien plaisir ?
– En doutez-vous, madame ?
– Mon Dieu…
Le prince Nikita se leva. Quittant le fauteuil où il était assis, il s’avança de deux pas vers le canapé sur lequel M mede Brémonval venait de se jeter :
– Vous êtes cruelle, madame, vous savez fort bien quel bonheur j’ai à pouvoir, comme je le fais en ce moment, prendre votre petite main mignonne et…
Mais, au même moment, tandis que le lieutenant Nikita voulait saisir la main de Mathilde de Brémonval, et peut-être la porter jusqu’à ses lèvres, celle-ci se levait, l’air subitement devenu hautain :
– Je vous en prie, dit-elle.
Et, sans affectation, la jeune femme allait s’asseoir sur un siège plus éloigné du prince Nikita.
Comme il n’apparaissait cependant pas que son audace eût exagérément déplu à celle qu’il courtisait, le prince Nikita ne fut nullement troublé.
– Madame, reprit-il, vous êtes très méchante aujourd’hui. Voulez-vous donc que je pense réellement avoir forcé votre porte et que ma présence vous désoblige ?
Cette fois, un sourire passa sur le visage gracieux de M mede Brémonval.
– Là, là, vous employez tout de suite les grands mots. Et d’abord, pourquoi voulez-vous que j’ajoute foi à vos déclarations ? Vous prétendez que vous avez plaisir à me voir, c’est fort galant à vous, mais qui me prouve que vous m’êtes réellement dévoué ?
– Oh, oh, songea le jeune homme, me serais-je donc réellement fourvoyé ? Vais-je avoir discrètement une invitation à passer chez le bijoutier ?
Voulant pousser l’aventure jusqu’au bout, le prince n’hésita pas :
– Vous n’avez pas de preuves, madame, de mon dévouement, je le reconnais, répondait-il en souriant, mais il ne tient qu’à vous d’en avoir autant qu’il vous sera agréable ; parlez donc : votre chevalier servant vous écoute et, soyez-en certaine, vous obéira.
– Je me contenterai de savoir qu’il ne m’a pas désobéi.
Cette phrase, le prince Nikita ne la comprit pas :
– Vous avoir désobéi, madame ? en quoi ? mon Dieu, vous m’aviez autorisé à me présenter chez vous, j’espère…
– Il ne s’agit pas de cela.
– De quoi donc, alors ?
– Je vous ai demandé, monsieur, de renoncer à chercher le portefeuille rouge que vous étiez venu reprendre en Bretagne. Vous occupez-vous encore de cette affaire ?
– Madame, répondit le prince Nikita, mon devoir est de m’occuper de cette affaire, je n’y saurais faillir. Je m’en occuperai donc encore, croyez-le bien, sauf…
– Sauf quoi, monsieur, quelles conditions mettriez-vous à abandonner une recherche qui me fait peur pour vous ?
– Une condition, madame, que sans doute vous ne sauriez imaginer. Je dois aller m’occuper du portefeuille rouge, gardez-moi prisonnier près de vous, je n’irai pas.
Et, en achevant cette réponse, précise à en être insolente, le prince Nikita, qui savait qu’une femme pardonne toujours qu’on lui manque de respect parce qu’elle en est toujours flattée, leva les yeux, cherchant à deviner sur le visage de M mede Brémonval la réponse qu’elle allait lui faire et qui, sans doute, allait être décisive.
Or, la jolie femme, loin de l’écouter, maintenant, prêtait l’oreille, l’air fort inquiète.
– Qu’avez-vous donc, madame ?
– Ne bougez pas, monsieur, ne bougez pas, je reviens dans deux minutes.
Resté seul, Nikita tendit l’oreille.
De la galerie voisine, des bruits de voix arrivaient jusqu’à lui, des bruits de voix qu’il ne parvenait pas à comprendre nettement, mais où il démêlait néanmoins, par moments, des intonations qui trahissaient l’organe de dame Brigitte, puis encore des accents masculins.
– Bigre, pensa l’officier, assez inquiet de la suite des événements ; qui diable peut survenir si malencontreusement ? Dame Brigitte n’a point l’air satisfaite. Oh, oh, aurais-je la mauvaise fortune d’être sur le chemin d’un mari peu complaisant ?
Quelques secondes, le prince s’efforçait encore d’écouter les conversations voisines, puis, subitement, il tressaillit.
Brusquement la porte du salon s’ouvrit. Un homme entra dans la pièce, d’une quarantaine d’années, élégamment vêtu, que dame Brigitte suivait à distance respectueuse.
– Que désirez-vous, monsieur ? demanda le visiteur.
Le prince Nikita s’inclina, avec une nuance d’impertinence :
– Pardon, mais à qui ai-je l’honneur de parler ?
– Peu importe. Vous ne me connaissez pas. Veuillez me dire tout bonnement, je vous en prie, la cause de votre visite ici. Vous étiez venu voir M meBrigitte ?
Était-ce un quelconque M. de Brémonval ?
– Mille grâces, monsieur, répondit le prince Nikita. J’ai eu le plaisir d’être reçu par madame, en effet, mais j’ai eu le bonheur, ensuite, de voir M mede Brémonval, et je serais encore avec elle, j’imagine, si, pour échapper à vos importunités, je suppose, elle n’avait cru bon de me demander de l’attendre deux minutes.
– Impossible, dit l’autre, M mede Brémonval n’est pas à Paris.
Et c’était là une phrase, en vérité, extraordinaire pour le prince Nikita.
– Je vous le répète, je causais avec elle quelques secondes avant votre arrivée.
L’inconnu alors se retourna vers Dame Brigitte :
– Je suppose, lui demanda-t-il d’une voix que la rage faisait trembler, qu’il ment ? Répondez, Brigitte.
Dame Brigitte n’eut pas à répondre.
Avant même qu’elle eût pu ouvrir la bouche, le prince Nikita, d’un geste furieux, venait de tirer son portefeuille, d’y prendre une poignée de cartes de visite qu’il jetait à la figure de l’inconnu qui osait le soupçonner de mensonge, en hurlant.
– Vous me rendrez raison.
L’inconnu eut un sourire froid et très calme :
– Vous rendre raison ? Me battre avec vous ? Vous êtes fou, monsieur. Je n’en ai nul motif et nulle envie. Vous êtes grotesque. Sortez. N’éternisez pas une scène ridicule. Sortez donc vous dis-je. Puisque vous êtes familier de la maison, vous devez connaître le chemin.
Et telle était l’autorité avec laquelle cet inconnu parlait que le prince Nikita sortit, en effet, mais non sans s’être incliné gravement devant Dame Brigitte et lui avoir déclaré :
– Vous voudrez bien présenter mes hommages respectueux à M mede Brémonval et lui affirmer que je saurai, coûte que coûte, la débarrasser d’un goujat qui se permet de parler chez elle en maître et n’en a sûrement pas le droit, puisqu’il n’ose pas se nommer.








