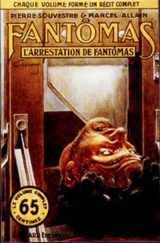
Текст книги "L'Arrestation de Fantômas (Арест Фантомаса)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Et puis les heures avaient passé.
Juve, à son tour, s’était laissé aller à une profonde somnolence, il avait complètement perdu la notion des choses, oublié sa mission, oublié même qu’il était arrêté, emprisonné en compagnie de Fandor, lorsque, soudain, à près de deux heures du matin, l’excellent policier avait sursauté, croyant entendre une sorte de plainte, de gémissement provenant de la pièce voisine, de la pièce contiguë à la « chambre de force », où, sur sa demande, le colonel Mastillard devait faire veiller un gendarme sous le fallacieux prétexte de les surveiller, Fandor et lui.
Déjà d’ailleurs, le journaliste était retombé au sommeil. N’entendant plus rien, Juve allait en faire autant, quand déchirante, sinistre, une plainte s’éleva de nouveau :
– Au secours, à moi, à l’aide, à l’assassin.
En un instant, Juve fut debout.
Le policier se précipita sur la porte de sa cellule, y cogna à grands coups de poing.
Mieux inspiré, derrière lui, Fandor avait bondi :
– Reculez-vous, Juve, reculez-vous.
Et, sans laisser le temps au policier de comprendre ses intentions, Fandor empoigna Juve à bras le corps, l’écarta de la porte, dont, il fit sauter la serrure à coups de revolver :
– Un coup d’épaule, Juve et nous passons.
En un clin d’œil, la porte de la chambre de force, en effet, tombait, arrachée de ses gonds.
Mais, au moment même où Juve et Fandor s’échappaient ainsi de leur prison pour courir dans la direction où ils venaient d’entendre appeler au secours, on venait à la rescousse.
Emportés par leur élan, trébuchant, les deux hommes venaient, en effet, de buter dans une troupe de gendarmes à demi éveillés, qui descendaient des étages de la gendarmerie portant des falots et plus grotesquement armés les uns que les autres, qui, d’un pistolet, qui, même d’un simple balai.
Dans la petite pièce qui attenait à la chambre de force, ce fut, alors une sombre mêlée.
– Au secours, à l’aide, par ici.
– Mais où diable est Pancrace ?
Un vrai tohu-bohu.
Par bonheur, l’arrivée du colonel Mastillard suffit à rétablir l’ordre.
– Taisez-vous donc, nom d’un chien, hurla le chef, que se passe-t-il donc ?
C’était la voix de Juve qui répondit :
– Mon colonel, criait Juve, c’est épouvantable. Votre malheureux gendarme vient d’être assassiné.
Et Juve montrait sur le sol, le corps du brave Pancrace, au flanc gauche traversé d’un poignard.
Au petit jour, Juve et Fandor partirent, toujours vêtus en trimardeurs.
– Mon pauvre Fandor, disait Juve, as-tu compris pourquoi ce malheureux Pancrace est mort ?
– Oui.
– Alors pourquoi ?
– Pour moi, Juve, Fantômas a tué ce malheureux qui veillait à notre porte pour arriver jusqu’à nous.
– Non, Fandor, tu te hâtes trop de deviner. Si Fantômas, réellement, avait voulu s’attaquer à nous, il se serait contenté d’immobiliser le gendarme Pancrace, il ne l’aurait pas tué. Crois-moi, ce n’est pas à nous, c’est bien à Pancrace que le bandit en voulait.
– Ah ?
– Écoute, Fandor, il s’est imaginé que pendant notre sommeil nous avions confié le portefeuille rouge au planton qui nous veillait. Et c’est pourquoi Pancrace a été tué, tué à notre place. Sais-tu, Fandor, que nous n’avons peut-être jamais joué partie aussi grave que celle que nous disputons en ce moment pour ce fameux portefeuille rouge ?
– Que vous avez dans votre poche, Juve.
Chose curieuse, le journaliste, en disant cela, avait un vague sourire au coin des lèvres.
10 – AVIS AUX AMATEURS
– Tout de même Juve, vous exagérez.
– J’exagère ? Fandor, que veux-tu dire ?
– Nous venons à peine d’arriver à l’hôtel, nous avons à peine déposé notre valise, et voilà que vous me faites repartir, voilà que vous prétendez visiter Morlaix.
– Fandor, tu n’es qu’un imbécile.
– Possible, mon bon Juve, mais j’ai sommeil.
« Juve, continuait Fandor, vous êtes insupportable. Dites-moi au moins où vous me menez, et pourquoi vous me faites gravir toutes les marches de cet escalier ?
– Pour arriver à son sommet, mon cher Fandor.
– Juve, vous vous moquez de moi ?
– C’est bien possible, Fandor… Mais, trêve de plaisanteries, Fandor. Puisque tu tiens à savoir où nous allons, sache que je te guide vers un superbe point de vue. Nous montons vers le viaduc.
– Vers le viaduc ? Vous êtes fou ? Que diable comptez-vous faire là-haut ?
– Admirer le paysage.
Le viaduc était, et Fandor dut en convenir lui-même, très digne d’intérêt. Gigantesque, élevé à donner le vertige, ce travail d’art, qui fait la fierté de la petite ville et que l’on vient admirer de fort loin, unit, à près de cinquante mètres de haut, le sommet des deux collines entre lesquelles Morlaix se répand.
– Juve, dit Fandor, si vous voulez vraiment étudier la construction de ce viaduc, allons l’admirer par en bas, mais ne me faites pas grimper au sommet.
– Fandor, tu es le dernier des idiots, dit Juve.
Dix minutes plus tard, les deux hommes atteignaient la petite gare de Morlaix, et Fandor ne fut pas médiocrement étonné de voir Juve, le plus gravement du monde, prendre deux billets de troisième pour la station la plus proche.
– Partons-nous donc ? se demandait Fandor.
Pas du tout.
– Mon petit Fandor, dit Juve, nous sommes ici, sur le quai de la gare, à quelque chose comme à une vingtaine de mètres du commencement du viaduc. Attention à la manœuvre. Profite du moment où les employés auront le dos tourné, glisse-toi le long de la voie, va-t’en jusqu’au milieu du viaduc, je t’y rejoins…
Peu après, en effet, Juve et Fandor se retrouvaient, perdus dans la nuit au milieu du viaduc, et tous deux s’accotaient à la balustrade, regardant, saisis d’admiration, le panorama sous leurs yeux.
– Est-ce assez joli, dans la nuit commençante, l’aspect de cette petite ville, mal éclairée, d’ailleurs, et de ces maisons qui semblent tassées les unes sur les autres et où clignotent de vagues lueurs.
– Ma foi, Juve, je ne vous connaissais point si poétique. Bigre de bigre, est-ce vraiment pour admirer Morlaix endormie que vous m’avez fait monter ici ?
– Non, avoua-t-il, nous sommes ici, mon petit, pour examiner notre chambre à coucher.
– Notre chambre à coucher, Juve ?
– Parfaitement. Fandor, tu n’es pas surpris que nous soyons arrivés sans encombre jusqu’ici ?
– Si Juve, j’en suis surpris. Mais je ne vois pas quelles conclusions vous pouvez en tirer ?
– Raisonne un peu, Fandor. Si ni Fantômas, ni Ellis Marshall, ni Sonia Danidoff n’ont trouvé bon de nous attaquer sur la route, crois-tu que nous devions en conclure qu’ils ont renoncé à s’emparer du portefeuille ?
– Non, certes.
– Eh bien, alors, Fandor, tu devrais te dire ceci : c’est qu’ayant évité les embuscades de jour, nous avons grande chance de subir des embuscades de nuit. Si je t’ai amené ici, au viaduc, c’est parce que de ce viaduc nous voyons parfaitement notre hôtel qui est situé juste au-dessous de nous, et que, voyant notre hôtel, tiens, là, près de la rivière, nous apercevons aussi les fenêtres de notre chambre, ce qui va nous permettre d’être aux premières loges pour voir comment nos affaires vont être fouillées tout comme elles l’ont été à Brest. Et ils n’ont pas perdu de temps. Regarde sur le toit de notre hôtel…
***
Juve et Fandor avaient à peine quitté l’auberge où ils avaient déposé leur valise, qu’une luxueuse automobile s’était arrêtée devant le petit hôtel.
Deux personnages en descendirent qui, après avoir donné leurs instructions à leur chauffeur, pénétrèrent dans la maison.
– Monsieur l’hôtelier, criait avec un fort accent anglais, l’un des voyageurs.
Et comme celui-ci accourait, fort ému d’avoir à loger d’aussi riches clients, le même étranger continuait :
– Avez-vous, monsieur l’hôtelier, une chambre disponible pour moâ ?
– Une chambre à deux lits ?
– Non, une chambre seulement pour moâ.
– Et une autre pour moi, alors, s’empressa d’ajouter la jeune femme en souriant.
– Alors, c’est deux chambres qu’il vous faut ? demanda l’aubergiste, je n’en ai plus qu’une. Justement, je viens de recevoir deux pauvres bougres qui m’ont pris l’autre. Si j’avais su que vous veniez.
– Eh bien, mettez-nous tous les deux dans la même chambre, dit la jeune femme, on s’arrangera.
– C’est un peu choquant, commença l’Anglais.
– Bah, laissez donc, dit la jeune femme, vous êtes toujours, mon cher Ellis, à vous préoccuper d’un tas de questions protocolaires qui sont véritablement déplacées dans la situation où nous nous trouvons. Prenons une chambre en commun, que diable, vous verrez bien ce qui arrivera.
– Honni soit qui mal y pense, reprit l’Anglais, monsieur l’hôtelier, conduisez madame et moâ dans la chambre que vous avez.
Le brave homme eût été bien autrement surpris s’il avait pu voir ce que, à peine la porte refermée sur lui, entreprenait la remuante jeune femme, qui, de force, avait conquis droit d’asile dans la chambre de l’Anglais.
– Ellis, ordonnait en effet Sonia Danidoff, tout shocking que cela peut vous sembler, il convient que j’enlève ma robe pour être plus libre de mes mouvements. Ne vous inquiétez pas. J’ai des dessous qui n’offusqueront en rien votre pudeur.
Tout en parlant, la jolie Sonia Danidoff se dépouillait en hâte pour apparaître très sobrement vêtue d’un jupon noir, d’une chemisette noire, vêtements très ajustés qui ne devait aucunement gêner ses évolutions.
– Ellis, continuait ia jeune femme en frappant sur l’épaule de son compagnon, qui, de plus en plus pudique, avait trouvé bon de se mettre lui-même en pénitence, tournant le dos et regardant fixement le mur, Ellis, il s’agit maintenant de ne plus perdre un instant. Vous avez vu la disposition des lieux et l’endroit où se trouve la chambre de Juve et de Fandor ? Croyez-vous qu’ils soient chez eux ?
– Possible, Sonia, ma chère, le contraire aussi.
– Eh bien, Ellis, il faut nous en assurer. Comment, monter sur le toit ? Ah, au fait, prenez donc ça.
Elle venait d’arracher à la toilette une petite glace ovale.
– Prenez cette glace, répétait Sonia, tendant le miroir à l’Anglais ébahi, et maintenant, suivez-moi.
Ébahi, Ellis l’était. Il n’en suivit pas moins la princesse. Le couloir de l’auberge était vide.
– Il doit y avoir un grenier.
Sonia trouva une échelle accrochée à la muraille, juste au-dessous d’une trappe :
– Dressez ça, commanda-t-elle, allons, dépêchez.
– Vous prétendez aller sur les toits ? Ce n’est pas sur les toits que se trouve le portefeuille rouge.
Sonia ne répondit rien. Elle venait de monter à l’échelle, avait soulevé la petite trappe qui la mettait en communication avec le couloir, et là, elle se livrait à une étrange manœuvre. Sonia accomplissait le tour complet du toit. La jeune femme arriva de la sorte au-dessus de la fenêtre de la chambre de Juve et de Fandor. Se couchant alors sur les tuiles de la toiture, Sonia arracha la petite glace des mains de l’Anglais. À bout de bras, elle la tendit alors devant la fenêtre et, de la sorte, dans le miroir, elle aperçut l’intérieur de la pièce.
– Personne, s’écria Sonia joyeusement, nous avons de la chance. Vous, dit-elle encore à Ellis, mon cher ami, vous m’avez l’air tout indiqué pour redescendre dans le couloir et faire le guet pendant que je pénètre dans cette chambre. J’imagine que Juve et Fandor ne vont pas tarder à revenir. Je ne tiens pas à être surprise par eux en flagrant délit de perquisition. Allez, montez la garde, vous dis-je. Si jamais vous les aperceviez, vous n’auriez qu’à siffler l’air de la Marseillaise.
– Aoh, dit l’Anglais, ce ne serait point convenable. On ne siffle pas la marche nationale d’un pays. Je ferai le chant du hibou.
Et, comme Sonia haussait des épaules narquoises, Ellis Marshall, gravement, quitta le toit pour aller faire le guet dans le couloir de l’auberge.
Bientôt, il entendit Sonia redescendre. La jeune femme était radieuse.
– Vite, murmurait-elle en se précipitant dans la chambre qu’elle occupait avec Ellis Marshall. Ne perdons pas une seconde.
Et Sonia Danidoff agitait le portefeuille rouge qu’elle avait découvert dissimulé dans la chambre de Juve et de Fandor.
Sonia avait compté sans son hôte.
Elle n’avait pas sitôt montré à Ellis Marshall le fameux portefeuille, en effet, que soudain l’Anglais sortit de son apathie.
– Je vous somme, madame, de me remettre ce portefeuille, dit-il.
Et très tranquillement, comme s’il eût été certain que Sonia allait accéder à ses désirs, Ellis Marshall tendait la main.
La jeune femme fit un bond en arrière.
– C’est moi qui l’ai trouvé, il m’appartient.
Mais Ellis Marshall s’obstinait :
– Mille regrets, madame. Il est possible que ce soit vous qui ayez pris ce portefeuille, mais il est certain que Sa Majesté mon Roi sera heureux de l’avoir. Je suis plus fort que vous, j’ai besoin de ce document, vous l’avez, je le prends.
La jeune femme tira un poignard de son corsage.
– Il est possible que vous soyez le plus fort, cria-t-elle, mais ce n’est pas certain.
Malheureusement, si Sonia, son poignard en main, pouvait tenir Ellis Marshall en respect, celui-ci n’en était pas moins le maître de la situation.
Il était, en effet, adossé à la porte de la chambre, et ne paraissait pas disposé à reculer.
– Vous ne sortirez pas avant que je connaisse le contenu de ce portefeuille rouge.
– Et d’abord, vous vous conduisez comme un sot, Ellis, en exigeant que je vous remette cette serviette de maroquin. Rien ne nous dit que nous ne nous trompons pas, que c’est bien là le portefeuille qui nous intéresse tous les deux.
– Si. Je suis certain de le reconnaître, Madame.
– Vraiment ?
Brusquement, Sonia, du bout de son poignard introduit en guise de levier, venait de faire sauter la serrure du portefeuille.
Et, à peine eut-elle jeté un coup d’œil, qu’elle éclata d’un grand rire :
– Nous sommes joués, Juve et Fandor se sont moqués de nous. Voyez plutôt, Ellis.
Et la jeune femme brandit une feuille de papier blanc prise dans la pochette de sûreté, une feuille de papier blanc sur laquelle on pouvait lire :
« Il y a portefeuille et portefeuille. Il y a documents et documents. Avis aux amateurs. »
11 – LA REMPLAÇANTE
Tandis qu’Ellis Marshall, en compagnie de Sonia Danidoff, s’emparait du portefeuille rouge que Juve et Fandor promenaient depuis leur départ de Brest, les deux amis, embusqués au sommet du viaduc de Morlaix, ne perdaient pas un geste des deux agents diplomatiques.
Et Juve et Fandor, enthousiasmés par le succès de leur ruse, ne se tenaient pas de joie, en vérité, en constatant combien la jolie représentante du gouvernement russe, tout comme le policier anglais, étaient tombés facilement dans le piège tendu à leur simplicité.
– Ma foi, Juve, s’écriait Fandor, qui venait de rire aux larmes, c’est une scène digne du Palais-Royal que celle à laquelle nous venons d’assister. Sonia volant un portefeuille qui n’a aucune valeur, se disputant poignard en main avec Ellis Marshall pour garder sa conquête, puis, enfin, s’apercevant qu’elle est illusoire.
– Tu avoueras, Fandor, que j’ai été fort bien inspiré en inventant cette ruse du portefeuille vide et en te parlant comme je l’ai fait, à haute et intelligible voix, dans la cour de l’hôtel de Brest. Sonia et Ellis Marshall sont complètement dépistés. Après avoir réussi à nous voler ce portefeuille qui ne contenait rien, ils ne vont évidemment plus savoir où donner de la tête. N’en doute pas, tous deux, ils imagineront que nous n’avons jamais eu en notre possession le véritable portefeuille, et je gage qu’en conséquence nous aurons la paix avec eux d’ici notre retour à Paris.
– Vous avez raison, Juve ; il y a de grandes chances pour qu’Ellis Marshall et Sonia Danidoff nous laissent en paix, mais cela n’arrange pas définitivement nos affaires. Même s’il ne leur prend pas fantaisie de nous attaquer encore pour s’assurer que nous ne cachons pas ailleurs le véritable portefeuille, nous ne devons pas oublier que nous avons toujours Fantômas à nos trousses. Il ne se serait pas laissé prendre à votre invention du faux portefeuille, lui. Juve, que pensez-vous faire ?
– Pour une fois, confessa Juve, tu raisonnes avec un sang-froid parfait, mon brave Fandor, tu es bien inspiré, en effet, en disant que, débarrassés d’Ellis Marshall et de Sonia, nous demeurons exposés aux attentats de Fantômas. Mais tu vas voir.
Juve et Fandor causaient toujours en haut du viaduc de Morlaix.
Le policier tira de son gousset la vieille montre d’argent, à laquelle il tenait fort, car, un jour, la balle d’un bandit s’était écrasée sur son boîtier, ce qui lui avait évité une horrible blessure. Il regarda l’heure, et annonça à Fandor :
– Dans dix minutes, mon bon ami, va passer le rapide de Paris. J’y monterai tout bonnement, sans même prendre de billet. Pour regagner la capitale. Et toi, Fandor, tu vas retourner à l’hôtel, puis revenir à petites journées, par la route, en musant, en t’amusant si tu le peux. Cela te va-t-il ?
Fandor ne pouvait, bien entendu, qu’approuver son ami.
En se séparant, ils devaient gêner Fantômas. Le bandit ne saurait plus lequel d’entre eux était en possession du portefeuille rouge, et de toutes manières, Fandor y songeait, – si lui ou Juve devait tomber sous les coups du tortionnaire, l’un d’eux au moins réussirait à rentrer dans la capitale, à y attendre le Prince Nikita, à lui donner les instructions qu’ils avaient à lui donner pour lui permettre d’entrer en possession de l’inestimable document.
– Séparons-nous donc, mon vieux Juve, et Dieu nous aide.
Mais, après quelques instants de silence, Fandor ajoutait :
– Juve, je ne sais pourquoi, mais j’imagine que nous n’allons pas être seulement l’un sans l’autre durant quatre jours. Eh bien, voulez-vous que nous convenions d’une chose ?
– De laquelle, Fandor ?
– De celle-ci : Juve, si dans trois mois, jour pour jour, nous ne sommes pas réunis, toute affaire cessante, l’un et l’autre, nous nous mettrons à la recherche l’un de l’autre.
– Tu as raison, Fandor, prenons rendez-vous ici, ici, où, vraisemblablement, nul ne songerait dans l’avenir, à supposer que nous pouvons nous rejoindre. Dans trois mois, jour pour jour, si nous ne nous sommes pas retrouvés, nous viendrons nous chercher ici, et à bientôt.
– À bientôt, Juve, oui, à bientôt.
Et, après une cordiale étreinte, Fandor quitta le policier, revint vers la gare d’où il sortit sans encombre, tandis que Juve prenait la direction des quais, où déjà les voyageurs attendaient le rapide de Paris.
***
Trois jours avant le moment où Juve et Fandor se quittaient sur le viaduc de Morlaix, une scène étrange se déroulait près du manoir de Kergollen, au bas de la colline toute semée d’ajoncs et de ronces sur laquelle s’élevait le château de dame Brigitte.
Là se trouvait une roulotte de romanichels, dont les hôtes, le père et la mère Zizi, incarnaient merveilleusement les types de la race errante par excellence.
Le père Zizi, vannier de profession, était un homme d’une soixantaine d’années, resté étrangement mince et souple et dont le type tzigane, brun à en être presque mulâtre, n’était pas dépourvu de beauté. Il s’était marié jeune, avec celle qui était devenue la mère Zizi.
À force d’économies, ils avaient pu acheter la roulotte, et depuis près de trente ans, ils couraient au hasard des routes.
La mère Zizi, plus jeune que son mari d’une dizaine d’années était, elle aussi, de la plus pure race bohémienne. Ses cheveux bruns, crépus et bouclés, entouraient un visage d’un ovale régulier. Elle avait les yeux profonds et doux et la voix mélodieuse.
***
D’une foire à l’autre, le père Zizi conduisait la roulotte marron attelée de son vieux cheval blanc. On campait à l’abri de quelque baraque plus importante, le père Zizi dressait les tréteaux, et la mère Zizi, alors costumée en chasseresse, émerveillait les badauds par un exercice de tir à la carabine. Le public affluait à l’entrée de la petite tente du couple.
Hélas, le malheur est vite venu. Ce jour-là, précisément, le père et la mère Zizi venaient de faire connaissance avec ce détestable visiteur. La mère Zizi qui n’était jamais malade, avait voulu cueillir le long d’une haie un fruit dont la bonne apparence l’avait séduite. En étendant le bras, elle s’était écorchée à une ronce de fer, si bien écorchée qu’elle en avait maintenant le bas enflé, ce qui laissait à prévoir que, de longtemps, il lui serait impossible de se livrer à aucun exercice.
– Sang de Dieu, jurait de temps à autre le père Zizi, qui s’était tout juste assez civilisé au cours de ses voyages pour apprendre quelques jurons bien français, sang de Dieu, comment allons-nous faire, la mère ? Jamais tu ne pourras ces jours-ci tenir la carabine.
La mère Zizi, qui regardait son bras enflé, et qui, de plus, ressentait de vives douleurs dans toute l’épaule, hocha tristement la tête :
– Parbleu, le père, tu as raison. Il faudrait que tu me fasses remplacer par quelqu’un. Plus facile à dire qu’à faire.
Le « quelqu’un » que la vieille Bohémienne proposait d’engager était des plus hypothétiques, car il devait présenter des qualités assez rares. Ce devait être une femme, ce devait être une bonne tireuse.
Or, le hasard allait bien faire les choses.
Alors que le père Zizi se lamentait et criait à tous les échos sa douleur de voir la mère Zizi hors d’état de tenir son rôle, il eut la surprise de voir déboucher brusquement d’un sentier voisin une jeune fille qui, tout naturellement, – et ayant certainement entendu les plaintes des deux Bohémiens – s’offrit à remplacer la mère Zizi, si toutefois on voulait lui assurer le vivre et le coucher.
Le père Zizi s’empressa d’accepter.
Même, il voulut que la jeune fille prit tout de suite ses premières leçons de tir, et ce n’est pas sans surprise qu’il s’aperçut que sa nouvelle recrue maniait expertement la carabine de tir qu’il lui avait confiée.
Le Bohémien, dès lors vit l’avenir en rose.
Ce n’était que le commencement de ses ennuis.
12 – LA BELLE HOMICIDE
Fandor venait à peine de quitter Juve que, descendant les rues de Morlaix, il tombait à l’improviste sur une petite place transformée en champ de foire.
De toutes part, des bateleurs faisaient leur boniment, brutalement éclairés par des lampes à acétylène.
– Entrez, entrez, messieurs, dames, criait sur une estrade transformée en tribune, une sorte de gentleman comiquement habillé d’une redingote trop longue. Entrez, il n’y a pas de premières, et pas de secondes, et pas de troisièmes. Ici, toutes les places sont au même prix. On voit aussi bien d’un bout à l’autre de la salle. Et le spectacle en vaut la peine, messieurs et dames. Entrez, Les artistes de la troupe vont avoir l’honneur de représenter devant vous les cérémonies du mariage telles qu’elles s’effectuent dans les différents peuples du monde, et cela, d’après les documents rapportés par les plus célèbres explorateurs. Entrez, on ne paye qu’en sortant. Si l’on est content. Le prix des places est à la portée de tous les membres de l’honorable société qui m’écoute.
Le journaliste, toutefois, n’était guère disposé à s’amuser plus longuement de l’aspect du champ de foire.
Il allait donc poursuivre son chemin, revenir à l’hôtel, regagner la petite chambre si expertement perquisitionnée quelques minutes auparavant par Sonia et Marshall, lorsque soudain il tressaillit.
– Diable de diable dit Fandor, qui soudain, s’était immobilisé et fixait un personnage avec des yeux littéralement ahuris. Qui est-ce donc ? J’ai déjà vu ce bonhomme-là. Mais où ?
Et délibérément dès lors, Fandor se hâta pour rejoindre le passant et le regarder à loisir.
Le passant, bien évidemment, ne se doutait nullement qu’il était suivi par Fandor.
Peut-être n’avait-il aucune raison de vouloir éviter que l’on observât ses démarches ?
Très naturellement, après avoir traversé le champ de foire, il alla s’arrêter à l’entrée d’un humble baraquement dont l’enseigne, éclairée à giorno par une abondance de lampions, portait ces mots alléchants :
« À la femme qui tue, sans tuer. »
Évidemment, l’homme allait entrer à la suite de la foule pour assister à la séance.
Fandor arriva tout juste pour le voir passer de l’autre côté du petit bureau servant de contrôle, où siégeait, imposant et digne, vêtu d’un extraordinaire uniforme de vieux général, un mince vieillard, patron de l’établissement…
– Miséricorde songea Fandor, que dirait Juve, dans son wagon, probablement endormi, s’il me voyait en train de baguenauder dehors à la poursuite d’un inconnu que je crois reconnaître ?
Le journaliste était toutefois trop têtu pour renoncer à sa poursuite.
À son tour, il franchit les degrés de l’estrade, à son tour, il entra voir la femme qui « tuait sans tuer ».
Debout sur la scène ménagée au fond de la tente, le journaliste aperçut une femme, une jeune fille plutôt, une jeune fille qu’il reconnut parfaitement, qu’il ne pouvait pas ne pas reconnaître, qui n’était autre qu’Hélène.
Oui, Hélène, la fille de Fantômas, la malheureuse et innocente enfant du Maître de l’Effroi.
Comment Hélène se trouvait-elle là ?
Le jeune homme, toutefois, était bien trop maître de lui-même pour trahir ses impressions.
À peine avait-il reconnu en entrant dans la baraque la fille de Fantômas, qu’il se jeta en arrière, se dissimulant dans un coin sombre de la tente…
– Morbleu, songeait Fandor à ce moment, je vais laisser finir le spectacle et il faudra bien, coûte que coûte, la toile tombée, que j’obtienne un entretien de cette énigmatique enfant. Sait-elle seulement si son père est sauf ? Pourquoi est-elle là ? n’est-elle pas devenue sa complice ?
Mais le spectacle débutait. La mère Zizi – car l’établissement dans lequel Fandor venait de pénétrer était l’établissement forain du père Zizi – s’avançait et annonçait :
– Messieurs et Mesdames et vous aussi, militaires la jeune femme, merveilleusement belle, que vous avez devant vous va avoir l’honneur d’exécuter avec l’un des honorables membres de la société, qui voudra bien se désigner lui-même, un exercice éminemment intéressant et émouvant, l’exercice du sabre magique. Messieurs et Mesdames, la jeune fille merveilleusement belle va prendre le fusil de chasse que voici, et que vous pouvez examiner dans tous les sens. Elle va charger ce fusil avec la cartouche que voici, et que vous pouvez encore examiner vous-mêmes, afin de vous assurer visuellement qu’elle n’est point truquée. Puis, elle épaulera son arme, elle visera l’amateur qui voudra bien tenter cet exercice. Et si c’est un honnête homme s’il n’a rien à se reprocher, grâce à la vertu du sabre magique que je lui donnerai, non seulement cet amateur ne sera pas tué, mais encore il retrouvera dans sa poche, la balle qui se trouve dans cette cartouche, et cette balle sera enveloppée dans une feuille de papier, où sera disposée, encore, la somme de deux sous, dix centimes.
Et subitement, avec cet esprit de décision qui lui était particulier, voilà que Fandor, en bon gavroche qu’il était, se sentit pris du désir de faire une bonne blague.
La mère Zizi, à ce moment, demandait :
– Un amateur qui veut éprouver la vertu du sabre magique ?
– Moi, dit Fandor.
Or, en même temps que Fandor sautait sur l’estrade, prêt à affronter le feu à coup sûr inoffensif de « la merveilleuse jeune femme », voilà qu’à nouveau son regard se croisait avec le regard du colosse, et il semblait à Fandor qu’il démêlait comme une sombre expression de haine dans les yeux de l’individu.
Fandor, toutefois, était bien trop occupé pour prêter plus longue attention au personnage.
Rapidement, la mère Zizi passa près de Fandor, et le journaliste sentit parfaitement qu’on lui glissait dans la poche la balle et la pièce de deux sous.
– Parbleu, pensait à ce moment Fandor, quand Hélène va lever les yeux pour me viser et qu’elle va m’apercevoir…
La fille de Fantômas au commandement leva la tête, en effet, fit machinalement le geste d’épauler le fusil.
– Feu, commanda la mère Zizi.
Une détonation.
Mais en même temps que le claquement sec de la cartouche, deux cris, deux cris terribles retentirent dans la baraque.
Et tout de suite, dans la foule, une panique se produisit :
– Arrêtez-la, arrêtez-la.
– À l’assassin, à l’assassin !
Que s’était-il donc passé ?
Au moment même où la fille de Fantômas levant la tête avait aperçu Fandor, elle avait poussé un cri et appuyé sur la détente. Et, à trois mètres d’elle, elle avait vu s’écrouler, atteint à l’épaule, dangereusement peut-être, le malheureux Jérôme Fandor.
***
Dans le public, un quart d’heure après, tandis que Fandor était emporté à une pharmacie voisine où on lui prodiguait les premiers soins, tandis que l’on entraînait vers la prison la malheureuse fille de Fantômas que le public voulait lyncher, un homme s’agitait, hurlait, ameutait les badauds, une sorte de colosse au visage bestial et repoussant : Jean-Marie.
Dans la poche de cet individu si quelqu’un avait pu fouiller, on aurait retrouvé une cartouche truquée, la cartouche préparée par la mère Zizi et à laquelle il avait criminellement substitué une autre cartouche, chargée, celle-là.
Jean-Marie, tout en ayant l’air furieux, était en réalité au comble de la satisfaction.
– Voilà, songeait l’ignoble apache, j’ai tenu ma promesse. Le Maître sera content. J’ai retrouvé sa fille. Je l’ai fait arrêter. Il la reprendra quand il voudra. Et puis j’ai vu du sang, du beau sang rouge. Le sang de cet imbécile de journaliste.
13 – MYSTÈRES ET PRÉCAUTIONS
Le train n’avait qu’une demi-heure de retard, et lorsqu’il vint se ranger le long du quai d’arrivée, à la gare Montparnasse, un homme en descendit précipitamment. Bien qu’il parût très préoccupé de regarder fixement devant lui l’employé portant sa valise, il jetait néanmoins de furtifs coups d’œil, à droite et à gauche, sur les voyageurs qui comme lui descendaient de ce train, lequel pour arriver de Rennes à Paris avait roulé pendant une bonne partie de la nuit.
Descendu, le voyageur sortit place de Rennes, héla un taxi-auto, et d’une voix claire et nette, bien timbrée qui pouvait être entendue des passants, il jeta au conducteur une adresse :
– Rue de la Banque.
Le véhicule démarrait aussitôt, et conduisait son client à l’endroit indiqué.
Le voyageur, alors descendit sa valise, mais garda le véhicule : il alla déposer son colis sous la voûte d’un immeuble, puis revint parler au mécanicien et cependant qu’il lui glissait le prix de sa course, augmentée d’un bon pourboire, dans la main, il lui ordonnait à voix basse :








