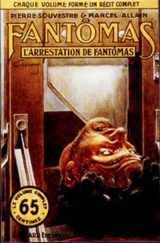
Текст книги "L'Arrestation de Fantômas (Арест Фантомаса)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Le petit matin blafard, sale, pluvieux, suintait semblait-il des toits d’ardoise entourant de tous côtés, avec de pittoresques clochetons, la petite place où se dressait la maison de la mère Kéradeuc.
Dans la cuisine, où l’on voyait mal, le brouillard entrait à gros flocons, rendant l’atmosphère quasi irrespirable, et pourtant la mère Kéradeuc ne songeait pas à allumer la moindre chandelle, non plus qu’à vaquer à quelque occupation.
Quelle heure était-il donc ?
La mère Kéradeuc, de temps à autre, d’en dessous son tablier, jetait un regard timide et effaré à la grande pendule accotée à la muraille qu’elle avait à côté d’elle, et alors, elle se lamentait :
– Deux heures et demie seulement et c’est à cinq heures, à cinq heures quatre, m’a-t-on dit, que cela aura lieu. Ah, j’en deviendrai folle, dame oui.
La vieille Bretonne, de plus en plus, se dissimulait sous son tablier relevé, et même bientôt elle appuyait ses deux mains contre ses oreilles comme quelqu’un qui ne veut pas entendre, qui n’a qu’un désir : être dans le noir, demeurer dans le silence.
Or, comme la vieille Bretonne, au comble de l’effroi, se ratatinait sur elle-même de plus en plus, voilà qu’elle sursauta brusquement, montrant bien la peur violente qu’elle venait d’éprouver.
Du premier étage de sa maison, par l’escalier de bois blanc, une voix venait de la héler, une voix forte qui ne tremblait pas, elle, la voix d’un homme, d’un homme qui devait être jeune :
– Madame Kéradeuc, venez donc un peu ?
– Descendez donc vous-même, mon bon monsieur. Qu’est-ce que vous voulez ? Seigneur ma Doué, si c’est possible d’avoir la curiosité que vous avez, et que tous les autres qui sont sur la place ont comme vous. Ah, dame, il faudrait me payer cher, moi, pour aller regarder à la fenêtre.
Un pas pesant ébranla le petit escalier, puis un homme, l’homme qui venait d’appeler, fit son entrée dans la pièce.
– Allons, madame Kéradeuc, dit-il non sans hausser les épaules d’impatience, vous êtes effroyablement peureuse. Il faut vous secouer. Voulez-vous monter ?
– Ah, Dieu non, je ne veux pas monter.
– Eh, madame Kéradeuc, je crois pourtant que je vous ai payé assez cher le droit de me mettre à votre croisée pour que vous n’ayez pas regret de l’autorisation que vous m’avez donnée. D’ailleurs, il ne s’agit pas de ça. Voyons, renseignez-moi au moins, puisque vous ne voulez pas m’accompagner. Par quelle porte doit-il sortir ?
La mère Kéradeuc ne répondit pas. L’homme, d’ailleurs, n’insista pas.
– La vieille est complètement affolée, songea-t-il. Ne nous faisons pas d’illusion, elle ne nous apprendra rien.
Tournant sur ses talons, l’inconnu abandonna la cuisine où la mère Kéradeuc resta seule, puis remonta l’escalier sans hâte.
Il pénétra dans une petite chambre claire et proprette, sentant le pitchpin, dont le lit était couvert d’une cretonne blanche, dont les rideaux étaient de toile blanche et sur la cheminée de laquelle, poussiéreuse et touchante, on pouvait juste apercevoir, sous globe de verre, une couronne de fleurs d’orangers.
L’inconnu ouvrit la fenêtre, fit tomber le store et à travers les trous de l’étoffe regarda la petite place de Quimper.
On n’aurait certes pas reconnu ce jour-là la tranquille petite ville bretonne. Alors que d’ordinaire personne ne s’arrêtait sur la place déserte s’étendant devant la maison de la mère Kéradeuc que bordaient d’un côté de vieilles bâtisses et de l’autre la monumentale prison, une foule immense y grouillait aujourd’hui, chantant, riant, buvant. Rares étaient ceux qui s’étaient couchés la veille au soir. Il y avait là des paysans, des paysannes aussi, mais il y était surtout venu, d’on ne savait où, des chemineaux, des gars de batteries et aussi de ces travailleurs aux allures équivoques qui abondent dans les campagnes comme ailleurs et qui ne manquent jamais de se rassembler pour des spectacles analogues à celui dont ils allaient être témoins.
L’inconnu, d’un œil morne, lassé, presque blasé, examina la foule grouillante :
– Décidément, songeait-il, il y a là toute l’aristocratie spéciale de la Bretagne. Dommage, en vérité, que toute cette foule soit exposée à être cruellement déçue d’ici quelques instants.
Il y eut comme un frémissement.
– Parbleu, dit l’inconnu, ce sont les fourgons.
À l’un des bouts de la petite place, une voiture poussiéreuse, peinte en vert, fit son apparition, traînée au trot d’un vieux cheval blanc.
– Deibler, vive Deibler.
Les cris se croisaient : on applaudissait, on s’agitait.
L’arrivée des voitures composait en quelque sorte le premier acte de l’exécution d’Œil-de-Bœuf qui, à l’heure fixée par la Loi, c’est-à-dire au lever du jour, allait prendre place.
Les fourgons, car une seconde voiture venait d’apparaître, encadrée par un escadron de gendarmes à cheval, sabre au clair et galopant botte à botte, traversaient la foule qui s’ouvrait pour leur laisser passage, gagnèrent le centre de la place, s’immobilisèrent enfin en un endroit que le bourreau la veille au soir avait soigneusement déterminé.
– Eh, eh, songeait toujours l’inconnu, observant la place de Quimper de la fenêtre qu’il avait loué à la mère Kéradeuc, Deibler n’est pas en retard, et même il ne paraît pas ému. Bigre, c’est un tempérament. J’aurais cru, après le drame d’il y a trois jours, après la découverte de son aide assassiné, de ce Jean-Marie que j’ai si proprement expédié, qu’il aurait eu quelque frayeur à venir opérer à Quimper. N’empêche, la tête qu’il va faire en voyant que la bascule est truquée.
Fantômas, en effet, n’était pas reparti immédiatement après l’exécution du lugubre équarrisseur devenu valet de guillotine. Quelques minutes encore, le Maître de l’Épouvante, au risque d’être surpris par le bourreau, était demeuré dans le Hangar Rouge, quelques minutes il avait travaillé à la guillotine. Il savait à présent que le truquage était parfait, que la bascule ne basculerait pas, que le couperet resterait suspendu, qu’impuissant à guillotiner Œil-de-Bœuf, Deibler devrait le laisser retourner au cachot où, sans aucun doute, suivant un usage constant, il serait gracié par le Président de la République.
Fantômas surveillait donc d’un œil calme le montage de la machine.
– Décidément, remarqua-t-il encore, s’intéressant au spectacle en amateur averti, Deibler connaît son métier. Il opère avec une habileté classique. L’emplacement est sablé, nivelé. Il ne laisse rien au hasard. Tiens, les soldats.
Tandis que le bourreau, en effet, s’occupait aux détails d’installation des bois de justice, sur la place des soldats étaient apparus.
Distraitement, alors, Fantômas suivit des yeux les évolutions de la troupe qui, en dépit des protestations unanimes, impitoyablement, refoulait vers les rues adjacentes ceux qu’avait attirés le spectacle.
– Quels imbéciles, songeait Fantômas, on ordonne que les exécutions soient publiques, et puis, chaque fois que la justice opère, on repousse au loin ceux qui viennent contempler la chose. Il faudrait, pourtant une bonne fois s’entendre, décréter que l’on cachera la guillotine comme une chose hideuse dans la cour des prisons, ou admettre au contraire que sa vue est moralisatrice et alors, laisser la foule s’en repaître les yeux.
Lentement, implacablement, la petite place fut donc déblayée par les soldats. Les badauds sanguinaires durent se retirer. Bientôt, dans le cercle vide que dessinaient les soldats rangés en piquet d’honneur, on ne distinguait plus, s’agitant à la lueur des lanternes que commençait à jaunir le jour naissant, que quatre hommes, Deibler et les trois valets de guillotine, quatre hommes qui s’affairaient à descendre du fourgon vert les caisses numérotées où reposaient les montants de la machine.
Fantômas, vite lassé par le spectacle des évolutions de la cavalerie dispersant les curieux, considéra alors le travail même du bourreau. En bras de chemise, car il avait dû retirer sa redingote, négligemment jetée sur le siège d’un des fourgons, M. de Paris, à gestes précis et méticuleux, dirigeait les aides. Et, bien qu’il fût assez distant, Fantômas entendant par moments les éclats de sa voix, une voix qui semblait étrange, tant elle paraissait calme et qui ordonnait :
– Prenez donc garde. Vous voyez bien que ce montant est mal fixé. Et puis, dépêchez-vous, nous allons être en retard.
Un coupé de maître arrivait, suivi d’une Victoria, suivi de voitures de louage plus modestes, mais toutes ayant des allures officielles. De graves personnages, en tenue de cérémonie, mirent pied à terre, et leurs traits tirés, leurs mines blafardes confessaient l’émotion qu’ils éprouvaient, les uns et les autres, à se rencontrer à pareille heure et pour cette besogne.
La foule, qui, repoussée par les soldats, était revenue, avait grimpé sur les toits voisins, escaladé les arbres, franchi des clôtures, envahi les maisons riveraines, saluait l’arrivée des voitures d’exclamations satisfaites :
– Le procureur. Tiens, voilà l’aumônier.
– Vous reconnaissez l’avocat ? Le juge d’instruction ?
– Celui-là, c’est un journaliste.
Fantômas hochait la tête, devenu un peu pâle :
– Mon Dieu, songeait-il, maintenant malgré lui étreint d’une secrète anxiété, pourvu que ni Deibler, ni ses aides, n’aient l’idée d’essayer la machine avant d’aller procéder au réveil de ce malheureux Œil-de-Bœuf ? Si jamais ils s’apercevaient que la bascule ne fonctionne pas, tout serait perdu.
Fantômas, lentement, souleva le store qui l’empêchait de voir facilement dans tous ses détails le spectacle sur la place. Or, comme il jetait à nouveau les yeux vers la guillotine, voilà que le bandit se mordit les lèvres, laissa échapper une exclamation de fureur :
– Voilà ce que je craignais. Il est là.
À cet instant, faisant crier le gravier sous les roues, une voiture traversa les lignes de gendarmes, puis les rangs de cavaliers composant le service d’ordre, vint se ranger à quelques pas de la guillotine.
Un homme vêtu de noir, un homme au maintien sévère en descendit, et c’est la vue de ce personnage, qui avait fait blêmir le Maître de l’Effroi.
– Juve, répétait Fantômas. Juve, pourquoi est-il venu ici ? que pense-t-il faire ? Je sais qu’il a tenté, mais vainement d’obtenir du Président de la République la grâce d’Œil-de-Bœuf. Juve ne voudrait pas qu’on le guillotinât ce matin, c’est évident, car il sait qu’Œil-de-Bœuf n’a jamais assassiné l’officier russe. Mais Juve, par devoir, s’il s’aperçoit que la guillotine a été truquée, avertira le bourreau.
Et, dans l’âme de Fantômas, à cet instant, la peur s’installait en maîtresse. Fantômas, en effet, ne pouvait admettre que l’un de ses lieutenants, qu’un de ceux qui l’avaient fidèlement servi, pût être guillotiné. Etrange conscience de ce bandit que n’avait jamais effrayé aucune atrocité et qui tremblait à la pensée de n’avoir pu, lui, le Roi du Crime, lui, le Redoutable, lui, l’Insaisissable, sauver l’un de ses complices.
– Juve est là, se répétait-il, que vient-il faire ?… Juve. C’est ce que je pouvais craindre de plus terrible.
Une pensée, pourtant, calma le bandit.
Juve n’avait pas eu de regard pour la guillotine. Le policier, trop de fois, avait assisté à des exécutions pour éprouver encore la moindre curiosité à l’égard de ce spectacle de sang.
S’il était venu à Quimper, ce n’était pas pour voir tomber la tête d’Œil-de-Bœuf.
Juve, en compagnie du procureur général et du juge d’instruction qui étaient venus lui serrer la main dès sa descente de voiture, faisait le tour du service d’ordre, plongeant des regard curieux dans les rangs de la foule qui se pressait un peu partout.
– Parbleu, songeait Fantômas, Juve se dit qu’au moment où la tête d’Œil-de-Bœuf va tomber, Fantômas ne doit pas être loin. C’est moi qu’il cherche. C’est moi qu’il s’efforce de trouver. C’est moi que Juve voudrait jeter à cette bascule, à ce couperet, à la tombe que l’on creuse en ce moment au cimetière.
Juve, à cet instant, passait au pied de la maison de la mère Kéradeuc. Instinctivement, le policier leva la tête, toisa la façade hostile de la bâtisse. Peut-être son regard s’arrêta-t-il sur le store derrière lequel se tenait Fantômas ? Peut-être un pressentiment le fit-il tressaillir ? Hélas, le policier ne pouvait, au travers de l’étoffe, deviner le bandit en embuscade. Et Fantômas qui, lui, par la déchirure où il collait ses yeux, ne perdait pas un mouvement du policier, se gaussait du policier :
– Cherche bien, Juve, cherche-moi bien, tu ne me tiens pas encore, tu n’es pas encore le triomphateur que tu voudrais être. Fantômas est libre et Fantômas va sauver l’homme que tes pareils s’apprêtent à tuer.
Fantômas était d’ailleurs si dédaigneux de l’enquête, forcément vaine, que tentait en ce moment le Roi des Policiers, qu’il détacha bientôt ses yeux du groupe que formaient Juve et les officiels qui l’accompagnaient, pour regarder encore la guillotine.
Mais, à peine Fantômas eut-il vu la guillotine, presque prête maintenant, qu’il blêmit.
– Mon Dieu, me serais-je donc trompé ? Vais-je donc avoir la douleur… il ne faut pas que cela soit, je ne veux pas que cela soit.
Fantômas tremblait maintenant de tous ses membres, une sueur froide perlait à son front, lui coulait des tempes.
– Il ne faut pas que cela soit. Je ne veux pas qu’on le tue. Je ne veux pas m’être trompé. Une erreur de ma part serait criminelle. Ah, malédiction.
Que venait donc d’apercevoir Fantômas ?
Il lui avait semblé que la machine qu’il avait devant les yeux était plus petite que celle qu’il avait truquée dans le Hangar Rouge. Oui, les bras sanglants étaient moins épais, moins hauts. Oui, le couperet était de dimension plus exiguë. Oui, le bâti même de la guillotine différait par quelques traits essentiels. Et Fantômas, affolé, se demandait :
– Me suis-je donc trompé ? N’ai-je pas truqué la guillotine qui doit servir ce matin ? Était-ce une autre guillotine que celle-ci qui m’a servi à tuer Jean-Marie ?
Et, avec une lucidité effarante, le bandit, qui avait voulu sauver Œil-de-Bœuf, se rappela soudain que Deibler possédait deux guillotines, l’une dont il se servait à Paris, l’autre, de dimensions moindres, qu’il n’utilisait qu’en province, et que c’était la guillotine parisienne que Fantômas avait mise hors d’état. C’était la guillotine des départements qui se dressait lugubre devant lui, à qui, dans quelques minutes, on allait jeter Œil-de-Bœuf, Œil-de-Bœuf, que, désormais, rien ne pouvait plus sauver, qui, devant Fantômas, allait avoir la tête tranchée.
***
Le bandit, derrière le store, était, certes, plus pâle qu’Œil-de-Bœuf, pourtant livide, la chemise échancrée, les cheveux coupés ras, les bras attachés derrière le dos, entre deux gardiens de prison, précédé de l’aumônier, suivi du bourreau et de ses valets.
Il fallait que Fantômas, à cet instant, fit un effort terrible sur lui-même pour ne pas se précipiter sur la place, courir à son lieutenant, l’étreindre, lui demander pardon de sa méprise.
Fantômas se dompta pourtant.
– Il va mourir, se répétait-il. Il va mourir. Nul ne peut le sauver.
Et d’ailleurs, dans le silence angoissé qui soudain pesa aussi bien sur les soldats du service d’ordre que sur la foule juchée partout, s’écrasant dans les ruelles, s’agrippant en grappes aux toits des maisons voisines, le drame se déroula avec l’instantanéité d’un éclair.
La porte de la prison s’était ouverte, Œil-de-Bœuf, le cou instinctivement enfoncé entre les épaules, gardait une attitude de vrai courage. L’aumônier, brusquement, se jeta de côté. Ce mouvement démasquait la guillotine. Œil-de-Bœuf sembla vaciller sur ses jambes, deux aides le prirent sous le bras. On le poussa vers la bascule.
Alors, des lèvres exsangues du misérable qu’on allait tuer, un cri, presque indéchiffrable, s’éleva :
– J’étais innocent. Je n’ai pas tué l’officier russe. Adieu.
Pouvait-il dire plus ?
Deibler, qui marchait derrière le condamné au moment où celui-ci débouchait de la prison, s’était déjà précipité à la droite de la guillotine et, le doigt sur le déclic, il attendait.
Les valets du bourreau alors intervinrent.
L’un d’eux, par les épaules, coucha Œil-de-Bœuf sur la planche de la bascule. Les courroies, que maniait un autre valet, bouclèrent les chevilles, les épaules du malheureux. Un troisième aide se tenait prêt à tirer la tête du condamné par les oreilles afin de l’introduire dans la lunette où, dans quelques secondes, le couperet allait s’abattre avec une foudroyante rapidité.
Et tout cela s’était fait en moins d’une demi-seconde. Et déjà Deibler, visage impassible, pesait sur le levier manœuvrant la bascule.
Fantômas vit distinctement l’effort que faisait le bourreau. Il voyait le geste de Deibler. Il le voyait… et, brusquement, il s’étonnait de le voir.
Des lèvres du bandit, alors, un rauque juron s’échappait :
– Mort de Dieu, mais qu’est ce qu’il se passe ?
Que se passait-il, en effet ?
C’était, autour de la guillotine, en cet instant, un affolement extraordinaire.
Et tandis que, de la foule, aussi bien que des soldats rangés tout autour de la « Veuve », aussi bien que des personnages officiels groupés à quelques pas de l’échafaud, une clameur formidable montait, Fantômas voyait que Deibler, paraissait faire un effort surhumain, s’efforçait vainement de manœuvrer la bascule de la guillotine. La bascule demeurait immuable. Il était impossible de guillotiner Œil-de-Bœuf. En vain les aides se précipitaient-ils. La machine ne fonctionnait pas.
Deux minutes plus tard, sans doute, brusquement le Procureur intervint. On déligota le condamné évanoui. Des hommes le prirent aux épaules. On l’emporta vers la prison, cependant que la foule, rompant les barrages, commençait à envahir la place. Cependant que les commandants du service d’ordre, sabre en main, hurlaient à leurs hommes :
– Chargez. Il ne faut pas que la foule approche des bois de la justice.
***
Au moment où Deibler avait appuyé de toutes ses forces sur le levier commandant le déclic de la guillotine, et qu’il était effaré de le voir résister, Juve, qui se tenait à quelque distance de la machine fatale, s’était élancé en courant vers le bourreau.
Juve était blême, Juve tremblait de tous ses membres.
Et comme l’instant fatal s’éternisait, comme le couperet ne tombait pas, Juve le premier s’était écrié :
– Cela ne peut pas durer. Il faut détacher le condamné. Vous voyez bien que la guillotine est truquée. Il faut télégraphier au Président de la République qu’il fasse grâce.
Le Procureur, qui d’ailleurs perdait la tête, hurlait lui aussi au bourreau :
– Vous voyez bien que la guillotine est cassée. Lâchez le condamné. Qu’on le ramène en prison.
Dans un grand brouhaha, les aides de Deibler, affolés, entraînèrent Œil-de-Bœuf.
Les officiels, sur les traces du condamné, s’engouffrèrent dans la prison, dont les portes ouvertes semblaient happer le cortège de tous ces hommes éperdus.
Seul, Juve demeurait à côté de la guillotine, en compagnie de Deibler, de Deibler, blême lui aussi, pour une fois.
Et Juve encore, fut le premier à comprendre.
Il se précipita d’un mouvement fou vers la guillotine, il s’agenouilla sur les premiers montants des bois de justice, il se penchait sous la bascule, et soudain il hurla :
– Là, là, ah, sacrédié, je m’en doutais. Ce ne peut être que Jean-Marie qui a fait cela. Ah miséricorde.
Et Juve introduisant la main dans le mécanisme commandant le système de bascule en retirait, au risque de se faire broyer les doigts, quelque chose de rouge, quelque chose qui était caché là, quelque chose qui était le portefeuille rouge.
C’était le moment où la populace affolée, hurlante, débordait les barrages, envahissait la petite place.
– Monsieur Juve.
Deibler qui d’abord n’avait rien compris au geste du policier qui, atterré, avait regardé sans voir, cette chose rouge que Juve, une seconde, agitait triomphalement, avait voulu se précipiter sur le détective. Deibler n’avait pas fait deux pas qu’il se heurtait au premier groupe se précipitant vers la machine sinistre et poursuivi par les gendarmes. Le bourreau fut pris dans un remous de foule, bousculé, renversé presque, il ne voyait plus Juve.
Juve avait disparu.
***
– Il faut jouer serré.
Juve, hors d’haleine, ayant couru de toute la vitesse dont il était capable, jusqu’à la gare, se précipita comme un furieux au guichet où l’on délivrait les billets.
– Pas de doute, songeait le policier à cet instant ; Fantômas doit être là. Fantômas doit avoir vu que je m’emparais du portefeuille. Il doit être sur ma piste. Je vais l’avoir à mes trousses dans moins de cinq minutes. Ah, Dieu veuille qu’un train parte tout de suite, parte avant qu’il ait pu me rejoindre. Dieu veuille que je puisse porter jusqu’à Paris ce document, que je puisse le remettre entre les mains du prince Nikita.
Et Juve, cogna au guichet, faisant un vacarme de tous les diables :
– La préposée ? C’est stupide. Il n’y a donc personne. Un billet pour Paris. Un billet de première. Vite.
Les appels du policier, ses hurlements plutôt, avaient fini par secouer l’apathie d’un employé, occupé à lire un journal du lieu.
– Eh bien, quoi ? après ? Vous en avez une manière, de demander un billet. Vous avez bien le temps. Le rapide part que dans une demi-heure.
– Nom de Dieu, donnez-moi un billet. Je ne vous demande pas autre chose.
En possession du ticket, qu’il paya d’un billet de cent francs dont il n’attendit même pas la monnaie, Juve franchit en deux sauts la salle d’attente, pénétra sur le quai.
Le train était là.
Mais une pancarte ironique renseignait le policier : « Départ à 7 h. 30. » Il était 7 h. 5.
– Vingt-cinq minutes à attendre. Je suis fichu. Vingt-cinq minutes. Fantômas va me rattraper.
Juve, une seconde, demeura immobile.
Et soudain, comme il considérait la petite gare, tranquille et déserte, où nul employé ne se montrait – le train n’était pas encore en partance – une idée folle, une idée merveilleuse lui vint à l’esprit. Juve, sans bruit cette fois, s’élança vers la pendule donnant l’heure officielle de la gare.
Monter sur un banc, ouvrir le cadran de cette pendule, avancer l’aiguille de vingt-cinq minutes, fut pour Juve l’affaire d’une seconde.
– Parbleu, songeait le policier, au premier aiguillage, mon train attendra. Mais, au premier aiguillage, nous serons trop loin pour que Fantômas me rejoigne.
Juve sauta à bas du banc, il grimpa dans un wagon ; il n’en avait pas fermé la portière que, déjà, à la cantonade, en digne voyageur qui proteste, Juve se prenait à crier :
– Ah ça, en voilà une compagnie. C’est l’heure de partir, nom d’un chien. On va encore nous faire rater la correspondance.
Et le truc grossier, mais merveilleusement simple, génial d’enfantillage, que Juve venait d’inventer réussit entièrement.
À sa voix, un chef de gare apparut, regarda, ébahi, la pendule, puis se précipita vers la locomotive. Des coups de sifflet. L’apparition d’employés brusquement tirés de leur léthargie et claquant les portières. L’énervement des mécaniciens sautant sur la machine.
Juve voyait tout cela, partagé entre le fou rire et l’anxiété. Et puis, brusquement, à bout d’énergie nerveuse, le policier s’affala sur la banquette.
Le train partait. Juve en était certain, nul n’avait rejoint le convoi. Juve avait dépisté Fantômas. Juve serait à Paris avant le bandit.
29 – JUVE, VOUS ÊTES UN TRAÎTRE
Littéralement abruti, hors de lui, fatigué au point de marcher comme un automate, Juve, dont la main crispée serrait à l’intérieur de sa poche de redingote le portefeuille rouge retrouvé dans les bois de justice, grimpa l’escalier conduisant à son appartement de la rue Bonaparte.
Durant le long voyage de Quimper à Paris, le policier n’avait pas fermé l’œil. Encore que la chose fût invraisemblable, il s’était continuellement méfié d’une arrivée inopinée de Fantômas, d’une tentative du bandit. Tout lui avait été sujet à précaution, il avait tout surveillé.
Et maintenant encore, au moment où il introduisait sa clef dans sa serrure, il était décidé à demeurer debout, à ne point s’accorder une seconde de repos, que quand il aurait remis, de la main à la main, le document qu’enfin il avait rattrapé, à l’envoyé du tsar.
– Morbleu, je dormirais bien, songeait le bon Juve, mais il ne sera pas dit que je succomberai à la fatigue dans les dernières minutes. Il faut que je tienne bon, je tiendrai bon.
Et puis, brusquement, Juve songeait que sa tâche eût été singulièrement simplifiée si à ce moment il avait pu avoir comme compagnie son inséparable ami Fandor, son fils, presque. Mais qu’était devenu Fandor ?
Juve ne le savait pas, Juve ne le savait plus, et même ce n’était pas sans une certaine inquiétude qu’il songeait au journaliste.
Énervé, Juve ouvrit brusquement la porte d’entrée de son appartement, traversa le corridor obscur, sentant un peu le moisi, cette odeur de tous les appartements inhabités depuis quelque temps, et pénétra dans son cabinet.
Or, Juve n’était pas entré dans la pièce, il tenait encore en main le bec-de-cane de la porte, qu’abasourdi, il devait s’arrêter, immobilisé, les yeux dilatés par la surprise, mais non point par la peur car Juve ne connaissait pas ce sentiment.
Juve aurait été peut-être fondé cependant à éprouver à cette minute une vive crainte. Le spectacle qu’il voyait était peu rassurant.
Devant lui, face à la porte par laquelle il entrait, Juve apercevait son bureau, et, derrière son bureau, visiblement ayant fouillé dans ses tiroirs, ayant bouleversé ses papiers, mais maintenant se tenant debout, un revolver à la main, un revolver braqué dans sa direction, un homme : le lieutenant prince Nikita, un homme dont l’attitude était faite de colère et de folie, un homme hors de lui évidemment et qui accueillait le policier par ces mots, prononcés d’une voix que la haine faisait trembler :
– Pas un cri, pas un geste. Je sais que vous êtes un traître. Je vous tuerai sans merci.
Certes, tout autre que Juve, mis à cette minute en face d’un individu en apparence aussi résolu aux pires extrémités que l’était le prince Nikita, eût été affolé.
Juve, lui, ne tressaillit même pas.
– Nom d’un chien, voilà que le lieutenant Nikita est devenu fou, se dit-il simplement.
– Vous permettez que je pose mon chapeau ? demanda tranquillement Juve, qui savait qu’il importe avant tout de ne jamais exciter les déments, de ne pas raisonner avec eux. Je suis très fatigué, cher monsieur et enchanté de vous revoir.
Juve allait continuer à bavarder avec le lieutenant prince, feignant de ne pas s’étonner de sa présence, mais l’officier russe ne lui en laissait pas le loisir. De sa même voix vibrante de rage, il reprenait :
– Ah çà, vous plaisantez. Vous êtes fatigué, monsieur Juve ? Belle affaire. Vous serez moins fatigué dans quelques minutes, vous pourrez vous reposer longtemps, toute l’éternité. Je vais vous tuer.
Juve resta très calme.
– Ce n’est pas gentil, répondait-il, affectant de rire, se gardant du moindre mouvement, et commençant à trouver l’aventure déplaisante. Vous voulez me tuer ? pourquoi donc ?
– Vous êtes un traître !
– Et vous, vous êtes fou.
– Je suis fou, monsieur ? Vraiment ? Ah ça, qui de nous deux est le plus fou ? de vous, qui m’avez trahi et qui revenez benoîtement chez vous, sans vous douter que je vous y guette, que je vous y attends, ou de moi, qui vais me venger de votre trahison, et qui, après, me ferai sauter la cervelle, s’il le faut ?
Juve s’assit.
– Je ne vous comprends pas du tout, déclara-t-il. Vous me parlez tout le temps de trahison. En quoi vous ai-je trahi ?
– En quoi vous m’avez trahi ?… en ceci : vous vous étiez engagé, monsieur Juve, à retrouver le portefeuille rouge. J’étais chargé par mon gouvernement de le rapporter au tsar. Le tsar attendra demain, monsieur, à la frontière, que je vienne lui restituer ce document. Je ne saurais le faire si vous ne me le livrez pas. Or, vous ne me le livrez pas. Le portefeuille rouge que vous deviez me remettre, vous ne l’avez pas retrouvé. Ou vous n’avez pas voulu le retrouver, je n’en sais rien.
« Demain le tsar croira que je n’ai point su me dévouer à sa cause, mais demain je serai mort, je me serai tué de ma propre main. Et vous serez mort aussi, vous, Juve, parce que j’estime que si vous l’aviez voulu, vous auriez le portefeuille et que vous ne l’avez pas.
– Le voici.
Le bras de l’officier, une seconde avant tendu vers Juve, le menaçant d’un revolver, s’abaissa lentement.
Et des lèvres du lieutenant s’échappaient une série de phrases, de phrases sans suite, qui trahissaient le désarroi de sa pensée :
– Je ne le vois pas. Ce n’est pas lui. C’est impossible. Ah mon Dieu.
Dans l’excès de son bonheur, l’envoyé du tsar semblait ne plus même comprendre que c’était bien le portefeuille rouge, le fameux portefeuille rouge qu’il avait là, à portée de sa main, offert à son désir, retrouvé, sauvé, prêt à être remis au tsar.
Le policier en cet instant goûtait l’âpre volupté du triomphe, du triomphe définitif qu’il venait de remporter sur Fantômas, en faisant parvenir à l’envoyé du tsar le portefeuille rouge, ce portefeuille rouge que Fantômas avait voulu ravir, qu’il avait ravi par deux fois, mais que Juve pouvait être fier de lui avoir repris. Juve, toutefois, était trop simple, trop bon aussi pour éterniser l’angoisse du malheureux officier.
Il le voyait devant lui, pâle et tremblant, si ému qu’il ne pouvait articuler une parole. Il en eut pitié.
– Prince Nikita, commençait Juve, remettez-vous donc, tout est bien qui finit bien. Vous avez maintenant le document. Je suis déchargé de ma mission. J’ajouterai à cela un conseil. Ne gardez pas trop longtemps le portefeuille rouge en votre possession, hâtez-vous de le porter au tsar. Ceux qui ont intérêt à s’en emparer ne reculeront devant rien, vous le savez, pour arriver à leurs fins. Vous avez le portefeuille, c’est bien. Quand vous l’aurez remis au tsar, ce sera mieux encore.
– Vous avez raison, monsieur Juve, je suis maintenant, moi aussi, pris d’une hâte extrême de me débarrasser de ce redoutable document. Mais n’ayez crainte, avant de venir vous retrouver, avant la sotte scène que je viens de vous faire et dont je vous demande infiniment pardon, j’avais bien réfléchi. J’ai examiné la manière dont je dois faire tenir ce document au tsar. Je suis assuré que rien n’empêchera l’Empereur, mon maître, d’en prendre connaissance.








