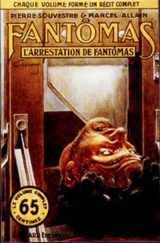
Текст книги "L'Arrestation de Fantômas (Арест Фантомаса)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
– Il est évident, disait Ellis Marshall, qu’il sera dans quelques heures aux environs de la pointe Saint-Mathieu.
Sonia Danidoff approuvait. Ellis Marshall poursuivit :
– C’est là sans doute qu’il faudrait nous rendre, mais comment procéder pour atteindre le navire ?
Sonia Danidoff avait un petit sourire mystérieux :
– Ceci, déclara-t-elle, me regarde et je ferai le nécessaire, soyez-en certain. Tout ce que je vous demande, mon cher Ellis Marshall, c’est de m’amener à cette pointe Saint-Mathieu dans le plus bref délai.
***
Il était dit que les deux agents mystérieux de l’Angleterre et de la Russie ne parviendraient pas à accomplir paisiblement leur voyage.
Après leur conversation au café, Ellis Marshall s’en était allé découvrir un loueur de voitures. C’est en vain qu’il avait cherché à se procurer une auto, il n’avait pu y réussir. En revanche, on lui avait trouvé une voiture attelée, et le cocher assurait qu’il lui fallait deux heures à peine pour se rendre à la pointe Saint-Mathieu.
Après un rapide dîner, Ellis Marshall et Sonia Danidoff avaient pris place dans ce véhicule et on était parti à travers la région aride et montagneuse qui sépare Brest de l’extrémité nord du Finistère.
Le temps avait changé. Aux rafales d’un vent violent succédait une pluie lourde et froide, la brume montait.
Depuis trois heures déjà, ils roulaient, cahotés dans de mauvaises routes lorsque Sonia Danidoff se décida à interroger le conducteur.
– Ah ça, dit-elle, mon ami, où nous conduisez-vous ?
– Mais, madame, à la pointe Saint-Mathieu ?
– Nous devrions y être arrivés depuis une heure déjà. Êtes-vous bien sûr de votre chemin ?
Le brave homme qui pilotait le véhicule courba les épaules et, d’un air confus, avoua :
– Eh bien, pour tout vous dire, monsieur, madame, je sais plus très bien où j’suis. Avec ce brouillard, j’ai dû me tromper de parcours.
Sonia Danidoff et Ellis Marshall, à la lueur falote d’une lanterne, échangèrent un regard mécontent.
Le cocher cependant s’efforçait de leur faire reprendre espoir :
– Je suis, fit-il, sur la mauvaise route et je ne pourrai pas vous conduire à la pointe, sans faire un grand détour, mais si vous êtes pressés d’arriver, prenez donc le petit sentier à droite. Une demi-heure de marche et vous arrivez au pied du phare, dont vous voyez la lueur à travers le brouillard.
Assurément, le brave cocher ne tenait pas à conserver plus longtemps ces étranges clients.
Cependant qu’Ellis Marshall bouillait d’impatience et se demandait ce qu’il convenait de faire.
– Eh bien, dit Sonia, puisqu’on ne veut plus nous conduire en voiture, suivons notre chemin à pied.
La demi-heure de marche annoncée s’allongea d’une seconde demi-heure, puis d’une troisième. Il était à ce moment onze heures du soir et les deux marcheurs acharnés s’arrêtèrent. Ils arrivèrent à la lisière d’un bois, dans un champ labouré, transis par l’humidité, tout maculés de boue. Ils s’étaient irrémédiablement perdus.
La princesse Sonia Danidoff n’avait plus sa belle assurance. Maintenant elle suppliait Ellis Marshall :
– Je vous en prie, mon ami, fit-elle, trouvons un abri quelconque, une chaumière, une cabane, n’importe quoi, je n’en puis plus.
– Et moi, donc, princesse, je suis exténué.
Le baronnet contournait pendant quelques instants la lisière du bois. Soudain, il poussa une exclamation de surprise :
– Princesse, fit-il, une lumière et une maison.
Les deux malheureux piétons, rassemblant leurs dernières forces, s’avancèrent dans la direction indiquée par Ellis Marshall.
Avant de frapper, avant d’essayer de se faire ouvrir, l’un et l’autre jetaient un rapide coup d’œil sur l’extérieur de la maison : une construction importante, comportant un grand corps de bâtiment, des tourelles, des créneaux, de nombreuses fenêtres.
Le bruit de la clochette retentit longuement, se répercutant sous les voûtes lointaines de la demeure en échos prolongés. Puis ce fut un silence, ensuite un bruit de pas furtifs se rapprochant de plus en plus.
Une voix interrogea :
– Qui va là. Qui êtes-vous ?
– Nous sommes égarés dans la nuit. Nous cherchons du secours. Ouvrez-nous, pour l’amour de Dieu.
L’ombre qui avait interrogé s’était reculée. On entendit des chuchotements à l’intérieur de la maison. Allait-on leur venir en aide ?
Enfin, la porte s’ouvrit. Une petite bonne en costume breton apparut. Elle s’effaça pour laisser entrer les deux voyageurs. Ceux-ci se trouvèrent dans une salle basse, tout en pierre. À peine y pénétraient-ils, qu’ils voyaient tout au fond de la pièce se profiler la carrure énorme d’un robuste gaillard qui s’éclipsa aussitôt.
Mais ils avaient eu à peine le temps de s’apercevoir de la présence de ce personnage, qu’une portière se soulevait. Une dame apparut courbée par l’âge. Elle avait sur le front, descendant très bas, deux lourds bandeaux de cheveux d’une blancheur éblouissante. Elle appuyait sur une canne son corps affaibli, mais, malgré les années, elle avait une voix douce et harmonieuse et un visage aux traits délicats.
Elle s’inclina devant les nouveaux venus qui s’empressaient respectueusement auprès d’elle, s’excusant de leur intrusion et se nommant l’un l’autre.
– Princesse Sonia Danidoff. Ellis Marshall.
– Soyez les bienvenus dans ce pays lointain, par cette mauvaise nuit. Vous êtes ici au manoir de Kergollen. Je vais vous faire préparer quelque chose de chaud, entrez donc dans la salle à manger.
Sonia Danidoff se confondit en remerciements, cependant qu’Ellis Marshall, toujours convaincu qu’on ne s’acquiert la complaisance des gens qu’en flattant leur cupidité, glissait un louis d’or dans la main de la petite bonne bretonne, stupéfaite.
– C’est à la châtelaine du manoir de Kergollen, interrogea Sonia Danidoff, toujours très femme du monde, que j’ai l’honneur de parler ?
– Je m’appelle dame Brigitte. Vous êtes en effet, ici, chez moi.
Installés devant un grand feu, Sonia Danidoff et Ellis Marshall, de plus en plus confondus de l’amabilité avec laquelle on les recevait, s’étaient à peu près séchés.
– Nous nous sommes perdus, expliquait Sonia Danidoff, alors que nous nous croyions tout près de la pointe Sainte-Mathieu.
– La pointe Saint-Mathieu ? s’écria la vieille dame, mais vous en êtes à trois cents mètres à peine. Que voulez-vous donc y faire à cette heure de la nuit ?…
– Mon Dieu, madame, dit Marshall, si étrange que cela puisse vous paraître, nous tenions à nous assurer du passage à proximité de cette pointe d’un navire que nous attendons.
– Vous attendez un navire à la pointe Saint-Mathieu ? et pour quoi faire mon Dieu ?
– C’est un navire de guerre, madame, un navire de mon pays, un cuirassé russe qui remonte du sud et se dirige vers la Baltique. Nous avions des raisons d’État pour nous efforcer de l’apercevoir…
Dame Brigitte parut émue.
– Le nom de ce navire ? balbutia-t-elle.
– Le Skobeleff.
Dame Brigitte ne répondait pas, mais elle se leva précipitamment, quitta le voisinage de la grande cheminée devant laquelle elle était assise, trottina jusqu’à une fenêtre, l’ouvrit toute grande, en poussait les volets. Un nuage de brouillard pénétrait dans la pièce, mais la vieille châtelaine du manoir de Kergollen ne paraissait pas s’en apercevoir. Elle appela M. Ellis Marshall et avec précipitation, comme si elle eût été désireuse de changer le thème de la conversation, elle déclara :
– Je vous disais que la pointe Saint-Mathieu était à trois cents mètres d’ici. Oui, le manoir de Kergollen est construit au sommet de la falaise. D’ailleurs, poursuivait-elle, prêtez un instant l’oreille, et vous entendrez le bruit de la mer qui se brise sur les récifs de la pointe.
À cette clameur immense des flots semblait s’en mêler une autre, plus étrange encore, plus vague. C’était comme des voix, des plaintes et des cris, des grognements qui retentissaient, nets et précis, par intervalles irréguliers. On croyait percevoir aussi un son de cloches et par moments la sirène d’un navire.
– Fichu temps, dit Ellis Marshall, pour dissimuler le léger trouble qu’il éprouvait.
Mais la vieille dame, d’une main tremblante, lui imposa silence :
– Écoutez, écoutez encore.
– Le Skobeleff, murmura enfin Sonia Danidoff, n’est-ce pas le bruit d’une sirène ? d’un navire en détresse que nous entendons ?
La princesse russe avait à peine prononcé ces mots, que la vieille dame joignait les mains, puis soudain, elle rentra dans la pièce et elle appela :
– Jean-Marie.
Au bout de quelques instants, un pas lourd de sabots se fit entendre sur les dalles de pierre, la porte donnant dans la salle à manger s’ouvrit, un homme apparut.
C’était un gaillard solide, à la barbe hirsute, aux yeux noirs, étincelants, dissimulés sous des sourcils touffus et trop longs.
– Jean-Marie, demanda la vieille dame, quels sont ces bruits sur la côte ?
– Ça doit être un navire qui ne reconnaît pas sa route ; le phare n’éclaire pas cette nuit.
La vieille dame parut alarmée :
– Jean-Marie, fit-elle, j’ai peur. Ne quittez pas la maison, vérifiez bien les fermetures.
L’homme hocha la tête affirmativement, puis quelques instants après, il se retirait sans mot dire.
La petite bonne, à son tour, fit sa réapparition. Elle annonça que les chambres étaient prêtes, que ce monsieur et cette dame pouvaient gagner leurs appartements.
***
Jean-Marie cependant, une fois dame Brigitte remontée dans son appartement, avait recouvert de cendres le feu qui brûlait dans le foyer de la grande cheminée de la salle à manger, puis il avait éteint les lampes du vestibule.
D’un ton bourru, il avait ordonné à la petite bonne de regagner sa chambre. Alors, le colosse resta seul au rez-de-chaussée. Pour faire croire qu’il accomplissait soigneusement la besogne dont il avait été chargé, Jean-Marie fit tourner pênes et clés. Mais, à un moment donné, alors qu’il vérifiait une petite porte, au lieu de la clore de l’intérieur, il sortit de la maison et tourna la clef du dehors.
Dehors, Jean-Marie fonça dans la nuit noire, en direction de la falaise.
Au bout de vingt minutes, il s’arrêta net. Il était à proximité d’une roche qui surmontait la falaise ; il entendait un murmure confus de voix :
– Qui va là ? cria quelqu’un.
Jean-Marie répondit :
– C’est moi l’Équarisseur…
À peine avait-il donné ce nom étrange, que deux ou trois hommes surgissaient de derrière les rochers et s’approchèrent de lui :
– Alors, fit l’un d’eux, ça colle, mon poteau, tu as pu te débiner ?
– Et comment ! répliqua Jean-Marie, dont l’attitude et l’aspect devenaient tout autre, j’étais assez curieux de savoir ce que tu pouvais venir faire ici, mon vieux Bedeau avec toute la bande.
– C’est vrai qu’on est au complet. Montrez vos blairs, vous autres, ayez donc pas la trouille, c’est l’copain Jean-Marie, c’est l’Équarisseur qui vient de s’amener. Faut croire qu’il nous sera utile, c’est un gars du patelin, il doit connaître le nouveau métier que nous allons faire. Et toi, d’abord, sa payse, va-t’en lui donner un bécot.
Le Bedeau, qui paraissait être le chef de cette bande étrange, adressait ces dernières paroles à une fille très brune, au regard farouche, à l’allure décidée.
C’était une jeune pierreuse qui, depuis six mois seulement, fréquentait cette bande d’apaches à Paris. Elle avait été ramenée là et débauchée par Jean-Marie, c’était une fille d’Ouessant, qui répondait au sobriquet de « Fleur de Rogue ». Elle eut un regard singulier, dont on ne pouvait préciser la nature, s’approcha lentement, souple et lascive, de Jean-Marie, lui noua ses bras bronzés autour du cou et se laissa étreindre.
Mais Jean-Marie, dernier venu ce soir-là, avait encore d’autres politesses à faire. Il salua rapidement d’une poignée de main un grand diable efflanqué :
– Comment, Œil-de-Bœuf, tu en es aussi ? Tu n’as donc plus les foies tricolores ?
– Bon sang grommela l’individu, répondant à ce pittoresque sobriquet, je les ai jamais eus comme tu dis, les foies, mais il y aurait de quoi ma parole, dans ce sacré pays de malheur, ousqu’il n’y a seulement pas un bistro d’ouvert.
– Un bistro d’ouvert, voilà, s’écria d’une voix aigre une grosse femme à la face enluminée.
C’était la mère Toulouche, libérée le mois précédent, qui était aussitôt rentrée dans la bande et plus serviable que jamais, s’en était constituée la cantinière.
La mère Toulouche tendit alors à Œil-de-Bœuf une petite gourde remplie d’alcool, sur laquelle l’apache se précipita.
Cependant, il s’arrêta, Œil-de-Bœuf connaissait les usages, savait qu’il lui restait une présentation à faire :
– Écoute voir, Jean-Marie, disait-il, voilà au moins une saison qu’on ne t’a pas vu, que je te présente ma famille.
Œil-de-Bœuf empoigna par l’épaule une petite blonde, frêle et menue, sordidement vêtue, qui esquissait en regardant l’équarrisseur une vilaine grimace.
Œil-de-Bœuf, d’un coup de pied dans les reins la redressa. Il la lançait à Jean-Marie :
– Voilà ma nouvelle femme, c’est Loulou Planche-à-Pain, et comme tu vois elle n’a pas volé son surnom.
Le Bedeau, cependant, avait attiré Jean-Marie à l’écart :
– Alors, ça t’épate, fit-il, de nous voir par ici. Tu y es bien toi-même.
– Moi, déclara Jean-Marie, je suis domestique dans un château, et puis tu sais bien qu’après ma dernière affaire il valait mieux que je quitte un peu Paris. Mais vous autres ?
– Nous autres, déclara le Bedeau, on a reçu des ordres.
– Des ordres, de qui ?
– Des ordres de quelqu’un, faut croire, et de quelqu’un de bien, il y avait du pèze à la clef. On nous a dit de venir une douzaine de costauds jusqu’ici en s’amenant par le grand frère, séparément ou par couple ne dépassant pas deux, histoire de ne pas se faire remarquer. Paraît qu’on n’a plus qu’à attendre maintenant, que c’est pour cette nuit.
– Mais quoi donc ? fit Jean-Marie.
– Mon pauvre Équarisseur, fit le Bedeau, d’un ton de commisération profonde, on voit que ça t’abrutit de faire le larbin à la campagne, tu es plus innocent que l’enfant qui vient de naître. Si l’on est ici sur la côte, il faut croire qu’on va avoir du turbin dans ce voisinage. On m’a expliqué comme ça tout à l’heure qu’il y a un certain navire dont on entend gueuler la sirène, qui va venir se foutre le nez dans les cailloux, juste en dessous de nous, alors on va pouvoir s’occuper, paraît qu’il y en a pour de l’argent dans ce machin-là. Enfin si tu comprends tant mieux, et si tu comprends pas, tant pis. Toujours est-il que nous autres on se contente d’obéir, il y en a d’autres dont c’est le métier, qui s’occupent un peu plus loin de faire tromper de route à la coquille de noix en baladant des lanternes au bout de leurs bâtons sur la falaise ; ceux-là, c’est des spécialistes de par ici qui avaient certainement le mot d’ordre, quand on est arrivés, ils nous ont reconnus sans qu’on se connaisse. On les laisse donc faire, on se contente, nous autres, de jouer à cache-cache avec les douaniers, rapport à ce que ces gars-là sont curieux et qu’ils ont toujours de la mitraille dans la culasse de leur flingot.
Jean-Marie approuva, il comprenait vaguement ce qui avait dû se passer.
Un chef, un chef de bande quelconque, un de ces chefs mystérieux, comme il en est, qui donnent des ordres, qui paient, et que l’on voit rarement, avait fait venir la Bande du Bedeau à la pointe Saint-Mathieu, pour prêter main-forte à une de ces cohortes de naufrageurs qui, quoi qu’on dise, sont encore très fréquentes et merveilleusement organisées sur les côtes inhospitalières de la Bretagne.
Jean-Marie, breton d’origine, les connaissait, ces bandes, il savait comment elles procédaient.
Et le sinistre équarisseur se réjouissait à l’idée que dans quelques instants peut-être, il allait pouvoir s’occuper, s’occuper à une besogne sanguinaire, dont son imagination bestiale et cruelle goûtait à l’avance l’âpre volupté.
5 – DÉFI POUR DÉFI
Dans l’infirmerie du Skobeleff, la sœur préposée à la garde des malades du cuirassé, s’affairait, douce et patiente, auprès des deux lits de repos dressés au centre même de la pièce.
– Petit père, disait la brave femme, il faut que tu boives cela. Ne refuse pas, tu me ferais de la peine.
– Mais je ne suis pas malade du tout, que diable.
– Si, si. Tu es fatigué, et après l’effroyable aventure que tu as vécue ce matin, il importe, je t’assure, que tu fasses attention. Tiens, bois. Qu’est-ce que cela te fait, petit père. C’est du rhum et du tilleul.
– Oui, un drôle de mélange.
– Quelque chose qui te fera fort et solide, petit père. D’ailleurs, regarde, tu aurais tort de refuser ce breuvage : ton ami en a pris et tu vois que maintenant il repose très calme et parfaitement bien portant. Plus pieux que toi, sais-tu, petit père ? Il n’a pas refusé de saluer les Saintes Images.
Juve, car c’était Juve auquel la bonne infirmière du Skobeleffadressait ces puissantes exhortations, se souleva sur sa couchette, se pencha, regarda dans la direction que lui indiquait l’infirmière.
Celle-ci n’avait pas menti.
Docilement, Fandor avait absorbé la boisson capiteuse qu’on avait préparée à son intention.
Et maintenant, bien tranquille, étendu de tout son long sur le lit de repos sur lequel il avait été déposé, Fandor dormait avec un grand calme.
Le matin même, Juve et Fandor avaient été miraculeusement repêchés par le Skobeleff, et cela grâce à la manœuvre ordonnée par l’officier de quart, puis par le lieutenant Alexis, alors qu’accrochés à leur épave, ils couraient grand risque de se noyer, de trouver dans les flots tourbillonnants du raz de Sein une mort cruelle.
Depuis, ni l’un ni l’autre n’avaient échangé une parole et Juve devait s’avouer qu’il n’avait plus, somme toute, qu’une idée confuse de la façon dont le sauvetage s’était effectué.
Il n’en éprouvait d’ailleurs qu’une sensation plus pénétrante de calme et de paix à s’éveiller dans la tranquille infirmerie, en cette petite pièce, toute blanche, toute silencieuse, où flottaient de vagues relents de potions et de remèdes et qui semblait un véritable asile.
Quelle que fût cependant sa fatigue, quel que fût l’état d’épuisement où il se trouvait, Juve était bien trop énergique pour se laisser longtemps aller au besoin de somnolence qui l’engourdissait. Aussi, aux injonctions de l’infirmière, le policier qui, brusquement, dans un éveil de sa mémoire venait de songer à Fantômas, se contentait-il de répondre :
– Ma sœur, vous êtes infiniment bonne, mais je vous assure que maintenant, je suis parfaitement rétabli. Je veux bien boire votre potion, mais je ne veux pas dormir.
– Bois toujours, petit père, et on verra.
Des mains de l’infirmière, Juve prenait donc le grand bol fumant, le punch d’un nouveau genre, que la religieuse avait préparé.
Juve but avidement, puis, tout ragaillardi par l’absorption de cette liqueur, s’assit sur la couchette.
– Ma sœur, déclarait le policier, je vous assure qu’il faut m’autoriser à me lever.
Et avant que la religieuse, qui s’effarait des intentions de ce rescapé récalcitrant, eût pu s’opposer à ses désirs, Juve appelait d’une voix forte, bien timbrée :
– Fandor, veux-tu te réveiller, paresseux.
Fandor, à vrai dire, dormait tout son saoul.
Mais le journaliste était trop habitué à toujours se tenir prêt aux pires éventualités pour ne pas, même en dormant de toute son âme, garder le sentiment de ce qui se préparait.
À l’appel de Juve, Fandor brusquement se dressa sur son lit et d’une voix comique, encore tout empâtée de sommeil, répondit :
– Présent, Juve. Bon Dieu, je dormais bien… Que diable voulez-vous ? Ah oui, voilà.
Juve, pour toute réponse, éclata de rire. Et c’était la bonne sœur qui intervint :
– Petit père, cria-t-elle, veux-tu bien laisser dormir en paix ton ami.
Mais elle devait elle-même rester interdite car Fandor éclata lui-même d’un grand fou rire.
– Petit père, répéta le journaliste. Ma foi, Juve, cela vous va très bien.
Puis, comprenant ce qu’avait d’irrespectueux son intempestive gaieté à l’endroit de la garde-malade, Fandor s’efforça de rattraper son sérieux…
– Ma sœur, déclarait le journaliste, d’une voix qu’il voulait raffermir, ne m’en veuillez pas de rire un peu : je ne suis point méchant, mais je ne puis jamais être sérieux plus de dix minutes de suite.
Et comme la religieuse hochait la tête, souriante, Fandor ajoutait pour Juve :
– Ah ça, mon bon ami, mais savez-vous qu’à bord du Skobeleffon nous a parfaitement recueillis tous les deux et que pour deux noyés volontaires, nous apparaissons, somme toute, maintenant, en excellente santé.
– Hum.
Et le policier allait ajouter quelques phrases sceptiques, lorsque soudain, la porte de l’infirmerie s’ouvrit : un officier, le médecin-chef, faisait son apparition :
– Eh bien, mes gaillards, demanda-t-il, vous voilà rétablis, je pense ?
D’un geste spontané, Juve tendit la main au praticien.
– Docteur, répondait-il, croyez bien que sœur Natacha et vous-même, vous avez fait un miracle. Mon ami et moi, nous voici sur pieds.
– Complètement ? pas de malaise ? pas de fièvre ?
– Mais non, docteur, répondit Fandor. Nous sommes même si bien portants que nous étions en train d’exiger notre bulletin de sortie.
– Mon bon ami, vous allez vite en besogne. Voyons d’abord votre pouls ?
Juve laissa le docteur tranquillement ausculter Fandor, et se prêta lui-même à l’examen médical. Mais comme l’homme de l’art gardait un bon sourire, il demanda :
– Vous nous autorisez à nous lever, docteur ?
Le médecin venait de remettre sa montre dans le gousset de son gilet, il hocha la tête :
– Parfaitement ! faisait-il, levez-vous, mes bons amis, il n’y aura d’autre suite à votre aventure que la perte de votre jolie embarcation. Mais, aussi, quelle drôle d’idée avez-vous eue d’aller vous promener par le raz de Sein ? Dès que vous serez prêts, sœur Natacha vous conduira sur le pont, vous trouverez à l’escalier de la coupée un planton qui vous conduira vers notre Commandant, notre nouveau Commandant, qui désire vous parler.
Le médecin cependant, après un cordial salut à la sœur Natacha, venait de quitter l’infirmerie.
– Debout, Juve.
– Debout Fandor.
Les deux amis en un clin d’œil se jetèrent à bas de leur couchette.
Mais comme Juve passait sa veste et machinalement tâtait sa poche, il étouffait un juron :
– Bigre de nom…
Sœur Natacha accourut.
– Ah ! petit père, déclarait la bonne religieuse, tu t’étonnes de ne point retrouver tout ce que tu avais dans tes poches ? Ne te fâche pas ! vois-tu, on te rendra tes armes quand tu quitteras le Skobeleff, à notre prochaine escale, mais, ici, l’ordre est formel : j’ai dû faire porter ton revolver, ainsi que celui de ton ami à notre capitaine d’armes.
Il n’y avait rien à dire. Juve fronça les sourcils.
***
Sous la conduite de sœur Natacha, ainsi qu’il avait été convenu, Juve et Fandor au sortir de l’infirmerie avaient suivi un étroit petit couloir, puis étaient arrivés en une sorte de vestibule où débouchait un tortueux escalier menant sur le pont.
Avec un bon sourire, sœur Natacha les quitta alors, en bas des marches :
– Montez, disait l’excellente religieuse, et Dieu vous garde, petits pères. Je ne vous oublierai point dans mes prières aux Saintes Images. Pour vous, souvenez-vous quelquefois de sœur Natacha qui fut heureuse de vous soigner. Montez donc, mes petits pères, les règlements du bord m’interdisent à moi, pauvre femme, de paraître sur le pont, mais vous trouverez en haut de ces degrés un planton qui vous conduira à notre Commandant.
Que répondre ?
– Ma sœur, disait le policier, fouillant dans son portefeuille et en tirant un billet de banque, vous avez bien, quelque part, un pauvre malade à qui vous vous intéressez ? Voilà de quoi améliorer son sort.
Et Fandor avait ajouté :
– Mais ne croyez pas, ma sœur, que nous pensions, avec un peu d’argent, payer vos soins. Vous saurez peut-être, quelque jour, que les deux pauvres diables que vous avez aidés sont de braves gens. Si vous ne les oubliez pas, ils ne vous oublieront pas eux non plus.
L’escalier qui menait au pont était long et étroit. Juve marchant devant, Fandor suivant le policier, le gravirent pourtant en moins d’une minute, car il leur prenait une hâte extrême de se trouver en face du commandant du Skobeleff.
Qu’allait-il se passer ?
Fantômas les avait-il reconnus alors qu’on les repêchait ?
À mi-chemin, Juve s’arrêta et regardant Fandor :
– Mon petit, déclara froidement le policier, tu comprends bien, j’imagine, l’importance de la partie que nous allons jouer ? nous n’avons aucune arme. Matériellement, nous sommes dans ses mains. Moralement, nous sommes en son pouvoir. S’il lui fait plaisir de nous envoyer par-dessus le bastingage piquer une tête dans l’Océan, rien ne peut s’opposer à l’accomplissement de sa fantaisie. Par conséquent…
– Par conséquent, conclut le journaliste, en poussant doucement le policier qui s’était retourné vers lui, par conséquent ne perdons pas de temps !
Juve tendit sa main à Fandor. Puis Juve haussa les épaules :
– Allons, Fandor.
– Allons.
Ils trouvèrent un fusilier-marin au débouché de l’escalier.
Fandor et Juve suivirent leur guide, sans mot dire, et fort occupés à résister aux surprises du roulis et du tangage. Ils passèrent sur cette partie du pont que l’on appelle « la plage », encombrée d’engins formidables, de canons aux culasses reluisantes, aux mécanismes complexes, de mitrailleuses, à peine reconnaissables sous les housses de toile épaisse qui les garantissaient des intempéries. Ils arrivèrent enfin :
– Entrez, petits pères.
Le brave matelot qui, sans doute, ne connaissait que quelques mots de français, car si tous les Russes de haute condition tiennent à honneur de parler couramment notre langue, il n’en est pas de même chez le peuple, venait de pousser une porte toute ceinturée d’épaisses barres de cuivre, garnie d’un robuste vitrage dépoli, qui donnait accès dans une sorte de petit salon attenant à la cabine du Commandant. Juve et Fandor entrèrent. Fantômas allait-il paraître ? Juve et Fandor entendirent la voix du bandit. Il murmura quelque chose d’incompréhensible, peut-être un mot russe, le fusilier entrouvrit la porte à laquelle il venait de frapper, puis il s’effaça, il répéta, regardant Juve et Fandor :
– Entrez.
Et les deux amis pénétrèrent dans la cabine où se trouvait Fantômas.
C’était une pièce, petite, mais confortablement meublée, toute garnie de tapis et de tentures. Au fond se trouvait un lit de dimensions exiguës, devant lui, une table-bureau surchargée de papiers. Les chaises étaient fixées au sol. Un jour timide et blême pénétrait par des hublots s’ouvrant sur le pont.
Pas plus que Fandor, toutefois, le policier ne s’attardait à regarder les détails de l’installation de la cabine du Commandant du Skobeleff. Au premier coup d’œil, en effet, Juve avait aperçu, assis derrière le bureau, le monstrueux criminel, celui qui se donnait pour le commandant du Skobeleff, Fantômas.
Juve, très à son aise, avec un léger signe de tête, tranquillement, salua en disant :
– Bonjour.
Fantômas, ne sourcilla pas.
Si Juve était à son aise, le bandit ne paraissait nullement troublé : imitant la voix de Juve, plagiant son intonation, il riposta :
– Bonjours, Juve. Bonjour, Fandor. Vous allez bien ? Oui ? Vraiment ? Allons, tant mieux.
Puis, jugeant sans doute qu’il avait sacrifié suffisamment à l’ironie, brusquement, avec cet art de parfait comédien qui faisait une grande partie de sa force, Fantômas changea de ton :
– Ah ça, demanda-t-il, d’une voix qui était devenue brève et impérative, j’imagine que vous allez me fournir une explication ?
Mais jamais Fantômas ne devait surprendre Juve. À sa phrase qui était presque une menace, Juve haussa les épaules.
– Nous fournirez-vous des justifications, vous, Fantômas ?
– Des justifications, Juve ? à quoi ? Que voulez-vous savoir ?
Fantômas éclata de rire : puis il ajouta :
– Sans doute vous prétendez que je vous livre mon but ? Le plan que je poursuis ? Vous êtes monté à bord du Skobeleffpour apprendre où Fantômas menait le Skobeleff ? C’est cela ?
– Nous sommes montés, répondit-il, parce que la malchance nous a fait naufrager devant votre bâtiment.
Là encore, Fantômas éclata de rire :
– Allons donc, vous plaisantez. C’est enfantin.
Et changeant encore une fois de ton, devenant insinuant, Fantômas reprit :
– Juve, jadis, nous avons eu à lutter ensemble, à lutter, mon Dieu, la chose fut amusante, contre les Autorités. Vous rappelez-vous les aventures de Tom Bob ?
– Certes, mais où voulez-vous en venir ?
– Vous allez le savoir. À ce moment, Juve, je me souviens fort bien que nous jouâmes certaine partie de cartes intéressante au plus haut point. Je vois à votre air que vous ne l’avez pas oubliée non plus ? Mais vous rappelez-vous tout spécialement mon cher Juve, la façon dont nous jouâmes cette partie ?
– Je ne vous comprends pas.
– Eh bien, vous allez me comprendre : Nous jouâmes, alors, cartes sur table. Voulez-vous que nous recommencions à jouer ainsi ?
Il fallait en vérité que Fantômas eût une belle impudence pour oser parler sur ce ton à Juve.
Ce n’était pas, toutefois, le moment de discuter avec lui, d’user de formalisme.
Juve, brusquement, se leva :
– Soit, déclara le policier, cartes sur table. Jouons franc jeu, Fantômas. Dites-moi quel but vous poursuivez, dites-moi ce que vous comptez faire, je vous dirai ce que je vais tenter.
Mais pour toute réponse, nouvel éclat de rire de Fantômas.
– Franchement, déclara le bandit, votre ami, monsieur Fandor, est déconcertant. Cartes sur table me dit-il, mais quelles cartes a-t-il donc dans la main à retourner contre moi ? Juve, vous me dites : « Confessez-moi votre but, je vous confesserai le mien. » Quel but pouvez-vous avoir, mon bon Juve ? Vous voici à bord du Skobeleffet c’est superbe à vous d’être parvenu à embarquer de force à mon bord, car, je n’ai pu empêcher votre sauvetage, c’est entendu, mais, maintenant, que pouvez-vous contre moi ? Pensez-vous me démasquer ? Non, n’est-il pas vrai ? Vous ne pouvez tenter un pareil scandale, vous n’avez aucune preuve, on vous croirait fou, le médecin de ce bord serait le premier à appuyer l’ordre d’une mise aux fers que je ne manquerais pas de donner. Alors ?
– Donc, vous estimez, Fantômas, que je ne puis rien contre vous ? Parfait. Mais que pouvez-vous vous contre Fandor et moi ? Pouvez-vous donner un ordre quelconque qui nous porte préjudice ? Vous le savez aussi bien que moi, cela vous est impossible. Nous sommes des naufragés, des rescapés. Aux termes des règlements maritimes vous devez, vous, Fantômas, au premier navire que nous croiserons, à la première escale que vous ferez, nous débarquer. Par conséquent…








