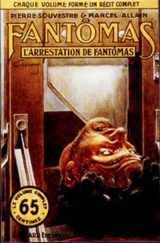
Текст книги "L'Arrestation de Fantômas (Арест Фантомаса)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
– Vous allez rester ici m’attendre pendant dix bonnes minutes, après quoi vous serez libre de vous en aller.
Le voyageur, alors, entra sous la voûte, traversa la cour intérieure de la maison, s’introduisit dans un petit couloir et comme quelqu’un qui est fort au courant de la disposition des lieux, il ne tardait pas à gagner la cour intérieure d’une maison mitoyenne dont la façade donnait sur la rue Notre-Dame-des-Victoires.
Sous la voûte de cette deuxième maison, dans laquelle personne ne se trouvait, le voyageur à la valise profita de sa solitude pour, d’un geste brusque et certainement inattendu, arracher la barbe qui encadrait son visage ; et les traits d’un homme glabre alors apparurent, au visage énergique.
Ce voyageur n’était autre que Juve.
Si le policier prenait de telles précautions pour dissimuler son itinéraire, c’est qu’il redoutait évidemment d’être suivi, filé et peut-être même attaqué.
Juve, lorsque la veille au soir, il avait quitté Fandor à la gare de Morlaix pour prendre l’express de Paris, s’était bien gardé de fermer l’œil pendant toute la nuit. Il avait ses raisons pour redouter une agression, si audacieuse fût-elle, dans le cas, vraisemblable d’ailleurs, où Fantômas aurait suivi sa trace.
Le policier savait qu’il fallait s’attendre à tout de la part du bandit.
Et, s’il avait agi avec une semblable prudence, se faisant conduire rue de la Banque, à un immeuble qu’il connaissait pour avoir deux issues, s’il avait dit au mécanicien du taxi de l’attendre dix minutes pour faire croire à son poursuivant éventuel qu’il allait revenir, c’était afin de couper la filature que peut-être Fantômas avait organisée autour de lui.
Sans perdre une minute, Juve fit signe à une voiture de place qui descendait la rue Notre-Dame-des-Victoires et, s’étant assuré d’un rapide coup d’œil circulaire que nul cette fois n’était à ses trousses, il donna sa véritable adresse au cocher et décida enfin de se faire conduire à son domicile, rue Bonaparte.
Dix minutes plus tard, Juve arrivait chez lui sans encombre.
Certes, il y avait eu des changements chez Juve et encore que l’on n’eût guère renouvelé le mobilier depuis que le célèbre inspecteur s’était installé rue Bonaparte, au moment où il commençait à se faire une situation à la Préfecture de Police, le personnel, lui, avait changé.
Et c’est ainsi que Juve, lorsqu’il rentrait, ne trouvait plus dans son appartement la vieille silhouette familière de son domestique Jean, mort depuis quelques mois, mais bien la silhouette plus grave et un peu solennelle de son nouveau serviteur, brave homme ventripotent et chauve, un certain Joseph, ancien huissier de la Préfecture de Police que Juve avait pris à son service au lendemain du jour où ce fonctionnaire avait été mis à la retraite.
Juve pouvait entrer, dans son appartement, entre sept heures du matin et huit heures du soir, il était à peu près certain de découvrir dans un angle obscur de l’appartement, le fameux Joseph, immobile, la main sur la crosse de son revolver, qui attendait les événements. Joseph, en outre, était muet comme la tombe et lorsqu’il avait proféré :
– Salut, chef, ou : Au revoir, chef, il n’aurait pas annoncé le moindre événement, quelle que fût son importance, avant qu’on ne l’eût prié de parler.
Juve, en rentrant chez lui, avait donné son bagage à défaire à son domestique puis, il se fit préparer un bain, et en se déshabillant, le policier posait quelques questions à son serviteur :
– Il n’est venu personne, Joseph ?
– Si, chef. L’homme du gaz. J’ai payé la note.
– Pas de courrier ? Pas de communications téléphoniques ?
– Pardon, chef, quelqu’un a téléphoné ce matin qu’il viendrait vous voir vers les onze heures.
– Quelle est cette personne ?
– Elle ne s’est pas nommée.
Quelques instant après, Juve s’allongeait dans sa baignoire, éprouvait un bien-être extrême à la douce caresse de l’eau tiède. Peu à peu, il sentit une torpeur exquise, un délicieux engourdissement l’envahir lentement.
Juve, alors qu’il prenait son bain, aurait vu surgir Fantômas, qu’il n’aurait pas été autrement étonné. N’avait-il pas eu jadis, l’occasion de se trouver dans la pièce toute voisine de sa salle de bain, dans son cabinet de travail, en tête à tête avec le bandit, alors que Juve tout en soupçonnant ce visiteur, était à cent lieues de se douter, qu’il avait en sa présence et à sa merci l’insaisissable Roi du Crime.
C’est qu’alors, en effet, Juve ignorait l’extraordinaire faculté de transformations, que possédait Fantômas, et qui lui permettait de se déguiser si habilement que les plus avertis s’y trompaient.
C’était là aussi, dans cet appartement, que Juve arrachant au bouge dans lequel il menaçait de se corrompre et de se perdre, le petit Fandor, l’avait pris sous sa protection, préparé pour les luttes de la vie, débrouillé et fait de lui ce qu’il était.
Et enfin Juve n’oubliait pas non plus que si ces murs, qui avaient été témoins de tant de scènes, devaient en conserver une empreinte d’horreur, ils renfermaient aussi des souvenirs plus doux et plus paisibles.
Soudain, comme Juve achevait de s’habiller, un coup de sonnette retentit.
Joseph introduisit le visiteur dans le cabinet de Juve. C’était un tout jeune homme, très blond, au visage coloré, comme celui de quelqu’un qui vit au grand air. Il avait des yeux bleus très clairs, des yeux de porcelaine, et sa lèvre supérieure s’ornait d’une petite moustache coupée ras. Les cheveux étaient courts, l’allure du visiteur, martiale et décidée.
– Est-ce bien à monsieur Juve que j’ai l’honneur de parler ?
Ce jeune homme s’exprimait dans un français très correct, avec à peine une pointe d’accent. Juve inclina la tête, affirmativement :
– C’est moi-même, monsieur.
– Je suis le lieutenant prince Nikita.
– Je le sais, monsieur, dit le policier, j’ai eu l’honneur de vous voir à maintes reprises, et je n’ai point de doute quant à votre identité, encore que vous ayez beaucoup changé depuis quelques années.
Il fouillait dans sa poche, pour y prendre une pièce d’identité.
– C’est inutile, monsieur, dit Juve, je sais qui vous êtes. Permettez, toutefois.
Juve prit un compas et, s’approchant de l’officier russe, qui, stupéfait, se laissa faire, il mesurait exactement la hauteur, depuis le sommet jusqu’à l’extrémité du lobe inférieur, de son oreille droite.
– Ah, fit le jeune homme.
– Si je procède ainsi, si je prends ce détail sommaire d’anthropométrie, ce n’est pas pour m’assurer de votre identité, mais c’est pour être sûr de vous reconnaître un jour si d’aventure, expliqua Juve, il vous arrivait malheur. Les criminels, lorsqu’ils ont fait une victime, et qu’ils veulent en dissimuler l’identité, se donnent généralement beaucoup de mal pour détériorer le visage, briser les mains ou les pieds, et ne songeant guère aux oreilles que, le plus souvent, ils laissent intactes. L’oreille est une chose essentiellement personnelle, et sa dimension varie à l’infini. Donnez-moi l’oreille de quelqu’un, j’identifie aussitôt son propriétaire, si ces mesures figurent dans ma collection. D’ailleurs…
Mais Juve s’interrompait, souriant de la stupeur de l’officier russe, puis il reprit :
– Pardon si j’évoque devant vous de si terribles éventualités. Du fait que je prends mes précautions, il n’en résulte pas que votre existence soit en danger. On ne meurt pas sous prétexte que l’on vient de faire son testament.
Juve désigna un siège au lieutenant prince Nikita,
– Monsieur le comte Vladimir Saratov, ambassadeur extraordinaire du Gouvernement Russe, vous a rappelé voici quatre jours de Moscou, où vous étiez en villégiature, pour vous confier une mission importante.
– C’est exact, répondit le lieutenant-prince Nikita, j’ai vu Son Excellence, ce matin même. Elle m’a confié le très grand honneur de recevoir de vous un document secret que j’irai remettre en mains propres à Sa Majesté le Tsar.
– Oui, fit Juve.
– Donnez-moi donc ce document, monsieur.
– Un instant, poursuivit Juve en souriant, nous avons à causer encore. Tout d’abord je dois vous prévenir, monsieur, que vous êtes chargé d’une mission terriblement périlleuse. Vous savez l’importance du document secret et vous n’ignorez pas que, dès qu’une chose est intéressante, il se trouve toujours quantités de personnes pour vouloir se l’approprier, c’est l’éternelle histoire de l’offre et de la demande. Or, je ne vous cacherai pas, prince, qu’il y a beaucoup de demandes sur ce portefeuille.
– Je ferai mon devoir de mon mieux, lorsque vous m’aurez confié ce document, nul, moi vivant, ne pourra le reprendre.
– C’est entendu, fit Juve, mais vous mort, on s’en emparerait aussi facilement que d’un caillou sur la grand-route, ou que d’un tableau au Musée du Louvre.
– Que puis-je faire ? interrogea le lieutenant.
– Il faut, expliquait Juve, simplement ne pas vous mettre dans le cas de risquer votre existence. Dans les circonstances actuelles ce serait mal servir les intérêts de l’Empereur.
– Bien, monsieur, fit le lieutenant, dites-moi donc ce que je dois faire.
Je dois tout d’abord vous dire que, depuis mon arrivée à bord du « Skobeleff, » car j’étais à bord de l’infortuné navire, jusqu’au moment où j’ai pris le train hier pour Paris, j’ai été l’objet, ainsi que mon meilleur collaborateur, des attaques les plus audacieuses et des vols les plus téméraires. Il est bien évident que j’aurais été dépouillé, au moins deux ou trois fois pour une, du portefeuille rouge contenant le document secret si j’avais eu l’imprudence de le porter sur moi.
– Vous n’avez donc pas le document ?
– Je n’ai rien du tout, et c’est fort heureux. Le document est en parfaite sécurité là où je l’ai laissé. C’est vous, lieutenant prince Nikita, vous que nos adversaires ne connaissent pas, qui allez partir le chercher, vous le trouverez là où je l’ai mis, vous le rapporterez à votre maître, pendant ce temps je continuerai à dérouter nos poursuivants, en multipliant les maladresses, les imprudences, en faisant l’impossible pour les induire en erreur.
– C’est un jeu dangereux que vous jouez là, monsieur.
– C’est un bon jeu, fit Juve simplement.
– Où dois-je aller chercher le document, monsieur ?
Juve se leva, alla à son bureau, en tira une carte d’état-major et, mettant le doigt au milieu de la carte, déclara :
– C’est ici que vous irez chercher le document.
Et comme l’officier paraissait de plus en plus intrigué, Juve lui expliquait :
– J’avais réussi à savoir où se trouvait le portefeuille à bord du Skobeleff, lorsque soudain le navire vint à s’échouer. Le naufrage avait-il été prémédité ou non ? je suis partisan de la première hypothèse, mais là n’est pas la question : profitant de l’émotion générale et cependant que les flots tumultueux envahissaient le navire, j’ai pris ce portefeuille. Je suis tombé à la mer avec, et fort heureusement j’ai pu me sauver. Mais, par malheur, le plus redoutable adversaire que j’avais, que nous avions et que nous avons encore dans cette affaire, a échappé lui aussi au désastre et j’ai deviné que, me sachant possesseur du document, il allait mettre tout en œuvre pour me le reprendre. J’avais à le conserver quatre jours, jusqu’à votre arrivée. Je l’ai immédiatement dissimulé dans une anfractuosité de la falaise qui constitue un abri sûr, une cachette presque inaccessible, et, jouant les lièvres du rallye, j’ai aussitôt orienté mes poursuivants sur ma trace. Vous comprenez, n’est-il pas vrai, mon procédé ? Il est fort simple, et il ne me reste plus maintenant qu’à vous préciser, lieutenant, l’endroit exact de la falaise où il faudra vous rendre pour retrouver le document.
Dix minutes encore, le policier expliqua au lieutenant prince Nikita l’endroit exact de la cachette.
À peine le prince Nikita avait-il quitté l’appartement de Juve que Joseph apportait une dépêche.
Elle était signée Fandor :
« Hélène arrêtée, lettre suit ».
Le télégramme venait de Rennes.
Juve demeura perplexe.
Ainsi donc on avait retrouvé la trace de la fille de Fantômas et celle-ci s’était laissée prendre ? Mais dans quelles conditions ? Le téléphone sonna. Joseph alla répondre.
– Qu’est-ce qui se passe ? interrogea Juve d’une voix qui tremblait d’émotion.
– Chef, c’est le chef de mon chef qui désire parler à mon chef.
– Qu’est-ce que vous me chantez là ?
Joseph, de plus en plus troublé, allait répéter sa phrase obscure, aux allures de rébus, mais Juve, précipitamment, avait couru à l’appareil. À l’autre bout du fil il reconnaissait la voix du Directeur de la Sûreté, de M. Havard, qui lui disait :
– C’est vous Juve ? Je suis bien content de vous savoir rentré à Paris. Passez donc d’urgence à mon bureau, il importe que nous nous mettions d’accord sur les mesures à prendre à l’occasion de la prochaine arrivée à Paris de l’Empereur de Russie. Et puis vous me raconterez l’affaire du Skobeleff. Qu’est-ce que c’est donc que cette histoire-là ? J’imagine que Fantômas y est pour quelque chose.
– Peut-être, répondit Juve qui, prenant son chapeau et son pardessus, partit aussitôt pour la Préfecture de Police.
14 – L’HEURE FATALE
– Je sors pendant une heure.
– Yes, mister Bolton.
– Je rentrerai d’ailleurs assez tôt.
– Yes, mister Bolton.
– Et demain matin vous me réveillerez à cinq heures et demie précises.
– Yes, mister Bolton.
Cependant que le client du Britannic-Hôtelqui donnait ainsi ses instructions, nettes et précises, s’exprimait dans un français très pur, bien qu’il eût l’aspect caractéristique d’un naturel d’Outre-Manche, le garçon s’obstinait, lui, à lui parler dans la langue de Shakespeare, qu’il écorchait.
Néanmoins, les deux hommes s’étaient très facilement compris et le voyageur sans répondre aux salutations exagérées du domestique, fit avancer une voiture devant la façade de l’hôtel de la rue de Rome et y monta aussitôt.
Fred Bolton se fit conduire à toute allure à la gare du Nord. Il changea de véhicule après avoir passé à la consigne d’où il retira une valise. Puis, il ordonna au cocher de le mener rue Duphot, à l’hôtel de la Paix. Lorsqu’il descendit de voiture, l’homme à l’allure anglaise avait changé d’aspect. De roux qu’ils étaient précédemment, ses cheveux étaient devenus bruns. Lorsqu’il se présentait au bureau de l’hôtel, la caissière, dont il était évidemment connu, le salua d’un :
– Bonjour, monsieur Archinet, familier et cordial.
– Chère madame, donnez-moi, je vous prie, la chambre du rez-de-chaussée, vous le savez, l’état de mon cœur m’interdit les escaliers, ainsi que l’ascenseur.
La caissière appela un domestique qui prit les bagages du voyageur, cependant, qu’aimable, toujours, elle répondait à celui-ci :
– Nous connaissons vos habitudes, monsieur Archinet, la chambre que vous occupez d’ordinaire est à votre disposition.
– Eh bien, poursuivit ce bizarre habitué de l’hôtel, je suis très fatigué, je comptais aller voir mes enfants ce soir, mais la banlieue me fait peur. Elle est trop loin. Je vais me coucher. Inutile de me réveiller. Demain, au petit jour, je partirai pour me rendre comme d’ordinaire chez mon gendre, à Boissy-Saint-Léger. Et il est probable, mademoiselle, que je n’aurai pas le plaisir de vous voir demain matin.
– En effet, monsieur, poursuivit la caissière, je veille ce soir jusqu’à minuit. Ce sera ma remplaçante.
L’individu qui, à l’hôtel de la Paix, répondait au nom d’Archinet, ne tarda pas à éconduire le garçon exagérément complaisant qui s’éternisait dans sa chambre.
Sitôt le serviteur parti, il ferma sa porte à double tour, éteignit, mais il ne se coucha pas.
Le mystérieux M. Archinet entrebâilla sa fenêtre, s’assura que la cour sur laquelle elle donnait, était absolument déserte, il enjamba alors le petit balcon, puis, se dissimulant le long du mur, il gagna la sortie de service de l’hôtel et se retrouva dans la rue sans que personne eût pu soupçonner son départ.
Frédérik Bolton qui, rue Duphot, s’appelait M. Archinet, prit alors une troisième voiture qui le transporta rue des Saints-Pères où il descendit devant un troisième hôtel aux apparences modestes mais confortables, qui portait pour enseigne : Aux Amis de la Gironde.
M. Bolton-Archinet avait encore changé de physionomie. Il avait sur ses cheveux naturels, une perruque blanche et sa lèvre rasée s’ornait d’une épaisse moustache grise.
Le patron, un robuste Gascon, vint à lui, la main tendue :
– Hé, tiens, M. Collimasque. Quel bon vent vous amène ?
– Mon cher patron, répondit l’énigmatique voyageur, ce n’est pas le vent mais le chemin de fer, je descends de la gare d’Orsay à l’instant même, j’arrive de Bordeaux.
– Une chambre, monsieur Collimasque ?
– Bien entendu, patron.
– Voulez-vous le 23, on y est très bien, vous en avez l’habitude.
– Va pour le 23, répliqua avec enjouement celui qui, successivement venait d’être appelé Bolton, Archinet et Collimasque. Seulement je ne monte pas me coucher de sitôt, voilà bien trois semaines que je ne suis pas venu à Paris, vous pensez bien que j’ai envie de faire un petit tour.
– L’hôtel est ouvert toute la nuit, faites donc comme chez vous.
– Oh, comme chez moi, poursuivit le voyageur, mieux que chez moi, car je vous promets bien qu’à Bordeaux, si je m’avisais de rentrer après onze heures du soir, la bourgeoise ferait une musique épouvantable.
– Tandis qu’à Paris, ni vu ni connu…
– Surtout, comme je rentrerai peut-être tard, ne me faites pas réveiller. Je descendrai bien tout seul.
À peine avait-il regagné la rue des Saints-Pères que le personnage aux trois noms, reprenait encore une voiture, et ce n’était pas pour se faire conduire dans les endroits de plaisir comme en fréquentent volontiers les provinciaux à Paris. Le pseudo vieillard donna à son automédon, l’adresse du Britannic-Hôtelet, quelques instants après, M. Collimasque, qui rue Duphot venait d’être M. Archinet, redevenait l’Anglais Frédérik Bolton au Britannic-Hôtel.
Lorsque le faux Anglais eut regagné sa chambre, ayant soigneusement fermé les rideaux des fenêtres, il tourna le commutateur et se mit en devoir d’enlever sa perruque, de supprimer les favoris roux qu’il avait substitués depuis quelques instants à sa moustache grise et il apparut enfin tel qu’il était.
Ce mystérieux individu n’était autre que Fantômas.
C’était bien le bandit qui, désormais, seul et sans témoin, ne jouait plus de comédie, ne tenait plus de rôle. Il se déshabilla lentement, le front soucieux, puis, une inspiration subite le détermina à remettre sa perruque rousse et ses favoris jaunes. Il sonna alors, se fit monter par le garçon de l’eau chaude et les journaux du soir, puis il boucla sa porte.
***
Fantômas, machinalement, avant de se mettre au lit, avait déchiré la bande d’un journal qu’il déployait devant lui.
Mais, le bandit ne lisait pas : il était préoccupé. Soudain, celui que l’on avait tant de fois qualifié d’insaisissable, et qui ce soir-là se disposait à passer une nuit paisible et tranquille comme la nuit du plus honnête des bourgeois, tressaillit soudain en considérant le journal qu’il avait sous les yeux.
Cette feuille, en effet, portait la date du 24 mars.
Le bandit tira sa montre :
– Dix heures, fit-il, et dire que je n’y songeais plus. Me suis-je donc trompé de jour ? Non pourtant. Nous sommes bien aujourd’hui le 24.
La pensée de Fantômas se reportait à quelques journées en arrière, à la conversation avec le sinistre équarrisseur rencontré sur la falaise bretonne, avec l’énigmatique et mystérieux Jean-Marie, au rendez-vous avec lui. Tant pis, il n’y serait pas. Il avait dépêché Jean-Marie aux trousses de sa fille et l’émotion qu’il éprouvait donc ce soir-là en s’apercevant que l’on était le 24 mars, qu’il était 10 heures 1/4 du soir et qu’il avait rendez-vous dans un quart d’heure, à six cents kilomètres de là, n’était qu’une émotion rétrospective, car il se doutait bien que s’il manquait au rendez-vous, Jean-Marie, lui non plus, n’avait pas pu s’y rendre. Fantômas se rassura, mais sa tranquillité ne devait être que de courte durée.
En effet, comme il parcourait le journal, le bandit ne put retenir un cri d’angoisse. Il lut un fait-divers, le relut avec attention, poussa des exclamations étouffées, puis, devint tout pale, cependant qu’une inquiétude extrême se peignait sur son visage.
La dépêche envoyée au journal, dépêche datée de Rennes et réduite à quelques lignes, était ainsi conçue :
« Au cours d’une expérience de tir effectuée dans les faubourgs de notre ville par une jeune fille employée dans la baraque de deux romanichels, répondant au nom du Père et de Mère Zizi, un accident qui aurait pu être grave s’est produit Les cartouches que l’on croyait chargées à blanc, étaient chargées à balles et la jeune bohémienne feignant de tirer sur un spectateur qui s’était offert comme compère bénévole, a failli tuer ce malheureux. On a procédé à l’arrestation de l’involontaire coupable qui, n’ayant pu justifier de son identité a été conduite au Commissariat de Police, puis écrouée à la prison de Rennes. »
– Hélène, murmura Fantômas, Hélène est arrêtée. Qu’a-t-il bien pu se passer ? la malheureuse, que va-t-il advenir d’elle ?
Fantômas, en effet, savait bien que la seule jeune fille faisant partie de la troupe du père et de la mère Zizi, était sa fille. Mais comment le drame s’était-il produit ? par suite de quelle affreuse supercherie, Hélène avait-elle été mise, à son insu dans un aussi mauvais cas ?
Et, tout naturellement, Fantômas en était amené à se demander quel rôle Jean-Marie, qu’il avait catégoriquement chargé de surveiller et de protéger la jeune fille, avait joué dans cette affaire.
Jean-Marie avait manqué à sa mission, peut-être même avait-il trahi ? Cette idée, Fantômas ne pouvait la supporter. Il se leva brusquement, arpenta la pièce à grands pas, faisant de profondes aspirations, en homme qui étouffe. Puis, une nouvelle inquiétude parut envahir son esprit.
– En admettant même, se disait Fantômas, que Jean-Marie ait accompagné Hélène et l’ait protégée jusqu’au moment du scandale, il est bien évident qu’il a dû déguerpir sitôt après l’accident.
Fantômas vérifia :
– La dépêche est datée du 22, fit-il. Mais alors, Jean-Marie voyant qu’Hélène était conduite en prison, a dû considérer sa mission comme terminée. Il a dû se dire qu’il convenait de m’aviser au plus vite des incidents, qu’il fallait me les expliquer. Oui, c’est évidemment logique, Jean-Marie en toute hâte a dû regagner la falaise, il doit m’attendre aux abords du manoir de Kergollen où il croit me retrouver, oh, c’est simple, terriblement simple. Nous avons rendez-vous ce soir à dix heures et demie à la porte du manoir, Jean-Marie y sera et moi je me trouve à six cents kilomètres du lieu du rendez-vous, nulle puissance humaine ne pourrait désormais me permettre d’arriver à temps. Et si Jean-Marie se trouve seul il agira peut-être.
Et Fantômas, en effet, songeait au sinistre crime que tous deux avaient comploté, le bandit songeait que dans un quart d’heure, une demi-heure peut-être, devait d’après leurs conventions, sonner l’instant suprême où Dame Brigitte allait être hors d’état de nuire.
Soudain, Fantômas bondit, pris d’une inspiration subite.
Il venait d’apercevoir, accroché au mur, l’appareil téléphonique. D’une main tremblante il décrocha le récepteur, se fit mettre en communication avec le portier de l’hôtel :
– Allô, disait-il, donnez-moi l’interurbain, dépêchez-vous, c’est très urgent.
– Que désirez-vous ?
– Jusqu’à quelle heure le téléphone fonctionne-t-il à Brest ?
– Jusqu’à minuit, monsieur.
– Peut-on avoir la communication rapidement ?
– Dans deux ou trois minutes, monsieur, les lignes ne sont pas chargées en ce moment.
Fantômas poussa un soupir de soulagement, il allait peut-être pouvoir parer au danger immédiat que courait la châtelaine du manoir de Kergollen, en l’avisant de se tenir sur ses gardes :
– Quel numéro voulez-vous à Brest ? demanda le téléphoniste.
Mais, à cette question, Fantômas paraissait à nouveau effroyablement troublé. Il se souvenait que le manoir de Kergollen n’était pas directement relié à Brest, qu’il fallait passer par le poste de la pointe Saint-Mathieu.
Les bureaux n’étaient-ils pas fermés à cette heure tardive, dans cette petite localité ? Le bureau de la pointe Saint-Mathieu était fermé à huit heures du soir.
Fantômas lâcha l’appareil, s’écroula sur le plancher, la tête entre les mains.
Quiconque aurait vu dans cette posture, celui qui, depuis des années, faisait trembler l’humanité entière, n’aurait jamais pu reconnaître en cette loque l’insaisissable bandit, le génie du crime, l’incomparable Fantômas.
Fantômas voyait Jean-Marie pénétrer dans la pièce, fermer derrière lui la porte, balbutier d’abord quelques paroles vagues, il le voyait, profitant d’un moment d’inattention, se précipiter sur la vieille dame, lui plonger son couteau dans le cœur et regarder couler le sang, ce sang que Jean-Marie aimait tant à répandre, et dans lequel il prétendait éprouver une si grande joie à tremper les mains.
15 – NIKITA RÊVAIT-IL ?
– Me suis-je trompé ? L’endroit que j’ai visité ne serait-il pas celui que m’indique Juve ? Si seulement il faisait clair, si je pouvais consulter une carte, mais non, la nuit est obscure et des nuages épais interceptent le moindre rayon de lune. Quelle nuit sinistre. Quelle obscurité de cauchemar.
Relevant le col de son pardessus, le personnage monologuant ainsi, cependant qu’il arpentait à grands pas la falaise abrupte qui s’étend au nord de la pointe Saint-Mathieu, n’était autre que le lieutenant prince Nikita, qui, sitôt après avoir quitté le policier Juve, était venu sur ses indications à la pointe extrême du Finistère, rechercher sur la falaise escarpée le précieux document que le policier lui déclarait y avoir dissimulé. Le voyageur était arrivé au crépuscule dans les environs de la pointe Saint-Mathieu.
Pendant plusieurs heures, il avait exploré l’endroit nettement désigné par Juve, mais ses recherches avaient été vaines.
Par moments, le prince Nikita se demandait s’il avait bien compris les indications qui lui avaient été données.
Mais non, impossible. S’il n’avait pas trouvé le précieux document dans l’anfractuosité du rocher indiquée par le policier de la rue Bonaparte, il avait du moins très nettement découvert la cachette qui l’avait contenu.
Or, cette cachette, le prince Nikita s’en rendait aisément compte, était vide, absolument vide, et l’officier devait en conclure qu’entre le départ de Juve et la venue de l’envoyé russe, quelqu’un avait découvert la cachette et emporté le dépôt.
À présent, le prince Nikita cherchait en vain sa route. Au cours de ses pérégrinations, il s’était égaré et désormais ne retrouvait plus le véhicule qui, plusieurs heures auparavant, l’avait conduit à quelque cent mètres du phare de la pointe et s’y était arrêté.
Fouillant des yeux l’obscurité, après de longues tentatives infructueuses, Nikita avait aperçu une petite lumière qui scintillait à l’horizon, émergeant d’une masse d’ombre.
Il s’en était approché, croyant découvrir quelque maison de pêcheurs dans laquelle il pourrait prendre un peu de repos. Mais, comme il arrivait aux abords de la demeure ainsi éclairée, il s’apercevait en présence d’une habitation fort importante, d’un manoir aux épaisses murailles, aux contours tourmentés.
Il hésita à sonner.
Lentement, il fit le tour du vieux manoir, espérant rencontrer quelque domestique, trouver quelqu’un d’éveillé. Mais c’était partout le silence et la nuit.
Soudain, cependant, comme il passait entre les écuries et une grange voisine de la maison, le prince Nikita s’arrêta.
Il venait d’entendre un léger bruit et à peine s’était-il arrêté qu’une voix dans l’ombre appelait :
– Psst.
Instinctivement, l’officier se rapprocha d’une petite porte basse à peine entrebâillée. Derrière cette porte, la même voix articulait doucement :
– Ici, c’est par ici, suivez-moi, je vais vous montrer le chemin.
Surpris, Nikita allait se nommer à cet interlocuteur invisible, mais celui-ci, curieux évidemment de savoir à qui il s’adressait, venait de braquer sur l’inconnu le pinceau lumineux de sa lanterne sourde.
La voix qui avait appelé Nikita murmura avec une intonation de surprise :
– Tiens, ce n’est pas vous ? Ce n’est pas lui.
Puis la voix ajoutait, une voix d’homme, grave, un peu rude :
– Je comprends. Vous venez peut-être de sa part ?
Intrigué, soupçonnant un mystère, peut-être aussi une aventure, et redoutant par-dessus tout d’être laissé dehors, Nikita répondit évasivement.
L’homme, cependant, qui l’avait si opportunément rencontré et appelé poursuivit la conversation :
– Évidemment, vous venez pour l’affaire.
Ce fut, dans l’esprit de l’officier russe, un trait de lumière :
– Oui, je viens pour l’affaire, répondit-il.
Tout en parlant l’officier avait franchi la porte du vieux manoir, et il se trouva bientôt à l’entrée d’un couloir.
Son interlocuteur le considéra un instant avec une certaine attention, presque de la méfiance, mais, sans doute l’air décidé et martial du jeune officier lui plut :
– Ça va bien, suivez-moi.
Nikita avait eu le temps de voir cet hôte étrange et mystérieux qui peut-être allait dans un instant lui fournir les explications dont il avait si grand besoin.
C’était un homme de médiocre condition, à en juger par ses vêtements mal tenus, et même déchirés.
Mais le personnage ne paraissait pas s’inquiéter de l’examen dont il était l’objet.
Il avait pris l’officier par le bras, lui faisait gravir un petit escalier de pierre et soudain se penchant à son oreille, déclarait :
– Nous allons l’avoir aisément, rien n’est plus facile, j’ai tout préparé.
Il ajouta :
– Mais pourquoi n’est-il pas venu ?
À ce moment, Nikita pensait aux dernières paroles de Juve qui, fort subtilement d’ailleurs, avait suggéré à l’officier de se rendre seul en Bretagne, d’où il pourrait plus à son aise revenir avec le document, sa personnalité étant ignorée des bandits qui prétendaient s’en emparer.
Et, spontanément, répondant à son interlocuteur, Nikita déclarait :
– C’est qu’il avait peur d’être reconnu.
– Je comprends fit l’homme, il a eu raison. Il est connu.
Cependant, les deux hommes arrivaient au sommet de l’escalier, ils se trouvaient sur un palier étroit où s’ouvraient trois couloirs obscurs.







