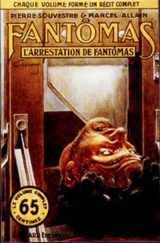
Текст книги "L'Arrestation de Fantômas (Арест Фантомаса)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
***
– Ainsi, disait à présent l’inconnu, s’adressant à la femme de charge de M mede Brémonval, ainsi voilà ce que tu fais ? Tu sais que je suis aux prises avec les pires difficultés, tu sais que je joue ma tête, tu sais que Fandor et Juve ont juré de me faire monter à l’échafaud, que je frôle la mort tous les jours, et c’est ce moment-là que tu choisis pour me trahir, pour me tromper, pour t’acoquiner avec des officiers étrangers, avec un Russe, avec ce prince Nikita, qu’un jour peut-être je devrai combattre comme j’ai combattu tous ceux qui ont fait obstacle à ma route. Oh ! sans doute, je sais ce que tu penses. Ta pauvre cervelle de femme trouve des excuses à ta conduite. Vous autres, vous avez une imagination folle dès qu’il s’agit de vous justifier. Tu inventes en ce moment que c’était ton droit de me trahir ? que j’ai eu des maîtresses ? que tu te vengeais ? Hé, malheureuse, faut-il donc que je plaide devant toi la différence qui fait moindre la trahison de l’homme que la trahison de la femme ? Trahie. Tu penses que je t’ai trahie ? Était-ce quand je recherchais ma fille à Paris-Galeries et que tu t’imaginais que Raymonde était ma maîtresse ? Réponds.
Mais Dame Brigitte se taisait toujours.
– Ton silence prouve, peut-être mieux que n’importe quoi, ton inconscience. Je t’aimais, entends-tu. Je t’aimais. Moi, moi qu’on dit incapable d’amour, moi qu’on croit impassible, moi qui passe aux yeux de tous pour une brute sans cœur, je t’aimais. J’avais pour toi des trésors de tendresse, des vertiges d’adoration. Et il faut que je m’aperçoive que tu me trahissais lâchement, bêtement, sottement.
La voix de Fantômas – car l’inconnu qui entretenait Dame Brigitte, qui venait de jeter à la porte le prince Nikita, n’était autre que Fantômas – semblait sombrer dans un sanglot muet.
Le bandit, bientôt, maîtrisa pourtant son émotion :
– Je t’aimais, dit-il encore, je t’aimais, mais je ne t’aime plus. Je ne veux plus t’aimer, comprends-tu ? Il faut que je ne t’aime plus.
Mais, comme il prononçait ces mots de désespoir, brusquement, d’un élan insensé, la duègne aux cheveux blancs, se jeta à ses genoux.
– Il faut que tu ne m’aimes plus, cria-t-elle. Ah, ne dis pas ça, ne blasphème pas. Gurn, mon amant, ma joie, ma vie, mon âme. Il est impossible que tu ne m’aimes plus ? c’est impossible.
– Tu m’as trahi.
– Non, ce n’est pas vrai.
– Pourquoi recevais-tu cet officier ?
– Tu sais bien que je frémis chaque fois que je sais que quelqu’un contrarie tes plans, tes projets. Écoute. Tu ne peux pas m’en vouloir ? Tu ne peux pas exiger, toi que j’aime, que je sois à ce point aveugle, que j’oublie qui tu es ? ce que tu fais ?
– Tu me reproches mes crimes ?
– Je n’ai pas la force de rien te reprocher. Mais, pitié. Écoute-moi. Ne me dis pas que tu m’aimes plus, toi que j’aime. Écoute pourquoi je recevais cet officier, ce Nikita ? Oh, pas pour te trahir, crois-le bien. Tout simplement pour le supplier de ne plus s’occuper du portefeuille rouge, pour l’écarter de ta route, pour le sauver de toi qui es le maître de tout, de toi que rien n’arrête, de toi que j’aime quand même follement, furieusement. Je te le jure.
Et, tandis que Dame Brigitte adressait à Fantômas cette prière passionnée, voilà que tout d’un coup elle se relevait, elle se reculait et, d’un geste fou, arrachait sa perruque, dépouillait son corsage, enlevait sa jupe. Et ce n’était plus Dame Brigitte alors. C’est, dans tout l’éclat de sa beauté affolante, dans la tiédeur de sa chair passionnée, dans la griserie de son corps jeune et svelte, la séduisante lady Beltham qui se jeta au cou du bandit.
– Pardonne-moi ? supplia-t-elle, puis elle expliqua : c’est tout à fait par hasard, alors que Jean-Marie voulait m’assassiner, que le prince Nikita est parvenu jusqu’à moi, à Kergollen, au moment où, prête à m’endormir, je venais de quitter mon déguisement de Dame Brigitte. Il m’a vue, il m’a trouvée belle. Mais je suis belle pour toi, pour toi seul. Écoute, j’ai su qu’il s’occupait du portefeuille rouge. Je l’ai supplié de te laisser la route libre. Aujourd’hui, s’il a vu M mede Brémonval, c’est pour le faire céder. Mais je n’aime que toi au monde.
Fantômas convaincu par son accent passionné, pardonna en effet. Il repoussa doucement sa maîtresse :
– Va, dit-il, je te crois, je veux te croire. Si tu m’aimes, je t’aime aussi, je ne veux pas t’arracher de moi, mais je ne veux plus de cette existence perpétuellement malheureuse qui est la nôtre. Maud, je t’en conjure, quitte Paris, ne sois plus ni lady Beltham, ni M mede Brémonval, ni Dame Brigitte, ni quoi que ce soit au monde. Accepte de ne rien être que la femme que j’aime. Pars où je te dirai d’aller, où nous vivrons tous les deux, seuls, l’un pour l’autre, à tout jamais.
Et, très doucement alors, lady Beltham répondait :
– Ordonne, commande, je suis ta chose, je t’aime.
19 – L’HOMME AUX MAINS ROUGES
– Alors, mère Zizi, vous n’avez pas trouvé que c’était une chose épouvantable que de vendre ce brave Papillon ?
– Ma foi, non, ma fille. Qu’est-ce que tu veux, la malheureuse bête est morte sur le coup. Elle avait reçu la roulotte juste en plein ventre et sur la tête. Que voulais-tu que nous fassions de son corps, le père Zizi et moi ?
– Vous avez raison, maman Zizi. Mais, tout de même, je suis bien certaine que ce n’est pas vous qui avez eu l’idée d’appeler l’équarrisseur. Avoir vendu Papillon à l’équarrisseur. Tenez, je ne peux pas me faire à cette idée-là, mère Zizi. La pauvre bête, elle méritait un autre sort.
– Dame, qu’est-ce que tu veux, on n’est pas riche ? Les réparations vont coûter cher. Quand on nous a donné le conseil de vendre Papillon à l’équarrisseur, ni le père Zizi, ni moi, n’avons rien trouvé à redire.
– Mais qui est-ce qui vous a donné ce conseil, encore une fois ?
– Je ne sais pas. N’importe qui. Quelqu’un qui était là, un camelot, il me semble. Oui, un camelot. Mais pourquoi me demandes-tu ça ?
– Oh, pour rien, par curiosité. Et on a enlevé les harnais ?
– Oui. Nous avons vendu le cadavre de notre bête et puis ses harnais, et puis tout. Nous nous faisons vieux, et l’époque des grands voyages est finie pour nous deux Zizi. Nous réparerons la roulotte parce que le père et moi, nous sommes tellement habitués à vivre sous son toit que ce serait un crève-cœur d’être obligés de nous installer ailleurs. Mais voilà tout. Et toi, Hélène, qu’est-ce que tu aurais fait à ma place ?
La fille de Fantômas n’insista pas. Elle revenait du travail chez l’Accapareur.
On ne soupçonnait toujours rien. La roulotte avait glissé parce que les roues étaient mal calées. La pente avait fait le reste. La panique qui avait suivi était injustifiée. Pourquoi poursuivre un coupable alors que le hasard seul l’était ?
Hélène apprit d’ailleurs, avec une indifférence à peine apitoyée, que la roulotte avait subi de graves dommages au cours de sa chute. Elle se montra, en revanche, fort affectée du décès du vieux cheval, de l’excellent Papillon.
Papillon avait été enlevé le matin même par l’équarrisseur. Son corps avait été vendu pour quelques francs. On ne pouvait plus rien pour lui, sa pauvre destinée de bête de somme était terminée.
Hélène, après quelques vagues phrases de regrets, trouvait bon de ne point s’appesantir davantage sur le trépas du vieux cheval.
Le père et la mère Zizi, au lendemain de l’accident, avaient été hébergés par des biffins, leurs voisins.
Ils demeuraient, à présent, dans une simple cabane. C’était là qu’Hélène avait trouvé la mère Zizi et qu’elle prit congé d’elle :
– Eh bien, ma brave maman, tant pis, il faut s’en faire une raison. N’empêche, ça me fait de la peine de songer que Papillon est chez un équarrisseur.
Cela devait évidemment faire un gros chagrin à la fille de Fantômas d’apprendre que le cheval de la roulotte, les jambes broyées, les flancs déchirés, à moitié mort, avait été mené chez l’équarrisseur.
Qui eût rencontré à ce moment cette jeune fille s’en allant à grands pas vers la barrière de Saint-Ouen, se fût douté que de graves préoccupations rendaient songeur ce front de vingt ans.
La fille de Fantômas, à pied, traversa tout Paris.
Elle sortit de la capitale par la porte de Châtillon, se dirigeant vers le cimetière de Bagneux, puis, avant d’atteindre la vaste nécropole, alors qu’elle se trouvait dans les terrains vagues semés de champignonnières abandonnées, elle prit sur la droite, coupa à travers champs, parvint bientôt à une sorte d’enclos ceinturé de hauts murs dont elle fit le tour, lentement.
– Pourvu, se disait la jeune fille de plus en plus inquiète, pourvu que je réussisse. Pourvu qu’il n’y ait personne.
Autour d’elle, à perte d’horizon, s’étendaient les champs de détritus innombrables, incultes, dont n’avaient pas voulu les maraîchers.
Devant la jeune fille se dressaient les murs élevés de l’enclos dont elle venait de faire le tour à deux reprises.
La jeune fille, après un dernier coup d’œil à la campagne déserte, n’hésita pas davantage. De dessous sa cape de chiffonnière, elle tira un rouleau de cordage.
– Au travail, murmura-t-elle, les voleurs de chevaux n’opéraient pas autrement au Natal. Pourquoi ne réussirais-je pas ?
Déroulant sa corde avec un soin extrême, Hélène attacha à l’un des bouts une énorme pierre trouvée le long du mur. Puis, faisant tourner l’extrémité de la corde, comme si elle eût voulu s’en servir ainsi que d’une fronde, elle jeta la pierre de l’autre côté du mur.
Le caillou tomba dans un jardin, probablement. On entendit le bruit sourd qu’il faisait en roulant sur le sol, et la fille de Fantômas tressaillit, prêtant l’oreille. Mais les craintes de la jeune fille décidément étaient vaines. Elle pouvait faire tout le bruit possible. Nul ne s’inquiétait d’elle, ne faisait attention à ses gestes.
Après quelques minutes d’une attente anxieuse, la fille de Fantômas s’étant convaincue qu’elle pouvait agir en toute sécurité, commençait à haler sur sa corde. Bien qu’elle eût de petites mains, bien qu’elle parût frêle et délicate, la jolie Hélène était robuste en réalité. Bientôt, elle raidit les bras, elle fit effort et la pierre qu’elle avait jetée à l’intérieur des murs apparut au sommet de ceux-ci, roula à nouveau de son côté. Que voulait donc la jeune fille ? Hélène sembla désappointée d’avoir réussi à ramener la pierre.
Elle tenta un peu plus loin la même manœuvre. Quatre fois de suite la jeune fille envoya la pierre à l’intérieur des murs, hala sur la corde, la ramena. À la cinquième reprise pourtant, comme elle s’était sensiblement écartée de l’endroit où elle avait commencé ses mystérieuses opérations, il se trouva que la corde se raidit durement entre ses mains. Hélène avait beau haler, elle ne parvenait plus, cette fois, à ramener la pierre. Victoire. Souriante, souple, leste, immédiatement, la jeune fille se mit en mesure de se hisser le long de la corde enroulée au pied d’un arbre voisin et qui, retenue à son autre extrémité par la pierre, vraisemblablement accrochée à une branche, lui faisait une sorte de chemin aérien permettant d’atteindre la crête du mur. La fille de Fantômas acheva son escalade en s’asseyant purement et simplement au haut de la muraille qu’elle venait de franchir.
Et, penchée sur le vide noir de la cour qu’elle dominait, elle prêta longuement l’oreille, s’assurant qu’elle n’entendait aucun bruit, que rien ne décelait aux environs une présence d’être humain.
Le silence partout.
Fermant les yeux, mais raidissant ses muscles, elle s’accroupit sur les talons, puis, légère, en vraie acrobate insoucieuse du danger, elle se jeta dans le vide, sauta du haut du mur dans le jardin qu’elle ne voyait même pas, dans le trou noir plein de silence et de mystère, qu’encerclait un mur de quatre mètres.
Elle se reçut habilement sur la pointe des pieds, garda son équilibre, et, bien que la secousse eût été rude, réussit à ne point se blesser.
La fille de Fantômas avança de quelques pas dans l’ombre, puis tira une petite lampe de sûreté, une de ces lampes électriques que tous les coureurs d’aventures emploient pour le plus grand profit de leurs entreprises.
Elle déclencha le mécanisme de la lampe. Un pinceau lumineux éclaira la cour où Hélène venait de pénétrer de façon si mystérieuse.
Or, à peine la jeune fille avait-elle jeté les yeux autour d’elle que, bien qu’elle s’attendît au spectacle qu’elle allait voir, elle ne put s’empêcher de pousser une exclamation d’horreur.
Autour d’elle, près d’elle, contre elle, ce n’étaient que des cadavres de chevaux, des cadavres d’animaux de toutes sortes, dont les uns, écorchés, étaient rouges de sang, dont les autres, pattes raidies, ventres ballonnés, yeux vitreux, corps à demi décomposés, répandaient d’horribles odeurs de putréfaction.
Le sol détrempé de sang, le sol gluant et visqueux, collait aux talons, infecte boue grasse qui vous faisait glisser et trébucher.
Le premier moment de terreur et de dégoût passé, Hélène rappelait à elle toute son énergie.
– Il faut que je trouve Papillon. Il faut que je le voie, se dit-elle.
À la lueur de sa petite lampe, la jeune fille partit de cadavre en cadavre.
Soudain, elle manqua crier de joie. Dans un coin de la cour, au milieu d’un lot de bœufs déclarés impropres à la consommation, le corps gris pommelé du regretté Papillon.
– Dieu soit loué.
Misère, il ne portait plus ses harnais.
Mais au bout de la courette s’élevait une remise. Porte fermée, dont il suffit de soulever le battant pour faire sauter la serrure branlante.
Là, dans ce hangar, dont le toit mal clos laissait par moments pénétrer quelques souffles de l’air pur de la nuit, les chauves-souris en grand nombre voletaient, faisant des rondes inlassables et s’enfuyaient, soudain mises en fuite par la lumière de la petite lampe électrique que tenait toujours la fille de Fantômas.
Enfin, elle put décrocher de la muraille de nombreux harnachements achetés sans doute avec les cadavres des chevaux et pendus là en attendant le revendeur.
La fille de Fantômas fouilla dans cette sellerie mortuaire pendant près d’une demi-heure.
Puis soudain, un cri de victoire :
– Ah, cette fois, ça y est.
La fille de Fantômas à ce moment, tenait un harnais assez coquet, fait de cuir marron liséré de blanc. Vieux harnais, acheté sans doute à quelque cirque riche, c’était le harnachement du malheureux Papillon.
Mais pourquoi Hélène avait-elle voulu à toute force retrouver ces objets de sellerie ?
Repoussant les colliers, délaissant les brides, elle saisit les œillères qui, jadis, empêchait le pauvre Papillon de se laisser distraire par l’horizon des routes.
C’est d’une main tremblante qu’elle palpa l’une de ces œillères, et avec une hâte fébrile, elle en arracha le cuir, elle en enleva la doublure.
– Dieu soit loué, s’écria aussitôt la fille du bandit.
C’est qu’entre les deux épaisseurs de cuir, dissimulé dans une cachette que nul, bien sûr, n’aurait seulement songé à soupçonner, venait d’apparaître le maroquin rouge d’un portefeuille. C’était le portefeuille rouge qu’Hélène tirait de cette cachette. Comment se trouvait-il là ? Comment la fille de Fantômas avait-elle pu venir reprendre dans la sellerie du malheureux Papillon l’important document ?
À la vérité, l’explication était simple.
Quand, en compagnie de son père, la jeune fille s’était embarquée à bord du Skobeleff, elle n’avait pas été longue à s’apercevoir que Fantômas attachait une extrême importance au portefeuille rouge.
Plus tard, alors que le Skobeleffs’enfonçait dans les flots, en train de se sauver à la nage, Hélène anxieusement s’était demandée ce qu’il était advenu du portefeuille rouge.
– Je m’emparerai du portefeuille, s’était juré Hélène, j’empêcherai mon père de s’en servir pour de nouveaux crimes, j’empêcherai Juve d’en tirer parti contre Fantômas.
Le hasard l’avait aidée.
Quand Juve et Fandor avaient été cacher le portefeuille dans l’anfractuosité de la falaise à la pointe Saint-Mathieu, la fille de Fantômas les avait vus. Alors que les deux amis s’éloignaient, elle était revenue à la cachette, elle s’était emparée du portefeuille.
Jean-Marie s’était trompé quand il avait cru que la fille de Fantômas dissimulait quelque chose dans un rocher. Elle n’y cachait rien. Elle venait au contraire y dérober un dépôt.
Et de même plus tard, quand Fantômas avait trouvé sur le sable de la grève la trace des pas de Juve, Fandor et sa fille, il s’était trompé en imaginant que Juve et Fandor étaient venus après sa fille, alors qu’en réalité, Hélène avait passé après eux.
La fille de Fantômas, arrêtée à l’improviste, n’avait pas eu le temps d’enlever le portefeuille de sa nouvelle cachette.
Après une angoisse épouvantable, au sortir de la prison de Brest, elle s’était jetée à la poursuite de la roulotte des Zizi, puis, l’ayant enfin retrouvée, elle était demeurée au camp des chiffonniers, afin de pouvoir surveiller plus facilement le harnais de Papillon.
***
Cinq minutes plus tard, la fille de Fantômas abandonnait l’enclos. Elle avait serré dans son corsage le redoutable document qu’au péril de sa vie elle était venue reprendre dans ce maléfique endroit.
Or, comme s’aidant d’une échelle trouvée dans un coin du clos, elle en franchissait l’enceinte, Hélène pensa s’évanouir de frayeur.
Une voix rude l’interpellait :
– Hé là-bas, la jolie fille, que diable trafiquez-vous par ici ?
D’un mouvement accéléré, Hélène avait glissé au bas du mur, puis elle avait pris sa course, elle fuyait, éperdue.
Du clos d’équarrissage, un homme était sorti, porteur d’un gros falot d’écurie, un homme gigantesque, qui bientôt la rejoignit, l’agrippa, la secoua :
– Nom d’un chien, criait-il, c’est pas des magnes à faire. Qu’est-ce que vous fichez sur le mur ? Répondez voir un peu. C’est-y que ça vous amuse de regarder la charogne ?
– Lâchez-moi. Je ne fais rien de mal. Je regardais.
– Oui, vous regardiez, mais quoi ?
L’homme leva sa lanterne.
– Ah, nom de Dieu, s’écria-t-il, c’est rien farce, tiens. Je vous reconnais, la petite. C’est vous, la nommée Hélène, la fille adoptive des chiffonniers ? Je vous ai déjà reluquée auprès de la mère Zizi. Là ousque c’est qu’on a acheté un bidet l’autre après-midi. Et puis, vous êtes tout plein gironde. On ne s’embêterait pas avec vous.
Il la serrait moins fort et lui faisait les yeux doux. La malheureuse fille de Fantômas, tremblante, à son tour dévisagea son brutal interlocuteur.
Il était vêtu d’une chemise de nuit crasseuse, dont bâillait le col sur sa poitrine velue. Un pantalon mal attaché lui serrait la ceinture, s’enfonçait dans de grandes bottes, et surtout, surtout Hélène distinguait ses bras, ses bras tachés de sang rouge et elle voyait du sang encore, du sang caillé, séché, coagulé sur ses mains, son vêtement.
– Mais qui êtes-vous donc ?
– Moi ? Jean-Marie l’équarrisseur. Allons, n’faites pas de magnes et venez visiter un peu la turne puisque aussi bien, tout à l’heure, vous vous donniez la peine de sauter le mur, rien que pour regarder la cour d’écorchage. Allons, v’nez donc.
Hélène, à cette minute, défaillait.
Pour tenter la périlleuse entreprise qu’elle venait de réussir, elle avait dû faire appel à toute son énergie, maintenant elle était à bout, épuisée.
Mais Jean-Marie, qui avait parfaitement reconnu la fille de Fantômas, et qui se demandait, très anxieux, ce que celle-ci avait bien pu venir faire au clos d’équarrissage, n’était nullement disposé à la laisser partir.
Il ouvrait le bras, dans le geste d’un homme qui veut prendre de force quelqu’un contre sa poitrine et il ricanait, risible mais formidable.
– Allons ! la donzelle, v’nez donc.
Mais, au même moment, brusquement, Jean-Marie culbuta dans l’ombre en poussant un cri sourd :
– Ah nom de…
Qu’arrivait-il donc ?
La fille de Fantômas, éperdue, n’eut même pas le temps de s’en rendre compte. Devant elle, Jean-Marie, tombé à terre, se débattait, luttant avec un inconnu qui l’avait empoigné par les épaules et violemment jeté sur le sol.
Une voix cria :
– Fichez le camp, fichez donc le camp, nom de Dieu.
Hélène suivit le conseil, prit sa course, s’enfuit, folle de peur.
***
Près du clos d’équarrissage, une heure plus tard, Jean-Marie se démenait pour rompre les liens dont on lui avait entouré les poignets, les chevilles, pour arracher le bandeau qui l’aveuglait.
L’apache-équarrisseur était furieux :
– Ah saloperie de saloperie, bon sang de bon sang, sûr et certain que c’était un coup monté que c’t’affaire-là. Mais je les repincerai tous les deux. Jour de Dieu, d’où diable venait-il ce maudit camelot, ce camelot qui s’est jeté sur moi, qui m’a arrangé comme je suis, et puis s’est trotté, si vite, si habilement que je sais plus du tout maintenant de quel côté il a fichu le camp, ni même ce qu’il voulait, ni même si la fille de Fantômas s’est sauvée avec lui ou toute seule ?
20 – LA TÊTE D’ŒIL-DE-BŒUF
– Vous ne voulez pas répondre ? vous vous obstinez à prétendre que vous ne comprenez rien à toutes ces aventures ? que vous êtes parfaitement innocent de la mort de cet officier ? que vous n’avez pris part à aucune des opérations criminelles relevées contre vous au cours de l’instruction ? C’est bien cela ?
– Mais, mon président, c’est la vérité pure.
– Eh bien, le jury appréciera. Nous allons suspendre quelques instants, puis nous reprendrons l’audience pour l’audition des témoins.
Le président de la Cour d’Assises se recouvrit et ses assesseurs se levèrent et, graves, dignes, imposants, majestueux, leurs robes rouges dessinant des taches sanglantes sur le fond sombre des boiseries, les magistrats, un par un, se retirèrent dans la chambre des délibérations, avec le désir de se reposer quelques instants pendant que les gendarmes entraînaient au dépôt le malheureux Œil-de-Bœuf qui comparaissait ce jour-là devant le jury criminel de Quimper.
Mais pourquoi l’apache parisien qui, avec Bec-de-Gaz et tant d’autres étoiles de première grandeur de la pègre des faubourgs, avait commis des milliers de crimes, « passait-il » aux assises, ce jour-là ?
Œil-de-Bœuf avait été arrêté quelques heures après le naufrage du Skobeleffau moment où il détroussait un noyé, un officier de marine russe, victime du naufrage.
Il y avait contre Œil-de-Bœuf, et l’acte d’accusation les avait relevées, de lourdes charges. Non seulement on l’accusait d’avoir assassiné l’officier qu’il dévalisait au moment de son arrestation, mais de plus, on l’accusait d’avoir pris part aux manœuvres des naufrageurs.
On ajoutait qu’Œil-de-Bœuf faisait partie de la bande interlope qui, quelque temps auparavant, s’étaient répandue sur la Bretagne entière, où elle avait volé, pillé, tué.
***
L’audience, présidée par un magistrat sévère, n’avait encore été marquée par rien d’intéressant.
Le public qui se pressait dans le Tribunal de Quimper n’avait pas encore eu l’occasion de frémir.
Œil-de-Bœuf, très abattu, se bornait à nier.
– Mon président, avait répété l’apache d’une manière ininterrompue, sur un ton de voix plaintif et résigné, j’ai rien fait, j’suis innocent.
Quelle importance ? Puisque Œil-de-Bœuf avait toutes les chances du monde d’être condamné à mort. Le crime suffisait. Les autres délits perdaient de leur intérêt.
Mais tout le monde dans l’auditoire, avait été persuadé de la culpabilité d’Œil-de-Bœuf, rien qu’à la lecture de l’acte d’accusation, et chacun maintenant attendait la comparution des témoins, avec la certitude que leur interrogatoire ne ferait qu’établir plus manifestement encore la culpabilité de l’accusé.
Pendant ce temps, sur la place de Quimper, un homme, d’une quarantaine d’années parlementait avec l’un des gendarmes qui montaient la garde à l’extrémité du couloir où on avait fait entrer les témoins.
– Laissez-moi donc passer. C’est stupide de m’interdire l’accès des chambres des témoins. Quand je vous dis que je suis policier.
– Mille regrets, monsieur, mais la consigne est la consigne.
– Je vous dis que c’est grotesque. Comprenez, je m’appelle Juve.
– Juve ? dit le gendarme, c’est vous monsieur Juve ? le policier Juve qui poursuit Fantômas ?
– Hé oui, c’est moi Juve. Vous comprenez bien, j’imagine, que ce n’est pas aux agents de la Sûreté qu’on interdit de causer aux témoins ? C’est notre métier, cela, mon ami.
Et haussant les épaules, superbe d’autorité, Juve, passa devant le gendarme interloqué, à bout de résistance.
Juve se dirigea vers la salle des témoins :
– M. Ellis Marshall ? Madame Sonia Danidoff ? princesse Sonia Danidoff ?
Juve, qui venait d’entrouvrir une porte, avait appelé deux personnes enfermées dans une petite pièce qui, entendant prononcer leurs noms, se retournèrent d’un même mouvement, fort surprises :
– Vous, monsieur Juve.
– Moi-même. Voulez-vous m’accorder une minute d’entretien ?
– Nous vous écoutons, monsieur Juve. Mais que diable désirez-vous ?
Juve entra dans la pièce, referma soigneusement la porte, sourit, puis très franchement, tendit la main à Sonia Danidoff.
– Princesse, je suis ici pour vous parler d’une affaire intéressante, mais qui ne peut vous causer aucune espèce de désagrément.
– Mais, monsieur Juve.
– Non plus qu’à M. Ellis Marshall.
Juve s’amusait visiblement.
– Aôh, répondit l’Anglais, je suis enchanté, monsieur Juve, de faire votre connaissance et serais très heureux d’apprendre ce qui me vaut le plaisir de votre visite. Venez-vous nous voir, M meSonia Danidoff et moi, au sujet du procès ? ou alors…
Il allait parler, c’était sûr, du maroquin rouge. La princesse ne lui en laissa pas le temps.
– Taisez-vous donc, mon cher Ellis, dit-elle, M. Juve va certainement nous expliquer ce qu’il désire ?
– Vous avez raison, fit Juve, je crois, monsieur Marshall que vous êtes ici, à Quimper, en compagnie de la princesse Sonia Danidoff pour vous plaindre du vol d’une automobile, vol dont vous avez souffert récemment alors que vous vous rendiez à la Pointe Saint-Mathieu, et qui est, si je ne m’abuse, imputé à Œil-de-Bœuf. Est-ce exact ?
– C’est exact, mais en quoi ?
– En quoi cela m’intéresse-t-il ? continuait Juve, mon Dieu, cela me touche directement. Figurez-vous, monsieur Ellis Marshall, figurez-vous, princesse, que j’éprouve en ce moment de violents remords. Si vous ne voulez pas, en effet, vous en rapporter à ma parole, je vais être cause d’une erreur judiciaire. Le réquisitoire et l’acte d’accusation font en effet grief à Œil-de-Bœuf de vous avoir volé votre voiture. Or, Œil-de-Bœuf n’a jamais touché à votre automobile. Je puis vous en donner ma parole.
– Qui donc a volé cette voiture ? demanda Sonia, n’est-ce point la bande des naufrageurs ? Parlez, parlez, Juve.
– Qui a volé cette voiture, princesse ? mais moi, moi, tout simplement, moi, Juve aidé de mon ami Jérôme Fandor.
Il expliqua comment.
– Dans dix minutes, conclut Juve, vous allez monsieur Marshall et vous princesse, témoigner contre Œil-de-Bœuf. Vous pouvez le croire coupable. C’est pour cela que je suis à Quimper.
Était-ce réellement pour éviter à Ellis Marshall et à Sonia Danidoff de faire une déposition inexacte que Juve s’était rendu à Quimper ?
On eût pu en douter à voir avec quel soin, quelle passion, Juve suivait les débats.
À la vérité le policier se doutait parfaitement qu’Œil-de-Bœuf était innocent du crime que la justice lui reprochait. Juve, de plus, savait que la fille de Fantômas s’était enfuie, non déguisée cette fois, sous sa véritable apparence de femme, à bord de la roulotte du père et de la mère Zizi, et que certainement, elle avait dû, lors du naufrage du Skobeleff, conserver son déguisement d’aspirant de marine.
Il n’avait pas eu de peine, en conséquence à deviner qu’Œil-de-Bœuf n’avait nullement assassiné l’aspirant de marine qu’on lui reprochait d’avoir tué, et qui n’était qu’un cadavre « utilisé » par la fille de l’Insaisissable. Pouvait-il cependant, l’excellent policier, sauver l’apache ? Avait-il les éléments suffisants pour emporter la conviction des membres du tribunal ?
Non.
Et c’est pourquoi Juve, très ému, assistait au procès d’Œil-de-Bœuf, appréhendant, à juste titre, une erreur judiciaire qui entraînerait la condamnation à mort de la sinistre crapule, qui certes méritait largement la peine capitale, mais pas pour les faits qui allaient la lui valoir.
Juve, à la reprise de l’audience, avait été s’installer au bout du prétoire, sur l’une des banquettes de bois réservées au public. Il fut tout surpris de voir venir prendre place à côté de lui, un extraordinaire petit bossu, vieux et sale, remarquablement loquace, qui, tout de suite, engagea la conversation avec lui, en déclarant, péremptoire :
– Pour moi, vous savez, l’accusé est complètement innocent. Jamais Œil-de-Bœuf n’a tué cet officier. Qu’en pensez-vous ?
– Vous avez raison, répondit-il au bossu, instinctivement satisfait de rencontrer quelqu’un de sympathique à l’accusé. Cet homme est certainement innocent du crime qu’on lui reproche. Malheureusement, comment le prouver ?
– Eh, dit le bossu, comment le prouver ? je ne sais pas moi. Ce n’est pas mon métier. C’est affaire aux agents de la Sûreté. Ce devrait être à eux de toujours trouver les coupables et de toujours défendre les innocents.
Or, Juve, étonné de la remarque, eut à peine le temps de tourner la tête dans la direction de son mystérieux interlocuteur, que celui-ci se levait, et, sans prendre garde aux signes impératifs de l’huissier que scandalisait un pareil sans-gêne, traversait le prétoire, s’en allait vers la porte de la salle, la franchissait, disparaissait.
– Ah ça ! songea le policier, qui diable est ce bonhomme ? et pourquoi m’affirme-t-il qu’Œil-de-Bœuf est innocent et qu’il appartient aux agents de la Sûreté d’arrêter les coupables ? Quel est ce bossu ?
Il fallut peu de temps à Juve pour réfléchir. Il lui en fallut moins encore pour se décider à l’action.
Brusquement, le policier se leva, quitta lui aussi le prétoire où s’achevaient maintenant les dépositions des témoins venant confirmer les agissements de la bande des naufrageurs. Juve s’élança hors du tribunal, dans l’intention de rejoindre le bossu.
Le policier parvint sur le perron du Palais de Justice, trois minutes peut-être après que son bizarre interlocuteur devait en avoir descendu les degrés. Or, Juve à peine en haut des marches, aperçut le bossu sur les traces duquel il se précipitait – un bossu d’aspect misérable, un pauvre diable – qui avait déjà eu le temps de traverser la place. Juve le vit monter dans une superbe voiture automobile, dont le moteur trépida sous la conduite d’un mécanicien déjà en train d’en manœuvrer les leviers.








