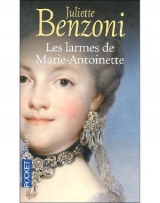
Текст книги "Les Larmes De Marie-Antoinette"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
– Où êtes-vous descendue ? demanda-t-il.
– Au Ritz. D’abord, j’aime cet hôtel. En outre, il présente l’avantage d’être situé près de ma future exposition.
– Et c’est ?
– Chez moi ! triompha Vauxbrun. Je vais déménager une partie de mon magasin mais sans toucher au décor. Les œuvres de Pauline seront admirablement mises en valeur par mes tapisseries anciennes…
– Bravo ! On dirait que tu as l’art de mettre toutes les chances de ton côté…
– Chacun son tour ! Pendant que je me morfondais à Boston, toi tu coulais des jours délicieux à Newport.
Le regard de Pauline alla de l’un à l’autre. La tension était palpable et elle se hâta d’intervenir :
– Tellement délicieux qu’il a failli y laisser la vie ! Ainsi qu’Adalbert et certains autres… Veuillez m’excuser, je désire saluer Mme de Sommières !
– Nous allons faire mieux, s’empressa l’antiquaire qui se sentait sur un terrain glissant. Il se fait tard et la nuit fraîchit : je vais lui proposer de la ramener à l’hôtel avec Mlle du Plan-Crépin.
Tante Amélie accepta volontiers même si la distance entre la villa et le Palace était courte : elle sentait de la lassitude et craignait l’humidité du petit matin :
– Je ne suis plus à l’âge romantique où, après avoir dansé la nuit entière, on s’isole à deux pour regarder se lever le soleil, soupira-t-elle. Je suis à celui des rhumatismes. Aussi ne vais-je pas tarder à partir pour Dax mais auparavant, chère baronne…
– Dites Pauline, je vous en prie !
– Alors, Pauline, j’aimerais vous avoir à dîner chez moi ! La fête étant finie, je compte regagner la rue Alfred de Vigny le plus tôt possible !
– Oh non ! gémit Marie-Angéline. La fête est peut-être finie mais il y a…
– Une affaire suffisamment sordide pour que je souhaite vous en extraire ! D’ailleurs il faut que je rentre si je veux garder Eugénie. C’est ma cuisinière, précisa-t-elle à l’usage de l’Américaine, et elle menace de rendre son tablier si je la laisse encore longtemps au chômage forcé ! Ma chère, vous viendrez apprécier ses talents. Nous vous en serons reconnaissantes toutes les deux… Quant à vous, Plan-Crépin, vous aurez le choix entre ma vénérable voiture et le train. Que diable, Versailles n’est qu’à 17 kilomètres de Paris…
Quand la Rolls-Royce de Vauxbrun eut disparu, Aldo et Adalbert rentrèrent dans la maison où quelques membres du Comité formaient encore cercle autour de leur hôtesse, qui aimait à prolonger la nuit jusqu’au retour de la lumière. On commentait la soirée et l’on buvait. À l’exception de Mme de La Begassière, il ne restait que des hommes. Mme de Malden avait emmené une Léonora visiblement furieuse. Quant à Crawford, s’il était toujours là, il avait choisi de fumer son dernier cigare sur la terrasse en compagnie d’un verre de whisky. Aldo alla le rejoindre. Il y avait des moments où l’Écossais l’intriguait : il semblait n’attacher aucune importance aux relations de sa femme avec Vauxbrun. Tout à l’heure, elle avait fait une évidente crise de jalousie qu’il n’avait pas paru entendre. De même, il l’avait laissée partir sans faire le moindre geste pour la retenir : il est vrai qu’elle avait énormément bu et qu’il ne lui restait rien d’autre à faire qu’aller se coucher.
Arrivé près de l’Écossais, Morosini ne dit rien, se contentant d’allumer une cigarette et d’en tirer quelques bouffées. Au bout d’un moment il entendit :
– Croyez-vous qu’elle soit venue cette nuit ?
– Qui donc ?
– Elle voyons !… la Reine ! Je n’ai pensé qu’à elle au cours de cette soirée en me demandant si elle lui plaisait. Tant que cela a duré j’ai attendu un signe, un geste… j’ai fouillé les buissons du regard en espérant l’apercevoir… Il est vrai qu’avec ces figurants répandus un peu partout… par Elsie.
– Vous espériez voir… la Reine ? émit Morosini un peu suffoqué tout de même.
– Évidemment ! Trianon est hanté, vous ne le saviez-vous pas ?
– Vous faites allusion à ces deux Anglaises, miss… Moberly je crois et miss Jourdain qui se sont trouvées soudain introduites dans le passé, un jour de l’été 1789. Elles auraient vu la Reine coiffée d’un grand chapeau de paille en train de dessiner. On en a beaucoup parlé il y a quelques années… C’était étrange évidemment…
– Oh, elles n’ont pas été les seules !… En 1908 des amis américains, les Crooke, ont vu, à plusieurs reprises, la dame à la capeline en train de dessiner. Elle apparaissait et disparaissait avec la même soudaineté. Une autre fois, Mrs Crooke a vu un seigneur coiffé d’un tricorne noir qui l’a saluée avant de s’évaporer. Deux Anglaises, encore, ont vu une femme en coiffe secouer un linge à la fenêtre de la Ferme en ruine. Plus récemment un magistrat londonien a rencontré une dame en grande robe de satin jaune escortée de deux hommes en habit de cour. Moi-même enfin…
– Vous l’avez vue ?
Le regard perdu dans les ombres blanchissantes du parc, Crawford n’offrait à son compagnon qu’un profil dont le dessin le surprit. À cause de l’empâtement du visage on le remarquait moins mais le nez en bec d’aigle, la bouche serrée, l’immobilité de l’œil sous sa lourde paupière l’apparentaient aux rapaces. L’homme ne bougeait plus. Il semblait suivre à travers le ciel quelque chose qu’il était seul à distinguer.
– Dites-moi si vous l’avez vue ? insista doucement Aldo.
– Oui… à deux reprises ! La première fois c’était il y a trois ans dans l’escalier de Trianon. Elle portait cette merveilleuse robe d’un bleu un peu vert qu’a immortalisée Mme Vigée-Lebrun. La dernière fois c’était sur les marches de son petit théâtre, qu’il est impossible d’utiliser maintenant. Elle avait ce costume de bergère qui l’amusait jadis mais elle désignait la bâtisse et le Hameau dont il faut bien admettre qu’ils ont un sérieux besoin de réparations et elle pleurait… C’est à la suite de ce fait que j’ai lancé l’idée de l’exposition, afin d’attirer l’attention sur le délabrement de ce coin charmant où elle se plaisait tant ! Je suis riche et j’ai de nombreuses relations : cela a été facile.
Aldo avait vécu assez d’expériences supranormales pour mettre en doute les confidences de l’Écossais.
– Et vous avez réussi ! Dommage qu’un tueur s’acharne à tenter de détruire ce que vous et votre Comité avez réalisé ! Ce qui est bizarre c’est qu’il s’attaque seulement à des descendants – ou supposés tels ! – de gens qui ont joué un rôle si néfaste dans l’existence de Marie-Antoinette. Je ne vous cache pas que je redoutais une mauvaise surprise pendant le déroulement de la fête.
– Pas moi ! Nous avons trop besoin de l’argent récolté ce soir. S’il est logique avec lui-même l’assassin ne pouvait pas risquer de semer une panique.
– Alors, pourquoi depuis l’ouverture ces meurtres à répétition qui pouvaient tout détruire ?
– Pourtant il n’en a rien été… au contraire. Cela nous a fait, si l’on peut dire, la meilleure des publicités… et la Reine n’a pas manifesté son mécontentement. C’est pour moi la preuve que les… victimes portaient en elles le sang de ces misérables dont elle a eu à souffrir !
– C’est peut-être un peu léger comme raisonnement ?
Cette fois, Crawford se redressa pour regarder son voisin mais dut s’appuyer à la balustrade afin d’assurer son équilibre, preuve qu’il avait beaucoup bu même si ses propos ne s’en ressentaient pas :
– Vous me surprenez ! Vous, descendant d’une longue lignée, comment pouvez-vous nier que votre personnalité ne réunisse celles qui vous ont précédé ?
– Je vous croirais volontiers pourtant…
– Non. Vous savez que j’ai raison. Parce que à travers le temps j’ai hérité de celle de mon aïeul Quentin qui aima la Reine en silence – avec d’autant plus d’ardeur qu’elle n’en sut jamais rien – et qui a dépensé une fortune pour l’arracher à son destin tragique. Il a financé la fuite vers Montmédy. Malheureusement, Fersen avait l’entière confiance de Marie-Antoinette et l’exécution lui a été confiée. Cet imbécile en a fait un désastre…
– Cet imbécile ? Fersen et votre ancêtre n’étaient-ils pas amis ?
– Comment peut-on être l’ami de l’homme qui couche avec votre femme ? Sa passion pour la Reine n’empêchait pas le Suédois d’être l’amant de mon aïeule Léonora…
– Léonora ?…
Crawford se mit à rire mais ce rire grinçait :
– Oui, comme ma femme, et italienne comme elle. C’est drôle, n’est-ce pas, qu’après plus de cent cinquante ans, un même couple se reforme ? C’est à cause de cette similitude de noms que je l’ai épousée quand je l’ai rencontrée aux Indes. La première Léonora en venait aussi. Après avoir été la maîtresse du duc de Wurtemberg, de l’empereur Joseph II et d’un diplomate français, elle avait suivi là-bas un Irlandais nommé Sullivan qui l’épousa. Quentin Ier avait édifié son énorme fortune dans la Compagnie des Indes. Il y séjournait lors de leur rencontre et avant de repartir pour l’Angleterre, il l’a enlevée. C’est sur le tard qu’ils se sont mariés !
– Et… c’est uniquement à cause de son prénom que lady Léonora est devenue votre épouse ?
– Revoyez-la telle qu’elle était tout à l’heure, vous aurez votre réponse !
Dans sa robe blanche inspirée de l’Empire, Léonora était en effet fort belle ce soir. La simplicité de la coupe mettait en valeur le large collier de diamants orné de grandes pendeloques qui accrochait la lumière et la renvoyait en flèches bleutées.
– Je comprends… mais, au fait, il m’a semblé reconnaître son collier. Marie-Antoinette ne l’aurait-elle pas porté ?
– Si. Il faisait partie des joyaux ayant appartenu à la mère de Louis XVI, Marie-Josèphe de Saxe. Louis XV les avait offerts à la dauphine. Et à présent vous allez me demander pourquoi il n’a pas été exposé avec les autres bijoux ? Léonora refuse de s’en séparer. Elle le considère comme son talisman et, chez nous, elle passe des heures à le contempler, à le faire jouer dans la lumière, à le caresser même…
– Parce qu’elle partage votre culte de la Reine ?
– Absolument pas mais elle aime son goût et ses bijoux la fascinent. Ce qui la rapproche encore de la première Léonora. On dit de celle-ci, quand elle s’appelait encore Mrs Sullivan, qu’elle était dévouée corps et âme à Marie-Antoinette mais c’est faux. Axel de Fersen était devenu son amant et un amant passionnément aimé. Tirez vous-même les conclusions !
– Elle n’aurait tout de même pas tenté quelque chose pour faire échouer la fuite ?
– Honnêtement, on n’en a jamais rien su ! Et c’eût été dangereux : si elle l’avait fait et que mon aïeul l’eût appris, il était capable de la tuer. D’autre part, si l’aventure réussissait, elle n’aurait plus revu Fersen qui devait rejoindre la Reine. Alors…
– Disons que cela fait partie des ombres du passé. Vous possédez d’autres bijoux de même provenance ?
– Non, c’est le seul en dehors d’une infinité de boîtes à mouches, de tabatières, de boîtes à pastilles, de flacons, d’éventails et autres objets provenant de Versailles, des Tuileries et même du Temple et de la Conciergerie qui me sont plus précieux encore. Et que j’aimerais vous montrer. Pourquoi ne viendriez-vous pas dîner un soir prochain avec quelques amis ?… Ce serait pour moi un réel plaisir…
– Pour moi aussi, n’en doutez pas.
– En ce cas nous arrêterons une date avec ma femme. À présent je vous donne le bonsoir. Il est temps que je rentre.
Les deux hommes se séparèrent sur une poignée de main et Aldo rejoignit Adalbert, qui bavardait sur le coin d’un divan avec Elsie Mendl. Celle-ci riait beaucoup :
– Savez-vous que, selon notre ami, j’aurais d’innombrables points communs avec Néfertari, l’épouse du grand Ramsès II ! Décidément, j’aurai tout entendu !
Considérant le fin visage auréolé de ses cheveux argentés, Aldo sourit :
– Vous devriez le croire : il se trompe rarement quand il s’agit de l’Égypte ancienne et si vous acceptiez de porter une lourde perruque de laine noire…
– Je préfère rester ce que je suis ! En tout cas, ce soir nous avons ramassé une petite fortune… et aucun cadavre n’est venu troubler la fête…
En rentrant à l’hôtel, Aldo fit part à Adalbert de l’invitation de l’Écossais :
– Ce sera bientôt, je pense. J’ai l’intention de rentrer chez moi dès que possible.
– Vraiment ?… J’aurais cru le contraire.
– Eh bien, tu te trompais…
Puis baissant la voix jusqu’à un murmure trahissant une lassitude inattendue :
– Je ne suis pas un surhomme, Adal ! Quelqu’un dont j’ai oublié le nom a dit que la meilleure façon d’oublier une tentation était d’y céder mais il y en a qui peuvent mettre une âme en péril…
Soulagé, l’égyptologue passa un bras compréhensif sous celui de son ami :
– Une âme non… mais un couple peut-être. Elle est plus séduisante encore que dans mon souvenir, cette Pauline, et je sais bien pourquoi.
– Vraiment ?
– Allons ne joue pas les modestes ! Elle est amoureuse de toi et tu le sais pertinemment. C’est pourquoi je t’approuve d’employer la technique de Napoléon : la fuite et le plus tôt sera le mieux !
On venait de franchir la grille de l’hôtel à l’intérieur duquel les femmes de ménage étaient à l’ouvrage. Aldo alla s’asseoir dans un fauteuil de la terrasse.
– Tu crois qu’elle m’aime ?
– Mais je n’en sais rien ! gronda Adalbert furieux contre lui-même. Il avait voulu adoucir le désir de séparation affiché par Aldo et il avait échoué misérablement. Écoute, poursuivit-il, si je ne savais ce que je sais, je te dirais : passe-toi l’évidente envie que tu as d’elle puis, sans respirer, saute dans le Simplon Express ! Mais…
– Ça veut dire quoi : « Si je ne savais… » ?
– … que c’est déjà fait !… Pardonne-moi mais il m’est arrivé, l’été dernier, d’écouter ce qui se passait derrière certaine porte de bibliothèque.
– Ah !
Aldo était trop désorienté pour avoir le courage de se fâcher. Il leva sur son ami un regard peiné :
– Et tu penses ?
– Qu’il faut que ce soit la dernière nuit de Casanova ! Si tu recommences, tu auras encore plus de mal à t’arracher à elle et tu ramèneras à ta femme un époux défraîchi… Va dormir à présent ! Tu es fatigué et comme moi tu as trop bu. Quelques heures de repos, une douche et tu verras les choses différemment. Si tu veux, je t’accompagnerai à Venise…
– Ça, c’est une idée !… Tant pis pour le dîner de Crawford : on ramène Tante Amélie chez elle et on part !
– Sans oublier tout de même de faire nos adieux à Lemercier !
Depuis plusieurs heures Aldo dormait de ce bon sommeil des fermes résolutions quand le téléphone sonna lui apportant la voix courtoise et précise du chef de la réception : le journaliste Michel Berthier était en bas et insistait pour être reçu.
Un coup d’œil à sa montre affichant midi lui fit admettre que l’heure était plus que convenable pour une visite :
– Priez-le d’attendre dix minutes et faites-le monter ! Envoyez-moi aussi du café très fort ! Pour deux !
Il sauta à bas de son lit, se précipita sous la douche sans attendre que l’eau chauffe, s’étrilla vigoureusement, s’arrosa de lavande anglaise et s’habilla sommairement d’un pantalon de flanelle grise, d’un chandail de même couleur sur une chemise blanche. Il achevait de se brosser les cheveux quand on frappa : précédé par un plateau de café que soutenait un serveur, Berthier fit son apparition avec une mine défaite laissant supposer qu’il n’avait pas dû dormir beaucoup la nuit précédente.
C’était inhabituel chez lui. Grand garçon d’un mètre quatre-vingts taillé comme un rugbyman, le journaliste jouissait d’une évidente bonne santé et ne cultivait pas les états d’âme. Il accepta avec empressement le fauteuil confortable et la tasse de café que Morosini lui tendait et en avala le brûlant contenu avant même que le domestique se fût retiré. Du coup, Aldo lui en versa une seconde.
– Ça n’a pas l’air d’aller très fort ? remarqua-t-il le nez dans sa propre tasse.
– Ça ne va même pas du tout ! La petite Autié a disparu !
– Comment ça disparu ?
– Envolée, volatilisée ! Il me semblait pourtant que disparu était le terme idoine ? J’explique : hier en fin d’après-midi on l’a vue rentrer chez elle et on n’a plus bougé.
– C’est qui : on ?
– Moi et mon copain Ledru, le photographe avec qui en général je fais équipe. On s’est installés dans ma voiture légèrement en retrait de la grille afin de pouvoir surveiller les allées et venues éventuelles. Je vous avoue qu’on s’est demandé un instant ce qu’on faisait là. Tout avait l’air si tranquille ! Pas un chat dehors en dépit de la douceur du temps qui incite généralement les gens à prendre le frais devant leur porte…
– C’est un quartier de petites maisons pourvues de jardins. On prend le frais chez soi !
– Vous n’y connaissez rien ! Dans mon village d’Indre-et-Loire, chacun a son jardin. N’empêche que tout le monde s’installe dehors avec des chaises ou des tabourets, histoire de se raconter les derniers potins de la journée…
Devant le geste impatient de Morosini, il poursuivit :
– J’y viens ! Donc on a pris la veille à tour de rôle. Vers minuit c’est moi qui étais de garde et j’ai entendu du bruit. Assez fort comme si quelqu’un tapait dans les murs pour accrocher des tableaux ou quelque chose dans ce genre-là. J’ai réveillé Ledru…
– Et vous êtes allés voir ?
– Sous quel prétexte ? En rentrant, la demoiselle avait fermé ses volets et aussitôt elle a allumé. D’ailleurs, au moment du vacarme c’était encore éclairé. J’ai tout de même escaladé le mur pour essayer de voir par les fentes des volets. J’ai juste aperçu les jambes de la demoiselle qui devait être assise dans un fauteuil. Jolies d’ailleurs ! Le bruit s’est arrêté à ce moment et je suis retourné à la voiture. La demoiselle a fini par éteindre et moi j’ai passé la garde à Ledru. La nuit s’est achevée sans autre incident.
Au matin on a vu la voiture du laitier. Il a sonné puis sans attendre il a posé la bouteille de lait et il est parti. La bouteille est restée là sans qu’on vienne la chercher mais on ne s’est pas inquiétés en pensant que la demoiselle dormait. Plus tard, en revanche, il y a eu le facteur. Il n’y avait pas de courrier mais un petit paquet pour lequel il devait avoir besoin d’une signature. Et lui il a sonné, sonné et resonné pendant un bon moment. Il a fini par en avoir assez, a déposé ce qui devait être un avis de passage et puis il est reparti…
« Cette fois on y va ! » m’a dit Ledru, en sortant son couteau suisse grâce auquel nous avons ouvert la grille sans trop de peine après nous être assurés qu’il n’y avait personne en vue. La porte de la maison n’a pas présenté plus de difficultés et nous sommes entrés. À l’intérieur tous les tableaux étaient par terre et certains meubles renversés. Nous avons appelé : pas de réponse ! Alors on a fait le tour et, dans une chambre qui devait être celle de la jeune fille, on a vu le lit en désordre et la fenêtre grande ouverte… elle donne comme vous le savez sans doute sur un chemin menant à un bâtiment…
– L’atelier du grand-père. Vous y êtes entrés ?
– Comme de juste mais il n’y avait rien d’intéressant à l’exception d’une espèce d’autel avec dessus un torse de femme nue qu’on a trouvé bizarre. Les chandelles qui sont devant ont dû servir dans la nuit : ça empestait la cire refroidie. Après on a fouillé le jardin mais nulle part on n’a trouvé trace de la demoiselle. Ledru voulait aller à la police mais comme c’est vous qui m’avez envoyé j’ai préféré venir vous voir…
– Vous avez eu raison, dit Aldo songeur. Vous avez vraiment tout examiné ?
– Pour ça, on peut nous faire confiance. Tout a été passé au peigne fin et on a pratiquement acquis la certitude que votre protégée est partie en chemise de nuit et en pantoufles. On a retrouvé ses vêtements d’hier et, dans son armoire aucun cintre n’était inoccupé. Et si vous ajoutez ceci…
D’un morceau de papier plié dans sa poche Berthier sortit un large tampon de coton auquel s’attachait encore une odeur de chloroforme.
– Cela signe l’enlèvement ! soupira Aldo. Et comme vous n’avez pas perdu l’entrée de vue on peut se demander par où les ravisseurs sont passés.
– L’atelier s’appuie à un mur possible à franchir. Même avec un fardeau si l’on est suffisamment solide.
– Il donne sur quoi votre mur ?
– Une impasse aveugle et, comme il a pas mal plu ces temps derniers, la terre y a gardé l’empreinte de pneus assez larges indiquant une grosse voiture. Qu’est-ce qu’on fait maintenant ?
– On déjeune ! Faites un brin de toilette pendant que je vais chercher Vidal-Pellicorne. Où est votre Ledru ?
– Il est rentré à notre hôtel… qui n’est pas celui-là.
– On va l’y prendre. Il y a, paraît-il, rue du Pain, près du marché Notre-Dame, un bon restaurant tranquille. Après, vous rentrerez provisoirement dans le rang et moi je vais voir le commissaire Lemercier pour lui dire que je suis allé ce matin chez Mlle Autié et que je crains fort qu’elle n’ait disparu.
Il fut impossible de ramener Adalbert à la réalité du jour. Victime d’une solide gueule de bois, il était vert comme une salade et refusait de bouger même une oreille. On le laissa là.
Après un repas confortable au cours duquel Aldo fit pour Berthier et Ledru le compte rendu détaillé de la fête nocturne, on se sépara : les journalistes pour téléphoner le « papier » qu’il venait de leur suggérer et Morosini pour se rendre à l’hôtel de police afin de faire part à Lemercier de son « inquiétude » au sujet de Caroline.
Plus « Dur-à-cuire » que jamais et l’œil mauvais, le policier le reçut comme un chien dans un jeu de quilles. Assis à son bureau, la tête dans les épaules, il ne lui offrit pas de s’asseoir et grogna :
– Il date de quand votre dernier coup de téléphone ?
– Mais… un peu avant midi. Pourquoi ?
– Vous ne seriez pas allé faire un tour chez elle, par hasard ?
– Mon Dieu non ! Je me suis couché extrêmement tard et je n’ai pas quitté l’hôtel ce matin, fit Aldo avec la satisfaction de dire la vérité. Je venais même vous demander de me faire accompagner par un de vos hommes. Je ne vous cache pas que nous sommes soucieux, Mme de Sommières et moi, d’avoir dû la laisser rentrer dans une maison aussi… malsaine !
– Cette grande inquiétude ne vous a pas empêchés de passer une excellente soirée, n’est-ce pas ?
Le ton était franchement acerbe mais Aldo ne parut pas le remarquer :
– Vous savez pour quelle raison nous l’avons maintenue puisque votre opinion allait dans ce sens mais nous en avons connu de plus… détendues. Tout le temps qu’elle a duré nous avons appréhendé une catastrophe et quand tout a été fini, nous étions soulagés…
– Vous redoutiez une catastrophe, ricana Lemercier en cherchant fébrilement un papier parmi ceux qui encombraient son bureau. Est-ce que ça vous paraît suffisant ? Il y a là une petite plaisanterie dont je ne suis pas certain que vous allez apprécier le sel !
Du premier coup d’œil, Aldo reconnut l’écriture et sentit un frisson désagréable couler dans son dos :
« À mon grand regret, écrivait l’assassin, il me faut constater que vous ne vous donnez guère de peine pour vous procurer ce que je vous avais demandé. La larme est introuvable, n’est-ce pas ? Vous vous contentez de tendre le dos dans l’attente d’un nouveau cadavre ? C’est assez facile, au fond ! Aussi me mettez-vous dans l’obligation de stimuler votre zèle. En attendant que le diamant reparaisse en surface, ce qui ne saurait manquer un jour ou l’autre, je me suis pris d’un intérêt passionné pour deux autres parures de Marie-Antoinette ; les diamants roses du prince Morosini et les bracelets de son beau-père le richissime Kledermann. Et comme je me doutais bien que mon simple désir risquait de vous paraître insuffisant je me suis assuré la collaboration – tout involontaire ! – de la charmante et si malheureuse Caroline Autié. Depuis cette nuit elle est entre mes mains et n’en sortira intacte que si vous vous montrez raisonnables. Je vous ferai savoir, en temps voulu, le lieu et l’heure où nous ferons l’échange. Tenant compte que Morosini n’est pas seul engagé dans cette affaire et qu’il lui faut avertir son beau-père, sachez que je vous donne cinq jours. Après cela, chaque soleil qui se lèvera marquera pour ma belle prisonnière la perte d’une de ses grâces : un doigt, une oreille, un autre doigt, la seconde oreille. Le nez ne viendra que si vous vous montrez par trop avare. Cependant, je suis persuadé de ne pas être contraint d’en arriver là : ces messieurs sont trop galants pour mettre en balance quelques colifichets d’une part et la beauté d’une malheureuse dont c’est la seule richesse… Cela dit, je vous laisse à vos réflexions en vous conseillant de ne pas recourir une seconde fois au coup de la copie !… Ce que je tiendrais pour une offense… »
Suivaient des considérations sur les déviations de l’âme humaine, singulièrement sur l’avarice cause de bien des maux, et un long dithyrambe sur la Reine que Morosini lut avec agacement : ce misérable voyait un pieux devoir dans la restitution à Marie-Antoinette du trésor personnel dont elle avait été privée. Cela par tous les moyens, fût-ce les plus sanglants…
– Écœurant ! exhala Morosini en rendant la lettre au commissaire.
– Pour vous sans doute mais en ce qui me concerne je trouverais plutôt insultant !
– Pour qui ? Pour vous ?
– Naturellement. Ce genre de poulet aurait dû vous être adressé avec l’ordre exprès de ne pas avertir la police. Or, c’est à moi qu’on l’envoie, preuve évidente où l’on me tient… On me prend pour un imbécile.
– On peut l’interpréter différemment. Cette lettre vous fait l’arbitre de la situation. Si mon beau-père et moi-même n’obtempérons pas, nous sommes déshonorés aux yeux de la force publique vite relayée par la presse. C’est habile au contraire…
– Que comptez-vous faire ?
– Prendre le premier train pour Zurich ! Ce genre de tractation ne saurait passer par le téléphone et, par chance, nous avons cinq jours !
– Mais en ce qui concerne votre part du marché ?
Le regard dédaigneux qu’Aldo posa sur Lemercier le vengea des avanies que celui-ci lui avait fait subir :
– Entre la vie d’une jeune femme et un joyau, si cher qu’il soit à mon cœur de collectionneur, pensez-vous réellement que je puisse hésiter ? Je donnerai ce que l’on exige de moi… mais je ne vous empêche pas de faire, de votre côté, quelques efforts pour sauver Mlle Autié et mettre la main sur le maître chanteur…
– Et… M. Kledermann ?
– Je ne peux répondre pour lui. C’est un homme d’honneur, sans aucun doute, un grand seigneur même mais il ne guérit pas de la blessure causée par la mort tragique de son épouse et les bracelets qu’on lui réclame étaient de ceux dont elle aimait se parer. C’est pourquoi je préfère lui parler… si toutefois vous acceptez de me rendre mon passeport ?
De mauvaise grâce, Lemercier fouilla dans un des tiroirs de son bureau, en tira la pièce demandée :
– Vous n’en profiterez pas pour rentrer à Venise ?
Le sang d’Aldo ne fit qu’un tour. S’appuyant des deux poings sur le bureau et se penchant pour être à la hauteur de l’adversaire, il lui jeta à la figure :
– Vous êtes bien un flic ! Perdez donc cette habitude de jauger les gens à votre aune personnelle ! S’il n’existait pas des Langlois et des Warren, ce serait à désespérer de l’espèce !








