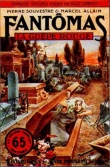Текст книги "La disparition de Fandor (Исчезновение Фандора)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Il fallait en finir cependant. Le gérant péremptoire donnait des ordres, éloignait les serviteurs.
– À vos ouvrages, voyons, je ne veux personne ici ! Narcisse, montez dans votre chambre. Je vous ferai appeler tout à l’heure. Félicie, partez à la lingerie. Vous, Guillaume…
Le gérant n’acheva pas.
Le caissier, en effet, mis enfin en possession de son pantalon et de son veston, s’était rapidement habillé. D’un geste instinctif, il fouillait dans ses poches et voilà qu’une pâleur soudaine envahissait son visage.
Tandis que Narcisse Lapeyrade s’apprêtait à remonter dans sa chambre, ainsi qu’on venait de le lui commander, Guillaume se précipita sur lui, Guillaume à son tour était blême de rage.
– Misérable, cria-t-il, vous m’avez volé.
Ce fut une stupeur.
Déjà le gérant s’élançait, prêt à séparer les deux hommes, déjà Félicie revenait sur ses pas, joignant les mains, terrifiée dès lors que ce n’était plus son mari qui se plaignait, mais bien son cher amant.
– Misérable, cria toujours Guillaume, vous m’avez volé la clef du coffre, rendez-la-moi !
« Je n’ai plus la clef du coffre, répétait Guillaume, tout en se fouillant fébrilement. Mes vêtements étaient sous le lit, c’est sûrement Lapeyrade qui a pris cette clef.
Le mari trompé, en entendant une pareille affirmation, demeurait complètement muet, offrant l’aspect d’un homme anéanti, abasourdi, ahuri. Pourtant, Félicie déjà, s’avançait. La jeune femme, elle aussi, était tremblante de colère.
– Tais-toi, Guillaume, suppliait-elle, ce n’est pas Narcisse qui t’a volé la clef, c’est un autre, un autre homme, un homme qui était dans la chambre.
– Voyons, Madame, commença Juve, s’avançant vers Félicie, que diable nous racontez-vous là ? Il y avait cette nuit, dans votre chambre, combien de personnes ? Votre mari, n’est-ce pas ? Votre amant ? Et puis qui ?
– Et puis quelqu’un, expliqua Félicie. Quelqu’un que je ne connais pas, quelqu’un qui est parti en m’embrassant, que j’ai cru être Guillaume.
Mais c’était là une affirmation si stupéfiante que d’abord les témoins de la scène se gardèrent d’y ajouter foi.
Guillaume présentait d’ailleurs, lui aussi, le visage stupéfait d’un homme qui apprend son infortune.
– Alors ? demandait-il, dévisageant Félicie, alors, tu me trompais aussi, comme lui ? comme un imbécile. Nous étions trois, quand je suis venu chez toi ? Tu recevais déjà un amant ? Où l’avais-tu mis celui-là ?
Et Lapeyrade, le malheureux mari, soudain satisfait, en voyant le malheur de Guillaume, ajouta de son côté :
– Où l’avais-tu mis, Félicie ? il n’y a qu’un placard.
Pour couper court aux explications orageuses qui se préparaient évidemment, M. Hoch finit par faire descendre Félicie Lapeyrade, son mari, le caissier et Juve en qualité de témoin des premières altercations dans son bureau particulier.
Là, à l’abri des regards ironiques, des chuchotements du personnel et des voyageurs accourus, Félicie s’expliqua. Elle conta l’étrange aventure de la nuit précédente. Elle déclara :
– Je m’étais à peine recouchée avec mon mari, qu’un homme m’a réveillée, j’ai cru que c’était Guillaume, qu’il était sorti du placard. Je me suis levée pour lui ouvrir la porte, il est parti en m’embrassant, et je croyais toute l’aventure terminée, lorsque ce matin, j’ai eu la surprise de m’apercevoir que Guillaume était toujours dans son placard. Quel est donc l’individu sorti de chez moi qui n’était ni Guillaume, ni mon mari ? Je jure que je ne le sais pas.
Juve avait beau multiplier les questions, faire préciser les détails, le policier n’arrivait guère à démêler la vérité. Et pendant que, dans un angle du bureau directorial, Narcisse Lapeyrade marchait, la main tendue, vers Guillaume, en lui déclarant : « Puisque vous êtes trompé vous aussi, Monsieur, je vous pardonne et je ne vous en veux plus », Juve s’approchait du gérant accablé, désespéré du scandale, et lui conseilla :
– Avez-vous une double clé du coffre-fort ? Je crois qu’il serait utile d’aller visiter le contenu de votre caisse ?
C’était chose faite une demi-heure plus tard, et la sinistre vérité apparut alors : le coffre avait été cambriolé. Il était vide. L’homme qui avait volé la clef de Guillaume avait trouvé moyen d’entrer dans le bureau, d’ouvrir la caisse, de s’emparer non seulement de l’argent qui y était contenu, mais encore de tous les bijoux qui s’y trouvaient déposés, donnés en garde par les voyageurs.
– C’est inimaginable, c’est affolant, hurlait le malheureux gérant, s’apercevant du vol commis. Je ne sais plus où donner de la tête. Que faire ? que faire ?
Juve, lui, paraissait peu embarrassé.
– Un agent secret qui n’en est pas un, monologuait le policier. Un faux amant qui est tout simplement un rat d’hôtel, hé, hé, voilà qui pourrait bien faire croire que Fantômas n’est pas loin d’ici.
***
Une heure plus tard, Juve, dans la chambre de Félicie Lapeyrade, où la jeune femme achevait de se réconcilier avec son gros mari en lui prouvant, avec des arguments extraordinaires, que tout cela était l’effet d’un malentendu, Juve découvrait sous le lit des traces de boue, de petites traces insignifiantes, mais qui, pour lui, étaient significatives. Et Juve ne s’y trompait pas :
– C’est bien cela, murmurait-il, c’est un voleur très habile, très audacieux. Hé, pourquoi pas Fantômas, qui a fait le coup ? Ah sapristi, que faisait-il donc dans cet hôtel ? comment avait-il l’audace d’y séjourner ? Et Fandor qui n’arrive pas ? Voilà deux jours que je lui envoie télégramme sur télégramme.
14 – LA CAPTIVITÉ DE FANDOR
– Pourquoi donc riez-vous. Monsieur Jérôme Fandor ?
– Pourquoi, Madame ? Mais c’est la faute de ce roman-feuilleton dans lequel je suis plongé depuis une heure. Ma parole, c’est tordant, écoutez plutôt :
Enflant la voix, Fandor se mit à lire :
« … Tant de courage de la part d’un être, si beau, si jeune et si frêle, surprenait malgré tout l’effroyable vieillard. D’une main que faisait trembler la colère, cependant qu’il vociférait, l’immonde Mathubelzard menaça Dolorès du spectre de la torture :
– Dis-moi, ordonna-t-il, le nom de ton amant !
La jeune fille ne répondit point, car elle était muette ! Mathubelzard lui tendit alors un parchemin, avec une plume qu’il trempa dans du sang :
– Écris-le, rugit ce monstre.
Dolorès ne l’entendit point, car elle était sourde !
Alors l’affreuse ruine humaine, sortant un poignard de sa ceinture, s’avança lentement, l’arme levée, vers la malheureuse.
Dolorès n’eût pas même un tressaillement, elle ne voyait rien de cet horrible spectacle, car elle était aveugle… »
– Tout de même, dit Fandor, ces romancières populaires ont une façon de vous bourrer le crâne, avec leurs histoires à dormir debout, qui donnent une bien pénible idée de la littérature moderne. Mais malgré cela, on s’y laisse prendre. Qu’en pensez-vous ?
La personne à qui Fandor posait cette question était une assez jolie femme, blonde, un peu lourde, un peu épaisse sans doute, mais qui avait encore un charme extrême bien qu’elle parût âgée déjà d’une quarantaine d’années. Elle répliqua simplement :
– Je pense comme vous, mon cher ami, mais je vous en prie, ne vous agitez pas. Il me semble que vous avez bougé et rien n’est plus mauvais. Cela risquerait de retarder encore votre guérison.
– Sapristi, grommela Fandor, vous en avez de gaies. Voilà déjà suffisamment de jours et de nuits.
– Le temps vous semble donc bien long ?
– Oui, lâcha Fandor, étourdiment, qui, s’apercevant soudain du peu d’amabilité de sa réponse, essayait de se rattraper :
– Pardon, fit-il, je voulais dire que le temps me semble long, lorsque je suis seul. Mais dès que j’ai le plaisir d’avoir votre compagnie, cela change du tout au tout, ma chère Madame Olivet.
– Oh, fit l’interlocutrice de Fandor, en baissant les yeux, cependant que ses joues se coloraient de rose, vous pouvez m’appeler Valentine. Surtout quand nous sommes seuls.
– Je n’ose pas, dit Fandor.
M me Olivet s’était levée, elle s’approcha lentement de la chaise longue sur laquelle était étendu le journaliste, et d’une voix dont le tremblement trahissait l’émotion elle ajouta :
– Osez, osez. C’est moi qui vous en prie. Vous savez bien, soupira-t-elle, que vous pouvez avec moi, tout ce qu’il vous plaira.
Mais la porte du salon dans lequel avait lieu ce tête à tête, venait de s’ouvrir. Un homme parut, homme d’un certain âge, à la figure souriante, à la chevelure ébouriffée. Il portait autour de la taille, couvrant son gilet et protégeant sa redingote, un large tablier bleu comme en ont les cuisinières.
M me Olivet l’ayant aperçu, grommela d’un air vexé :
– Bon, encore lui.
Cependant Fandor souriait en s’adressant au nouvel arrivant :
– Bonjour, mon cher Monsieur Olivet. Par exemple, ça me fait plaisir de vous voir. Et comment va la santé ce matin ?
– Mais pas mal, pas mal, Monsieur Fandor, mais c’est à vous qu’il faut demander cela.
Sans attendre de réponse, M. Olivet jeta un regard inquiet et timide du côté de sa femme.
– Ma chère Valentine, fit-il, excusez-moi de vous déranger mais il y a en bas quelqu’un qui vous demande, c’est un client qui vient pour une consultation.
– J’y vais, déclara sèchement M me Olivet, et elle quitta la pièce.
Quelques instants encore, son mari demeurait avec Fandor, s’enquérait à nouveau de sa santé.
– Cette pauvre jambe, murmurait-il, ne se guérit donc pas ?
Puis il ajoutait :
– Excusez-moi, Monsieur Fandor, de vous quitter, mais il faut que je m’occupe du ménage, c’est aujourd’hui lundi, on fait le pot-au-feu et comme vous savez, ça prend du temps à cuire. Pour qu’un pot-au-feu soit bon, il faut le mettre sur le feu dès l’aube.
Fandor étouffa un fou rire tant que M. Olivet ne l’avait pas quitté, mais dès qu’il se trouva seul, le journaliste donna libre cours à sa gaîté :
– Ah, quels types, quels types, s’écria-t-il, véritablement je suis tombé, c’est le cas de le dire, dans une bien drôle de maison. Encore une fois, poursuivit le journaliste, je viens de l’échapper belle avec la captivante M me Olivet. Chaque jour, ma vertu court des risques de plus en plus sérieux et je me demande s’il ne faudra pas qu’à un moment donné ma pudeur ne cède à ses brûlantes invites. Décidément, quelle drôle de maison.
Fandor n’avait pas repris son roman-feuilleton. Le journaliste regardait autour de lui et considéra d’un air distrait l’ameublement élégant, confortable, du petit salon anglais dans lequel il était installé. Cet intérieur était vraiment charmant. Meublé avec goût, il y avait, dans les moindres détails, de la délicatesse et du charme, on retrouvait partout la trace discrète de cette M me Olivet, qui savait donner de l’allure aux moindres choses.
À côté de sa chaise-longue, Fandor avait à portée de la main une petite table, un guéridon laqué blanc, sur lequel était disposé un plateau portant lui-même une carafe avec de l’orangeade. Plus loin, était un élégant étui à cigarettes, puis, sur un fauteuil, à proximité du canapé, encore des livres, des journaux.
Comment Fandor se trouvait-il là ? Pourquoi le journaliste demeurait-il étendu sur cette chaise-longue, immobile ? Était-il blessé ?
Oui, sans doute, Fandor était blessé. Sous son pantalon, sa jambe gauche paraissait rigide et enflée d’une façon anormale. En fait, cette jambe, depuis le genou jusqu’à la cheville, était immobilisée dans un pansement de ouate et de plâtre qui permettait de comprendre à quiconque le voyait que le journaliste était en train de se guérir d’une fracture.
Fandor devait avoir fort envie, ce jour-là, de s’assurer des progrès de sa guérison, car, étant bien certain qu’il était seul désormais dans la pièce, il se souleva de sa chaise-longue et avec mille précautions essaya de poser à terre son pied malade.
La première expérience parut le satisfaire, car, forçant sur son pansement, le journaliste parvint à plier la jambe et à faire remuer l’articulation de sa cheville. Puis, satisfait encore de ce nouvel essai, il se leva. Fandor s’appuya d’abord, avec une instinctive méfiance, sur les meubles qui se trouvaient à sa portée, mais s’enhardissant bientôt, il commençait à marcher sans aucune aide, puis, peu à peu, il laissa peser le poids de son corps sur la jambe malade et constata avec une joie sans bornes, que celle-ci ne paraissait nullement en être affectée.
– Nom d’un chien, jura Fandor, c’est extraordinaire ! Mais j’ai beau faire tous les mouvements défendus, je n’éprouve absolument aucune souffrance. Qu’est-ce qu’elle me raconte que ma jambe doit être extraordinairement affaiblie ? Jamais je ne me suis senti les muscles aussi vigoureux.
Le journaliste fit quelques pas, plia les jarrets, sauta même, alla à cloche-pied.
– Mais, c’est inouï, continua-t-il, de ma vie je n’ai eu autant de souplesse, ni autant de vigueur.
Il ricana :
– Eh bien, ceux qui prétendent que l’on souffre lorsque l’on a la jambe cassée sont de rudes imposteurs, tout au moins d’invraisemblables douillets. En voilà une bonne blague. C’est-à-dire que si on ne vous assurait pas que vous avez une fracture, l’on ne s’en apercevrait point. Voilà quinze jours que je suis immobilisé, et c’est à peine si j’ai souffert pendant deux heures. Bravo, bravo, mais c’est que je vais extraordinairement bien !
Le journaliste sauta en l’air. Retombé lourdement sur le plancher, il s’arrêta net.
– Oh, oh, fit-il, j’entends du bruit, ça doit être cette excellente et redoutable M me Olivet qui revient, allons nous allonger.
Avec une agilité extraordinaire de la part d’un homme que l’on soigne pour une jambe cassée, Fandor bondit jusqu’à la chaise-longue et s’y étendit en l’espace d’une seconde. Il prêta l’oreille :
– Je me suis trompé, fit-il, mais la brave femme ne doit pas être loin, méfions-nous.
En effet, on entendait aller et venir dans la pièce voisine.
Depuis quinze jours, comme il l’avait annoncé, Fandor vivait une existence bizarre. Il recevait les soins assidus de M me Olivet, à la suite d’une mésaventure singulière. Quinze jours auparavant, en effet, Fandor avec son ami Juve, poursuivait leur redoutable adversaire, l’insaisissable Fantômas, dans un restaurant aux allures mystérieuses et louches, de la rue Froidevaux. Le policier et le journaliste s’étaient trouvés dans une salle de cet établissement connu sous le nom de L’Épervier, seuls avec Fantômas et sa bande.
Et leur existence avait été très en péril, fort compromise jusqu’à l’arrivée de la police, dont la venue avait déterminé la fuite des apaches à la tête desquels se trouvait le Maître de l’Effroi.
Bien entendu, Fantômas s’était enfui, mais tandis qu’il disparaissait dans l’ombre de la nuit, Juve s’élançait à sa poursuite.
Fandor, qui méditait de faire de même, était, à ce moment retardé par l’intervention de M. Havard. Le chef de la sûreté, prenant Fandor pour un malfaiteur, l’avait arrêté pour le relâcher aussitôt. Dès lors, Fandor n’avait plus eu qu’une idée : rattraper le temps perdu, courir après Fantômas.
Le journaliste avait vu fuir une silhouette sombre, non point dans la rue Froidevaux, mais bien sur les toitures dont le sommet se trouvait au niveau de la terrasse sur laquelle donnait la salle du restaurant de L’Épervier. Et Fandor, confiant en son agilité, s’était élancé sur les toits, longeant des corniches, contournant des cheminées, enjambant des balcons, se livrant à une poursuite effrénée.
Mais soudain, alors qu’il imaginait s’engager sur une toiture de zinc, le journaliste posait le pied sur un vitrage. Les carreaux se brisaient et Fandor tombait dans un trou sombre, se meurtrissait les membres, éprouvait une telle commotion qu’il en demeurait inerte.
Une heure après, lorsque le journaliste revenait à lui, ses yeux découvrirent avec étonnement l’endroit où il se trouvait.
C’était un salon, élégamment meublé, éclairé par une douce lumière électrique. L’éclat des ampoules était tamisé par de jolis abat-jour aux teintes variées. Une femme au visage sérieux se tenait auprès de Fandor, et, de sa main fraîche, serrait le poignet du jeune homme.
Abasourdi, le journaliste avait jeté les yeux sur cette inconnue et s’apprêtait à lui demander quelques explications sur ce qui venait de lui arriver, mais la jeune femme, d’un geste, lui imposait silence. Toutefois, après avoir compté pendant près d’une bonne minute, la dame murmura :
– Pas la moindre fièvre. Un pouls excellent. C’est parfait.
Elle se penchait vers Fandor, mettait sur son front la paume douce de sa main. Le journaliste, de plus en plus abasourdi, n’y tenant plus, l’interrogea alors :
– Où suis-je ? Que m’est-il arrivé ? Qui êtes-vous, Madame ?
On lui répondit :
– Vous avez fait une chute. Monsieur, pas bien grave, heureusement, mais j’ose dire que vous êtes bien tombé. Vous êtes ici chez M me Olivet, c’est-à-dire chez moi, et je suis docteur en médecine.
– Bon, pensa Fandor, cette excellente femme a raison, pour une fois, je suis bien tombé. Espérons que je vais me relever de même.
Et déjà il s’efforçait de bouger, mais une vive douleur lui arracha un cri.
– C’est à la jambe que vous avez mal ? interrogea la femme-médecin.
– Ma foi oui, reconnut Fandor, j’éprouve comme un élancement dans le mollet gauche.
Sans se départir de son calme, et avec des précautions infinies, M me Olivet avait alors retroussé le pantalon du jeune homme, cependant qu’elle disait à quelqu’un que Fandor n’avait pas encore aperçu :
– Déchaussez-le.
Le journaliste alors avait vu surgir devant lui un gros homme à la figure replète, à la tête ébouriffée, qui, avec des gestes empressés et maladroits, dénouait le lacet de sa bottine. M me Olivet le présenta à son malade :
– C’est M. Olivet, dit-elle, mon mari. Il m’aide de temps en temps, lorsque je n’ai pas de domestique sous la main.
– Bien, songea Fandor, voilà un époux qui m’a tout l’air d’être relégué au sixième dessous dans son ménage.
Mais le journaliste rapidement eut à se préoccuper d’autre chose.
Son docteur lui palpa le mollet d’un air entendu.
– Pas grand-chose, je l’espère, du moins, fit M me Olivet, toutefois, la jambe est encore enflée, et nous ne pourrons être fixés que demain matin.
– Ah, fit Fandor, que craignez-vous donc ?
– Je ne sais pas, dit mystérieusement M me Olivet.
Elle ajouta :
– Vous allez rester étendu sur ce canapé, on va vous mettre des coussins, des couvertures. Je n’ose pas vous faire transporter sur un lit, de peur de quelques complications.
Fandor ne savait comment remercier cette aimable femme qui soignait, en somme, un inconnu, et un inconnu dont l’arrivée chez elle était plus qu’extraordinaire, avec un extrême dévouement, une exquise compassion.
Le journaliste s’en voulut de n’avoir point encore dit qui il était, d’autant qu’à ce moment M me Olivet, qui décidément pensait à tout, venait de lui annoncer :
– Pour que vous ne manquiez de rien, mon mari vous veillera toute la nuit.
Fandor songea : « Il faut que je me présente ». Et, en s’excusant de donner à M. et M me Olivet tout ce trouble, le journaliste dit son nom.
M me Olivet changea de couleur.
– Jérôme Fandor ? s’écria-t-elle, est-ce possible que vous soyez Jérôme Fandor ? Ce journaliste si connu, ce héros si courageux, cet homme admirable ?
Fandor, fort gêné de voir l’estime dans laquelle le tenait cette aimable femme, voulait l’empêcher de continuer, mais M me Olivet était lancée, rien ne l’aurait arrêtée :
– Ah, soupira-t-elle, c’est assurément le ciel qui vous envoie, voilà si longtemps que j’entends parler de vous, de vos aventures, et que je rêve de vous connaître. Vous incarnez à mes yeux l’audace, le courage, la plus sublime témérité.
– Ma chère amie, interrompit à ce moment M. Olivet, tout ce que vous dites est certainement très exact, et même au-dessous de la vérité, mais ne craignez-vous pas de fatiguer votre malade ?
L’excellent homme s’arrêta net, foudroyé par un coup d’œil méprisant et hautain de sa femme :
– Vous, d’abord, déclara-t-elle, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Allez vous coucher, c’est moi qui veillerai M. Jérôme Fandor, vous seriez incapable de lui prodiguer des soins éclairés, si besoin en était.
– Madame, protesta le journaliste, qui véritablement se sentait gêné par cet excès de compassion, je vous assure que je n’aurai besoin de rien.
Mais la jolie femme redevenait le médecin pour avoir de l’autorité :
– C’est le Docteur, fit-elle, qui vous parle et le Docteur vous recommande de consentir à ce qu’il veut, sans discussion.
Fandor, après tout, n’était pas plus royaliste que le roi, et comme sa chute, ainsi d’ailleurs que les émotions qu’il avait éprouvées, lui donnaient une profonde envie de dormir, il ne tarda pas, suivant les conseils de M me Olivet, à s’assoupir profondément.
Le lendemain, lorsqu’il se réveilla, l’aimable femme était encore à son chevet. Lorsque Fandor ouvrit les yeux, il vit que ceux de la femme-médecin étaient fixés sur les siens, avec une singulière insistance et qu’ils exprimaient une douceur infinie.
Fandor était loin d’être un fat, néanmoins, il se demandait :
– Ai-je donc fait la conquête de cette femme pour qu’elle me regarde comme elle le fait ?
– Mon pauvre Monsieur Fandor, dit M me Olivet, je suis au regret de vous dire que vous avez la jambe cassée, et que vous voilà condamné au moins à quinze jours d’immobilité.
Fandor était demeuré abasourdi par cette déclaration, et il avait voulu se faire transporter à son domicile. Mais s’il était entêté, M me Olivet lui rendait des points sur ce chapitre, et après deux heures de discussion courtoise et aimable, Fandor devait obtempérer au désir de son hôtesse, à savoir : promettre de rester chez elle tant qu’il ne serait pas complètement rétabli.
– Pourquoi diable veut-elle me garder ? s’était d’abord demandé Fandor, dans sa naïve inconscience.
Il ne tardait pas à l’apprendre. M me Olivet était une excellente femme et vraisemblablement, un docteur très capable. Mais elle était également amoureuse et Fandor ne pouvait plus douter au bout de quelques jours qu’il ne fût, lui, l’objet de cet amour.
Le journaliste s’il était dans une certaine mesure, flatté de cette distinction, en était surtout très ennuyé car Fandor aimait aussi, mais ailleurs. Il avait donné son cœur à Hélène et la fille de Fantômas l’occupait tout entier.
Le journaliste, toutefois, n’était pas d’une pruderie exagérée et s’amusait volontiers à flirter avec l’excellente femme pendant les longues heures qu’ils passaient en tête à tête. Elle aimait sincèrement, M me Olivet, et n’était pas exigeante. Il suffisait que Fandor lui prenne la main dans la sienne et la garde pendant vingt minutes pour qu’elle estimât avoir vécu une heureuse journée.
– Je pourrais, pensait Fandor, lui faire ce plaisir-là tous les jours, sans trahir ma foi.
Mais M me Olivet, peu à peu, menaçait de se montrer plus exigeante et Fandor était d’autant plus gêné qu’il se rendait compte que la moindre privauté constituait une double trahison pour Hélène et pour M. Olivet, pour cet excellent mari qui remplissait dans la maison les fonctions qui incombent, d’ordinaire, à toute femme soucieuse de la bonne organisation de son intérieur.
C’était M. Olivet qui allait au marché, c’était lui qui traitait avec les fournisseurs, comptait le linge avec la blanchisseuse. M me Olivet, docteur en médecine, avait sa clientèle, ses visites, ses malades, mais depuis que Fandor se trouvait chez elle, elle négligeait un peu tout ce monde pour ne s’occuper que de lui.
Voilà pourquoi Fandor, qui en avait, au bout de quinze jours, par-dessus la tête des assiduités de M me Olivet, en était arrivé à douter de la gravité de son état. Madame lui interdisait toujours de poser le pied par terre, sous peine des plus graves complications. Or, depuis quatre jours déjà, Fandor, progressivement, s’assurait de la vigueur et de la souplesse de sa jambe et s’apercevait que celle-ci se comportait merveilleusement.
Pourquoi donc M me Olivet voulait-elle ainsi le retenir chez elle ?
Parbleu, la chose était simple à comprendre, du moment qu’elle était amoureuse. Fandor, non seulement par crainte des assauts redoutables qu’il avait à subir, désirait s’en aller au plus vite, mais encore il était inquiet, préoccupé. Qu’était-il advenu de Juve, de Fantômas, et surtout d’Hélène ?
Le journaliste n’en savait rien. À plusieurs reprises, il avait demandé à M me Olivet de lui faire venir son courrier, M me Olivet avait répondu que la commission était faite, et qu’il n’y avait pour Fandor, à son domicile, ni lettres ni télégrammes.
– C’est invraisemblable, pensait le journaliste, quelqu’un capte mon courrier, et il n’en avait que plus envie de partir.
Fandor, ce jour-là, après sa dernière expérience, qu’il considérait comme concluante, et convaincu que sa guérison était désormais chose faite, s’était décidé à quitter M me Olivet, à renoncer à l’hospitalité qu’elle lui avait offerte, voire même imposée.
– Ce soir, songeait Fandor, au plus tard demain, je quitterai cette maison.
Le journaliste, toujours seul, avait machinalement déplié un journal et, d’un œil distrait, en parcourait les colonnes, lorsqu’un petit entrefilet perdu dans les faits-divers attira son attention.
Il était dit en substance, dans cet article, que l’inspecteur de la Sûreté Juve avait, depuis quarante-huit heures, éclairci le mystère qui préoccupait les paisibles populations du département des Landes.
Juve avait identifié, dans une maison isolée du voisinage de Beylonque, les restes d’une femme et reconnu qu’ils appartenaient à une pierreuse de Paris connue, croyait-on, sous le nom de Fleur-de-Rogue.
C’était la première fois que Fandor, depuis quinze jours, découvrait dans les journaux quelque chose se rattachant aux intrigues auxquelles il songeait.
Après avoir lu ces lignes, Fandor tressaillit. N’avait-il pas appris, quelques jours avant sa chute intempestive dans la demeure de M me Olivet, que Fleur-de-Rogue avait subitement quitté Paris en compagnie d’Hélène, qui emmenait avec elle, disait-on, le fils de Didier Granjeard et de Blanche, pour le mettre à l’abri ? Or, voici qu’on apprenait que Fleur-de-Rogue était morte, morte peut-être assassinée. Qu’était-il advenu, dans tout cela, d’Hélène ? Fandor, cette fois, n’hésita plus.
– C’est fou, c’est lâche, grommela-t-il, de m’être ainsi laissé aller à cette inaction. Je ne suis pas plus malade que le Pont-Neuf, ma jambe est plus solide que l’Arc de Triomphe. Ne restons pas ici une minute de plus. J’ai déjà perdu trop de temps. Il se passe sûrement quelque chose d’extraordinaire, comment se fait-il que je n’aie pas de nouvelles de Juve ? Ah, coûte que coûte, avant ce soir je serai fixé.
Ne prenant plus la peine d’éviter de faire du bruit, de dissimuler ses agissements, Fandor, désormais, avec une activité fébrile, faisait en hâte une toilette sommaire, puis arracha le pansement de ouate et de plâtre qui lui comprimait la jambe.
– Au diable toutes ces saloperies, hurla-t-il, et fichons le camp. Bon, grogna le journaliste, voilà Valentine.
C’était en effet M me Olivet qui entrait.
– Mon Dieu, que faites-vous ? s’écria-t-elle, stupéfaite.
Le journaliste était si furieux à ce moment-là, si furieux soudain que s’il n’avait écouté que ses instincts, il aurait écarté de son chemin M me Olivet, en la bousculant sans la moindre vergogne. Mais Fandor était un homme du monde, et, de plus, il ne pouvait oublier, avec un sentiment de gratitude la cordiale et généreuse hospitalité qu’il avait reçue chez M me Olivet, après s’être introduit dans son domicile d’une manière si bizarre et si anormale qu’elle aurait mérité une réception à coups de trique ou à coups de revolver.
Fandor prit un air dépité :
– Hélas, Madame, fit-il, je suis désespéré d’avoir si mal suivi vos conseils. Mais je me suis senti mieux, beaucoup mieux, et alors…
– Alors quoi ? interrompit M me Olivet, d’une voix vibrante d’émotion.
– Alors, déclara Fandor, j’ai résolu de m’en aller.
Il s’attendait à quelque protestation, tant de la part de la femme amoureuse que de la part de la femme-médecin. Cette dernière disparaissait entièrement pour céder toute la place à la première.
M me Olivet entra dans la pièce, obligeant Fandor à y reculer avec elle, puis elle ferma les yeux, vacilla, se laissa tomber dans les bras du journaliste.
– Mon Dieu, soupira-t-elle, mon Dieu, quel effroyable coup, quelle terrible surprise.
Fandor pensait :
– Cette pauvre Valentine, ce qu’elle est lourde, que vais-je en faire ?
Le canapé qu’il avait occupé si longtemps était disponible. Fandor y fit s’allonger l’infortunée Valentine. Celle-ci était évanouie, le journaliste lui tapa dans les mains, s’agenouilla auprès d’elle :
– Remettez-vous, Madame, remettez-vous, Valentine, je vous en prie.
Mais, brusquement, M me Olivet revint à elle, prit de ses deux mains la tête de Fandor, l’attira près de ses lèvres, et déposa sur le front du journaliste un tendre, un long baiser. Puis, elle murmura, toute rouge :
– Pardonnez-moi, je vous en prie, surtout, oubliez cela. Je suis déshonorée.
– Mais non, mais non, déclara Fandor, pas encore.
– Oh, fit M me Olivet, ce n’est pas au sujet de ce que vous pensez que je m’estime déshonorée. Mais je vous ai menti, et désormais, je ne puis plus le cacher, c’est un secret qui m’étouffe, Fandor, écoutez-moi. Jamais vous n’avez eu la jambe cassée, jamais vous n’avez eu de fracture, et le pansement que je vous ai imposé, l’immobilité à laquelle je vous ai condamné, n’avaient qu’un seul but, un seul : vous garder avec moi, auprès de moi, longtemps, le plus longtemps possible. Voilà ce que j’ai fait, me pardonnerez-vous ?
De grosses larmes coulaient le long des joues de M me Olivet. Fandor, ému par l’amour naïf et sincère de cette femme au cœur tendre, répondit doucement.
– Vous avez eu tort. Madame, de jouer ce jeu-là avec moi, car l’inaction à laquelle vous m’avez condamné sera peut-être cause de malheurs irréparables. Sachez que je ne m’appartiens pas et que si mon cœur est pris ailleurs, j’ai, d’autre part mon devoir à remplir, et que ce devoir est d’être perpétuellement sur les traces de l’insaisissable Fantômas. Je suis obligé de partir et je pars, mais, si je vous pardonne bien volontiers, Madame, à mon tour, je vous demande pardon d’avoir si longtemps abusé de votre hospitalité, pardon aussi d’avoir encouragé, par mon attitude, vos sentiments, d’avoir été, si j’ose dire, coquet avec vous, coquet comme une femme.