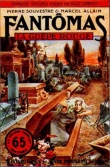Текст книги "La disparition de Fandor (Исчезновение Фандора)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
Dans la salle vide, il avisa une sorte de comptoir, il s’en approcha.
– Imbécile, où vas-tu ?
– Dame, répliqua le Bedeau, à la caisse.
– Crétin, poursuivit Fantômas, en éclatant de rire, triple idiot, décidément tu as fait ton temps le Bedeau, tu deviens complètement gâteux.
Puis, comme s’il prenait pitié de l’homme qui demeurait planté au milieu de la pièce, Fantômas désigna son flegmatique compagnon, puis solennellement déclara :
– Entends-moi bien, le Bedeau, la caisse, c’est Monsieur. Et je te recommande lorsque tu le rencontreras de ne lui parler que s’il t’adresse la parole. Défense naturellement, de ne jamais toucher un seul cheveu de sa tête, défense aussi de lui prêter secours si jamais il te demande ton aide. Tu t’en souviendras ? Il s’appelle L’Amateur.
– Bien.
Il s’approcha cependant du flegmatique personnage. Celui-ci, dès les premières paroles de Fantômas avait tiré un portefeuille de sa poche, il extrayait d’une liasse de billets de banque, une coupure de cent francs.
– Voilà, fit-il en tendant le billet au Bedeau.
L’apache se confondit en remerciements.
Mais, déjà, Fantômas et son ami, car assurément ce singulier personnage était un ami de Fantômas, s’étaient retournés et désormais ils conféraient à voix basse, sans plus se préoccuper du Bedeau.
Celui-ci, enfin prêt à partir, s’éclipsa prestement et une fois dans la rue, poussa un profond soupir de satisfaction :
– Après tout, grommela-t-il, toutes ces histoires-là tournent mieux que je ne l’espérais.
7 – L’INFANT D’ESPAGNE
– Monsieur Bourrinas, voulez-vous me rendre le service d’aller au Cabinet du juge d’instruction, vous verrez le greffier et lui demanderez quelques mandats en blanc que vous me rapporterez ?
– C’est une affaire entendue, Monsieur le procureur : vous faut-il des mandats d’amener ou des mandats de comparution ?
– Voilà une question, mon cher Monsieur Bourrinas qui dénote une ignorance professionnelle regrettable. Vous ne devriez pas ignorer qu’à notre Parquet, les mandats de comparution ou d’amener ont une seule et même formule et que la nature de la mention est mise à la main. Enfin vous êtes jeune et débutant dans la profession, je vous excuse.
M. Bourrinas était, en effet, un tout jeune attaché au Parquet de Bayonne qui débutait dans la carrière. Il avait reçu sa nomination depuis quinze jours au maximum.
Le jeune attaché quitta précipitamment le cabinet où il se trouvait avec le procureur général et ce haut magistrat, qui n’était autre que M. Anselme Roche, demeura seul en tête-à-tête avec ses dossiers dans le sévère, mais majestueux bureau que l’administration judiciaire mettait à sa disposition. M. Anselme Roche, avait un cabinet qui ne lui faisait aucunement regretter celui qu’il occupait jadis à Saint-Calais :
Une large fenêtre par laquelle la pièce s’éclairait abondamment s’ouvrait sur une jolie place de Bayonne, et comme le bureau du procureur se trouvait au second étage dans l’immeuble du tribunal, on pouvait apercevoir par-dessus les toits des autres maisons le panorama pittoresque qui s’étendait, non seulement au premier plan, constitué par la jolie ville de Bayonne, mais encore dans le lointain, par delà les fortifications historiques, jusqu’aux forêts de pins qui vont jusqu’à la mer.
Indifférent toutefois à ce spectacle, car il s’y était déjà accoutumé, M. Anselme Roche qui ne s’était approché de la fenêtre que pour jeter une allumette éteinte, revint à son bureau de travail, prit place dans son fauteuil et s’emparant de son porte-plume, fit mine, sur le buvard immaculé qui se trouvait devant lui, d’esquisser les jambages d’une lettre, puis d’un mot tout entier, d’un nom.
Le magistrat, machinalement murmurait :
– M… A… R… mar…
Puis il ajoutait un T dans sa pensée et finit par dessiner à quelques millimètres au-dessus du buvard, le nom de Martial.
– Martial, répéta-t-il machinalement.
Mais ce n’était pas tout. Le magistrat appuya presque la plume sur le buvard, traça un A, un L encore un T. Il s’arrêta net, puis murmura cette fois, presque à voix haute :
– Martial Altarès, oui, il n’y a pas lieu d’hésiter.
Le procureur général posa sa plume cette fois, se mit à se promener de long en large dans son cabinet en attendant le retour de l’attaché du Parquet.
Dorénavant, sa décision était prise. C’était le nom du spahi, de Martial Altarès qu’il allait faire figurer sur le mandat d’amener que M. Bourrinas était allé chercher.
On frappa à sa porte :
– Entrez, fit le procureur.
C’était l’attaché du Parquet qui rapportait une liasse d’imprimés :
– Voici quelques mandats, fit-il, Monsieur le Procureur.
Le magistrat, malgré ses préoccupations ne put s’empêcher de rire :
– Sapristi, fit-il, vous n’y allez pas de main morte, j’ai de quoi mettre en prison la ville entière.
– Le greffier en a beaucoup, Monsieur, répliqua l’attaché.
– Bien, fit-il, laissez-moi, j’ai à travailler seul. Nous reprendrons cet après-midi l’étude du dossier dont vous êtes venu m’entretenir.
Anselme Roche, seul encore une fois dans son cabinet, revint s’asseoir à sa table de travail, mais il ne se décida pas à écrire sur le mandat d’amener le nom de Martial Altarès.
– C’est grave, ce que je vais faire, pensa-t-il, et cependant…
Le magistrat, brusquement, tressaillit. La sonnerie du téléphone venait de retentir, imprévue, brutale comme à l’ordinaire, et toutes les fois que le timbre vibrait, le magistrat, nerveux au possible, éprouvait une impression désagréable, sentait son cœur se serrer.
Cette première émotion passée, il courut à l’appareil, décrocha le récepteur :
– Allo, qui me demande ?
Mais une nouvelle surprise l’attendait : à l’autre bout du fil, on lui disait d’abord que quelqu’un lui parlait de l’ Impérial Hôtelà Biarritz.
Intrigué, Anselme Roche restait à l’appareil, silencieux quelques secondes, une voix bien connue de lui se percevait enfin.
Anselme Roche en eut une commotion :
– Vous ? dit-il, vous, Madame ? Est-ce possible ?
Anselme Roche avait lieu d’être étonné, vraisemblablement, car ses traits se décomposaient littéralement et il agitait le bras qui lui restait libre, tout en répondant à son interlocutrice :
– Vraiment ? Ah si je pouvais m’y attendre. Vous êtes surprise de mon émotion. Pourtant, c’est bien naturel. Oui, au fait, vous avez raison, il est mauvais de parler trop longtemps au téléphone.
À ce moment le procureur s’exaspéra :
– Ne coupez donc pas, Mademoiselle ! hurla-t-il.
Puis, ayant obtenu que l’on rétablisse la communication, il reprit :
– C’est bien simple, toute affaire cessante, je pars à l’instant pour l’ Impérial Hôtel. Avec une automobile je serai dans un quart d’heure à Biarritz. À tout à l’heure.
Lorsqu’il eut raccroché le récepteur, le magistrat se prit la tête entre les mains, cependant que ses jambes vacillaient. Il était abasourdi, fou.
– Ce n’est pas possible, murmura-t-il.
Puis il ajouta :
– Non, je ne puis pas en douter. Mais c’est trop de bonheur. Par exemple, voilà qui va changer la face des choses.
En hâte, le procureur prit dans un placard sa canne et son chapeau. Au moment de s’en aller, ses yeux tombèrent sur le mandat d’arrestation qu’il avait laissé en blanc :
– Eh bien, se dit-il à lui-même, comme j’ai bien fait de ne parler de mon projet à personne ici et surtout de ne pas encore l’avoir fait mettre à exécution.
Le magistrat, deux secondes plus tard sautait dans un taxi-auto :
– À l’ Impérial Hôtel, à Biarritz, dit-il au mécanicien.
Le véhicule s’arrêtait à peine devant le perron du majestueux caravansérail, qu’Anselme Roche, avec l’agilité d’un jeune homme, sauta hors de la voiture et pénétra dans le hall de l’hôtel.
D’une voix qui tremblait légèrement, il interrogea le portier :
– Madame Borel, s’il vous plaît ?
Le magistrat attendait avec anxiété la réponse, doutant encore à ce moment que la communication téléphonique fut vraisemblable. Il poussa un soupir de soulagement, lorsque le concierge à l’uniforme chamarré s’en fut revenu lui dire d’un ton maussade et terne :
– C’est au 223, troisième étage, galerie B.
– Voulez-vous m’y faire conduire ?
Quelques instants après, dans l’appartement occupé par la personne qu’il venait de demander, M. Anselme Roche était introduit.
On le pria d’attendre dans un petit salon, mais cette attente ne dura pas longtemps. Une porte s’ouvrait, livrant passage à une femme d’une élégance rare et d’une parfaite distinction. Elle pouvait avoir de trente à trente-cinq ans environ. Tout en elle respirait la correction, la majesté, c’était incontestablement une femme dont, eu égard à sa démarche et à sa tournure, on pouvait dire qu’elle avait un « port de reine ». M me Borel, car c’était elle, était vêtue d’une grande robe noire faisant ressortir merveilleusement la pureté de son teint mat et les chaudes tonalités de sa chevelure luxuriante. D’un geste gracieux qu’elle accompagnait d’un sourire, elle tendit une main fine et blanche au magistrat qui, incapable de dissimuler son émotion prit avec empressement cette main, l’étreignit dans les siennes, puis d’un geste spontané, irréfléchi, la porta à ses lèvres.
Un peu surprise, M me Borel retira ses doigts. Le procureur général s’aperçut alors de la façon un peu trop familière dont il venait d’aborder la jolie femme et il s’excusait en balbutiant :
– Pardonnez-moi, Madame, mais je suis si heureux, si triomphant de bonheur, si satisfait de vous voir et puis… je vous l’ai déjà dit, mais à mots couverts et peut-être m’avez-vous mal compris… Or, aujourd’hui, je me sens toutes les audaces, je vous crie ce que pense mon cœur depuis si longtemps. Je vous aime, je vous aime. Ah, dites-moi que vous saviez que je vous aimais ? et que peut-être de votre côté ?
D’un geste indéfinissable, M me Borel interrompit le galant magistrat :
– Je vous en prie, Monsieur le Procureur, remettez-vous. Calmez-vous. Je ne sais si véritablement je puis continuer à vous entendre et cependant je veux le faire, eu égard à notre si cordiale amitié.
– De grâce, Madame, écoutez-moi, reprit le magistrat, j’ai tant de choses à vous dire et puis d’ailleurs il se passe des événements si extraordinaires depuis quelques jours que je ne sais comment m’expliquer, comment faire, je suis en outre incapable de dissimuler mon trouble, de vous taire mon amour. D’abord, interrogea le magistrat, qu’êtes-vous devenue ? Comment se fait-il que vous ayez disparu pendant plus d’une semaine, sans me donner de vos nouvelles ?
– Pardon, fit M me Borel doucement, mais nous n’avons pas, mon cher Monsieur, des relations suffisamment intimes, que je sache, pour que je sois contrainte à vous tenir au courant de mes déplacements, des moindres actes de ma vie ?
– Je vous en prie, chère Madame, ne me parlez pas sur ce ton-là. Il est bien entendu que vous ne me devez aucun compte et qu’au point de vue mondain je n’ai rien à vous demander, mais ayez pitié d’un cœur qui souffre, qui saigne, d’un cœur qui vous aime et que vous occupez tout entier.
– Cher Monsieur Roche, fit-elle, vous êtes un grand fou, mais un excellent homme et le meilleur des amis. C’est entendu, je ne vous taquinerai plus. Vous voulez savoir pourquoi j’ai disparu, comme vous dites. Rien n’est plus simple. Je suis allée à Paris avec M. Borel, puis, nous sommes revenus directement jusqu’ici. Il m’a installée à l’ Impérial Hôtel. Lui-même est parti, appelé par une affaire pressante, il me télégraphiera dans un jour ou deux pour que je sache où aller le rejoindre.
Le visage du magistrat s’épanouit :
– Vous êtes seule en ce moment ? Seule à Biarritz ?
– Seule en effet, répliqua M me Borel.
Et celle-ci comprenant la pensée secrète du procureur ajoutait :
– J’attends mon mari, comme je vous l’ai dit, il peut soit revenir d’un moment à l’autre, soit me télégraphier d’aller le retrouver.
Anselme Roche n’insista pas, encore qu’il eût fort envie de demander à la jeune femme de lui consacrer la majeure partie de ses heures de solitude, et puis aussi il avait un devoir à remplir. Comme homme, le procureur pouvait parler de son amour à M me Borel, mais en tant que magistrat, son devoir l’obligeait à la mettre au courant des événements survenus chez elle depuis son départ.
Anselme Roche déclara :
– Ne savez-vous rien de ce qui s’est passé chez vous ?
– Non.
Anselme Roche, alors, tout d’une haleine raconta les aventures survenues dans cette modeste propriété si calme et si paisible jusqu’alors, et qui était en passe de devenir désormais un lieu mystérieux et redoutable, un lieu célèbre aussi, dramatisé, rendu célèbre par le sang, par le crime.
– Ah si vous aviez connu mes angoisses, continuait le procureur, car naturellement, j’ai songé tout de suite que la victime ne pouvait être que vous. Aussi, pensez combien votre communication téléphonique de tout à l’heure m’a fait plaisir. Les mots seraient impuissants à décrire…
M me Borel interrompit le magistrat :
– Depuis que je suis arrivée ici, c’est-à-dire depuis hier soir, j’avais entendu vaguement parler en effet d’aventures bizarres survenues, disait-on, aux habitants d’une maison de campagne voisine de Beylonque. J’étais loin de me douter qu’il s’agissait de notre modeste demeure, néanmoins, j’avais comme un pressentiment, une crainte, c’est pour cela que je vous ai téléphoné.
– C’est pour cela, seulement ? et moi qui m’imaginais que vous m’appeliez auprès de vous, pour me permettre de vous voir et passer à vos côtés des heures tant souhaitées.
M me Borel sourit sans répondre, plus énigmatique, plus lointaine que jamais.
– Hélas, fit-il, si vous saviez comme je souffre, car il est une nouvelle morsure que votre attitude me fait au cœur. Vous ne m’aimez pas, je m’en aperçois et je m’en rends compte d’autant mieux que je sais que vous en aimez un autre. Un autre qui n’est pourtant pas votre mari.
– Plaît-il ? fit M me Borel.
– Oui, poursuivit le magistrat, la chose m’a été révélée au cours de l’enquête que je faisais avant-hier encore, chez vous.
– Vraiment ? poursuivit la jeune femme qui commençait à s’énerver et faisait visiblement effort pour demeurer calme. Et quel est ce galant, s’il vous plaît ?
– C’est le spahi, fit le magistrat.
– Quel spahi ?
– Voyons, ne vous moquez donc pas de moi. Je sais hélas, l’intimité que vous avez avec lui, je connais vos longues promenades en tête-à-tête dans la solitude des pignadas.
– Auriez-vous l’intention de parler, dit-elle, de ce jeune militaire, de Martial Altarès ?
– Oui, fit le magistrat d’une voix oppressée. Ah hélas, je sais qu’il est beau, jeune, qu’il porte un superbe uniforme, tandis que moi…
– Vous, mon cher ami, vous êtes le plus charmant, mais le plus naïf des hommes que j’aie jamais connus, certes, je suis convaincue que vous êtes un magistrat perspicace, mais en matière de femme, d’amour et de jalousie, un aveugle vous en remontrerait sur le chapitre de la clairvoyance.
– Vraiment ? oh, que je suis heureux. Alors ? ce spahi ?
– Ce spahi, reprit en riant M me Borel, c’est à peine si je l’ai vu trois ou quatre fois dans mon existence et si nous avons échangé dix paroles. Il se peut qu’il me trouve à son goût, mais il n’a jamais eu l’audace de me le dire, quant à moi, je l’ai si peu remarqué que, vous venez de le voir, il m’a fallu faire un effort de mémoire pour me souvenir qu’il s’agissait de lui.
Le procureur s’était levé, il prenait les mains de M me Borel, les serra chaleureusement entre les siennes :
– Merci, dit-il, ah, je suis heureux, bien heureux, d’abord de vous voir vivante, en bonne santé, ensuite de comprendre que vous ne m’en voulez pas trop, que vous avez peut-être pour moi un peu de sympathie, plus même que de la sympathie.
Le magistrat, à l’instar d’un adolescent qui, pour la première fois aime et ne sait comment exprimer son amour, balbutia des mots vagues et sans suite en rougissant comme une jeune fille. M me Borel semblait s’amuser infiniment de l’attitude du procureur. Toutefois, elle le reconduisait doucement jusqu’à la porte et un observateur perspicace se serait nettement rendu compte que la jolie femme devait trouver que la visite avait suffisamment duré et ne guère tenir aux galanteries du vieux magistrat. Cependant, pour ne point le laisser partir sur une impression mauvaise, M me Borel rendit au procureur sa poignée de main sincère, elle eut pour lui un regard aimable, tendre presque :
– À bientôt, dit-elle, j’irai vous voir à Bayonne, nous causerons de tout cela. Probablement, conclut-elle, je vais attendre le retour de mon mari. Dès qu’il sera là, nous partirons ensemble pour savoir ce qui se passe chez nous.
– Que ne puis-je y aller avec vous ? s’écria le magistrat. Je suis hélas trop occupé en ce moment par mon service, mais vous y trouverez Juve, le policier Juve.
À ce nom, M me Borel, malgré tout l’empire qu’elle avait sur elle-même, tressaillit et pâlit tellement qu’Anselme Roche s’en aperçut :
– Qu’avez-vous ? dit-il, êtes-vous souffrante ?
– Non, fit la mystérieuse personne.
Mais elle hâta les adieux. Modestement, par le tramway, M. Anselme Roche regagna Bayonne. Il était tout heureux des dernières paroles de M me Borel.
– Elle viendra me voir, se répétait-il, elle viendra me voir à Bayonne, et nous causerons de tout cela, de tout cela, ce ne peut être que mon amour, oserai-je dire de notre amour ?
Une autre pensée vint à l’esprit du magistrat. Du moment que M me Borel était vivante, bien vivante, c’est qu’assurément le spahi ne l’avait pas assassinée, ce militaire était donc innocent et le magistrat s’applaudissait de ne pas l’avoir fait arrêter.
– Comme il est bon de réfléchir et de ne pas agir trop vite, se disait-il. J’allais commettre une belle gaffe, certainement il ne s’est rien passé du tout, et quand on y réfléchit, on ne sait plus de quel côté en cette affaire s’est trouvé le véritable idiot : si c’est ce malheureux Saturnin qui a affolé tout le monde par son récit invraisemblable, ou si c’est la justice qui a ajouté foi aux propos d’un innocent ? Il n’y a pas de doutes, c’est la justice, c’est-à-dire Juve, moi, qui avons été stupides. Non, ce n’est pas possible qu’il ne se soit rien passé. Sapristi, j’allais oublier ces traces de sang que l’on a découvertes et puis enfin, on a beau dire, il n’y a pas de fumée sans feu.
***
Cependant, à l’ Impérial Hôteldepuis le commencement de cette journée, le personnel était sens dessus dessous. Les valets de chambre n’arrêtaient pas de nettoyer les appartements du premier étage, les hommes de peine fourbissaient les cuivres, astiquaient les boutons de porte, les poignées de fenêtre. Des femmes apportaient du linge, changeaient des draps, des serviettes.
Assurément on attendait des hôtes importants pour occuper ces appartements les plus luxueux de l’ Impérial Hôtel.Anselme Roche n’avait pas quitté M me Borel depuis dix minutes que, devant le perron de l’ Impérialvenait se ranger une superbe automobile, blanche de poussière. Deux messieurs en descendaient et le mécanicien, dûment stylé démarrait aussitôt, quittait le perron, se dirigeait vers le garage.
Il convenait de faire place, en effet, car une autre automobile, encore plus luxueuse, munie d’une élégante carrosserie landaulet, venait encore s’arrêter au pied des marches de l’hôtel. Trois voyageurs, cette fois, sortirent de ce véhicule, puis, encore, survenaient deux autres voitures.
Le personnel de l’hôtel, le portier et ses aides, le gérant, étaient venus faire la haie et, respectueusement, s’inclinaient très bas devant l’un des voyageurs qui, précédant les autres, montait à vive allure l’escalier de marbre qui conduit au hall.
C’était un homme très brun, d’une élégance raffinée et d’une extrême distinction. Il y avait beaucoup d’aisance dans sa démarche, de grâce dans sa tournure. Assurément c’était un grand seigneur, rien qu’à juger par son attitude et aussi par sa suite.
Des promeneurs ayant vu arriver ces luxueux équipages, étaient venus, curieux, grossir la haie qui s’était formée sur le court espace réservé au nouvel arrivant.
Et, dans cette foule admirative et polie, courait sur toutes les lèvres le nom du personnage :
Don Eugenio d’Aragon, infant d’Espagne !
C’était en effet, le cousin du roi qui faisait son entrée solennelle à l’ Impérial Hôteloù il venait s’installer pour une quinzaine de jours. C’est pour ce grand personnage qu’on avait si minutieusement préparé les appartements du premier étage.
Comme il passait, quelques cris s’élevèrent de la foule :
– Vive l’Infant ! Vive l’Espagne !
Don Eugenio entendit. Avec une grâce charmante, il sourit en inclinant la tête, remercia d’un geste. Puis, le parent du roi suivi de ses chambellans, pénétra dans l’hôtel. L’ascenseur le monta au premier étage de ses appartements.
Cependant que l’infant s’installait dans sa chambre, quelqu’un entrait à l’hôtel.
– Le directeur ? demanda-t-il d’un air sec.
Le portier considéra ce nouveau venu, le dévisagea des pieds à la tête et fit une moue significative.
– Si c’est pour un emploi, fit-il, nous n’avons besoin de personne.
L’interlocuteur du portier était en effet un homme de modeste apparence, bien que très correctement vêtu d’un complet noir de bonne coupe et d’un chapeau melon.
– Je désire voir le directeur.
– Il n’y a pas de directeur, répondit le portier. Il y a un gérant.
– Soit, poursuivit le visiteur, menez-moi au gérant.
– Le gérant, c’est M. Hoch, et il est très occupé.
– J’attendrai, fit le personnage qui se mit à faire les cent pas dans le hall.
M. Hoch s étant finalement dérangé de son bureau vint dans le hall, salua le nouveau venu.
– Vous désirez, Monsieur ?
– Ah, c’est vous le gérant ? demanda le visiteur.
– C’est moi. Monsieur.
– Bien, fit l’inconnu, dans ce cas, je vous prie de me donner une chambre.
– Mais Monsieur, poursuivit M. Hoch qui commençait à s’énerver, il était inutile de me déranger. il y a dans l’hôtel tout un personnel affecté à ce service et qui est là pour vous montrer les appartements et convenir avec vous des prix.
– Je le sais. Si j’ai demandé à vous parler c’est parce que j’ai autre chose à vous dire. Il me faut une chambre au premier étage.
– Elles sont toutes occupées, Monsieur, par Son Altesse Royale et sa suite.
– Erreur, jeune homme, dit l’inconnu, le n°7 est libre.
– C’est vrai, vous avez raison. Mais c’est une très vilaine pièce, toute petite donnant sur la cour.
– Je tiens à la prendre.
M. Hoch hésita un instant. Puis il répondit :
– Si vous y tenez particulièrement, monsieur, on vous la donnera, mais c’est vingt-cinq francs par jour.
Le voyageur ne sourcilla pas. M. Hoch ajoutait :
– Et pour ce prix-là vous auriez une chambre superbe au troisième.
– Ça m’est égal, je veux être au premier. Le 7 convient.
Baissant la voix, le voyageur poursuivit :
– Vous mettrez mes dépenses sur la note de Son Altesse Royale.
– Alors au lieu d’être de vingt-cinq francs, le prix de la chambre sera de trente-cinq.
– Pourquoi ?
M. Hoch, sous ses dehors corrects et distingués, ne brillait pas par le tact. C’était un maladroit, un gaffeur, qui n’hésita pas à répondre :
– Je majore de dix francs, parce que je suis obligé de donner dix francs par chambre à M. le Marquis.
– Soit, dit-il, ce sera trente-cinq francs. Mais je vous prie de noter ceci : il ne faudra faire aucune attention à moi tant que je séjournerai à l’Impérial, ne soyez pas surpris si je ne parle à personne de la suite de Son Altesse Royale et si nul n’a l’air de me connaître.
– Ah ?
– Non. Je suis l’agent de la police secrète qui accompagne toujours Son Altesse Royale, don Eugenio d’Aragon.
8 – JUVE SE DÉCIDE
Brûlé sous son déguisement de colporteur, Juve n’avait eu d’autres ressources que de descendre à l’auberge même de Beylonque, de s’y installer et de commencer minutieusement son enquête policière.
Malheureusement, si Juve se donnait beaucoup de mal, il ne semblait pas qu’il dût arriver à comprendre quoi que ce fût au mystère de la petite maison nichée dans les pignadas silencieuses.
Le crime avait été commis par un homme. Juve, en revanche, n’avait rien découvert depuis qui lui permît de spécifier quel pouvait être le coupable. Ni la victime. Était-ce M me Borel ? Possible. Mais, en somme, rien n’était moins certain. M me Borel pouvait fort bien être en promenade, en voyage, n’importe où. Le silence ne prouve rien.
Delphine Fargeaux, d’autre part, pouvait, elle aussi, être en voyage, et de plus, rien ne prouvait qu’elle fût jamais venue chez les Borel, dans leur maison.
– Pourtant, se dit Juve, il est invraisemblable qu’il y ait eu crime chez M me Borel, et que M me Borel ne soit ni l’assassin, ni la victime. Nom d’un chien de nom d’un chien.
Mais si Juve se mettait en colère, cela n’avançait à rien. Et puis encore, d’autre problèmes se dressaient devant lui :
Le malheureux idiot Saturnin Labourès n’avait-il pas conté une histoire incohérente ? N’avait-il pas affirmé qu’il avait été mordu par une dame, une dame qu’il avait nommée M me Borel ? une dame qui, d’après ses dires, se baignait tout habillée ?
Et Juve, entraîné par la logique, réfléchissant à ce détail, finit par se dire :
– Saturnin était un idiot. Donc, a priori, ses propos ont peu d’importance. De plus, comme il n’est pas coutume que l’on se baigne tout habillé, Saturnin peut très bien avoir inventé ça de toutes pièces.
Mais, cette dernière façon de voir, Juve, quoiqu’il en eut fort envie, ne pouvait guère s’y arrêter. Que Saturnin ait menti en inventant de toutes pièces son récit de morsure, c’était à la rigueur possible, mais en somme, si l’idiot inconsciemment avait improvisé une histoire pareille, il fallait reconnaître que vraiment une série de coïncidences venait en quelque sorte étayer ses affirmations.
Juve, en effet, devait bien reconnaître que la blessure de Saturnin Labourès avait existé. M. Peyrat, le pharmacien de Beylonque, interrogé par Juge, tout comme M me Labourès, l’avait affirmé : Saturnin portait bien une blessure à la main droite.
Cette blessure, il est vrai, pouvait avoir été causée de multiples façons. L’explication qu’en donnait Saturnin Labourès n’était donc pas forcément la bonne. Mais il fallait bien tenir compte de ce fait, vraiment surprenant, qui avait voulu que l’explication de Saturnin Labourès eût amené précisément la découverte du mystère de la Bicoque.
C’était parce que Saturnin Labourès avait prétendu avoir été mordu chez Borel, que Parandious s’était rendu à la maisonnette et y avait fait les découvertes que l’on sait.
Il y avait, hélas, une autre coïncidence qui effrayait Juve, plus encore :
Saturnin Labourès, songeait-il, a en somme donné l’alarme, lui seul a dit quelque chose relativement au drame et Saturnin Labourès au moment même où l’enquête commençait, est mort, mort dans la mare aux sangsues, assassiné.
Ceci amenait Juve à conclure que l’assassin avait supprimé le malheureux idiot pour l’empêcher de parler, de conter plus en détail ce qu’il avait vu, comment il avait été blessé. Juve, levé de grand matin, dans la modeste petite chambre qu’il occupait à l’ Auberge des Écarteurs, repassait en mémoire toutes ces présomptions, tous les indices recueillis jusqu’ici.
– Cent mille nom d’un chien ! finit par jurer le policier, s’épongeant vigoureusement avec une serviette trempée dans l’eau glaciale de sa cuvette, il faudra bien que j’en aie le cœur net et que j’arrive à démêler toutes ces aventures !
Juve s’habilla précipitamment. C’est d’un air grognon qu’il envoya au diable l’hôtelier qui, très aimable à son passage dans la salle commune, lui demandait s’il avait bien dormi, s’il désirait un petit déjeuner, s’il viendrait encore passer la nuit à l’hôtel.
– Fichez-moi la paix, je n’ai besoin de rien, sauf de tranquillité. Et oui, parbleu, je coucherai ici ce soir. D’ailleurs vous le verrez bien.
Le policier avait, naturellement, fait poser les scellés sur les meubles garnissant la maisonnette, il en avait, de plus, fait scrupuleusement respecter la position et l’état.
Rien n’avait été changé depuis le moment où Parandious, suivi des paysans, avait pénétré à la Bicoque et reculé d’horreur devant les traces de sang.
Juve, rapidement, examinait d’un coup d’œil, la pièce du rez-de-chaussée. Il n’y avait pas fait jusqu’alors de grandes découvertes et il songeait, mélancolique :
– Ici, je n’ai rien relevé d’intéressant, si ce n’est qu’étant donné le désordre de la salle, je peux établir qu’il y a eu lutte violente. De plus, cette éraflure contre le mur tend à prouver qu’un coup de fusil ou un coup de revolver a dû être tiré. Quant aux taches de sang, elles ne présentent rien de particulier, en somme. Si, cependant… Elles indiquent que c’est ici, suivant toute vraisemblance, que le crime a été commis. La victime a dû tomber en perdant son sang, au centre même de la pièce. Le meurtrier, un homme, et un homme vigoureux, a dû la saisir alors, la tirer jusqu’à l’escalier, la traîner dans cet escalier, comme en font foi les éclaboussures, qui maculent les marches. Mais, pourquoi diable, ayant tué cette femme au rez-de-chaussée, à supposer que ce soit une femme, et en somme, je n’ai guère de preuves, pourquoi diable, l’a-t-on montée au premier étage où je ne retrouve nul indice capable de me faire deviner comment on a pu faire disparaître le corps ?
Juve, après un petit moment de silence et de réflexion rageuse, monta au premier :
– Curieuse, aussi, dit le policier, s’arrêtant au seuil de la chambre à coucher, la disposition de cette maison. Pourquoi la salle d’en bas est-elle pauvrement meublée, meublée à la paysanne, alors que cette pièce-ci est cossue, bourgeoise, luxueuse presque ? Cette M me Borel et ce M. Borel dont personne n’a plus de nouvelles, tenaient donc à cacher leur identité ? Voulaient-ils donc, aux yeux des habitants de Beylonque, passer pour ce qu’ils n’étaient pas ?
Juve avança de quelques pas, examina encore les traces de sang qui souillaient le tapis.
– Le corps a été traîné, répéta-t-il, de l’escalier jusqu’ici, et ici, je suis à quelques pas de la baignoire. Bien. Il ne faut pas oublier que Saturnin Labourès a prétendu avoir vu une femme tout habillée dans cette baignoire. Incompréhensible cette histoire-là. Mais bougre de nom de nom ! répétait le policier, à genoux sur le sol. Puisque c’est ici, à cette place même où je suis, que les traces de sang s’arrêtent, il faut bien que ce soit ici que l’on ait cessé de traîner le cadavre. Mais que diable a-t-on pu en faire ? Le porter jusqu’à la fenêtre et le jeter dehors par-là ? Idiot. L’assassin n’aurait eu aucune raison alors, de monter sa victime du rez-de-chaussée au premier étage. Et puis, il y aurait des traces de sang sur la barre d’appui de la fenêtre, dans le jardin, et il n’y a rien. Dois-je conclure que c’est en cet endroit que le meurtrier a enfermé le corps dans une malle, dans une caisse ? Cette explication est matériellement impossible. Une malle pouvant contenir un cadavre serait trop grande, pour passer par l’escalier ou même par l’étroite fenêtre. Il aurait donc fallu que l’assassin dépèce sa victime. Il y aurait beaucoup plus de traces de sang qu’il y en a. Alors ?