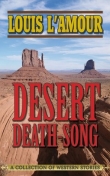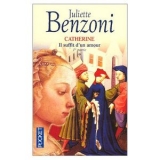
Текст книги "Catherine Il suffit d'un amour Tome 1"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
– Que lui faut-il encore à ce godon rapace ? confia-t-elle à Catherine quand les murs d'Amiens furent en vue. Il étrangle à plaisir le pays de France qu'il occupe contre toute justice, il prend pour femme la plus douce, la plus belle, la meilleure de nos filles et encore il réclame de l'or, lui qui devrait passer sa vie à genoux et baiser la poussière pour rendre grâce au ciel d'une telle faveur ! En vérité, je crève de rage, dame Catherine !... de rage, entendez-vous bien, quand je vois notre Duc tendre la main à l'ennemi séculaire du Royaume et lui donner sa propre sœur...
– Je crois qu'il désire surtout se venger du roi Charles. Il le hait si fort.
– Il veut se venger, mais il souhaite encore plus prendre sa place, grogna la comtesse. C'est déloyauté de la part d'un vassal, même s'il est prince et même s'il veut oublier sa vassalité. Les lois de l'honneur ne se discutent pas !
Un sourire étira brièvement les lèvres de Catherine, séchées par le vent glacial qui s'était levé et chassait les nuages sur les tours d'Amiens.
– Des paroles dangereuses à prononcer, Comtesse, dangereuses à entendre peut-être si le duc en avait vent, fit-elle malicieusement.
Mais la grosse dame posa soudain sur elle un regard si fier et si direct qu'elle se sentit rougir.
– Il n'ignore point ma façon de penser, dame Catherine. Une femme de mon rang ne s'abaisse pas à dissimuler, même en face d'un duc de Bourgogne ! Ce que je vous dis à vous, je le dirais aussi bien à lui !
Catherine ne pouvait se défendre d'une certaine admiration.
Ermengarde tonitruante, obèse, un peu comique même n'en était pas moins d'une grande et bonne race que rien, ni la graisse envahissante, ni les atours excentriques, ne pourraient jamais cacher. Sa grandeur, sa dignité étaient instinctives et surpassaient tous les petits travers humains. Amie sûre, elle était une ennemie redoutable. Il valait mieux être de son côté.
À Amiens, les princesses allèrent rejoindre leur frère. Il les attendait au palais de l'évêque, tandis que leur suite s'en allait prendre logement dans les maisons réservées à cet effet. Ermengarde, bien entendu, suivit celles dont elle avait la garde, tandis que Catherine et son mari s'installaient dans une maison, proche de la grande cathédrale blanche, et dont les fenêtres arrière donnaient sur un canal tranquille.
Cette maison, petite mais confortable, appartenait à l'un des plus gros drapiers de la ville avec qui le grand argentier avait d'étroites relations d'affaires. Garin, par avance, y avait envoyé son majordome Tiercelin avec son valet, son secrétaire et les femmes de Catherine sous les ordres de Sara. Ils avaient apporté avec eux, sous bonne escorte, le plus gros des bagages et, en entrant dans la maison du drapier, Catherine trouva que tout avait été disposé au mieux pour l'accueillir.
Le feu flambait dans les cheminées, sa chambre était douillette et tendue de toiles brodées, le lit fait et, sur une table, des violettes trempaient dans un pot de faïence peinte. Le repas était servi dans la pièce principale.
Cette installation, relativement modeste pourtant, était un rare privilège dans une ville surpeuplée, où le moindre lit se payait à prix d'or. Les nombreuses suites du duc de Bretagne, de Bedford, des comtes de Richemont, de Salisbury et de Suffolk avaient tout envahi.
Plus d'un bourgeois d'Amiens était réduit à s'entasser dans une seule chambre avec sa famille et ses servantes pour laisser place aux gens, brutaux et arrogants pour la plupart, de tous ces seigneurs venus rencontrer le duc Philippe. Ce n'était, à toutes les maisons, qu'écussons accrochés aux fenêtres, pennons et bannières flottant au vent du soir. Les queues d'hermines noires sur champ d'argent de Bretagne couvraient toutes les maisons à l'est du palais épiscopal, tandis que les pals sanglants du comte de Foix occupaient le quartier ouest. Le sud appartenait aux roses
écarlates de Lancastre, duc de Bedford. Le régent anglais à lui seul, avec le renfort des comtes de Salisbury et de Suffolk, occupait la moitié de la ville. Les Bourguignons, en général, s'entassaient au nord et les serviteurs de l'évêque d'Amiens, là où ils pouvaient.
Malgré sa fatigue, ce soir-là, Catherine ne put trouver le sommeil.
Toute la nuit, la ville retentit de chants, de cris, d'appels de trompettes si vigoureux que les maisons en tremblaient, préludant ainsi aux fêtes magnifiques annoncées par le duc Philippe. Et puis l'énervement s'ajoutait au vacarme du dehors. Dans la soirée, Garin s'était rendu au palais épiscopal, appelé par son maître. En rentrant, il était entré chez sa femme qui venait de se coucher. Elle bavardait avec Sara, tandis que la fidèle servante brossait et pliait les vêtements portés par sa maîtresse dans la journée.
– Demain soir, dit-il seulement, vous serez présentée à Monseigneur au cour du bal des accordailles. Je vous souhaite une bonne nuit...
Le lendemain, le palais de l'évêque rougeoyait dans la nuit comme un incendie. Les pots de feu couronnant ses créneaux, les flots de lumière pourpre et dorée que déversait chacune de ses fenêtres lancéolées s'allaient refléter sur l'immense ciselure blanche de la haute cathédrale, enveloppant pierres et statues d'une factice aurore. Chaque embrasure vomissait des cascades de soieries armoriées dégringolant jusqu'au sol, chaque colonnette supportait une bannière de soie et, sur la place où les gardes contenaient à grand-peine la foule des badauds de la ville, une étonnante fresque en couleurs violentes déroulait son faste. Seigneurs aux pourpoints rayonnants de pierreries, posant avec précautions
leurs
pieds
chaussés
d'absurdes
chaussures
à
l'interminable poulaine dont certains relevaient le bout avec des chaînettes d'or retenues à la ceinture, portant avec une assurance inouïe d'énormes chaperons brodés et de longues manches déchiquetées qui tombaient jusqu'à terre, dames en robes de rêve sous l'échafaudage fantastique des hennins pointus, cornus, à bourrelets simples ou doubles, toutes, ennuagées de dentelles et de mousselines, toutes, scintillantes de joyaux, traînant après elles les aunes de brocart, de satin, de velours ou de lamé de leurs robes de fête. Tous, gardés de la foule par la double haie de fer des gardes, s'en allaient d'un pas nonchalant vers la fête comme autant d'étoiles étranges qui scintillaient un instant sous le feu des torches et qu'engloutissait l'ombre du porche. Toutes les fenêtres de la place étaient bondées de curieux et l'on y voyait comme en plein soleil tant le duc avait prodigué torches et chandelles.
D'une fenêtre du palais, Catherine regardait couler le fleuve étincelant des invités. Elle était arrivée dans l'après-midi avec ses femmes et les coffres contenant ses atours, car la Grande Maîtresse n'avait voulu laisser à personne le soin d'inspecter minutieusement sa toilette de présentation. Pour plus de sûreté et afin d'être certaine que la jeune femme, entraînée par la curiosité ne se montrerait pas aux invités avant l'heure convenue, Ermengarde l'avait enfermée dans sa propre chambre, tandis qu'elle-même allait surveiller les toilettes des princesses. Prête et désœuvrée, Catherine regardait...
– Je me demande si Madame Marguerite et Madame Anne vous pardonneront votre beauté, ce soir. Car, en vérité, vous les éclipsez comme le soleil éteint les étoiles à l'aurore. Ce n'est pas permis d'être si belle, ma chère, c'est indécent, presque scandaleux !
Ermengarde avait l'air réellement offusquée, mais ses louanges n'en étaient que plus sincères. Pour une fois, cependant, Catherine n'en avait retiré aucune joie. Sans trop savoir pourquoi, elle se sentait triste, lasse et, volontiers, elle eût retiré cette robe de fête pour aller se blottir au fond de son lit, dans la chambre au-dessus du canal vert.
Jamais elle ne s'était sentie aussi seule !
Tout à l'heure Garin viendrait la chercher. Il la prendrait par la main et la conduirait vers la salle haute où s'assemblait la foule des invités. Là, elle ferait sa révérence au duc Philippe, aux princesses et à leurs futurs époux. Elle savait qu'elle retrouverait le regard gris dont, un instant, elle avait troublé le calme énigmatique. Elle savait que Philippe l'attendait, que cette soirée était l'aboutissement d'une volonté puissante, obstinée, mais de cela non plus elle ne retirait aucune joie. Que le puissant Duc la désirât, qu'il l'aimât même, s'il en était capable, ne la touchait pas. Parmi les couples qui entraient au palais, elle en avait distingué un, très jeune. Un chevalier adolescent, blond comme l'était Michel de Montsalvy, imberbe et joyeux dans un costume de satin bleu sombre. Il donnait la main à une belle enfant, aussi blonde que lui-même, simplement couronnée de roses, fraîches comme sa robe de moire rosée. De temps en temps, il se penchait vers sa compagne, murmurait quelque chose qui la faisait sourire, rougir et Catherine devinait les doigts qui se serraient un instant, les paroles caressantes chuchotées et les baisers qui s'apprêtaient. Ces deux-là ne voyaient qu'eux-mêmes. Lui n'avait pas un regard pour les femmes, souvent très belles, toujours éblouissantes, qui les entouraient. Elle ne détournait pas ses yeux câlins du visage de son compagnon. Ils s'aimaient avec l'ardeur de très jeunes êtres et il ne leur serait même pas venu à l'esprit de dissimuler si peu que ce soit leur amour. Ils étaient heureux...
À l'aune de cet insouciant bonheur, la jeune femme mesurait le vide de sa propre existence. Un cœur avide et solitaire, un mari postiche qui ne la parait que pour mieux la jeter dans les bras d'un autre, le désir d'inconnus qui ne l'émouvait pas malgré la fièvre de certaines nuits où le sang menait dans ses veines une infernale ronde, le mépris du seul homme aimé... triste bilan !
– Votre époux est là, dame Catherine, fit derrière elle la comtesse Ermengarde qu'elle n'avait pas entendu entrer.
Elle était là pourtant, rutilante et formidable dans sa robe de velours rouge et or avec un hennin aussi haut qu'une flèche de cathédrale. Elle accaparait à elle seule tout l'espace et cachait presque Garin dont la silhouette vêtue de noir s'érigeait près de la porte.
Il s'avança de quelques pas, contempla un instant Catherine puis prononça :
– C'est bien !...
– C'est mieux que bien ! s'insurgea Ermengarde. C'est impressionnant !
Le mot était exact. Catherine, ce soir, était impressionnante à force de simplicité voulue. Sa robe de velours noir, tout unie, retenue sous la poitrine par une large ceinture de même étoffe n'avait d'autre ornement que la doublure de drap d'or de ses longues manches traînant jusqu'à terre. Mais dans cette absolue sévérité, l'audace du décolleté faisait chanter victorieusement l'éclat de sa peau. Carré devant, cernant tout juste la rondeur de l'épaule et découvrant presque la moitié des seins, il plongeait en pointe dans le dos, plus bas que les omoplates. En revanche, les manches très longues, couvraient à peu près toute la main. Bien des femmes seraient aussi décolletées mais, grâce à la couleur sombre et mate de la robe, aucune ne paraîtrait aussi nue. Autre audace due à l'imagination de la comtesse de Châteauvillain, Catherine ne porterait pas de hennin. Ses cheveux magnifiques tombaient librement comme ceux d'une jeune fille sur ses épaules. Un seul bijou, mais fantastique : un diamant noir, fascinant comme une étoile maléfique, fulgurait sur le front de la jeune femme, retenu par un mince cercle d'or qui se perdait dans la chevelure. Cette pierre, d'un incomparable éclat, était le précieux trésor de Garin, la gemme la plus rare de sa collection. Il l'avait achetée à Venise, quelques années plus tôt au capitaine d'une caravelle qui revenait de Calicut et il l'avait payée fort cher, mais moins cher, tout de même, que ne le méritait la beauté exceptionnelle du diamant. Le marin semblait avoir hâte de se débarrasser de la pierre noire. C'était un homme malade et le bateau avait souffert de son dernier voyage.
– Toutes les tempêtes de la terre se sont données rendez-vous pour nous donner la chasse depuis que je possède ce maudit caillou ! avait-il dit à Garin. Je suis heureux de m'en débarrasser car il m'a porté malheur. Tout ce qui peut tomber en fait de calamité sur un navire, je l'ai eu, jusqu'à la peste au large de Malabar. En bon chrétien, je dois dire que cette pierre est maléfique, aussi maléfique qu'elle est belle. Je l'aurais gardée peut-être parce que pour moi rien n'a plus d'importance, je mourrai bientôt ; mais son prix dotera ma fille...
Garin avait payé et pris le diamant. Il n'était aucunement superstitieux et ne croyait pas au mauvais sort, chose rare à son époque. Il ne s'attachait qu'à un fait : la beauté de cette pierre unique, volée, comme le lui avait avoué le capitaine vénitien au front d'une idole, au fond d'un temple perdu dans la jungle.
Catherine connaissait l'histoire du diamant, pourtant elle ne craignait pas de le porter. Bien mieux, il la fascinait et tout à l'heure, quand Sara l'avait disposé sur son front, elle s'était prise à rêver de cette statue païenne dont, jadis, elle avait orné le visage.
– Il est temps de vous rendre dans la grande salle, dit la Grande Maîtresse. Monseigneur vient d'arriver et les princesses ne tarderont guère. Je me rends auprès d'elles. Courage !...
En effet, dans les profondeurs du palais, un appel prolongé de trompettes venait d'annoncer l'entrée du duc Philippe.
– Venez ! fit Garin brièvement en offrant son poing levé.
La grande salle offrait un spectacle si éblouissant qu'on ne remarquait même plus les magnifiques tapisseries d'Arras, représentant les douze travaux d'Hercule que Philippe avait apportées avec lui et qui couvraient les murs. Seigneurs et dames s'y pressaient sur le dallage noir et blanc, luisant comme un miroir d'eau où se reflétaient leurs silhouettes scintillantes.
Peut-être parce qu'il tranchait violemment sur cette assemblée colorée, Catherine ne vit que le duc en pénétrant dans la salle. Il était aussi noir qu'elle-même de vêtements, portant ce deuil perpétuel et hautain, qu'il avait juré de garder, dans la chapelle de la Chartreuse de Champmol, sur le corps de son père assassiné.
Il se tenait debout, sous un dais surélevé de plusieurs marches où trois fauteuils avaient été disposés pour les trois ducs souverains, celui de Bourgogne occupant évidemment le milieu, l'Anglais la droite et le Breton la gauche. Le haut dossier de chaque fauteuil reproduisait, brodées en soies brillantes, les armes des trois princes et le dais était de toile d'or. Sur ce décor là aussi Philippe ressortait, mince et sombre. Mais un magnifique collier de rubis et d'or, pendant sur sa poitrine, relevait la sévérité de son costume.
Lorsque Catherine parut, toutes les conversations cessèrent. Un silence subit s'abattit sur la salle, si profond, si inattendu que les musiciens, dans leur tribune au-dessus de la porte, posèrent leurs instruments et se penchèrent pour voir. Interdite, Catherine hésita un instant, mais la main de Garin la soutenait et l'entraînait à la fois. Elle s'avança alors, les yeux baissés pour ne pas voir les regards attachés sur elle, surpris et ardents chez les hommes, non moins surpris mais envieux chez les femmes. Les chuchotements qui s'élevaient étaient bien suffisamment gênants.
Ermengarde avait raison. Ce soir sa beauté faisait scandale parce qu'aucune autre femme ne pouvait soutenir la comparaison...
Catherine avait la sensation de s'avancer entre deux murs avides et malveillants qui ne lui feraient grâce d'aucun faux pas. Qu'elle chancelât et les murs se refermeraient sur elle pour l'écraser et la réduire à néant. Elle ferma les yeux un instant, prise d'un vertige. Mais la voix de Garin s'élevait, froide, mesurée.
– Daigne Votre Grâce me permettre de lui présenter mon épouse, dame Catherine de Brazey, son obéissante et fidèle servante...
Elle ouvrit les yeux, regarda droit devant elle et ne vit que les longues jambes noires de Philippe, ses pieds chaussés de poulaines de velours brodé. La main de Garin, qui l'avait arrêtée aux pieds du dais, lui dictait impérieusement sa volonté. Elle fléchit le genou, baissa la tête tandis que sa robe s'étalait autour d'elle. La révérence fut un miracle de grâce lente et cérémonieuse. En se relevant, la jeune femme releva aussi les yeux. Elle vit que Philippe était descendu de son trône, qu'il lui souriait, tout près d'elle et prenait la main que Garin venait d'abandonner.
Vénus, seule, Madame, a le droit d'avoir tant de grâce et de beauté !
Notre Cour, si riche déjà en belles dames, va, par votre présence, devenir incomparable au monde, dit Philippe assez haut pour être entendu de toute l'assistance et, nous remercions votre noble époux de vous avoir conduite jusqu'à nous. Nous savons déjà en quelle estime vous tient notre auguste mère et il nous plaît qu'à tant de charmes vous alliez aussi la modestie et la sagesse...
Un murmure s'était élevé dans la foule. Le nom de la duchesse-douairière avait produit l'effet qu'en escomptait Philippe. Il élevait entre Catherine et la jalousie qu'éveille tout astre naissant, un mur de protection. On ferait tout pour abattre la future maîtresse du prince, mais, si la redoutable Marguerite la protégeait, l'attaque devenait plus difficile.
Un peu de rouge était monté aux joues pâles de Philippe et ses yeux gris brillaient comme glace au soleil, tandis qu'il détaillait avec un ravissement visible le visage de Catherine. Sa main tremblait légèrement autour des doigts menus, glacés par l'émotion et, à la grande surprise de la jeune femme, une larme brilla un court instant sous la paupière du prince. C'était l'homme de l'univers qui pleurait le plus facilement. Le moindre émoi, artistique, sentimental ou autre, lui arrachait des larmes et, lorsque son cœur était touché de douleur, il pouvait répandre de véritables torrents mais, cette curieuse particularité, Catherine l'ignorait encore.
Une dizaine de hérauts, portant de longues trompettes d'argent où pendaient des flammes de soie pourpre, franchirent les portes de la salle, se rangèrent sur une seule ligne et embouchèrent leurs instruments. Un appel fracassant retentit, rebondit jusqu'aux voûtes qui le renvoyèrent en ondes joyeuses sur l'assistance. La main de Philippe, à regret, laissa glisser celle de Catherine. Les princes invités arrivaient...
Trois hommes franchirent le seuil. En tête marchaient Jean de Lancastre, duc de Bedford et Jean de Bretagne. L'Anglais, âgé de trente-quatre ans, roux et mince, avait la beauté célèbre des Lancastre mais une expression d'orgueil intense et de cruauté native qui, figeant ses traits presque parfaits, leur enlevait tout charme. Il avait un regard de pierre sous lequel se cachait une redoutable intelligence, un sens profond de l'administration. Auprès de lui, Jean de Bretagne, carré, aussi large que haut, paraissait rustre malgré son magnifique costume fourré d'hermine et son visage intelligent, mais le troisième homme était sans nul doute le plus intéressant. Carré, lui aussi, mais athlétique et d'une taille largement au-dessus de la moyenne, il semblait créé de tout temps pour porter l'armure. Ses cheveux blonds, coupés en couronne, coiffaient un visage affreux, couturé de blessures récentes et traversé d'une profonde balafre, mais les yeux, aigus, profondément enfoncés, avaient le bleu candide des yeux d'enfants et, quand un sourire se jouait sur ce visage ravagé, il en prenait un charme étrange.
Arthur de Bretagne, comte de Richemont, n'était sans doute plus un beau seigneur malgré ses trente ans. L'effroyable journée d'Azincourt était inscrite en toutes lettres dans les blessures de son visage et, un mois plus tôt, il était encore au fond des geôles anglaises, prisonnier à Londres. Mais il était mieux qu'un vaillant soldat : un homme valeureux, que l'on devinait loyal. Richemont était le frère du duc de Bretagne et s'il acceptait de devenir le beau-frère de l'Anglais, c'était pour deux raisons : d'abord parce qu'il s'était épris de Marguerite de Guyenne, ensuite parce que ce mariage arrangeait la politique de son frère, tout entière tournée vers la Bourgogne pour le moment.
Catherine avait regardé avec intérêt le prince breton sans trop savoir pourquoi. Il était l'un de ces hommes qu'on ne peut voir sans souhaiter, aussitôt, en faire un ami tant on les sent solides et vrais dans leurs affections. Par contre, elle n'avait eu qu'un regard indifférent pour l'Anglais et ceux de sa suite. Les trois ducs, après s'être copieusement embrassés, venaient de prendre place sous le dais et une troupe de danseurs, portant de fantastiques costumes rouges et or qui étaient censés représenter des Sarrasins, s'élancèrent pour exécuter une danse guerrière en brandissant des sabres courbes et des lances. En même temps des serviteurs faisaient circuler des gobelets de vin et des fruits confits pour permettre aux invités d'attendre le festin qui aurait lieu un peu plus tard.
Le spectacle n'intéressait Catherine qu'à moitié. Elle était lasse et, à l'endroit où posait le diamant noir sur son front, elle éprouvait une douleur vague, comme si la pierre creusait sa chair. Elle souhaitait se retirer après l'arrivée des princesses qui ne devaient guère tarder... Le duc, assis sur son trône, tournait continuellement ses yeux vers elle tout en causant avec Bedford, mais cette attention l'agaçait plus qu'elle ne la flattait. Tout aussi pénibles lui étaient les nombreux regards toujours attachés à elle.
Une nouvelle sonnerie de trompettes annonça les princesses. Elles arrivèrent ensemble, identiquement vêtues d'argent, leurs longues traînes portées par de petits pages en velours bleu et satin blanc.
Derrière elles, écarlate et satisfaite, venait dame Ermengarde. La Grande Maîtresse faisait planer sur l'assemblée un regard olympien.
Ce regard, elle l'arrêta sur Catherine et la jeune femme y lut un sourire complice auquel elle répondit. Dans les grandes fêtes, dame Ermengarde appréciait surtout le souper et Catherine n'ignorait pas qu'elle se délectait d'avance, comme une grosse chatte, du repas qu'elle allait faire.
– Le duc ayant présenté chacune de ses sœurs à son futur époux, le maître des Cérémonies allait s'avancer pour former le cortège vers la salle de festin quand un héraut d'armes apparut sur le seuil de la porte, sonna de la trompette et, d'une voix claire, lança : Un chevalier inconnu, qui refuse de dire son nom, demande à être reçu dans l'instant par Monseigneur.
Les conversations s'arrêtèrent. À nouveau ce fut le silence. La voix de Philippe le Bon s'éleva :
– Que veut ce chevalier ? Et pourquoi à cette heure et au milieu d'une fête ?
– Je l'ignore, Monseigneur, mais il insiste pour parler à vous et cela tout justement au sein de la fête. Il jure sur l'honneur qu'il est de sang noble et digne d'être entendu...
Le procédé était pour le moins surprenant et battait en brèche le protocole, mais le duc ne détestait pas la nouveauté. Ceci était étrange, inattendu au milieu d'un bal... Sans doute l'attention aimable d'un grand vassal désireux de rehausser l'éclat de la fête. Cette obstination à cacher son identité devait dissimuler une surprise. Il leva la main, en souriant et ordonna :
– Que l'on nous amène donc, en ce cas, le chevalier mystérieux...
Gageons que c'est là quelque galanterie de l'un de nos féaux sujets qui réserve aux dames et à nous-mêmes, une joyeuse surprise...
Un murmure satisfait salua cet ordre. L'arrivant qui se cachait ainsi soulevait une vive curiosité. Sans doute allait-on voir apparaître un magnifique cavalier portant un costume somptueux qui viendrait sous le masque d'un paladin d'autrefois dire des vers d'amour ou offrir au duc un galant compliment... Mais quand le chevalier mystérieux parut, le brouhaha s'arrêta net.
Dans le cadre des portes ouvertes, en armure d'acier noir, il s'érigeait comme une statue funèbre. Noir, l'épervier battant de l'aile au timbre de son heaume, noires les armes qu'il portait et qui n'étaient certes pas des armes courtoises, mais bien des armes de guerre. Ventaille baissée, silencieux, sinistre, il regardait l'étincelante compagnie. Il tendit à un garde la lourde épée qu'il tenait puis, lentement il s'avança vers le trône, au milieu de la stupeur générale. Dans le grand silence, le claquement des solerets de fer sur les dalles résonnait comme un glas. Le sourire s'était effacé des lèvres de Philippe et chacun retenait son souffle.
Le chevalier noir avançait toujours, d'un pas lourd qui avait l'implacable mécanisme du destin. Au pied du trône, il s'arrêta. Le geste qu'il fit alors fut aussi violent qu'imprévisible.
Arrachant son gantelet droit, il le jeta brutalement aux pieds de Philippe qui bondit, blême soudain de colère. L'assistance gronda.
– Comment osez-vous ? Et qui êtes-vous ? Gardes... Démasquez cet homme ! aboya Philippe blanc de rage.
– Inutile !...
Sans se presser le chevalier portait les mains à son casque. Sans savoir pourquoi, le cœur de Catherine s'était mis à battre à tout rompre. Le sang, lentement, désertait son visage, ses mains. Une angoisse montait... Elle atteignit sa gorge, éclata dans un cri, vite étouffé sous les deux mains de la jeune femme. Le chevalier venait d'ôter son heaume. C'était Arnaud de Montsalvy.
Hautain et méprisant, il se tenait droit au pied du trône, le casque à l'épervier logé sous son bras gauche. Son regard sombre monta audacieusement jusqu'à celui de Philippe, s'y accrocha.
– Moi, Arnaud de Montsalvy, seigneur de la Châtaigneraie et capitaine du roi Charles, septième du nom, que Dieu veuille garder, je suis venu vers toi, Duc de Bourgogne, pour te porter mon gage de bataille. Comme traître et félon je te défie en champ clos, au jour et à l'heure qui te plairont et avec les armes de ton choix. Je réclame le combat à outrance...
Un véritable rugissement accueillit ce discours que la voix sonore d'Arnaud avait envoyé aux quatre coins de la salle. Un cercle menaçant se formait déjà derrière le jeune homme. Des seigneurs tiraient de leurs fourreaux les dagues légères qu'ils portaient et qui eussent été bien inefficaces contre une armure de bataille. Mais le cœur de Catherine défaillit de peur. Pourtant, d'un geste de sa main levée, Philippe de Bourgogne avait fait taire ses courtisans. La colère, peu à peu, s'effaçait de son visage, laissant place à la curiosité. Il se rassit, se pencha en avant.
– Tu ne manques pas d'audace, seigneur de Montsalvy. Pourquoi dis-tu que je suis traître et félon ? Pourquoi ce défi ?
Arrogant comme un coq de combat, Arnaud haussa les épaules.
– La réponse à ces questions est inscrite sur les armes de ton principal invité, seigneur Philippe de Valois. C'est la rose rouge des Lancastre que je vois ici, c'est l'Anglais que tu traites en frère, à qui tu donnes ta sœur. Et tu me demandes en quoi tu trahis ton pays, prince français qui reçoit l'ennemi sous son toit ?...
– Je n'ai pas à discuter ma politique avec le premier venu.
– Il ne s'agit pas de politique, mais d'honneur. Tu es vassal du roi de France et tu le sais bien ! Je t'ai lancé un défi, le relèves-tu ou bien dois-je de surcroît te traiter de lâche ?
Le jeune homme se baissait déjà pour reprendre son gantelet. Un geste du Duc l'arrêta.
– Laisse !... le gant est jeté, tu n'as plus loisir de le reprendre.
Un mauvais sourire fit étinceler un instant les dents blanches d'Arnaud. Mais le Duc poursuivait :
– Pourtant, un prince régnant ne peut se mesurer en champ clos avec un simple chevalier. Notre champion relèvera donc le gage lancé.
Un éclat de rire insolent lui coupa la parole. Catherine vit se crisper les doigts de Philippe sur les bras de son siège. Il se leva.
– Sais-tu que je pourrais te faire saisir par mes gens,-jeter en quelque basse-fosse...
Arnaud renonça soudain à tutoyer le duc :
– Vous pourriez aussi, seigneur duc, m'opposer dans le champ tous vos escadrons. Mais ce ne serait pas non plus vous conduire en chevalier. Sur le champ de mort d'Azincourt, où toute la noblesse de France tint à honneur de rompre les lances, sauf vous et votre noble père, plus d'un prince croisa l'épée avec plus simple gentilhomme que moi.
La voix de Philippe atteignit alors, sous l'effet de la colère, un diapason aigu qu'on ne lui avait que rarement entendu et qui trahissait sa fureur mieux que ses paroles.
– Nul n'ignore combien grands furent nos regrets de n'avoir pu participer à cette glorieuse et désastreuse journée.
– N'importe qui peut en dire autant, huit ans après ! fit Arnaud goguenard. Moi j'y étais, seigneur duc, c'est peut-être ce qui me donne le droit de parler si haut. N'importe ! Vous préférez boire, danser et fraterniser avec l'ennemi, libre à vous. Je reprends donc mon gage et...
– Moi je le relève...
Un chevalier gigantesque, portant un extravagant costume mi-partie rouge et bleu qui moulait strictement un torse épais comme celui d'un ours s'était avancé. Courbé rapidement avec une agilité dont pareille masse semblait incapable, il ramassa le gantelet. Puis se tourna vers le chevalier noir.
Tu souhaitais t'affronter à un prince, seigneur de la Châtaigneraie, tu peux te contenter du sang de Saint Louis, même frappé de bâtardise...
Je suis Lionel de Bourbon, bâtard de Vendôme et je te dis, moi, que tu en as menti par la gorge...
Catherine se soutenait à peine. Sur le point de défaillir, elle chercha instinctivement un appui. Elle rencontra le bras solide de dame Ermengarde qui se tenait près d'elle. Prunelles dilatées, narines battantes, la Grande Maîtresse piaffait comme un cheval de bataille qui entend la trompette. La scène jouée sous ses yeux, accaparait toute son attention et la ravissait visiblement. Elle couvait d'un regard brillant la silhouette vigoureuse et noire du capitaine de Montsalvy et une véritable houle soulevait sa poitrine généreuse... Le chevalier cependant contemplait avec un sang-froid absolu la gigantesque silhouette de son adversaire. L'examen dut le satisfaire car il haussa ses larges épaules vêtues d'acier.
– Va pour le sang du bon roi Louis, bien que je m'étonne de le voir aventuré dans une mauvaise cause ! J'aurai donc l'honneur, seigneur bâtard, de te couper les oreilles, à défaut de celles de ton maître. Mais retiens bien ceci : c'est au jugement de Dieu que je t'appelle. Tu as choisi de défendre la cause de Philippe de Bourgogne comme je l'attaque moi, au nom de mon maître. Il ne s'agit pas ici de rompre des lances courtoises en l'honneur des dames. Nous combattrons à outrance, jusqu'à la mort de l'un de nous, ou jusqu'à ce qu'il crie merci.