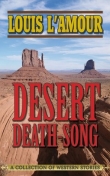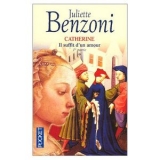
Текст книги "Catherine Il suffit d'un amour Tome 1"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Elle tendit un bras vers lui pour tenter de le ramener, déçue, et furieuse de le sentir échapper encore.
– Non ! Revenez Garin !... Pour l'amour du ciel, oubliez le duc...
Revenez à moi ! Nous pouvons être heureux ensemble, je l'ai senti !
Mais il repoussait doucement la main tendue, refermait son pourpoint avec des doigts qui tremblaient. Il hocha la tête. Son visage retrouvait sa pâleur. Une brusque envie de pleurer secoua Catherine.
Des larmes de colère jaillirent de ses yeux.
– Enfin... pourquoi ? Dites-moi pourquoi ? Je vous plais, je le sens... Vous me désirez aussi, je viens d'en avoir la preuve. Alors pourquoi ?
Lentement, Garin s'assit au bord du lit. Sa main caressa le joli visage en pleurs avec une infinie douceur, se posa sur la tête dorée.
Catherine l'entendit soupirer. Elle s'écria douloureusement :
– Osez dire que vous ne souffrez pas de cette contrainte inhumaine que vous vous imposez, osez le dire ? Je sens que vous êtes malheureux. Et pourtant, vous vous obstinez, stupidement, à nous faire mener, à tous deux, une vie ridicule, anormale...
Le regard de Garin, subitement, s'échappa. Abandonnant la forme rose étendue sur le lit, il s'en alla vers les ombres de la pièce. A nouveau, il soupira. Sa voix se chargea d'une étrange douceur où passait une souffrance cachée et d'autant plus poignante.
« J'en ai telle peine au cœur » murmura-t-il. « La vie était si belle jadis ! Telle peine que mon rire dut se changer en pleurs ! Jusqu'aux oiseaux des bois qu'afflige notre plainte ! Belle merveille que j'en perde courage ! Mais que dis-je, pauvre sot, dans le feu de ma rancœur ? Qui cherche la joie ici-bas, il l'a perdue ailleurs hélas, à jamais hélas !... »
Catherine, interdite, l'écoutait, surprise par l'étrangeté des paroles.
– Qu'est-ce là ? demanda-t-elle.
Garin eut pour elle un pâle sourire.
– Rien... pardonnez-moi ! Quelques vers d'un poète allemand qui s'en alla aux Croisades et que protégeait l'Empereur Frédéric II. On l'appelait Walther von der Vogelweide... Voyez-vous, je suis comme notre ami Abou-al Khayr ! j'aime beaucoup les poètes. Maintenant, je vous laisse, Catherine. Dormez ici, si tel est votre désir...
Avant que Catherine ait pu le retenir, il avait traversé la chambre, disparu dans la galerie. Elle entendit son pas décroître... Alors, la colère l'emporta. Glissant à bas du lit, elle récupéra son manteau, ses mules, puis s'enveloppant hâtivement, regagna sa chambre en courant.
Au bruit de la porte qui claquait derrière elle, Sara qui sommeillait sur un tabouret auprès du feu, sursauta et, la reconnaissant, bondit sur ses pieds.
– Alors ?
Rageusement, Catherine arracha le collier barbare et le lança de toute sa force à travers la pièce. Puis elle piétina le manteau de soie.
Des larmes de fureur jaillissaient de ses yeux.
– Alors... rien ! sanglota-t-elle, absolument rien !
– Ce n'est pas vrai ?...
– Mais si, puisque je te le dis...
Les nerfs de Catherine la lâchaient maintenant. Elle sanglotait nerveusement sur l'épaule de Sara sans même songer à enfiler un vêtement. La tzingara, sourcils froncés, la laissa se calmer un peu.
Quand les sanglots s'espacèrent, elle passa un doigt léger sur la gorge de Catherine où la trace des dents de Garin se voyait, avec une gouttelette de sang.
– Et ceci ? Qu'est-ce que c'est ?...
Catherine, vaincue, se laissa coucher comme un bébé puis, tandis que Sara soignait la petite blessure, elle raconta tout ce qui s'était passé entre elle et son mari. Elle conclut avec un haussement d'épaules :
– Il est plus fort que nous ne croyions, Sara... et terriblement maître de lui. Pour rien au monde il ne manquerait à la parole donnée à son duc.
Mais Sara secoua la tête.
– Ce n'est pas cela. Il a bien failli manquer à cette parole et tu as été tout près de gagner. Je sens qu'il y a autre chose, mais quoi ?...
– Comment le savoir ? Que faire ?
– Rien ! Attendre. L'avenir, peut-être, nous renseignera.
– En tout cas, fit Catherine en se calant confortablement dans ses oreillers, ne compte pas sur moi pour recommencer une telle expérience.
Sara se pencha pour embrasser la jeune femme, tira les rideaux du lit, puis sourit :
– Est-ce que je dois aller chercher le fouet à chiens pour la correction que tu m'avais promise ?
Cette fois Catherine se mit à rire et cela lui fit un bien immense. Sa défaite de la soirée perdait de son importance à mesure que son corps retrouvait le calme et le bien-être. L'expérience avait été intéressante, après tout, mais au fond, il n'était pas mauvais qu'elle se fût ainsi terminée... puisqu'elle n'aimait pas Garin.
Ces consolantes réflexions ne l'empêchèrent aucunement de faire toute la nuit des rêves extravagants dans lesquels Garin et son irritant secret jouaient le principal rôle.
Catherine ne portait pas le collier de turquoises, que d'ailleurs elle avait pris en grippe, quand, la main posée sur le poing de son époux, elle pénétra dans la salle du Palais Ducal où se tenait la duchesse-douairière de Bourgogne. Garin connaissait trop Marguerite de Bavière, mère de Philippe le Bon, pour avoir conseillé à son épouse autre chose qu'une assez simple toilette de velours gris portée sur une robe de dessous en toile d'argent assortie au hennin pointu, si haut que la jeune femme dut baisser la tête pour franchir le cintre de pierre de la porte. Un unique bijou, mais très beau, pendait à son cou, au bout d'une mince chaîne d'or : une très belle améthyste reliant entre elles trois perles en poire d'un merveilleux orient.
La salle de réception qui faisait partie des appartements privés de la duchesse était de dimensions réduites, meublée surtout de coffres et de quelques sièges massés auprès de la fenêtre où se tenait la princesse, assise dans un grand fauteuil armorié. Des carreaux de velours noir étaient éparpillés, à même le dallage, pour les filles d'honneur.
A cinquante ans passés, Marguerite de Bavière conservait de nombreuses traces d'une beauté qui avait été célèbre. Le port de sa tête fine demeurait inimitable et parvenait à faire paraître long un cou peu élevé. Ses joues avaient perdu la rondeur de la jeunesse et ses yeux avaient pâli un peu leur azur, mais leur regard restait direct et impérieux et le pli des lèvres un peu fortes trahissait un caractère énergique et obstiné. Le nez était long, mais élégant et bien dessiné, les mains admirables et la taille assez élevée.
Depuis la mort de son mari, Marguerite n'avait pas quitté le deuil et se vêtait de noir strict, mais somptueux. Sa robe et son hennin de velours noir s'ourlaient tous deux de zibeline, mais un très beau collier d'or, formant une guirlande de feuilles d'acanthe, luisait sous le voile de mousseline noire qui tombait de la coiffure, enveloppant le cou de la duchesse. Ce deuil sévère était moins inspiré, chez cette grande femme hautaine, par les regrets donnés à l'époux mort que par le souci inflexible de son rang. Bien plus séduisant que le revêche Jean-Sans-Peur, avait été pour Marguerite le charmant duc Louis d'Orléans qu'à la Cour de France on lui avait prêté comme amant. Et les gens bien informés chuchotaient que, plus encore que la lutte d'influence, c'était la jalousie qui avait poussé Jean-Sans-Peur au crime de la poterne Barbette. Jamais, pourtant, les lèvres serrées de Marguerite n'avaient laissé échapper leur secret. Elle était, pour son fils Philippe, une excellente mère et une collaboratrice dévouée. Entre ses mains fermes, la Bourgogne se portait bien et Philippe pouvait sans crainte se consacrer aux provinces du Nord.
Autour de leur mère, formant une couronne serrée parmi les demoiselles d'honneur, quatre des six filles de la duchesse étaient assises, travaillant avec elle au même ouvrage de broderie, une immense bannière de guerre, rouge écartelée d'une croix de Saint-André blanche. Du premier regard, Catherine reconnut la jeune veuve du duc de Guyenne, Marguerite, et ressentit une sorte de joie à trouver là celle qui avait tenté de sauver Michel de Montsalvy pendant l'émeute de l'hôtel Saint-Pol. Elle attachait à cette rencontre une valeur de présage. Âgée maintenant de vingt-neuf ans, la jeune duchesse n'avait pas beaucoup changé. Elle s'était seulement un peu alourdie, mais sa peau très blanche n'avait peut-être que plus d'éclat.
Plus âgée de trois ans que son frère Philippe, elle était l'aînée de la famille.
Auprès de son éclat épanoui, sa sœur Catherine faisait étrangement terne. Elle avait une silhouette quasi diaphane, s'habillait sans éclat, comme une religieuse, de robes sombres et de guimpes sévères qui ne laissaient passer qu'un visage mince de furet aux yeux inquiets.
Catherine était la malchanceuse de la famille. Fiancée une première fois, à dix ans, au comte Philippe de Vertus, elle avait appris six ans plus tard, au moment où le mariage devait être célébré, la mort glorieuse de son fiancé dans la boue d'Azincourt. Une autre union, avec l'héritier d'Anjou avait été projetée, mais la mort brutale du duc Jean, à Montereau, avait rejeté chacun des deux fiancés dans un camp ennemi, brisé le mariage projeté. Depuis, Catherine de Bourgogne refusait toutes les demandes.
Les deux autres princesses, Anne et Agnès, dix-neuf et dix-sept ans, encore filles, se contentaient d'être ravissantes, fraîches et gaies, mais les pauvres de Dijon chantaient déjà, avec vénération, les louanges d'Anne qu'ils proclamaient un ange descendu sur la terre.
Toutes deux accueillirent la révérence de Catherine avec un franc sourire qui alla droit au cœur de la jeune femme.
– Voici donc votre épouse, Messire Garin, fit la voix grave de la duchesse. Nous vous faisons grande louange : elle est admirablement belle et, cependant, sait garder la modestie qui convient à une jeune femme. Approchez, ma chère...
Le cœur battant, Catherine s'approcha du fauteuil de la duchesse et s'agenouilla, gardant la tête inclinée. Marguerite sourit, en détaillant d'un œil approbateur la toilette de la jeune femme, son décolleté modeste et son front rougissant. Elle n'ignorait pas les vues un peu spéciales que son fils avait sur cette jeune femme et ne s'en offusquait pas. Il était normal qu'un prince eût des maîtresses et, si son orgueil s'était cabré devant l'élévation d'une fille du commun, elle admettait honnêtement que cette bourgeoise avait l'allure d'une grande dame et une beauté véritablement hors de pair.
– Nous serons heureuse de vous compter désormais au nombre de nos dames de parage, dit-elle aimablement. Notre grande maîtresse, la dame de Châteauvillain, auprès de qui nous vous ferons conduire plus tard, vous expliquera votre service. Saluez maintenant nos filles et prenez place sur ce carreau à nos pieds, près de Mademoiselle de Vaugrigneuse...
Elle désignait une jeune fille au visage ingrat mais somptueusement vêtue. Un brocart d'azur et d'argent faisait ressortir assez fâcheusement un teint jaune, hépatique. La jeune fille désignée eut, en s'écartant précipitamment du coussin assigné à Catherine, un dédaigneux mouvement des lèvres qui n'échappa pas au regard aigu de la duchesse.
Nous tenons à ce que l'on sache, ajouta celle-ci, sans élever la voix mais d'un ton si tranchant que l'intéressée devint instantanément écarlate, que la naissance n'est pas tout en ce bas monde et que notre faveur peut en tenir lieu aisément. La volonté des princes a l'égal pouvoir d'élever la modestie là où il lui plaît et de courber plus bas que terre les fronts trop hardis...
Marie de Vaugrigneuse se le tint pour dit et trouva même un sourire pour répondre à celui, timide, de Catherine. Satisfaite d'avoir ainsi mis les choses au point, la duchesse se tourna vers Garin.
– Laissez-nous, maintenant, Messire. Nous souhaitons nous entretenir avec votre jeune épouse de questions ménagères et féminines qui ne sont guère intéressantes pour des oreilles masculines.
La duchesse, ayant vu le jour et passé toute sa jeunesse en Hollande, en avait apporté de solides qualités ménagères, l'amour de l'ordre et d'une maison bien tenue. Elle ne dédaignait pas de s'occuper elle– même du train du palais, veillait aux dépenses de sa maison, aux cuisines et même à la basse-cour. Elle savait, à l'unité près, le compte de ses draps, le nombre des dindons et si la dépense de chandelles était normale ou pas. De plus, elle avait le goût des animaux singuliers. Un marsouin était élevé dans un bassin creusé au milieu du jardin du palais et la duchesse donnait ses soins les plus tendres à un porc– épic pour qui elle avait fait construire une niche au bas de l'escalier de la tour Neuve1. Elle avait aussi un grand perroquet, un merveilleux cacatoès blanc à huppe rose qu'un voyageur vénitien avait rapporté pour elle des îles Moluques. Comme justement un page apportait l'oiseau, hiératique et grognon sur son perchoir d'or, le sujet de conversation entre Catherine et la duchesse fut tout de suite trouvé.
1. Aujourd'hui tour de Bar.
Catherine admira le plumage éclatant de l'oiseau avec une sincérité qui lui gagna le cœur de Marguerite, parla discrètement de son Gédéon sur lequel maintes et maintes questions lui furent posées avec un intérêt non dissimulé. La duchesse avait donné à son oiseau le nom de Cambrai qui avait vu son mariage avec le duc Jean. Elle s'amusa fort des méfaits de Gédéon et de son exil chez le petit médecin maure.
– Il faudra nous amener et l'oiseau et son gardien, fit Marguerite.
Nous sommes curieuse de voir aussi bien l'un que l'autre. Et peut-être ce physicien infidèle pourra-t-il quelque chose pour nos maux, qui sont nombreux.
La duchesse était si enchantée de sa nouvelle dame de parage, que, lorsque les écuyers de bouche apportèrent la collation, elle fit servir Catherine la première. Comme boisson on servit du galant, ce vin cuit fortement aromatisé, que feue la duchesse Marguerite de Flandres avait mis à la mode et qu'elle ne dédaignait pas de fabriquer ellemême. Des gâteaux et surtout le boichet, fait de farine et de miel1
composaient le léger repas.
Dans cette atmosphère de bienveillance et de sympathie, Catherine oubliait sa timidité. Elle sentit qu'elle se plairait, dans ce cercle, même si deux ou trois de ses nobles compagnes, comme Marie de Vaugrigneuse, lui faisaient grise mine. Elle grignota deux darioles et but un gobelet de galant avec plaisir. Garin lui avait dit que la duchesse appréciait les appétits vigoureux à la mode de son pays.
La collation se terminait et les valets emportaient les reliefs, quand un page vint annoncer à la duchesse qu'un chevaucheur de la Grande Écurie du Duc arrivait d'Arras avec un message urgent.
– Conduisez-le ici ! ordonna Marguerite.
I. L'ancêtre du célèbre pain d'épices dijonnais.
Quelques minutes plus tard, un pas rapide faisait résonner les dalles du vestibule sous une paire de sole– rets de fer. Un homme, pas très grand mais singulièrement vigoureux, portant l'uniforme de drap vert garni de plaques d'acier des chevaucheurs ducaux, entrait presque aussitôt et, conduit par un page, venait s'agenouiller aux pieds de la duchesse. Il avait ôté son casque poudreux qu'il tenait sous le bras et, de son tabard brodé aux armes ducales sortait un rouleau de parchemin qu'il tendit, tête respectueusement inclinée. Cette tête aux épais cheveux noirs coupés carrément, Catherine la regardait avec une surprise encore hésitante, mais qui, à mesure que la conviction se précisait, se faisait plus grande et plus joyeuse. Est-ce que vraiment, ce pouvait être lui ? Est-ce qu'elle n'était pas le jouet d'une illusion ?
Le profil busqué était tellement semblable à celui dont elle avait gardé le souvenir.
– Vous venez d'Arras en ligne droite ? demanda la duchesse.
– En ligne droite, Madame, et aux ordres de votre Grâce !
Monseigneur le Duc, en personne, a daigné me recommander la promptitude. Les nouvelles que j'apporte sont d'importance.
L'homme s'exprimait sans trouble, sans hardiesse non plus et le son de sa voix, un peu plus basse que jadis mais si familière, enleva à Catherine ses derniers doutes. Le chevaucheur de Philippe de Bourgogne, c'était Landry Pigasse, son ami d'enfance...
Il ne la regardait pas, ne tournait même pas la tête vers le groupe chuchotant et soyeux des filles d'honneur. Simplement, toujours à genoux, il attendait les ordres... Mais Catherine dut faire appel à toute sa bonne éducation pour ne pas bousculer tout le monde et sauter au cou de son camarade d'aventures. Hélas, ce qui était permis à Catherine Legoix, ne l'était pas à la dame de Brazey surtout sous l'œil de la duchesse.
Celle-ci avait pris le parchemin au grand sceau de cire rouge et le déroulait en le tenant à deux mains. Sourcils froncés, elle parcourut le texte à vrai dire assez court. Son visage se creusa un peu, sa bouche se pinça et la curiosité de sa cour se changea en inquiétude. Les nouvelles étaient donc mauvaises ?
D'un geste, la duchesse congédia Landry. Il se releva, s'éloigna à reculons, suivi avidement par le regard de Catherine. Quand il eut disparu, la jeune femme réprima un soupir mais se promit bien de le faire rechercher dès qu'elle pourrait...
Marguerite de Bavière, un coude appuyé à son fauteuil et le menton dans la main gardait le silence. Elle réfléchissait profondément. Au bout d'un moment, elle se redressa, jeta un regard circulaire sur ses femmes, arrêta ce regard sur ses filles.
– Mesdames, dit-elle d'une voix lente, les nouvelles que nous mande notre seigneur et fils sont, en effet d'importance. Il n'est pas trop tôt pour vous les communiquer. Dès maintenant, il nous faudra prendre nos dispositions afin d'accompagner auprès de Monseigneur Philippe celles de ses sœurs qu'il réclame...
Tandis qu'un léger murmure s'élevait, la duchesse se tourna vers sa fille aînée qu'elle regarda gravement.
– Marguerite, dit-elle, le bon plaisir de votre frère est de vous mettre à nouveau en puissance d'époux. Il vient d'accorder votre main à un haut et puissant seigneur, de belle réputation et de vieille noblesse.
– Qui donc, ma mère ? fit Marguerite qui avait pâli imperceptiblement.
– Vous devez épouser prochainement Arthur de Bretagne, comte de Richemont. Quant à vous, Anne... et la duchesse se tournait maintenant vers l'une de ses plus jeunes filles avec une émotion qu'elle ne parvenait pas à dissimuler.
– Moi, ma mère ?
Oui, vous, mon enfant. Pour vous aussi votre frère a fait choix d'un époux. En même temps que les fiançailles de votre sœur il entend célébrer les vôtres avec le régent de France, le duc de Bedford...
La voix de la duchesse avait faibli sur les derniers mots, couverte par le cri de la jeune fille.
– Un Anglais, moi ?
– Il est l'allié de votre frère, fit la duchesse avec un visible effort, et sa politique exige que les liens se resserrent entre notre famille et celle... du roi Henri.
Du fond de la salle, une voix vigoureuse protesta :
– Il n'est d'autre roi de France que Monseigneur Charles et l'Anglais n'est qu'un larron. Sans cette damnée putain d'Isabeau, qui nie la naissance royale de son fils, il n'y aurait aucun doute là-dessus !
Une dame grande et forte qui drapait d'écarlate une carrure de lansquenet et dont les douces mousselines blanches, encadrant son visage, ne parvenaient pas à idéaliser les traits vigoureux et le semblant de moustache, avait franchi la porte en femme habituée à les voir s'ouvrir automatiquement devant elle. Loin de s'irriter de cette entrée fracassante, la duchesse la regardait venir en souriant. Nul à la cour n'ignorait que la noble dame Ermengarde de Châteauvillain, grande maîtresse de la maison de la duchesse avait son franc-parler, qu'elle était l'ennemie irréductible de l'alliance anglaise et l'eût proclamé en pleine cour de Westminster si ses convictions lui eussent paru nécessiter un tel éclat. Elle haïssait l'Anglais, ne permettait à personne d'en douter et la puissance de son courroux avait déjà fait reculer plus d'un vaillant chevalier.
– Ma mie, fit la duchesse gentiment, le malheur veut qu'il y ait doute !
Pas pour moi qui suis bonne Française autant que bonne Bourguignonne ! Ainsi l'on va livrer cette agnelle à un boucher anglais
? fit-elle en étendant vers la princesse Anne une main grande comme un plat, mais d'une étrange beauté.
La pauvrette n'avait nul besoin qu'on l'encourageât à perdre contenance car, oubliant tout protocole, elle s'était.mise à pleurer doucement.
– Le Duc le veut, ma bonne Ermengarde. Puisque vous êtes si fidèle Bourguignonne, vous savez que nul ne se peut opposer à sa volonté.
– C'est bien ce qui m'enrage ! fit dame Ermengarde en se carrant dans le fauteuil qu'Anne de Bourgogne avait abandonné pour s'agenouiller près de sa mère.
Soudain, son regard se fixa sur Catherine qui avait assisté, un peu éberluée, à son entrée tumultueuse. La belle et grande main se tendit vers elle :
– Est-ce là notre nouvelle dame de parage ? demanda-t-elle.
– C'est en effet dame Catherine de Brazey, fit la duchesse tandis que l'intéressée saluait, avec tout le respect requis, la comtesse de Châteauvillain.
Celle-ci la regarda faire, répondit par un signe de tête, puis déclara avec bonne humeur :
– Jolie recrue !... Morbleu, ma belle, si j'étais votre mari je monterais une garde sévère autour de vous. Je sais ici plus d'un seigneur qui n'aura bientôt plus d'autre idée que vous mettre en son lit le plus vite possible.
– Ermengarde !... reprocha la duchesse. Vous gênez cette petite.
– Bah, fit dame Ermengarde avec un large sourire qui montra une redoutable rangée de solides dents blanches, un compliment n'a jamais tué personne quand il est sincère et je suppose que dame Catherine en a déjà entendu d'autres...
La bonne dame eût sans doute discouru un bon moment sur ce sujet car elle aimait les contes gaillards et les histoires lestes. Mais la duchesse Marguerite se hâta de couper court en informant ses dames qu'elles étaient toutes invitées à préparer leurs coffres pour se rendre en Flandres et en les priant de la laisser seule avec « sa chère amie de Châteauvillain avec qui de fort importantes questions devaient être débattues ».
Au milieu des autres, Catherine fit la révérence et quitta la salle avec l'idée de se mettre à la recherche de Landry. Mais dans la galerie, Marie de Vaugrigneuse la retint par sa manche.
– J'admire beaucoup le velours que vous portez, ma chère. Est-ce chez Monsieur votre oncle que vous vous fournissez ?
– Non, fit Catherine gracieusement, se souvenant des indications de Garin, ce sont les ânes de Monsieur votre aïeul qui vont les chercher pour moi jusqu'à Gênes...
Dès qu'elle eut le loisir de le faire, Catherine essaya de retrouver Landry. Mais le logis des chevaucheurs ducaux se trouvait auprès des écuries où une dame de parage n'avait que faire sans l'aveu de la duchesse et, de plus, il lui fut répondu, par l'écuyer auquel elle s'adressa, que Landry Pigasse ne faisait que toucher terre à Dijon. Il se restaurait pour le moment et reprendrait la route le soir même, porteur de dépêches que le chancelier Rolin avait fait parvenir de Beaune dans la journée. Il devait franchir les portes de la ville avant la clôture...
N'osant insister, Catherine rentra chez elle, pensant que, si elle devait faire partie de l'escorte des princesses, elle aurait, en Flandres, toutes les chances de retrouver son ami d'enfance. Elle avait éprouvé une joie profonde à le revoir car il portait en lui certains liens rompus avec le passé, tous ceux qui l'unissaient encore à la boutique du Pont-au-Change, aux rues de Paris et au terrible jour de l'émeute.
Les semaines suivantes, elle n'eut pas le loisir de s'étendre longuement sur les réminiscences d'autrefois. Presque chaque jour, elle se rendait au palais ducal auprès de la duchesse-douairière qui s'était prise d'amitié pour elle et réclamait volontiers ses services.
Catherine s'était vue chargée, avec Marie de Vaugrigneuse, qui était la filleule de la duchesse, de la garde– robe de sa maîtresse. Cela n'allait pas sans coups de bec et coups de griffes car la sympathie n'était toujours pas née entre les deux jeunes femmes. Catherine se fût fort bien passée de cette petite guerre, la jeune fille ne lui inspirant qu'une indifférence dédaigneuse, mais son caractère entier ne lui permettait pas d'endurer patiemment les continuelles piqûres d'amour-propre dont la gratifiait Marie. Les tissus de l'oncle Mathieu et les ânes du grand-père Vaugrigneuse, dont l'anoblissement était assez récent et qui avait gagné sa fortune dans le commerce, clandestin, mais très rémunérateur, de ces intéressants animaux, faisaient la plupart du temps les frais de la guerre.
Autre sujet d'activité pour la jeune femme : le prochain départ vers les Flandres et les préparatifs du double mariage des princesses. Étant attachée à la garde-robe, Catherine s'occupait activement du trousseau des deux princesses, les aidait à choisir les tissus, les modèles de robes, harcelant dame Gauberte, la bonne faiseuse, avec l'aide vigoureuse, il est vrai, d'Ermengarde de Châteauvillain. Elle avait eu l'adresse de se faire une alliée de la redoutable grande maîtresse par l'offrande, gracieuse autant que discrète, d'une magnifique pièce de velours de Gênes, pourpre et or, prise chez l'oncle Mathieu et qui avait fait la joie de la comtesse. Celle-ci appréciait au plus haut point les couleurs violentes et surtout le rouge vif, qui, pensait-elle, ajoutait à sa majesté naturelle. La pièce de velours et l'irrésistible sourire de Catherine, joints à une incontestable compétence en matière d'élégance et de soins ménagers, avaient définitivement rangé la comtesse du côté de l'épouse du grand argentier.
Quant à la vie privée de la nouvelle dame de parage, elle était sans histoires. Les jours passaient, paisibles et sans à-coups auprès de Garin, presque tous semblables. L'argentier recevait peu, n'aimant pas à étaler outre mesure sa fortune parce qu'il savait combien la grande richesse attire la jalousie. S'il tenait è un certain décorum, à un faste réel dans l'enceinte de ses demeures, c'était pour la seule joie de ses yeux et son unique satisfaction personnelle. Aux grands banquets, aux fêtes bruyantes, il préférait une partie d'échecs au coin du feu, la compagnie d'un livre, la contemplation de sa collection d'objets rares et, depuis quelque temps, la compagnie d'Abou-al-Khayr dont il appréciait la science et la sagesse orientale.
Les deux hommes avaient de longs entretiens auxquels Catherine assistait fréquemment mais qui la faisaient bâiller d'ennui car elle ne s'intéressait pas, comme Garin, aux mystères de la médecine et à la; science, dangereuse et subtile, des poisons. Le petit médecin maure, s'il était pour son époque un remarquable praticien, était encore beaucoup plus brillant toxicologue.
Enfin vint le temps où les princesses, Marguerite et Anne, quittèrent Dijon avec leur suite. La longue file de chevaux, de haquenées, de chariots et de mules chargées de coffres, protégée par une puissante escorte armée contre les convoitises des pillards, franchit la porte Guillaume dans les derniers jours de mars. Bien vite, derrière elle, l'enceinte fortifiée et le dessin fantastique des tours et des clochers qui faisaient ressembler Dijon, de loin, à une forêt de lances, s'estompèrent.
La gaieté, normalement de mise dans une expédition de ce genre, était cependant absente du convoi comme Catherine le constata sans surprise. La santé de la duchesse Marguerite s'était altérée, dans les dernières semaines et à son profond regret elle avait dû renoncer à escorter ses filles. C'était la comtesse Ermengarde qui la représentait et devait chaperonner les deux princesses.
Bien assise sur sa selle, emmitouflée d'une immense pelisse couleur lie-de-vin et toute doublée de renard roux, Ermengarde de Châteauvillain chevauchait à côté de Catherine. Ni l'une ni l'autre ne parlait, préférant contempler la jeune verdure qui commençait à poindre sur les branches, respirer l'air vif du matin et jouir du soleil.
Ce soleil qui entrait si difficilement dans les rues tortueuses, encaissées et empuanties de la ville... Catherine avait toujours aimé les voyages, même très courts et celui-ci lui rappelait celui qu'elle avait fait l'année précédente avec l'oncle Mathieu et qui avait été si fertile en événements.
Quant à la comtesse Ermengarde, elle aimait aussi les voyages mais pour une tout autre raison que sa jeune compagne. Outre la curiosité extrême qu'elle portait à toutes choses, elle aimait se laisser porter, au long de routes interminables par le pas doux et mesuré de sa monture.
Cela lui permettait de dormir très confortablement et elle retirait de ces siestes au grand air un grand bien-être et un appétit accru.
Le Duc de Bourgogne attendait ses sœurs à Amiens, où devaient être célébrées les doubles fiançailles, fruit de négociations menées depuis plusieurs mois avec le régent anglais et le Duc de Bretagne. Il avait fait choix d'une ville épiscopale, en principe neutre, pour ne pas peiner le Duc de Savoie, puisque les négociations patronnées par ce dernier, n'étaient pas considérées comme rompues. Mais, en fait, l'évêque d'Amiens était à sa dévotion et il se trouvait chez lui autant que sur ses propres terres.
Lorsque le cortège des deux princesses arriva sur la Somme, après un voyage sans histoire à travers la Champagne dévastée, la comtesse Ermengarde n'avait guère fait entendre autre chose que des monosyllabes de plus en plus rogues à mesure que l'on avançait. C'est que, sur tout le passage de la fastueuse cavalcade, on n'avait guère rencontré que des hommes, des femmes et des enfants aux corps trop maigres et mal vêtus, de haillons, des figures creusées par la faim où luisaient des regards de loups. Partout l'Anglais et les routiers, partout la misère, la faim, la peur, la haine. L'hiver qui se terminait avait été terrible. La famine, née des récoltes pillées et brûlées sur pied, avait ravagé des lieues et des lieues de terre, moissonné des populations entières. Nombre de villages étaient vides quand ils montraient autre chose que quelques madriers à demi calcinés. Ce voyage, commencé par Catherine avec un si vif plaisir tant que l'on était en Bourgogne, s'était mué peu à peu en un cauchemar permanent. Le cœur serré, la jeune femme fermait les yeux quand les hommes d'armes de l'escorte repoussaient avec brutalité, du bois de leurs lances, un groupe misérable qui osait demander la charité. Pourtant, chaque fois que le fait s'était présenté, la princesse Anne était intervenue avec indignation, reprochant violemment aux soldats leur dureté. Son cœur généreux se fondait de pitié à la vue de tant de misères et, inlassablement elle donnait, donnait encore, donnait tout ce dont elle pouvait disposer, laissant derrière elle un lumineux village de douceur et de compassion. Si Garin ne s'y était respectueusement, mais fermement opposé, elle eût distribué au long de sa route les trente mille écus d'or que portaient les mules et qui représentaient une partie de la dot princière, de cent mille écus, destinée au duc anglais. Cette dot entretenait une colère latente chez dame Ermengarde.