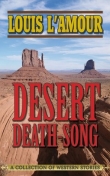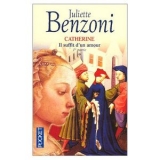
Текст книги "Catherine Il suffit d'un amour Tome 1"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Depuis son retour de Flandres, Catherine avait l'impression de vivre dans une peau qui n'était pas tout à fait la sienne et dans laquelle elle se sentait mal à l'aise. Elle avait eu beaucoup de mal à rentrer dans l'ordre familial, si soigneusement établi depuis des années, si immuable et l'ornière où roulait sa vie tranquille de petite bourgeoise lui
semblait
maintenant
bien
plus
profonde,
étrangement
inconfortable.
Il avait fallu une toute petite chose pour l'arracher à son univers paisible, un peu incolore et pour la jeter dans des chemins inconnus. Il avait fallu une simple gifle appliquée sur la joue d'un pelletier gantois trop entreprenant pour déchaîner le destin. Cette gifle avait retardé leur départ de Bruges tout en la jetant presque aux bras du duc Philippe et ce retard les avait amenés à point nommé pour porter secours à un chevalier blessé. Une minute, Catherine avait vu s'entrouvrir les portes d'un avenir éblouissant et puis ces portes s'étaient refermées, avec le claquement sec d'une autre gifle. En principe, le cercle était fermé, d'une gifle à l'autre, mais la jeune fille savait bien qu'il n'en était rien, que quelque chose viendrait.
Pour en être sûre, il lui suffisait de regarder le superbe perroquet qui sommeillait sur son perchoir doré, dans un coin de sa chambre, près de la fenêtre, un magnifique oiseau aux plumes bleues touchées d'écarlate qu'un page avait apporté un matin au nom du duc et que l'oncle Mathieu avait eu bonne envie de renvoyer d'où il venait.
Catherine rit toute seule en se rappelant l'arrivée de l'oiseau et la stupeur indignée du drapier devant cet animal étrange dont l'œil rond et arrogant l'examinait sans indulgence. En apprenant que l'oiseau était pour Catherine et que le duc en personne l'envoyait, Mathieu était devenu rouge de colère.
– Monseigneur Philippe nous fait trop d'honneur ! fit-il au page impassible qui attendait qu'on le débarrassât de son fardeau, mais ma nièce est fille et ne doit pas recevoir de si précieux cadeau.
Il ne savait comment expliquer son idée sans blesser son seigneur, mais le page avait bien compris ce que cela voulait dire.
– Je ne peux remporter Gédéon, dit-il. Ce serait offenser Monseigneur.
– Mais moi, répliqua Mathieu, Monseigneur m'offense en supposant que ma nièce pourrait accueillir ses hommages. La réputation d'une fille est fragile.
C'est alors que Gédéon, trouvant que la discussion s'éternisait, était entré dans le débat. Ouvrant son grand bec rouge qui le faisait ressembler vaguement de profil à l'oncle Mathieu, il avait clamé :
– Gloirrrrrrrre... au duc ! Gloirrrrrre... au duc !...
Mathieu avait été tellement stupéfait d'entendre parler l'oiseau qu'il avait laissé le page repartir sans plus songer à le retenir. Et Catherine qui s'étouffait de rire avait pu emporter dans sa chambre le papegeai.
Il continuait à hurler. Depuis, Gédéon était la grande récréation de la maison, et même de l'oncle Mathieu. Tous deux se disputaient férocement.
Après s'être recoiffée devant son miroir, Catherine s'apprêtait à redescendre quand le pas d'un cheval dans la rue l'attira à la fenêtre.
Une épaisse couche de poussière se levait sous les pas de l'animal car les rues de Dijon n'étaient pas encore pavées. Passant lentement entre la double rangée de maisons aux fenêtres desquelles s'agitaient les ménagères, elle reconnut Garin de Brazey et n'eut pas le temps de s'étonner. L'argentier, la tête levée, l'avait aperçue à sa fenêtre et la saluait gravement. Rougissante, elle rendit le salut et se retira au fond de la pièce ne sachant trop comment interpréter cette nouvelle rencontre, suivant de si près la première. Venait-il acheter des étoffes
? Mais non, le pas du cheval s'éloignait. Lissant machinalement du doigt sa jupe de toile vert amande garnie d'un simple galon blanc, la jeune fille descendit retrouver Mathieu.
Elle trouva le drapier dans le réduit où il serrait ses livres. Penché sur le pupitre de bois noir, une plume d'oie à l'oreille, il faisait des comptes dans un énorme livre relié en parchemin tandis que, dans la boutique, ses aides déballaient un gros colis de tissus tout juste arrivé d'Italie. Voyant que Mathieu était trop absorbé pour lui prêter attention, elle alla aider le vieux Pierre à ranger les nouvelles pièces.
C'étaient des brocarts de Milan et des velours de Venise. Catherine n'aimait rien tant que palper ces étoffes magnifiques, réservées à la noblesse et aux riches bourgeoises. Elle-même n'en porterait sans doute jamais de semblables. Un superbe brocart d'un rose pâle dont le perfilage d'argent dessinait des oiseaux fantastiques l'attira particulièrement.
– Vois donc cette merveille, fit-elle en drapant devant elle un pan du tissu. Comme j'aimerais la porter !
Le vieux Pierre jugeait à part lui que Catherine était digne de toutes les splendeurs et il la regardait avec un sourire indulgent.
– Demandez-le à maître Mathieu, fit-il ! Peut-être bien qu'il vous le donnera. Et si j'étais vous, je lui demanderais aussi ce tissu-là. Vous seriez bien belle avec.
Il désignait un velours ciselé vénitien fait de grandes fleurs noires qui se détachaient sur un fond lamé d'or et Catherine, avec un cri d'admiration, allait s'en emparer quand la voix grondeuse de Mathieu leur parvint :
– Laissez ces étoffes tranquilles ! Elles sont fragiles et coûtent fort cher !
– Je le sais bien, fit la jeune fille avec un soupir de regret, mais puisque ce magasin est le seul endroit où je pourrai jamais en toucher de semblables...
De la main elle désignait les armoires ouvertes sur des piles régulières de samits, de pailes dorés, de satins de toutes les couleurs, de velours doux au toucher. D'autres contenaient de grandes pièces de dentelles aussi fines que des fils de la Vierge, des voiles de Mossoul, des diaspres à fleurs chatoyantes venus de Perse, des cendals légers et bruissant. D'autres encore cachaient les draps de Champagne ou d'Angleterre, les blanchets moelleux tissés par les femmes de Valenciennes, les souples draps florentins, aussi doux et presque aussi brillants que des satins...
Prestement, Mathieu enlevait des mains de sa nièce le brocart rose, ôtait à Pierre le velours noir et or, les empilait dans une grande pièce de forte toile blanche et y ajoutait une respectable collection de tissus d'or et d'argent, de satins de toutes couleurs, brodés, rayés ou unis qu'il prenait dans le dernier arrivage.
– Tout ceci est déjà vendu, expliqua-t-il et doit être mis de côté ; c'est une commande de messire de Brazey, qu'il doit faire prendre plus tard. Quant à toi, ma fille, va donc finir les comptes de la semaine et cesse de rêver ! J'ai à sortir et veux que tout soit en ordre quand je rentrerai. Ah, tu feras aussi le compte de la dame de Châteauvillain qui l'a fait demander et tu veilleras à ce que l'on aune ce diaspre turquoise qu'attend la femme du sire de Toulongeon.
Avec un soupir de regret, Catherine quitta la boutique et alla prendre la place de son oncle dans le réduit. Ces gros livres tout pleins de chiffres romains1 l'ennuyaient profondément, encore qu'elle prît plaisir à lire la provenance lointaine des 1. Les chiffres arabes n'étaient pas encore usités.
Étoffes et ces noms aux consonances magiques. Mais, depuis le retour de Flandres, un visage brun se dessinait trop souvent de lui-même parmi les grandes pages jaunes et craquantes. Et quand cela se produisait, Catherine se retrouvait toujours avec une violente envie de pleurer car elle pensait alors qu'il y avait vraiment une infranchissable distance entre un écuyer du Dauphin et la nièce d'un drapier dijonnais.
Sans parler du mépris d'Arnaud, ni de la guerre qui les plaçait dans des camps opposés. Mais ce matin-là, Arnaud était absent de la pensée de Catherine. Trempant sa plume dans l'encre, elle se mit courageusement à l'ouvrage. Il n'y avait dans son esprit pour le moment qu'un merveilleux brocart dont elle avait très envie et aussi un peu de curiosité. Le gardien des joyaux de la couronne, toujours si sombrement vêtu, avait-il soudain décidé que le rose lui irait mieux ?
Malgré ce qu'il avait dit, on ne revit pas l'oncle Mathieu de toute la journée. Vers l'heure du dîner, il lit dire qu'il ne reviendrait que pour souper, mais le souper l'attendit en vain. À peine rentré, le drapier avait appelé sa sœur Jacquette et s'était enfermé avec elle dans sa chambre haute sans vouloir donner d'explications.
En ouvrant les yeux le lendemain matin, Catherine vit Sara assise à son chevet, attendant son réveil et s'en étonna. D'ordinaire c'était Loyse qui l'éveillait, avec quelque brusquerie et avant l'aube pour aller entendre l'office. Mais cette fois Loyse était absente et le soleil était déjà haut.
– Aujourd'hui est un grand jour, mon agneau, lui dit la tzingara en lui tendant sa chemise. Il faut te dépêcher. Ta mère et ton oncle veulent te parler.
– De quoi ? Est-ce que tu sais ?
– Oui, je le sais mais je n'ai pas le droit de te le dire.
Curieuse et, de plus, connaissant parfaitement son empire .sur sa vieille amie, Catherine se fit câline pour en savoir plus
– Dis-moi au moins s'il s'agit de quelque chose d'agréable ? Si cela me fera plaisir...
– Sincèrement je n'en sais rien ! Peut-être que oui... ou peut-être que non ! Lève-toi vite !
Elle-même s'agitait, versait de l'eau fraîche dans une cuvette, préparait des serviettes. Négligeant la chemise tendue, Catherine sortit de son lit comme elle était, c'est-à-dire aussi nue que la main car il n'était pas d'usage de dormir autrement à cette époque. Elle n'avait d'ailleurs jamais éprouvé de gêne devant Sara qui avait été pour elle une seconde mère.
La grande fille de Bohème n'avait guère changé durant toutes ces années. Elle était toujours belle, aussi brune que par le passé, la quarantaine proche n'apportant pas le moindre fil d'argent dans sa chevelure. Elle était seulement plus grosse, la vie douillette que l'on menait chez Mathieu ayant capitonné son corps d'animal sauvage d'une couche moelleuse et confortable. Mais l'esprit demeurait sauvage, toujours aussi indépendant. Parfois Sara disparaissait pendant deux ou trois jours sans que personne pût dire ce qu'elle était devenue. Barnabé seul, peut-être... Mais le Coquillart savait garder un secret et dans le milieu inquiétant et dangereux où il avait choisi de vivre malgré les supplications de Catherine, tout le monde savait se taire.
Tandis qu'elle procédait à sa toilette avec une hâte qui ne lui était pas habituelle, car elle aimait prendre son temps, Catherine surprit le regard pensif de Sara posé sur elle.
– Qu'est-ce que j'ai ? demanda la jeune fille. Tu me trouves laide ?
– Laide ? Tu cherches des compliments ? Certes non, tu ne l'es pas... pas assez peut-être. Il n'est pas toujours bon pour une fille d'être trop belle, vois-tu. Et, en te regardant, je pensais bien que peu d'hommes pourraient résister à la vue de ton corps. Tu es trop faite pour l'amour pour ne pas semer aussi la mort.
– Que veux-tu dire ?
Il n'était pas rare que Sara prononçât des paroles étranges. La plupart du temps, elle se refusait à les expliquer. C'était comme si elle avait pensé tout haut, parlé pour elle-même. Cette fois, il n'en fut pas autrement.
– Rien ! fit-elle brièvement en tendant à la jeune fille sa robe verte de la veille. Habille-toi et descends...
Quand Sara eut disparu, Catherine se hâta d'achever sa toilette, natta ses cheveux avec un ruban de la même teinte que sa robe et descendit dans la grande chambre où Sara avait dit que ses parents l'attendaient.
Elle trouva Mathieu assis dans son fauteuil, l'air sombre et soucieux. En face de lui, Jacquette, assise sur un banc, égrenait son chapelet. Ni l'un ni l'autre ne parlait.
– Me voici, fit Catherine. Qu'y a-t-il ?
Ils la regardèrent tous deux pendant un moment, avec une telle expression que Catherine eut l'impression qu'ils la voyaient pour la première fois.
Elle nota qu'une larme brillait dans les yeux de sa mère et courut à elle. S'agenouillant auprès de Jacquette, elle entoura de ses bras la taille maternelle, appuya sa joue contre sa poitrine.
– Mère... Vous pleurez ? Mais que se passe-t-il ?
– Ce n'est rien, ma chérie. C'est peut-être de bonheur...
– De bonheur...
– Mais oui... peut-être. Ton oncle va te dire.
Mathieu avait quitté son fauteuil et s'était mis à marcher de long en large dans la pièce qui tenait presque toute la longueur de la maison et toute sa largeur. Son pas était plus lourd que d'habitude et il mit un moment à se décider. Finalement, il s'arrêta devant sa nièce et dit :
– Tu te souviens des étoffes que j'ai reçues hier d'Italie et que tu admirais tant ? Ce brocart rose...
– Oui, fit Catherine. La commande de messire Garin de Brazey ?
– Justement. Si tu en as toujours envie, ils sont pour toi.
– Pour moi ?
L'oncle Mathieu était-il subitement devenu fou ? Pour quelle raison un homme important comme Garin de Brazey offrirait-il à la nièce d'un fournisseur un semblable présent ? Le regard de Catherine alla de sa mère à son oncle en faisant une rapide incursion dans les profondeurs de la chambre afin de s'assurer que tout cela n'était pas un songe. Tous deux guettaient une réaction sur le visage de la jeune fille.
– Mais... pourquoi ? demanda encore Catherine.
Mathieu se détourna et alla jusqu'à la fenêtre,
regarda dehors, arracha une feuille au pot de basilic posé sur cette fenêtre et revint vers sa nièce.
– Parce que messire Garin nous fait l'honneur de te demander pour épouse. Hier, je suis allé le voir et il m'a tout au long exposé son projet... contre lequel je n'ai rien à redire. Je le répète, c'est un très grand honneur, un peu inattendu, mais un grand honneur tout de même.
– Allons ! coupa Jacquette. N'influence pas cette enfant !
Je ne l'influence pas, fit Mathieu avec impatience. Je ne suis pas bien sûr moi-même de désirer ce mariage qui m'inquiète. Je dis ce qui est, voilà tout. Qu'en penses-tu petite ?
La jeune fille restait muette. C'est qu'aussi la surprise était de taille.
Il semblait que, depuis la veille, l'argentier eût décidé d'envahir son existence. Mais elle aimait trop connaître le fond des choses pour ne pas poser d'autres questions.
– Pour quelle raison messire Garin désire-t-il m'épouser ?
– Il t'aime apparemment, fit Mathieu en haussant les épaules. Cela n'a vraiment rien d'étonnant. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu plus belle jeune fille et j'en sais plus d'un qui est de cet avis. Que dois-je répondre ?
Une fois de plus, Jacquette s'interposa.
– Tu vas trop vite, Mathieu ! Tout ceci est surprenant, inattendu pour cette petite. Il faut lui laisser le temps de se faire à cette idée...
S'y faire ? Ah, certes, il fallait que Catherine s'y fît. Sur le fidèle miroir de sa mémoire, elle voyait se lever l'image un peu inquiétante de Garin de Brazey, son visage froid, cet œil unique et cette allure imposante, glaçante même. Il avait l'air d'un personnage de tapisserie animé soudainement par magie. On n'épouse pas un personnage de tapisserie.
– J'apprécie l'honneur qui m'est fait, dit-elle sans hésiter, mais vous voudrez bien dire à messire de Brazey que je n'ai pas envie de me marier. Je ne l'aime pas, comprenez-vous... mais, cela, c'est tout à fait inutile de le lui dire.
– Tu refuses ?
Mathieu était abasourdi. Il s'attendait à de l'étonnement, à une profonde stupeur et même à un certain émerveillement. La demande en mariage d'un personnage si riche et si puissant pouvait accabler une jeune fille timide sous le poids de l'honneur et de la joie. Mais que cette demande pût être repoussée aussi nettement, et sans autre examen, avait de quoi renverser un monde. Catherine, assise maintenant auprès de sa mère dont elle avait pris la main n'avait l'air ni accablée ni autrement émue. Son beau regard pur était demeuré très calme, très lucide. Sa voix aussi était paisible en répliquant doucement
: – Naturellement, je refuse ! J'ai, jusqu'ici, refusé tous les autres partis que vous m'avez offerts parce que je ne les aimais pas. Je n'aime pas davantage messire de Brazey. Donc, je refuse de l'épouser...
Cette logique sans défaut ne parut pas séduire Mathieu qui se rembrunit. Le gros pli creusé entre ses sourcils se fit encore plus profond. 11 hésita un moment, puis ajouta :
– As-tu songé que tu serais la plus riche dame de Dijon, la mieux parée ? Tu régnerais sur une superbe maison, tu aurais en quantité ces toilettes dont tu rêves, des bijoux de reine, des servantes, tu irais à la Cour...
– ... et, coupa Catherine, je dormirais toutes les nuits auprès d'un homme que je n'aime pas. Non, mon oncle. N'insistez pas, c'est non.
– Malheureusement, fit Mathieu sans regarder sa nièce, tu n'as pas la possibilité de refuser. Tu dois épouser Garin de Brazey. C'est un ordre !
Le mot fit perdre à Catherine son beau calme. Elle sauta sur ses pieds, fit face à Mathieu, brillante d'une colère qui rougissait ses joues et faisait flamber ses yeux.
– Un ordre ? Vraiment ? Et de qui ?
– De Monseigneur le Duc. Tiens, lis !...
Et, d'un coffret posé sur la table, Mathieu Gautherin sortit un grand parchemin aux armes ducales qu'il tendit à la jeune fille :
– Garin de Brazey me l'a remis en même temps que sa demande solennelle. Avant l'hiver tu seras la dame de Brazey...
Catherine passa toute la journée enfermée dans sa chambre. Nul ne vint l'y déranger car l'oncle Mathieu, épouvanté par le déchaînement de fureur qui avait suivi, chez la jeune fille, l'annonce de l'ordre ducal, avait jugé bon d'ordonner qu'on la laissât tranquille. Même Sara avait disparu pour ce lieu mystérieux où elle se rendait de temps à autre sans donner d'explications. Assise sur son lit, ses mains nouées reposant entre ses genoux au creux de sa jupe, Catherine réfléchissait avec Gédéon pour seul témoin. Mais sentant peut-être instinctivement que sa maîtresse traversait une crise, le perroquet se taisait. Le cou rentré, les yeux mi-clos sur son perchoir, l'animal semblait dormir et faisait sur le mur nu de la chambre une grosse tache chatoyante.
La colère de tout à l'heure s'était un peu calmée mais la révolte grondait toujours au cœur de la jeune fille. Elle avait cru que le duc lui voulait du bien et tout ce qu'il trouvait à faire pour elle c'était cet ordre bizarre, incompréhensible : épouser Garin de Brazey, un homme que non seulement elle n'aimait pas, mais qu'elle connaissait à peine. Rien que le procédé employé la révoltait. Philippe la considérait-il comme son propre bien dont il pouvait décider du sort à son gré alors qu'elle n'était même pas de son duché ? C'était cela qu'elle avait répondu à Mathieu : « Je ne suis pas sujette de Monseigneur Philippe. Je n'ai pas à lui obéir. Je n'obéirai pas ! »
– Ce sera alors, pour nous tous, la ruine, la prison... pire peut-être. Je suis, moi, sujet du duc et fidèle sujet. Tu es ma nièce et tu vis sous mon toit. Tu lui es donc vassale, que tu le veuilles ou non...
Il n'y avait rien à répondre à cela. Catherine, outrée de fureur, le sentait bien, mais elle ne pouvait se résoudre à se laisser livrer ainsi au bon plaisir de l'argentier, elle qui, jusque-là, avait si bien su se garder des hommes et s'était juré de continuer. Il y avait eu Arnaud, bien sûr, et l'expérience à la fois cruelle et douce vécue entre ses mains mais puisque ce bonheur-là devait lui demeurer à jamais interdit Catherine, sur la route de Flandres, s'était fait la promesse de n'être à nul autre qu'à cet homme brutal et tendre qui s'était emparé de son cœur et avait bien failli, si vite, asservir son corps.
Dans le cerveau enfiévré de la jeune fille d'autres images d'hommes se succédaient : Garin et le tragique bandeau noir de son œil, le jeune capitaine de Roussay, si follement épris et qui peut-être, pour l'amour d'elle, pourrait commettre une folie. Un instant, Catherine envisagea de se faire enlever par le jeune homme. Jacques, elle en était sûre, ne se le ferait pas répéter, même au risque de la colère du duc Philippe et c'était là un moyen infaillible d'échapper à Brazey. Mais au pouvoir de Roussay, elle ne pourrait moins faire que le payer de sa peine et lui accorder ce dont il desséchait de désir. Or, Catherine n'avait pas plus envie d'appartenir à Jacques de Roussay qu'à Brazey. C'était toujours subir l'amour d'un homme qui n'était pas Arnaud.
Un autre visage, brusquement, s'interposa, celui de Barnabé... Le Coquillart savait, comme personne, sortir des situations les plus difficiles. Il l'avait tirée de Paris insurgé, il avait arraché Loyse à Caboche, il les avait amenées à bon port à Dijon à travers des campagnes dévastées par la guerre, hantées de bandes féroces de soudards et de pillards. Il était l'homme de tous les miracles et de toutes les astuces. Au terme de sa longue songerie solitaire, Catherine se dit qu'elle irait trouver Barnabé car elle ne pouvait s'offrir le luxe d'attendre que le Coquillart fît à ses bourgeois amis l'une de ses rares visites. Le temps pressait.
On ne voyait pas souvent Barnabé dans la paisible maison de la rue du Griffon, justement parce qu'elle était trop tranquille pour lui.
Malgré l'âge, l'ancien vendeur de fausses reliques aimait toujours autant vivre dangereusement et n'avait pas renié son étrange monde, inquiétant peut-être, mais vivant et curieusement coloré. De temps en temps, il apparaissait, dégingandé, ironique, nonchalant et crasseux avec superbe. Il étendait ses longues jambes vers la flamme du foyer puis sous la table servie car Mathieu, qui l'aimait bien sans s'expliquer pourquoi, ne manquait jamais de l'inviter au repas.
Barnabé restait là quelques heures, bavardant de choses et d'autres avec l'oncle Mathieu. Il savait toujours tout ce qui se passait sur toute l'étendue du duché et donnait parfois de précieux avis au négociant pour son commerce tels que l'arrivée d'une nef génoise ou vénitienne à Damme ou bien la venue à Chalon d'une caravane de pelletiers russes. Il connaissait aussi les potins de la Cour, le nom des maîtresses du duc Philippe et le nombre exact des colères de la duchesse-douairière. Puis il repartait après avoir pincé la joue de Catherine et salué gravement Jacquette et Loyse, s'en retournant vers son existence nocturne. Ni Mathieu, ni Catherine n'ignoraient qu'il était l'un des lieutenants du sinistre Jacquot de la Mer, le roi de la Coquille, mais aucun d'eux n'en parlait et quand, parfois, la langue acerbe de Loyse laissait échapper une allusion à la peu recommandable profession de leur ami, ils se hâtaient de lui imposer silence.
Vers la fin du jour, Jacquette, inquiète du silence et de la longue réclusion de Catherine, vint lui porter une écuelle de soupe et quelques tranches de bœuf froid avec une jatte de lait. La jeune fille, en effet, n'avait rien pris depuis le matin.
Elle en remercia gentiment sa mère et, pour lui faire plaisir, mangea un peu de soupe, quelques bribes de viande et but du lait, malgré son absence totale de faim. Bien lui en prit car elle se sentit aussitôt ragaillardie, l'esprit plus clair et le corps plus dispos.
– Tu ne devrais pas te tourmenter autant, mignonne, lui dit Jacquette avec un sourire. Après tout, c'est plutôt une bonne nouvelle, cette demande en mariage. Beaucoup de filles par ici t'envieront et plus d'une grande dame. Et puis, messire Garin gagne peut-être à être connu. Il n'est point laid, tu l'aimeras peut-être et, en tout cas, tu seras gâtée, choyée...
Le regard de la bonne dame s'égarait sur le tas chatoyant des tissus que Mathieu avait fait porter chez sa nièce comme un rappel tentateur aux joies somptueuses qui l'attendaient. Catherine les avait relégués en vrac sur un coffre dans le coin le plus sombre de la pièce. Le ton que Jacquette employait à la fois humble et tremblant fit mal à la jeune fille qui, se levant d'un bond, alla embrasser sa mère.
– Ne vous tourmentez pas pour moi, mère... Tout ira bien, et, comme vous le dites, peut-être les choses s'arrangeront-elles toutes seules.
Se méprenant sur le sens des paroles de sa fille, Jacquette redescendit à la cuisine, grandement soulagée, pour annoncer à son frère que Catherine s'humanisait et ne disait plus « non » aussi catégoriquement.
Pourtant, la capitulation était toujours aussi éloignée de l'esprit de Catherine. Elle avait seulement voulu calmer les inquiétudes de sa mère et aussi garder sa liberté d'action. Son court repas terminé, elle alla s'étendre un moment sur son lit pour attendre la nuit noire. Elle entendit l'oncle Mathieu sortir comme chaque soir, pour se rendre auprès du vicomte– mayeur1 afin de lui remettre les clefs de la porte Saint– Nicolas dont il avait la garde2 puis rentrer ensuite et fermer ses propres portes.
– C'était en quelque sorte le maire de la ville.
– La garde des portes était confiée aux bourgeois les plus considérables du quartier pour qui c'était un fief viager. Ils étaient responsables de leurs portes et censés être constamment de service. Ils entretenaient les défenses au moyen d'une part des droits de vivre et de marchandise (Chabeuf).
L'oncle Mathieu venait tout juste de rentrer quand les marguilliers de Saint-Jean sonnèrent le crève-feu. De cet instant, les rues appartenaient à la galanterie, au vol, au brigandage et à l'aventure de toute sorte.
Catherine, étendue sur son lit, ne bougeait toujours pas. Elle entendit les marches de l'escalier gémir sous le poids de l'oncle qui regagnait son lit, Loyse gour– mander la servante et le vieux Pierre qui rejoignait son galetas en chantonnant. Peu à peu, le silence prit possession de la maison. Sara n'était toujours pas rentrée. Catherine savait bien qu'elle ne serait pas là avant le jour, en admettant qu'elle revînt le lendemain.
Quand il n'y eut plus d'autre signe de vie autour d'elle que le ronflement étouffé de l'oncle Mathieu, Catherine se laissa glisser de son lit, enfila une robe brune qu'elle avait sortie à cet effet, natta ses cheveux bien serrés sous un capuchon puis, s'enveloppant d'une ample cape qui dissimulait totalement sa silhouette, se glissa dans l'escalier.
Elle savait le descendre sans faire crier les marches. Elle savait aussi comment tirer sans bruit les verrous, d'ailleurs toujours bien graissés par les soins vigilants de Sara. Quelques minutes plus tard, elle était dans la rue.
Catherine n'était pas peureuse et la nuit de juillet était claire, une belle nuit de velours sombre sur lequel les étoiles faisaient scintiller plus de diamants que sur le manteau de la Vierge Noire. Mais il fallait un certain courage pour se rendre délibérément dans les pires endroits de la ville, là où les archers du guet ne se risquaient pas.
– Si tu avais un jour besoin de moi, lui avait dit une fois Barnabé en grand secret, tu m'enverras chercher à la maison publique. Elle appartient à un certain Jacquot de la Mer qui est sergent de la Mairie...
et qui est aussi notre maître à tous, gens de Haute et Basse Truanderie.
Je te dis ça parce que je sais que tu n'es pas bavarde et parce qu'il me semble que tu pourrais, un jour, en avoir besoin. Si je n'étais pas là, tu pourrais me faire chercher à l'Hôtellerie de la Porte d'Ouche où je vais de temps en temps, mais plus rarement...
Dans les débuts, Catherine ne savait pas bien ce que pouvait être une maison publique jusqu'au jour où elle s'en était ouverte à Sara. La tzingara avait pour principe de dire les choses comme elles sont, estimant la vérité cent fois préférable à l'hypocrisie pour l'éducation des filles.
– Une maison publique est une maison où des filles folles vendent leurs corps aux hommes pour de l'argent, avait-elle dit.
Ainsi renseignée, Catherine se l'était tenu pour dit mais elle pensait aux paroles de la bohémienne tandis qu'elle se glissait le long des maisons biscornues de la rue du Griffon, tâchant de se confondre autant qu'elle pouvait avec les ombres épaisses des toits et d'éviter le centre, plus clair, de l'étroite et tortueuse artère.
Quand il fallut traverser la place de la Sainte Chapelle, elle s'y prit à deux fois, courut d'une traite jusqu'au Calvaire élevé au milieu, y reprit haleine. L'ombre noire du Crucifié s'étendait loin sur la terre durcie de la place, flanquée de celles de la Madeleine et de saint Jean dont les visages de pierre contemplaient interminablement la Divine Agonie. Ayant retrouvé son souffle, Catherine longea le pourpris ducal. Les tours donnaient une ombre épaisse mais il fallait se méfier des archers de garde dont les casques luisaient faiblement. Reprenant sa course, elle se jeta dans la rue des Forges aux baraques lépreuses qui sentaient toujours le bois brûlé, le cuir roussi et la graisse d'armes.
La rue était extraordinairement étroite et, souvent, des incendies, allumés par les feux de forges trop proches, s'y déclaraient. Aussi chaque maison avait-elle, au seuil, un grand seau, un soilloz de cuir qui servait à charrier l'eau en cas de besoin. Catherine savait cela mais troublée ne s'en méfia pas. Elle buta dans un de ces seaux, tomba lourdement et jura le plus naturellement du monde. Ce n'était pas son habitude mais elle y trouva un réel soulagement.
A l'endroit où la ruelle rejoignait le Bourg, la grand-rue commerçante de la ville, elle s'élargissait pour former une placette, assez grande, toutefois, pour qu'un pilori y tînt à l'aise. Il était vide pour le moment mais ce n'était pas une vue agréable. Détournant les yeux, Catherine voulut poursuivre son chemin quand elle se sentit retenue par le pan de sa cape et poussa un cri. Une ombre cahotante sortit d'une encoignure, hoqueta puis se mit à rire tandis que des mains rudes s'emparaient de sa taille sous la cape qui tomba.
Paralysée par la peur, la jeune fille eut cependant un réflexe de défense. Sa taille souple se tordit entre les mains, peut-être maladroites, qui la tenaient et elle glissa comme une anguille. Sans plus se préoccuper de sa cape, elle se mit à fuir droit devant elle, s'efforçant malgré tout de dominer sa terreur pour ne pas se perdre. Il fallait qu'elle atteignit la taverne du roi des Truands.
Mais elle ne pouvait ignorer qu'on la poursuivait. Sur ses talons, elle entendait le claquement sourd et mat de pieds nus et le halètement de l'homme lancé sur sa piste. La nuit devenait plus sombre, plus noir le labyrinthe des ruelles étroites à travers lesquelles elle traçait son chemin. Des puanteurs d'eaux sales, de détritus et de viandes pourries la prenaient à la gorge et un instant elle crut défaillir. Nul ne songeait à enlever les ordures autrement que périodiquement, quand il y en avait trop. On jetait alors à l'Ouche et au Suzon ce dont les porcs et les chiens errants n'avaient pas voulu...