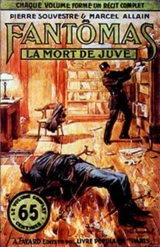
Текст книги "La mort de Juve (Смерть Жюва)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Le lieutenant de Kervalac colla le visage au hublot de la tourelle. Le manomètre était cassé, aucun appareil ne lui permettait de se rendre compte des mouvements de son navire. Les projecteurs électriques eux-mêmes s’étaient éteints. Allait-on remonter ? allait-on rester dans la vase ?
Voix du second maître :
– Tout est paré, mon commandant. Mais je viens de casser les boulons. Un peu plus, les plombs ne fonctionnaient pas.
– Laissez aller.
Les plombs lâchés, le sous-marin vibra, frémit. Le long de sa coque de bronze aux formes effilées un glissement lent se fit entendre. On eût dit que quelque chose de soyeux frôlait la coque, qu’une caresse la faisait frissonner.
– Tout le monde à l’avant, cria le commandant, se persuadant que le navire avait dû toucher par l’arrière.
Mais un hourrah lui répondait. Avant même que la manœuvre eût été exécutée, brutalement, L’Œufs’était redressé. Échappant à l’emprise des vases, il bondit à la surface avec une vitesse sans cesse accrue, à la façon d’un ballon qui s’enlève.
– Hourrah !
Les neuf hommes de l’équipage, qui, tout à l’heure, n’avaient même pas paru se rendre compte que la mort les tenait dans ses mains décharnées, applaudissaient à la remontée du sous-marin.
Très pâle, le lieutenant se contenta de donner les ordres nécessaires :
– Aux machines, battez avant.
– Les machines ne fonctionnent plus, commandant.
– Très bien, timonier, les gouvernails de plongée à l’altitude.
– Les gouvernails sont brisés, commandant.
Cela, c’était la réponse suprême. Dans quelques secondes, L’Œufatteindrait la surface des eaux, mais ce ne serait plus l’élégant et rapide navire que le lieutenant de Kervalac était si fier de commander, mais une épave.
– À quelle heure la mer basse ?
– À minuit, commandant.
– Fort bien. Nous sommes en pleine mer descendante, nous irons au large.
Il ajouta, pour rassurer l’équipage :
– J’aime mieux ça.
Le commandant de Kervalac n’avait point fini de parler, que L’Œuffit un tel bond qu’il renversa matelots et officiers. Le petit bateau, émergeant des profondeurs de la grande rade, avait dû arriver à une extrême vitesse à la surface, sauter presque à la façon d’un cachalot, puis retomber. Maintenant, la houle le prenait, le balançait, le secouait comme un bouchon.
Le lieutenant de Kervalac, résigné, se cramponnait au blockhaus, demanda :
– Le panneau d’avant fonctionne-t-il encore ?
– Oui, commandant.
– Qu’un homme de bonne volonté, alors, essaie de monter sur le pont et de faire des signaux. On nous verra peut-être des pontons de renflouement.
Un homme de bonne volonté ?
Les dix marins s’avancèrent.
– L’honneur au plus jeune, commanda en souriant le lieutenant de Kervalac. Le Goffic, allez prendre le poste de vigie.
– Bien, commandant.
Dans l’angoisse du naufrage, dans le souci des ordres à donner pour sauver le bâtiment, pour sauver les hommes, le jeune officier avait oublié sa passagère. Le présence de cette femme lui revint soudain à l’esprit. Qu’était-elle devenue ? qui donc avait tiré ce coup de revolver qui avait précédé d’une seconde la découverte de la torpille ?
– Visitez la coque, commanda le lieutenant, voyez les cloisons arrière, Premier maître, assurez-vous de la personne qui nous accompagnait.
Tandis que les hommes enlevaient le plancher à claire-voie formant le fond du sous-marin pour s’assurer que nulle voie d’eau ne s’était formée, le premier maître se rendait au compartiment arrière du submersible.
Et c’est avec une angoisse nouvelle que le lieutenant de Kervalac l’entendit jurer.
– Quoi ? qu’est-ce encore ?
– Notre passagère. Elle s’est tuée. Elle s’est fichu un coup de revolver dans la poitrine.
Le matelot ne se trompait point. Au moment même où la malheureuse Hélène avait aperçu les caisses immergées qui lui apprenaient le nouveau crime de son père, elle n’avait pu supporter son désespoir, la honte.
La jeune fille, en une seconde, avait eu l’impression que ses plus chers espoirs étaient ruinés une fois encore, que d’insurmontables obstacles allaient encore la séparer de Fandor, que si elle revenait vivante à Cherbourg, il lui faudrait trahir son père ou son fiancé.
Hélène n’avait pas hésité : elle avait tiré un revolver de sa poche, revolver qui ne la quittait jamais, son seul espoir d’une paix dernière. Elle avait fait feu. Et, au moment même où le matelot annonçait : « Une torpille, mon commandant », Hélène s’écroulait sur le plancher du sous-marin, la poitrine ensanglantée.
Le lieutenant de Kervalac, cependant, en entendant annoncer que la passagère s’était tuée, avait sursauté.
– C’est affreux. Est-elle morte ?
– Elle respire encore, mon commandant, mais c’est tout juste.
– Portez-la dans la chambre des machines. Faites au mieux.
Or, de violents coups ébranlaient la carcasse sonore. La vigie signalait quelque chose :
– Sauvés, nous sommes sauvés, cria soudain le jeune commandant, on nous a vus.
Le lieutenant de Kervalac, en effet, par les vitres du blockhaus, apercevait une barque arrivant, à force de voiles, droit sur L’Œuf.
C’était assurément un des canots accrochés aux pontons de renflouement, un homme le manœuvrait, il avait dû être témoin de l’accident de la torpille – si c’était un accident —, il avait vu remonter le sous-marin, s’était douté qu’il était désemparé et maintenant il venait à son secours.
Le lieutenant de Kervalac, le premier mouvement de joie passé, retrouvait tout son sang-froid. C’était d’une belle voix de commandement qu’il ordonnait :
– Allons, les enfants, tout le monde à son poste et du calme. Mécaniciens, prenez d’abord la blessée. Passez-la à Le Goffic, il faut qu’elle embarque la première. Quartier-maître, préparez un filin, on va nous donner la remorque, nous irons faire l’accoste le long des pontons.
***
– Hisse !
– Laisse aller !
Une corde jetée du sous-marin fut habilement saisie par l’homme qui manœuvrait la petite barque. En un tour de main, celui qui venait sauver l’équipage de L’Œufavait enroulé le cordage au pied du mât de sa barque. L’Œufet le bachot furent bientôt bord à bord.
– Un accident ? demanda le matelot.
– Un accident, répondit Le Goffic.
Et mis au courant par les camarades qui lui parlaient par le panneau, Le Goffic ajouta :
– Attends, mon gars, tu vas nous donner la remorque tout à l’heure, mais pour plus de sûreté, on va d’abord te passer quelqu’un. Fais attention, c’est une dame et elle est blessée.
C’était une manœuvre extraordinaire, folle d’imprudence, merveilleuse de témérité que Le Goffic réussit avec l’aide de ses camarades. Hélène, sans vie, sans mouvement, délirante, fut hissée par le panneau. Les marins bretons, s’agrippant à la coque de L’Œuf, trouvèrent prise sur le bronze lisse et luisant, réussirent enfin, en dépit des lames moutonneuses, en dépit de la houle grandissante, à passer la blessée à bord de la barque.
– File du câble, dit le sauveteur, ou bon Dieu, on s’en va chavirer.
La houle grandissait en effet. De minute en minute, les lames se creusaient davantage et elles commençaient à se coiffer de blanc, à mettre ce bonnet d’écume qui présage la formation des tempêtes, des vagues déferlantes et mauvaises.
Le Goffic, dans le vent, transmettait les ordres qu’il recevait de l’intérieur du sous-marin :
– Je te file dix brasses de corde. Arrime-nous à ton arrière et souque ferme, tâche de nous faire ranger près des pontons.
La réponse du matelot sauveteur se perdait dans le vent, mais il avait dû comprendre, il orienta sa voile, le sous-marin avança.
Or, tandis que sur les appels pressants du commandant de Kervalac, Le Goffic, trempé, épuisé, redescendait à l’intérieur du bateau, il se passait une scène étrange :
Le matelot, l’inconnu, l’homme qui était venu au secours de L’Œuf, après avoir commencé à remorquer le sous-marin, cessait brusquement de manœuvrer. Il se pencha sur le visage de celle qu’il avait prise à son bord, et il s’écria :
– Malédiction, c’est Hélène, c’est ma fille.
Moins de cinq minutes plus tard, Kervalac s’aperçut que la remorque était détachée, que son bâtiment flottait à l’aventure, que la marée l’emportait vers le large, cependant que la barque du sauveteur, dans la nuit, au lointain, comme un oiseau volant au ras des eaux, disparaissait au milieu de la tempête.
***
Dans le grand salon luxueusement meublé attenant à son cabinet de travail à bord du Courage, cuirassé d’escadre battant son pavillon, l’amiral Achard se tenait immobile, songeur.
C’était le type du vieux marin, parfait homme du monde, ayant conquis ses grades par sa valeur, les ayant justifiés par sa courtoisie parfaite, alliée à une haute science de technicien. L’amiral Achard était, en justes proportions, craint et aimé de tous les officiers. On le savait sévère, mais juste et il était redouté pour la discipline sévère qu’il maintenait dans son équipage. On s’accordait à reconnaître qu’il avait le droit d’être strict, étant lui-même le premier à faire son devoir, étant aussi bon homme de guerre que manœuvrier habile et chef indulgent, lorsque l’indulgence n’était pas une faiblesse. L’amiral Achard, peu de temps avant, avait été averti par un officier de son bord que le lieutenant de Kervalac, commandant le sous-marin L’Œuf, désemparé à la suite d’un accident inconnu, entraîné par le flot au large de Cherbourg, miraculeusement retrouvé par un contre-torpilleur qui lui avait donné la remorque et l’avait ramené en rade, demandait à lui parler pour lui faire un rapport très grave. L’amiral Achard déjà documenté sur l’ensemble des faits par le rapport qu’il avait reçu du lieutenant de vaisseau commandant le contre-torpilleur ayant sauvé L’Œuf, avait immédiatement donné l’ordre d’introduire le jeune capitaine. C’était lui qu’il attendait. Deux coups discrets, la porte du salon s’ouvrit, un fusilier présentant les armes annonça :
– Le lieutenant de Kervalac.
L’amiral Achard fit trois pas en avant. Son maintien, grave tout à l’heure, s’était soudainement fait ému. Comme le fusilier refermait la porte du salon, comme le lieutenant de Kervalac, après avoir fait trois pas, saluait à l’ordonnance l’amiral Achard, puis s’immobilisait dans une position déférente, le commandant suprême de l’escadre s’avança, les deux bras tendus, vers le jeune officier.
– Mon enfant, dit-il, mon brave enfant, merci, merci.
– Amiral, répondit le lieutenant, je ne sais de quoi vous me remerciez, je n’ai fait que mon devoir.
– Lieutenant, en effet j’oublie que je suis votre chef et que vous n’avez fait que votre devoir, comme vous le dites. Avant d’entendre votre rapport, je me rappelle que j’aime tous mes officiers comme des fils et c’est pourquoi je vous remercie encore. Je sais, mon enfant, je sais déjà que votre bravoure calme, votre sang-froid clairvoyant, ont évité une catastrophe. Vous avez conservé à la France ses braves matelots et un navire qui, maintenant, a fait ses preuves de robustesse, c’est de cela que je vous dis merci, d’homme à homme.
– Amiral, amiral…
Mais cette première minute d’émotion passée, l’amiral Achard sembla faire un violent effort sur lui-même pour retrouver son impassibilité coutumière. Et c’est maintenant l’amiral qui devait entendre le rapport du commandant du sous-marin :
– Je vous écoute, lieutenant de Kervalac, avez-vous rédigé votre rapport ?
– Non, mon amiral. J’ai des faits si graves à vous signaler que j’ai préféré vous demander audience auparavant.
– Parlez, lieutenant.
– Amiral, voici ces faits.
D’une voix nette, claire, incisive, le lieutenant de Kervalac fit à l’amiral Achard le récit détaillé du naufrage extraordinaire de L’Œuf. Il évita à dessein de se mettre en valeur. Il termina par ces mots :
– Mais il y a autre chose, mon amiral, autre chose que je ne comprends pas, que je ne sais pas, que je soupçonne, qui me fait frémir.
– Lieutenant, que voulez-vous dire ? Je ne vous comprends pas.
– Amiral, déclarait l’officier, j’attire votre attention sur ces faits : au moment où je m’apprêtais à quitter la rade pour aller explorer les fonds avoisinant le navire le Triumph, naufragé au cours de la dernière tempête, une inconnue, une femme, dont je vous ai déjà signalé la présence, demanda à monter à mon bord et je ne pus m’y opposer, car elle était porteuse d’une dépêche officielle émanant du ministère et l’autorisant en effet à embarquer. Cette femme, mon amiral, s’est tuée au moment où la torpille fonçait sur nous. Cette torpille, mon amiral, sauf erreur de ma part, je suis certain qu’elle provenait des pontons de renflouement. C’est de là qu’elle a été dirigée sur mon bateau. Ce n’était pas, en effet, une torpille perdue, flottant au hasard, mais bien une torpille en action, dont le mécanisme fonctionnait, qui avait été pointée sur nous. Amiral, cette femme qui s’est frappée à mon bord, cette femme dont je ne sais point le nom, je l’ai fait transporter, je vous l’ai dit, à bord de la barque qui nous accosta après notre remontée, et qui semblait vouloir nous donner la remorque. Mon amiral, je soupçonne que cette barque était menée par un homme venant des pontons de renflouement. Or, cet homme a volontairement coupé la remorque qui attachait son bachot à mon sous-marin. Cet homme nous a volontairement laissé partir à la dérive. Cet homme, amiral, ne peut être que l’assassin qui avait pointé la torpille sur nous.
– Que concluez-vous donc, lieutenant ?
– Ceci, mon amiral. Je me demande si la femme que nous avions à bord n’avait pas accepté la mission périlleuse de guider mon sous-marin, si cela avait été nécessaire, vers les pontons de renflouement d’où on devait le torpiller. Elle avait sans doute fait bon marché de sa vie. Elle acceptait de mourir avec mon équipage et moi. Mon amiral, c’est une coïncidence extraordinaire, un hasard miraculeux, plus encore que ma manœuvre, qui a sauvé L’Œuf. L’homme qui devait le torpiller, le voyant revenir à la surface, a dû, très étonné de sa réapparition, vouloir joindre mon bord pour s’assurer de ce qu’était devenue sa complice. Comme à ce moment je lui ai fait remettre cette complice. C’est alors, amiral, que l’ayant emportée, il s’est enfui en nous exposant à nouveau à un second naufrage.
– Lieutenant de Kervalac, ce que vous dites est épouvantable. Vous ne croyez pas à un accident ? Vous parlez de crime. C’est effroyable ce que vous inventez là. Avez-vous bien réfléchi, bien pesé la gravité de vos affirmations ? Avez-vous quelqu’un à accuser ? Savez-vous quel est cet homme ? qui il pourrait être ?
– Amiral, sur mon honneur et sur ma conscience, je ne parle pas au hasard, ce n’est pas au hasard que je porte une si grave accusation, ce n’est pas au hasard que je vais citer un nom. J’accuse quelqu’un, amiral, j’ai l’honneur d’accuser devant vous, de façon formelle, le journaliste Jérôme Fandor.
Et petit à petit, s’emportant, s’animant à développer ses arguments, à ajouter les preuves aux preuves, le lieutenant de Kervalac exposa à son chef les raisons qui l’avaient conduit à soupçonner Jérôme Fandor :
– Pourquoi ce journaliste porte-t-il un intérêt si pressant aux choses de la marine ? Pourquoi, depuis huit jours qu’il est à Cherbourg, le rencontre-t-on continuellement avec des officiers ? Pourquoi, s’il n’a pas un but mystérieux, se renseigne-t-il perpétuellement sur les opérations de renflouement tentées sur le Triumph, opérations, qui, je vous l’ai dit, mon amiral, sont extraordinairement suspectes, d’après ce qu’il résulte de mes explorations sous-marines. Amiral, le journaliste Fandor, à vingt reprises différentes, a questionné mes matelots, les a fait parler, les a interrogés sur mon bateau, je l’ai appris par une enquête rapide. Amiral, le journaliste Jérôme Fandor savait, par qui ? comment ? pourquoi ? je l’ignore, mais il le savait, que mon navire allait être chargé d’explorer l’épave du Triumph. Amiral, le journaliste Jérôme Fandor a obtenu du ministère, par je ne sais quelle influence occulte, une permission d’embarquement, qui n’est cependant délivrée que très difficilement. Amiral, j’ai réservé enfin la plus terrible preuve pour la fin de mon argumentation : non seulement il est facile d’établir que le journaliste Jérôme Fandor connaissait la jeune femme qu’il fit embarquer à sa place à bord du sous-marin, mais encore, au moment même où l’on transportait cette misérable pour la faire s’installer à bord de la barque qui avait l’air de venir nous sauver, je l’ai entendue murmurer très distinctement : « Au secours Fandor, au secours, à moi, je meurs ! »
Une heure plus tard, l’amiral s’entretenait de nouveau avec le lieutenant de Kervalac, Minutieusement, le chef de l’escadre avait interrogé les hommes de l’équipage de L’Œuf, convoqués d’urgence à bord du vaisseau-amiral. Minutieusement, il avait examiné, avec le jeune commandant, les charges pesant contre Fandor, et maintenant la conviction de l’amiral Achard était faite. Très pâle, les yeux jetant des éclairs, l’amiral Achard déclara :
– Vous avez raison, lieutenant, Jérôme Fandor, qui doit être un traître à la solde de quelque puissance étrangère, a bien voulu la perte de L’Œuf, c’est bien Jérôme Fandor qui pilotait la barque à bord de laquelle la jeune fille s’est enfuie. Nous allons porter plainte contre Jérôme Fandor, il faut, coûte que coûte, que ce misérable soit pris.
Au moment de sortir de son salon, l’amiral Achard posa sa main sur l’épaule du lieutenant de Kervalac :
– Lieutenant, vous avez eu tort d’accepter d’embarquer quelqu’un sur un ordre du ministère sans m’en référer. Vous avez eu tort surtout d’embarquer une femme alors que le permis de rester à bord de L’Œufétait libellé au nom d’un homme. Commandant, vous méritez d’être puni, je vous inflige trente jours d’arrêt.
L’amiral Achard se tut une seconde, puis brusquement, avec des larmes dans les yeux, il ouvrit ses bras au jeune officier, il serra sur son cœur le vaillant commandant de L’Œuf :
– Ah, mon enfant, mon enfant, murmurait le supérieur, vous avez été d’une vaillance que rien n’égale, votre présence d’esprit a sauvé votre navire et vos hommes, votre sang-froid vient de nous faire découvrir une épouvantable trahison. Ce soir-même, j’écrirai à notre ministre. Il y a en France une petite chose qui n’est rien et qui récompense cependant les hommes qui vous ressemblent. Mon enfant, c’est la croix des braves, je la demanderai pour vous, on ne pourra me la refuser.
***
Tandis que le lieutenant de Kervalac portait contre lui, auprès de l’amiral Achard, les plus terribles accusations, Fandor errait dans Cherbourg, en proie au désespoir.
Le jeune homme, certes, n’avait pu avoir la moindre idée tout d’abord des effroyables dangers courus par L’Œufau cours de son voyage de plongée. Il avait été pris d’une inquiétude grandissante au fur et à mesure que, les heures s’écoulant, le sous-marin n’avait pas regagné son port d’attache, le point des quais où il s’amarrait d’ordinaire. Fandor avait passé une nuit terrifiante à attendre le retour du submersible.
En désespoir de cause, il s’était rendu au sémaphore. Il interrogeait l’un des hommes de garde, demandait si rien d’anormal n’avait été aperçu du côté du ponton de renflouement.
Non.
Vers onze heures du soir, une barque à voiles s’était détachée des pontons, avait paru manœuvrer bizarrement, puis s’était éloignée vers le large. C’était tout ce que l’on savait, car la nuit avait empêché d’observer exactement quelle avait été la manœuvre.
Résigné, Fandor revint vers le port, espérant enfin apprendre le retour du submersible, puis il erra dans la ville, il retourna au sémaphore, il redescendit encore au petit matin vers les jetées. Et soudain, une rumeur sinistre éclatait. Une catastrophe s’était produite, le sous-marin avait failli couler, torpillé mystérieusement, puis il était parti à la dérive, un torpilleur l’avait rencontré heureusement, l’avait ramené en grande rade. On parlait d’un drame, d’une femme qui s’était tuée, d’une barque montée par un inconnu qui l’avait emportée au lointain. Bouleversé, Fandor se précipita vers le port militaire. Là, les rumeurs étaient plus précises. Et c’est d’un quartier-maître embarqué sur Le Couragequ’il apprit cette chose invraisemblable :
– Ah, pour sûr qu’il y a du raffut à bord de L’Œuf. Une donzelle qui se tue à moitié, qu’un de ses amants vient sauver. Le submersible qui manque de recevoir une torpille. Mais on connaît l’auteur de tous ces trucs-là… Paraît que c’est un journaliste, un certain Fandor, et l’on est sur sa piste. Ah malheur, si c’est jamais quelqu’un de la flotte qui lui met la main au collet, il y a des chances pour qu’il soit emporté en morceaux au poste.
Fandor questionna encore. Il apprit ainsi qu’Hélène n’était pas morte. Il crut comprendre que c’était son père, Fantômas, qui avait dû la sauver. Puis, se rendant compte du terrible danger qu’il y avait pour lui à demeurer plus longtemps près de l’arsenal, et terrifié des accusations portées contre sa personne, sans qu’il pût rien actuellement pour s’en défendre, il se décida à s’éloigner, la mort dans rame.
17 – À MORT FANDOR
Tandis que ces événements se déroulaient avec une étourdissante rapidité à Cherbourg et dans ses environs, Juve, péniblement installé dans sa villa de Saint-Germain, avalait sa camomille.
Il buvait sa tisane un peu trop chaude à petites gorgées, et pendant ce temps-là, alors qu’il s’interrompait pour souffler sur le liquide brûlant, d’un regard en coulisse, légèrement narquois, il surveillait une personne attentive à ce qu’il faisait, à côté de son lit. La personne en question, qui venait d’apporter à Juve sa tasse de camomille, paraissait prendre le plus vif intérêt au policier. Juve avait désormais une compagne, et celle-ci n’était autre que la demi-mondaine qui lui avait été adressée par Nalorgne et Pérouzin, Irma de Steinkerque, venue au lieu et place d’Hélène.
Et cette femme, excellente au fond, s’était instituée avec ardeur la garde-malade de celui dont elle rêvait de devenir la femme.
– Vous ai-je bien préparé cette camomille, monsieur Ronier ?
– Elle est excellente.
– Alors, monsieur Ronier, cela ne vous a pas attristé d’apprendre que je ne m’appelais pas Irma de Steinkerque ?
– Mais pas le moins du monde, chère madame, il est de ces noblesses qu’il faut acquérir parfois par nécessité, je ne suis pas bien instruit, toutefois, je sais encore que Steinkerque est le nom d’une ville, d’une bataille, et même d’une rue à Montmartre, et je sais aussi qu’il n’est porté par aucune famille figurant au Gotha, ni même au Bottin.
– Au Bottin, mon nom y figure. C’est celui de mes parents qui, comme je vous l’ai déjà dit, possèdent un petit commerce en Normandie, à Saint-Martin. Alors, ça ne vous offusque pas que je m’appelle Irma Pié ?
– Non, tous les noms, même les plus roturiers sont honorables du moment qu’ils sont bien portés.
– Vous vous moquez de moi ?
– Mais jamais de la vie. J’aurais mauvaise grâce, d’ailleurs, à railler une personne aussi affable que vous, aussi dévouée.
– Dites aussi aimante, monsieur Ronier.
Le vieux domestique parut :
– Ce sont ces messieurs, MM. Nalorgne et Pérouzin.
– Faites-les monter.
Jean se retira, non sans avoir jeté à la demi-mondaine un regard de mépris courroucé, car le vieux domestique voyait d’un mauvais œil l’intrusion de cette femme au chevet de son maître.
Irma, de son côté, toutefois, aussitôt qu’elle avait entendu annoncer les visiteurs, se levait, traversait la pièce :
– Je ne veux pas être importune, dit-elle, je passe dans le salon voisin.
Juve l’approuva. Quelques instants après, il recevait Nalorgne et Pérouzin. Les deux associés arrivaient avec l’air grave, important. On eût dit les témoins d’un duel ou des croque-morts.
– Monsieur Ronier, déclara Nalorgne, nous venons vous faire nos adieux. D’importantes affaires nous contraignent à partir en voyage et il se passera quelque temps avant que nous n’ayons le plaisir de vous revoir.
– L’ennui sera pour moi, fit Juve poliment.
– Nous venons, mon associé et moi, d’être l’objet, de la part du gouvernement, d’une haute distinction.
– Vous a-t-on nommés chevaliers de la Légion d’honneur ? demanda Juve, ou ambassadeurs en Chine ?
– Pas encore, déclara Pérouzin, mais nous sommes nommés inspecteurs auxiliaires du service de la Sûreté.
– Ah, ah, fit le policier, eh bien, toutes mes félicitations. Qu’est-ce que vous avez ? qu’écoutez-vous donc ?
–Êtes-vous seul, monsieur Ronier ? N’avez-vous reçu personne depuis quelques jours dans votre villa ?
– De qui parlez-vous ? D’un homme ? d’une femme ?
– La visite d’un homme.
– Eh bien, non, à part mon vieux domestique et vous, je n’ai reçu aucun représentant du sexe mâle.
– C’est que nous sommes chargés d’une arrestation.
– Oh, oh, fit Juve, et de qui donc s’agit-il ?
– Il s’agit, commença Pérouzin…
Mais Nalorgne lui coupa brusquement la parole :
– Du cocher Prosper, Monsieur Ronier, déclara-t-il, du cocher qui jadis était placé chez cet infortuné M. Hervé Martel, dont vous avez dû apprendre la fin tragique.
– Je sais, en effet, qu’il a été assassiné, je l’ai lu dans les journaux.
En réalité, c’était par un télégramme de Fandor que le faux M. Ronier avait été mis au courant.
Les associés, cependant, paraissaient fort désireux d’écourter leur visite et brusquement, sans préambule, ils prirent congé de Juve :
– À bientôt, monsieur Ronier, meilleure santé.
Ils étaient à peine sortis qu’Irma Pié, dite de Steinkerque, réapparaissait. Elle était bouleversée :
– Ah monsieur Ronier, je vous demande bien pardon, mais je me suis mal conduite.
– Une fois de plus.
– Oui, je me suis permis d’écouter à la porte ce que vous disaient ces messieurs. Et j’ai appris que l’on cherchait toujours le cocher Prosper. Hélas, j’étais déjà au courant des poursuites exercées contre lui, mais ma conscience va sans doute m’obliger à parler bientôt, à tout dire à la justice.
– Ah, fit Juve, subitement intéressé, que savez-vous donc ?
– Je sais, fit Irma, où il se cache. C’est une coïncidence extraordinaire, mais Prosper se trouve à quelques kilomètres du village de Saint-Martin, où habite ma famille. Précisément, comme je vous le disais, monsieur Ronier, je compte y partir demain pour aller voir mes parents. Que croyez-vous que je doive faire ? Faut-il aller raconter à la Sûreté ce que je sais ? Dois-je attendre, au contraire ?
– Attendez, chère madame, ne révélez rien encore, toutefois, faites-moi un plaisir, au lieu de partir demain pour Saint-Martin, partez donc ce soir.
– Oh, ce sera bien volontiers, monsieur Ronier. Vous savez, n’est-ce pas, ce que je veux aller demander à ma famille, ce sont les papiers qui me permettront peut-être un jour de devenir la femme légitime de quelqu’un qui… de quelqu’un que je…
– Jean, aidez donc Madame, ordonna le policier, à revêtir son manteau. Elle est très pressée. Il faut qu’elle s’en aille tout de suite.
Sitôt la demi-mondaine éloignée, le domestique vint retrouver son maître.
– Jean, il n’y a plus une minute à perdre. Vous allez téléphoner aux Ambulances Urbaines, il faut tout de suite une automobile pour me transporter.
– Vous voulez partir ?
– Non, je pars.
– Paralytique comme vous l’êtes ?
– Paralytique comme je le suis.
– Et où allez-vous ?
– À trois cents kilomètres d’ici, au fin fond de la Normandie.
***
Cependant, Nalorgne et Pérouzin s’étaient disputés en sortant de chez Juve :
– Quand il y a une gaffe à faire, vous êtes là !
– Je ne comprends rien, répondit Pérouzin, à vos perpétuels mystères. Nous avons obtenu de notre chef, M. Havard, de changer notre mission et il nous a chargés, au lieu de courir après le cocher Prosper, d’aller procéder à l’arrestation de ce Jérôme Fandor, l’auteur désigné par la rumeur publique, du mystérieux attentat ourdi contre le sous-marin, l’assassin présumé de la malheureuse Hélène. Nous sommes venus chez Juve qui s’obstine à se faire appeler M. Ronier, afin de déterminer si Fandor n’était pas caché chez lui et voilà tout.
– Vous alliez dire à Juve, poursuivit Nalorgne, le but de notre visite ?
– Eh bien, où était le mal ?
– Toujours votre indiscrétion proverbiale, Pérouzin. Du moment que Fandor n’était pas chez Juve, nous n’avions pas besoin d’ébruiter le but de notre mission.
– Mais, qu’allons-nous faire, maintenant ?
– Mais nous allons prendre le premier train pour Cherbourg. C’est là que doit être l’assassin, c’est là que nous l’arrêterons.
– Dieu vous entende, Nalorgne.
***
– Tiens, qui vient là ? En face de moi, dans cette glace ? Quel est donc ce monsieur si brun, avec cette grosse moustache ?
Le promeneur qui monologuait de la sorte éclata soudain de rire :
– Parbleu, c’est moi. Il faut pourtant que je m’y fasse. C’est égal, je suis joliment bien grimé puisque je ne parviens même pas à me reconnaître lorsque je me rencontre ou lorsqu’un miroir me renvoie mon image.
Le personnage qui monologuait ainsi devant une devanture de magasin, dans la rue principale de Cherbourg n’était autre que Jérôme Fandor. Le journaliste était méconnaissable en effet. Fandor avait teint sa chevelure blonde en noir d’ébène. Il avait peint les sourcils, peint le visage, grossi sa moustache en y ajoutant de grosses touffes de poils, si bien que le jeune homme paraissait à présent âgé d’au moins quarante-cinq ans, soit quinze ans de plus que son âge.
– Parfait, parfait, se répétait Fandor, puisque moi-même je m’y trompe, les autres ne seront pas plus malins que moi. Grâce à ce savant camouflage je m’en vais pouvoir poursuivre mes enquêtes au milieu de ceux qui me recherchent, et cela en toute sécurité.
– Pardon, monsieur, le cent cinquante de la rue de la Marine, s’il vous plaît, c’est où ?
Or, qui interrogeait ainsi l’ami de Juve camouflé en quidam ? qui, sinon les inénarrables Nalorgne et Pérouzin.
– Bon, se dit le journaliste, en voilà une rencontre. Qu’est-ce qui peut bien amener mes deux gaillards rue de la Marine ? et au numéro cent cinquante, mon domicile, encore ?
Déjà, Pérouzin, le spécialiste des gaffes, s’était chargé de répondre :
– Nous recherchons un malfaiteur car nous sommes agents de la Sûreté de Paris.
– Et ce malfaiteur s’appelle ?
Nalorgne voulut empêcher Pérouzin de répondre. En vain.
– Il s’appelle Jérôme Fandor.
– Comme ça se trouve, dit Fandor, avec le foudroyant esprit d’à propos dont il avait déjà donné tant de preuves. Moi-même je suis détective attaché à la Sûreté de Cherbourg.








